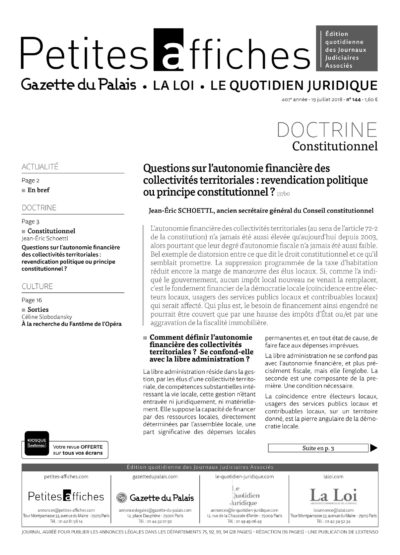Questions sur l’autonomie financière des collectivités territoriales : revendication politique ou principe constitutionnel ?
L’autonomie financière des collectivités territoriales (au sens de l’article 72-2 de la constitution) n’a jamais été aussi élevée qu’aujourd’hui depuis 2003, alors pourtant que leur degré d’autonomie fiscale n’a jamais été aussi faible. Bel exemple de distorsion entre ce que dit le droit constitutionnel et ce qu’il semblait promettre. La suppression programmée de la taxe d’habitation réduit encore la marge de manœuvre des élus locaux. Si, comme l’a indiqué le gouvernement, aucun impôt local nouveau ne venait la remplacer, c’est le fondement financier de la démocratie locale (coïncidence entre électeurs locaux, usagers des services publics locaux et contribuables locaux) qui serait affecté. Qui plus est, le besoin de financement ainsi engendré ne pourrait être couvert que par une hausse des impôts d’État ou/et par une aggravation de la fiscalité immobilière.
Comment définir l’autonomie financière des collectivités territoriales ? Se confond-elle avec la libre administration ?
La libre administration réside dans la gestion, par les élus d’une collectivité territoriale, de compétences substantielles intéressant la vie locale, cette gestion n’étant entravée ni juridiquement, ni matériellement. Elle suppose la capacité de financer par des ressources locales, directement déterminées par l’assemblée locale, une part significative des dépenses locales permanentes et, en tout état de cause, de faire face aux dépenses imprévues.
La libre administration ne se confond pas avec l’autonomie financière, et plus précisément fiscale, mais elle l’englobe. La seconde est une composante de la première. Une condition nécessaire.
La coïncidence entre électeurs locaux, usagers des services publics locaux et contribuables locaux, sur un territoire donné, est la pierre angulaire de la démocratie locale. C’est son triangle magique. Elle garantit, par la responsabilisation mutuelle des trois catégories d’acteurs, la bonne régulation de la gouvernance locale : si la population estime que les services qui lui sont fournis sont insuffisants au regard des impôts qu’elle paie, elle sanctionnera les responsables locaux aux élections. Elle pourra aussi élire une équipe qui, fût-ce au prix d’un effort fiscal supplémentaire, mettra en place des équipements auxquelles aspire la majorité des habitants.
Faut-il recentrer la notion de ressources propres des collectivités sur les seules impositions dont la loi les autorise à fixer l’assiette et le taux ou le tarif, c’est-à-dire développer le concept d’autonomie fiscale ? Quelle devrait alors être la part minimale de ces ressources propres ?
La dialectique vertueuse que nous venons d’évoquer suppose que les « ressources propres » méritent leur nom et, dès lors, qu’une collectivité territoriale puisse en fixer directement le taux, des éléments d’assiette ou le tarif, notamment pour faire face à des dépenses imprévues ou pour mener à bien un projet entériné par les électeurs.
Or la notion actuelle de ressource propre est trop large puisqu’elle inclut des ressources certes fiscales, mais dont l’attribution à chaque collectivité territoriale dépend exclusivement de la loi et sur lesquelles aucune collectivité, prise isolément, n’a de levier de manœuvre.
Comme l’a encore précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi de finances initiale pour 2018, les ressources propres, au sens de l’article 72-2 de la constitution, comprennent non seulement les recettes fiscales librement fixées par chaque collectivité, mais encore les ressources d’origine fiscale fléchées vers les collectivités territoriales et réparties entre celles-ci par la loi. Ne sont donc exclues que les subventions.
C’est au demeurant ce que dit l’article LO 1114-2 du Code général des collectivités territoriales, béni par le Conseil constitutionnel1 : les recettes fiscales entrant dans la catégorie de ressources propres des collectivités territoriales, au sens de l’article 72-2 de la constitution, sont « le produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer l’assiette, le taux ou le tarif, mais encore lorsqu’elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette ».
La décision du Conseil constitutionnel relative à la loi de finances pour 2018 ajoute (ce qui reste conforme à l’article LO 1114-2 du Code général des collectivités territoriales) : « ou lorsque la loi procède à une répartition de ces recettes fiscales au sein d’une catégorie de collectivités territoriales » (§ 16).
La proportion des ressources propres ainsi définies ne doit pas tomber, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, en dessous du ratio 2003 (CGCT, art. LO 1114-3, dernier alinéa).
Cette définition large des ressources propres, qui résulte de la loi organique et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, permet d’atténuer l’obligation, énoncée par l’article 72-2 de la constitution, que les « recettes fiscales et les autres ressources propres » des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie, une « part déterminante » de l’ensemble des ressources (à charge pour la loi organique de fixer les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre)2.
Il n’était pas réaliste d’adopter une définition stricte des ressources propres, car leur proportion (en 2003, date de la révision constitutionnelle, comme postérieurement) est minoritaire. Le ratio d’autonomie fiscale au sens strict (quatre impôts locaux et autres taxes locales dont les collectivités fixent le taux : taxe de séjour, taxe d’aménagement etc.) représente, bon mal an, un petit tiers des ressources locales totales. En 2015, ce ratio était de 41 % pour les communes, de 23 % pour les départements et de 9 % pour les régions. C’est une part significative, mais on peut contester qu’elle soit « déterminante ».
Autonomie financière ne rime donc pas avec autonomie fiscale. « Il ne résulte ni de l’article 72-2 de la constitution, ni d’aucune autre disposition constitutionnelle que les collectivités territoriales bénéficient d’une autonomie fiscale » précise le Conseil constitutionnel après 20033. L’autonomie financière des collectivités territoriales (au sens constitutionnel) n’a jamais été aussi élevée qu’aujourd’hui depuis 2003, alors pourtant que leur degré d’autonomie fiscale n’a jamais été aussi faible. Bel exemple de distorsion entre ce que dit le droit constitutionnel et ce qu’il semblait promettre.
Il serait plus satisfaisant que la notion de ressource propre soit limitée aux ressources sur lesquelles chaque collectivité a prise, en particulier en fixant un taux. Mais il faudrait alors modifier la rédaction du troisième alinéa de l’article 72-2 en n’exigeant plus que leur part soit déterminante.
La nouvelle rédaction du troisième alinéa de l’article 72-2 pourrait :
-
redéfinir les ressources propres comme celles dont la loi autorise les collectivités à fixer elles-mêmes l’assiette, le taux ou le tarif ;
-
disposer que la part des ressources propres, pour une catégorie de collectivités, ne doit pas être inférieure au ratio observé en 2003 : elle serait alors significative, sans être nécessairement déterminante.
L’autonomie financière des collectivités territoriales est-elle protégée constitutionnellement ?
Face à l’érosion de l’autonomie financière d’une catégorie entière de collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel reste vigilant sous l’empire des dispositions actuelles, et le resterait avec la rédaction qui vient d’être envisagée pour l’article 72-2.
La proportion des ressources propres ne doit pas tomber, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, en dessous du ratio 2003.
Dans sa décision sur la loi de finances initiale pour 20064, comme dans sa décision sur la loi de finances initiale pour 2018 (§ 19), le Conseil relève que, en application de l’article LO 1114-4 du Code général des collectivités territoriales, le gouvernement doit transmettre au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources. Si, au vu de ce rapport, il apparaissait que, en raison de l’évolution des circonstances, et notamment par l’effet d’une modification de la législation, éventuellement conjuguée à d’autres causes, la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources des communes devenait inférieure au seuil minimal déterminé par l’article LO 1114-3 du Code général des collectivités territoriales (ratio 2003), il appartiendrait à la loi de finances pour la deuxième année suivant celle de ce constat, d’arrêter les mesures appropriées pour rétablir le degré d’autonomie financière des communes au niveau imposé par la loi organique.
En outre, les dispositions de la loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales s’entendent sans préjudice de la possibilité pour le Conseil constitutionnel de censurer, le cas échéant, des actes législatifs ayant pour effet de porter atteinte au caractère déterminant de la part des ressources propres d’une catégorie de collectivités territoriales5.
Dans la perspective de la suppression totale de la taxe d’habitation après 2020 et d’une refonte de la fiscalité locale, quelles mesures vous paraissent de nature à garantir l’autonomie financière et/ou l’autonomie fiscale des collectivités territoriales ? Dans cette même perspective, quelles modalités de territorialisation des recettes fiscales et des autres ressources propres (assiette, taux produit) doivent être privilégiées ?
La mesure de dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages était dès l’origine critiquable sur le fond car elle met à mal la dialectique démocratiquement vertueuse des interactions entre électeurs, contribuables et usagers des services publics locaux.
Le principe de libre administration des collectivités territoriales ne semble pas avoir pesé très lourd dans les arbitrages, non plus que le coût budgétaire de la mesure en année pleine (10 milliards d’euros, plus du double en cas de suppression totale). Moins lourd que le parti argumentatif tiré de ce que les retraités des classes moyennes trouveront à terme, dans le dégrèvement de taxe d’habitation, une compensation à la hausse de la contribution sociale généralisée sur leurs pensions.
Le coût de la mesure laisse d’autant plus rêveur, en l’état de nos finances publiques, qu’il existait déjà, sous certaines conditions d’âge, de handicap et de ressources, un dispositif d’exonération et de dégrèvement de la taxe d’habitation conséquent6. En comptant les abattements, ces dispositifs touchaient d’ores et déjà 40 % des contribuables locaux. Le dégrèvement massif n’était donc pas une urgence sociale.
Mais au moins le dégrèvement de 80 % des foyers pouvait sembler présager une réforme globale de la fiscalité locale remplaçant la taxe d’habitation par une imposition plus équitable, mieux adaptée et préservant les ressorts contributifs de la démocratie locale.
C’est dans cette perspective que se place le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi de finances initiale pour 2018. Il prend dûment acte, au paragraphe 12 de cette décision, de ce que « les dispositions contestées ont été présentées au Parlement comme constitutives d’une étape dans la perspective d’une réforme plus globale de la fiscalité locale ».
Toutefois, le dégrèvement massif de taxe d’habitation compromet une telle perspective en habituant les ménages des classes moyennes à ne plus payer d’impôt local en dehors des taxes foncières (que tous sont loin d’ailleurs d’acquitter). Comment faire contribuer demain à une taxe locale rénovée les dégrevés d’aujourd’hui ? Ce serait perçu comme une régression.
Ne pas les faire contribuer, se résoudre à ce que la grande majorité des ménages ne paie plus jamais d’impôts locaux ? À ce que les contribuables locaux ne soient plus que les entreprises et les propriétaires aisés ? Ce serait mettre à mal la dialectique démocratique entre usagers, contribuables et électeurs locaux, qui veut que, si peu que ce soit, chacun contribue à raison de ses capacités contributives.
C’est pourtant le parti affiché par le ministère de l’Économie et des Finances. On peut trouver assez irresponsable d’envisager sans état d’âme pareille remise en cause d’une composante majeure de la citoyenneté.
Dans sa décision sur le dégrèvement massif de taxe d’habitation, le Conseil constitutionnel a prévenu par avance qu’il veillerait au respect de l’égalité devant les charges publiques et au caractère non confiscatoire de la future imposition lorsqu’il serait saisi de la réforme globale de la fiscalité locale faisant suite à la suppression définitive de la taxe d’habitation. Saisi de cette réforme, expose en effet le paragraphe 15 de sa décision, il réexaminera la question d’égalité devant les charges publiques « en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d’habitation… ».
Compte tenu de cet avertissement, il serait contestable que la totalité du manque à gagner résultant de la suppression de la taxe d’habitation incombe aux 20 % aujourd’hui non dégrevés, par exemple sous la forme d’une taxe foncière alourdie, voire indexée sur les revenus, comme si notre pays ne battait pas déjà tous les records européens en matière de taxation de la propriété immobilière…
C’est d’autant moins envisageable que la proportion des ménages dont les revenus excèdent le seuil de dégrèvement peut être très inférieure à 20 % dans une commune déterminée. Envisage-t-on sérieusement de faire peser sur deux ou trois ménages, dans une commune rurale, la totalité de la fiscalité locale ?
Supprimer la taxe d’habitation, sans la remplacer par un nouvel impôt, représente deux casse-têtes :
-
Comment l’État pourrait-il financer le coût total de la compensation due aux communes (environ vingt-cinq milliards d’euros en 2020) ?
-
Comment compenser aux communes sans dégrader leur ratio de ressources propres en dessous de la part déterminante imposée par la constitution ?
On peut évidemment jouer au mistigri : transférer aux communes la part départementale de la taxe foncière ; compenser les départements par une part d’impôt d’État (TVA ou impôt sur le revenu). Mais il faudrait in fine augmenter les prélèvements sur le contribuable national à hauteur d’une bonne dizaine de milliards d’euros. On n’aurait pas créé de nouvel impôt, mais on aurait alourdi la TVA, ou le barème de l’impôt sur le revenu, voire la CSG si on commet l’erreur historique de ne plus l’affecter intégralement à la protection sociale. La belle affaire vue du contribuable national ! Surtout on ne pourrait plus dire que le poids de la suppression de la taxe d’habitation « ne pèsera pas sur le contribuable national ».
Pour en revenir à la décision du Conseil constitutionnel sur la taxe d’habitation, que penser de la nécessité constitutionnelle d’une réforme globale de la fiscalité locale à moyen terme ? La référence appuyée faite par le Conseil constitutionnel, dans sa décision, à une réforme future répond à l’argumentation selon laquelle, si les bases de la taxe d’habitation sont aujourd’hui dépassées et inéquitables (principal motif officiel du dégrèvement), elles continuent à l’être pour les 20 % non dégrevés… et pour les assujettis aux taxes foncières. La décision subordonne-t-elle pour autant la constitutionnalité du dégrèvement, puis de la suppression, de la taxe d’habitation à son remplacement futur par une nouvelle imposition locale ? Ni la décision, ni son commentaire officiel ne répondent à cette question.
Quel type d’impôt pourrait remplacer la taxe d’habitation ?
Pourquoi d’abord s’en tenir à la suppression de la taxe d’habitation dès lors que le motif invoqué pour son immolation, l’inadaptation et la vétusté de l’assiette, vaut aussi pour les taxes foncières ? Psychologiquement, on voit bien d’ailleurs que la substitution d’un nouvel impôt local unique aux trois taxes actuelles pesant sur les ménages (habitation, foncière bâtie et foncière non bâtie) serait, à tout prendre, plus facile à faire accepter que le retour (en plus des taxes foncières) d’une taxe remettant à contribution les ménages dégrevés de taxe d’habitation.
Nous n’aurons pas la prétention ici de sortir de notre chapeau une introuvable réforme de la fiscalité locale, ni l’impudeur de céder aux joies perverses de l’imagination créatrice en matière fiscale. D’autres le feraient mieux et plus volontiers.
Esquissons cependant une piste : pourquoi l’assiette de ce futur impôt local universel ne serait-elle pas constituée des revenus des personnes résidant sur le territoire de la collectivité ?
Parlant d’une « assiette revenus » pour une nouvelle fiscalité locale, nous parlons des revenus des habitants et non pas seulement des revenus des propriétaires (cette dernière option est en revanche celle qui est implicitement retenue lorsqu’on parle, comme M. Darmanin, de mixer taxe foncière et revenus).
L’idée est bien sûr à affiner : le taux devrait rester uniforme, mais des abattements sont concevables, tenant compte des charges de famille et ménageant une certaine progressivité, sans excepter de l’imposition, comme c’est aujourd’hui la tendance, la majorité de la population. Il reviendrait au conseil municipal et aux établissements publics de coopération intercommunale de fixer les abattements comme les taux dans des fourchettes fixées par la loi.
La question des résidents secondaires appellerait une réponse spécifique : une taxe sur les résidences secondaires, non limitée aux zones sous tension et déconnectée des revenus, est concevable. Elle présenterait un certain intérêt lorsque les revenus du propriétaire sont difficilement connaissables (étrangers). Mais elle implique la tenue à jour des bases locatives, ce que la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation et des taxes foncières a précisément l’avantage d’éviter.
Les propriétaires de résidences secondaires ne sauraient être seuls mis à contribution pour compenser la suppression de la taxe d’habitation, ne serait-ce que parce que les résidences secondaires sont très inégalement réparties.
Quelles mesures, budgétaires ou autres, permettraient d’assurer la cohérence entre l’exercice par les collectivités territoriales des compétences qui leur ont été transférées et les recettes transférées pour y faire face ?
La compensation au coût historique, dont le principe est inscrit au quatrième alinéa de l’article 72-2 de la constitution (« Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice… »), se révèle insatisfaisante lorsque, pour des raisons matérielles, économiques ou sociales profondes et continues, l’évolution des charges transférées croît plus vite que l’index de la compensation et que la capacité contributive des collectivités territoriales. On a le sentiment qu’il en est ainsi pour les charges sociales des départements et qu’il faut corriger le tir. Les propositions de la mission Richard Bur doivent être méditées à cet égard.
Dans ses décisions sur la loi de finances initiale et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, le Conseil constitutionnel rejette les griefs tirés de ce que les dépenses liées au revenu minimum d’insertion progresseront de façon plus dynamique que le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) qui constitue la compensation de la charge transférée. La compensation prévue par le quatrième alinéa de l’article 72-2 de la constitution, juge-t-il, n’a pas à être intégrale et glissante. Il faut et il suffit que le montant de la compensation ne se dégrade pas en euros constants. Le Conseil constitutionnel émet à cet égard la réserve d’interprétation suivante : si les recettes départementales provenant de la TIPP venaient à diminuer en euros constants, il appartiendrait à l’État de maintenir un niveau de ressources équivalant à celui qu’il consacrait à l’exercice de cette compétence avant son transfert.
Toutefois, si l’article 72-2 n’impose de compensation qu’au coût historique, il n’interdit pas au législateur de prévoir des mécanismes d’ajustement tenant compte d’un accroissement de charges indépendant de la volonté des collectivités territoriales, accroissement qui peut ou non être lié à l’action de l’État.
Ainsi, l’article L. 1614-2 du Code général des collectivités territoriales7 prévoit la compensation de l’accroissement net de charges induit par une obligation réglementaire postérieure au transfert et affectant spécialement la compétence transférée. Le montant de la compensation des nouvelles charges est égal à la différence entre le coût de la compétence tel qu’il résulte de l’application du décret imposant de nouvelles normes et le coût de cette même compétence selon les règles antérieurement en vigueur, déduction faite des effets des décisions librement prises par les collectivités exerçant la compétence.
De même, l’article L. 1614-8-1, neuvième alinéa8, du Code général des collectivités territoriales prévoit que toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en matière de services régionaux de voyageurs donne lieu à compensation intégrale.
De même encore, la loi de finances pour 2004 (art. 59) prévoit une compensation du transfert du revenu minimum d’insertion en partie « glissante », puisque la fraction de TIPP ajustée fin 2004 tiendra compte du coût supplémentaire résultant, pour les départements, d’une part, de la création d’un revenu minimum d’activité et, d’autre part, de l’augmentation du nombre d’allocataires du revenu minimum d’insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l’allocation de solidarité spécifique.
Il reste que, sur le plan constitutionnel, toute réforme législative intervenant dans le champ d’une compétence transférée et générant des charges nouvelles n’ouvre pas nécessairement droit à compensation financière, et moins encore à compensation intégrale.
Ainsi, dans ses décisions n° 2010-56 QPC du 18 octobre 2010, relative à la mesure d’accompagnement social personnalisé et n° 2010-109 QPC du 25 mars 2011, relative au fonds national de protection de l’enfance, le Conseil constitutionnel considère que le législateur n’a ni créé de nouvelles prestations sociales à la charge des départements, ni élargi le champ de leurs bénéficiaires.
Le législateur s’est contenté, juge-t-il, d’« aménager » respectivement les conditions d’exercice de la compétence d’aide sociale de droit commun des départements et les « missions des services de protection maternelle et infantile et d’aide sociale à l’enfance exercées par les départements depuis les lois du 22 juillet 1983 et du 6 janvier 1986 ». Le Conseil constitutionnel considère donc que les dispositions contestées n’ont procédé « ni à un transfert aux départements d’une compétence qui relevait de l’État, ni à une création ou extension de compétences ».
Rappelons que, dans ces deux derniers cas (création et extension de compétences), l’article 72-2, quatrième alinéa, prévoit non pas une compensation (comme pour un transfert), mais un simple accompagnement financier (« Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi »).
Il existe cependant une hypothèse dans laquelle la dynamique des charges transférées soulèverait une question de constitutionnalité faute d’être compensée autrement qu’au coût historique : c’est celle dans laquelle cette évolution serait d’une ampleur telle qu’elle entraverait la libre administration.
Cette hypothèse a été évoquée à propos du revenu minimum d’insertion et de la loi de finances initiale pour 20049. Elle l’avait été, avant la révision de 2003, pour la vignette automobile10.
Après 2003, la jurisprudence fournit deux illustrations du caractère opérant du grief tiré de ce que l’insuffisance des ressources d’une collectivité par rapport à ses charges entrave sa libre administration11.
La seconde de ces décisions prononce une censure. Celle-ci touche l’article 100 de la loi « relative à l’égalité et à la citoyenneté » qui prévoyait de priver de « dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale » les communes qui n’atteignent pas leurs objectifs de réalisation de logements sociaux. Le Conseil constitutionnel a relevé que le dispositif mis en place par cet article faisait perdre à la commune le bénéfice de la dotation quel que soit l’écart entre le niveau de logements sociaux dans la commune et les objectifs auxquels elle est tenue et que la perte de ressources en résultant ne faisait l’objet d’aucun plafonnement. Il en a déduit que les dispositions en cause restreignaient les ressources de ces communes au point d’entraver leur libre administration et méconnaissaient ainsi l’article 72 de la constitution.
Examinant le texte qui allait devenir la loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales12, le Conseil constitutionnel avait déjà souligné le lien entre autonomie financière et libre administration. Ainsi, relève-t-il dans cette décision, en prévoyant que le rapport transmis par le gouvernement pour garantir l’autonomie financière des collectivités territoriales présentera, pour chaque catégorie de collectivités, non seulement la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources mais également ses « modalités de calcul », le législateur organique a nécessairement voulu que le Parlement soit mis à même de connaître cette part pour chaque collectivité territoriale (et non seulement pour la catégorie) et d’évaluer ainsi sa capacité de libre administration.
La péréquation constitue-t-elle une limite à l’autonomie financière ?
À s’en tenir aux termes de l’article 72-2 de la constitution, l’autonomie financière des collectivités territoriales doit être respectée au niveau de chaque catégorie de collectivités territoriales et non en dessous de ce niveau d’agrégation. Les règles constitutionnelles relatives à l’autonomie financière des collectivités territoriales ne protègent donc cette autonomie que collectivement, « en moyenne ».
Or une collectivité territoriale déterminée peut avoir un ratio de ressources propres dégradé, sans que cela soit le cas de la moyenne de sa catégorie. Il suffit pour cela qu’elle subisse des circonstances particulières provoquant un décalage durable entre ses ressources et ses charges : ses assiettes fiscales fondent, sa population diminue ou/et s’appauvrit, ses besoins s’accroissent etc. En pareil cas, la libre administration se voit « entravée », notion que le Conseil constitutionnel utilise pour évoquer la situation particulière d’une collectivité ou de plusieurs collectivités territoriales représentant un sous-ensemble d’une catégorie.
Restituer à une communauté territoriale, dont la libre administration est ainsi entravée, une capacité de gouvernance propre est précisément l’objet des mécanismes de péréquation.
À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a attiré l’attention des pouvoirs publics nationaux sur le fait que telle ou telle mesure, bien que n’appelant pas d’objections du point de vue des règles générales relatives à l’autonomie financière des communauté territoriale, inscrites à l’article 72-2 de la constitution, pouvait mettre à mal – entraver – la libre administration de telle ou telle collectivité en particulier et qu’il fallait trouver à cet égard des mécanismes correctifs. Il l’a fait par exemple pour les départements à propos de l’allocation personnalisée d’autonomie13.
La péréquation est donc non seulement compatible avec l’autonomie financière, mais encore inhérente à celle-ci, entendue non pas seulement comme un ratio moyen, mais comme la garantie de la libre administration de chaque collectivité territoriale.
Un bémol toutefois s’agissant de la péréquation dite horizontale, car on voit bien qu’au-delà d’un certain seuil (qui est loin d’être atteint aujourd’hui !), l’autonomie financière des collectivités les plus contributrices pourrait être atteinte.
Des transferts supplémentaires de compétences sont-ils nécessaires ? Dans quels domaines ?
On peut avoir le sentiment que cette question n’est pas d’actualité tant que :
-
les conditions de financement des compétences transférées sont perfectibles dans divers domaines (aide à l’enfance, revenu de solidarité active…) ;
-
les domaines transférés sont susceptibles de faire l’objet de réformes structurelles affectant le rôle des collectivités territoriales (formation professionnelle, apprentissage, transports ferroviaires) ;
-
la fiscalité locale peut connaître des bouleversements dans les années à venir.
Illustrent bien la nécessité d’une pause les problèmes posés par le transfert de la gestion de milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux intercommunalités depuis le 1er janvier 2018.
En revanche, les mesures de « différenciation territoriale » figurant dans la prochaine révision constitutionnelle pourraient se traduire par des interventions des collectivités territoriales dans des domaines normalement régis par la loi ou le règlement ou/et par dérogation à ceux-ci. Les compétences ainsi déléguées aux collectivités territoriales non plus seulement à titre expérimental (comme c’est déjà aujourd’hui possible en vertu du quatrième alinéa de l’article 72 de la constitution), mais permanent, ne semblent toutefois pas soulever des problèmes de compensation car elles seraient exercées à titre volontaire et seraient de nature normative plutôt que matérielle.
Les conditions d’évaluation du coût des charges transférées vous paraissent-elles satisfaisantes ?
Dès lors que la compensation se fait au coût historique, l’évaluation initiale des charges transférées revêt une importance cruciale.
Les ressources transférées doivent être équivalentes aux dépenses de l’État au titre des compétences transférées.
Toutes les dépenses, directes et indirectes, liées à l’exercice des compétences transférées doivent donc être prises en compte.
Chaque dépense doit faire l’objet d’une évaluation sur une période prévue par la loi et qui varie selon le type de dépense.
Ces périodes de référence ont été définies en dernier lieu par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) :
-
3 ans au maximum pour les dépenses de fonctionnement ;
-
au moins 5 ans pour les dépenses d’investissement.
Cela semble raisonnable. Paraît notamment satisfaisante la procédure suivie, qu’il s’agisse de sa transparence14 et surtout de l’intervention de la commission consultative sur l’évaluation des charges, composée pour moitié d’élus. Cette participation apporte une vraie garantie aux collectivités territoriales. Cette commission a joué un rôle très utile, par exemple en faisant adopter la référence à l’indice des prix de la formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques, plutôt que l’indice INSEE des prix à la consommation, pour le calcul de l’actualisation des dépenses d’investissement.
L’évaluation semble avoir fait preuve d’une certaine flexibilité en ajustant de façon réaliste la période de référence (par exemple 1 an plutôt que 3, pour les dépenses de fonctionnement et 10 ans plutôt que 5, pour les dépenses d’investissement). Pour les dépenses de fonctionnement les plus dynamiques, il est souhaitable en effet de prendre la seule dernière année.
L’évaluation a pu même prendre en compte, en faveur des collectivités territoriales, des éléments de charge futurs. Ainsi, à l’instigation de la parité élue de la commission consultative sur l’évaluation des charges, il a été tenu compte en 2009, en matière de formation sanitaire, de mesures adoptées peu avant le transfert et qui ne s’étaient pas encore répercutées sur les dépenses de l’État de la période de référence.
Plus généralement, les facteurs certains d’élévation future des charges transférées pourraient être plus souvent intégrés dans leur évaluation, même si, au regard de l’article 72-2, on va ainsi au-delà de l’obligation constitutionnelle.
Enfin, des erreurs d’évaluation initiales, apparues après le transfert, devraient pouvoir être corrigées ex post.
Comment améliorer la couverture, dans le temps, du coût de ces charges, dans le respect de la libre administration et de la responsabilité des collectivités territoriales ?
Comme il a été dit, la constitution n’impose la compensation qu’au coût historique.
Toutefois, rien n’interdit au législateur, dans la limite des contraintes budgétaires, de prévoir des modes d’indexation de la compensation mieux ajustés que la dotation globale de fonctionnement à la croissance structurelle des dépenses transférées.
En matière de lignes ferroviaires régionales, par exemple, la hausse des péages prélevés par réseaux ferrés de France doit être compensée.
Comment améliorer l’évaluation de l’impact, sur les collectivités territoriales, des normes décidées au niveau national ainsi que le partage du financement de leur coût ?
La fixation de normes au niveau national, qu’elle affecte ou non spécifiquement les coûts d’une compétence transférée, doit être évaluée dans ses conséquences financières sur les collectivités territoriales :
-
dans l’étude d’impact assortissant un projet de loi si la norme est législative ;
-
ou dans la fiche d’impact accompagnant le décret si elle est réglementaire.
Beaucoup d’études d’impact législatives ne sont, il est vrai, qu’un habillage a posteriori de mesures décidées pour des raisons politiques indépendantes de tout véritable souci rationnel des effets produits.
L’éthique de la responsabilité, qui devrait inspirer les études d’impact, cède souvent le terrain à l’éthique de la conviction, voire à la pure et simple posture.
En outre, s’agissant des réformes annoncées dans un programme présidentiel, il est irréaliste de compter sur une étude d’impact pour les écarter ou même les infléchir (pensons à nouveau à la taxe d’habitation).
Cela dit, on prendrait davantage au sérieux les études d’impact si leur insuffisance était effectivement sanctionnée, ce qui, in fine, est du ressort du Conseil constitutionnel.
Or celui-ci les a deux fois tuées.
Une première fois, en examinant la loi organique du 15 avril 2009 qui en fixait les modalités, lorsqu’il a censuré la règle selon laquelle l’élaboration de l’étude d’impact devait commencer tout en amont du processus décisionnel aboutissant à un projet de loi15.
C’est pourtant la raison d’être d’une étude d’impact que d’inventorier des options, dont certaines ne sont pas législatives.
Il les a tuées une seconde fois lorsqu’il a été saisi par le Premier ministre, pour la première et unique fois, selon la procédure spéciale prévue par l’article 39 de la constitution, du refus de la conférence des présidents du Sénat d’inscrire le projet de loi « sur la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral » en raison de l’insuffisance de son étude d’impact. Il a donné laconiquement raison au Premier ministre sans véritablement examiner le sérieux de cette étude, pourtant contestable, notamment quant à la faisabilité des élections locales groupées que prévoyait le projet16.
Pour ce qui concerne les fiches d’impact assortissant les décrets réglementaires, la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 conditionne désormais l’entrée en vigueur d’un décret réglementaire comportant des mesures constitutives de normes nouvelles contraignantes, notamment pour les collectivités territoriales, à l’adoption simultanée d’au moins deux mesures d’abrogation ou (subsidiairement) de simplification de normes existantes.
Ces abrogations ou simplifications doivent intervenir dans le même champ ministériel ou dans le cadre d’une même politique publique que la norme créée. Dans le cas spécifique où la norme créée s’applique aux collectivités territoriales, les abrogations ou simplifications proposées doivent également concerner des normes s’appliquant aux collectivités territoriales.
« Une norme en plus, deux normes de moins », voilà qui parle à l’imagination. C’est un peu comme ne remplacer qu’un fonctionnaire sur trois qui partent à la retraite.
Mais quelle est cette unité que la circulaire appelle « norme » ? Comment les compte-t-on dans un décret ? Est-ce l’article ou une de ses subdivisions ? N’est-ce pas plutôt un ensemble connexe de dispositions spécifiant une contrainte (de fond ou de procédure) imposée aux bénéficiaires de la circulaire ? Et ne faut-il pas pondérer alors par l’intensité de cette contrainte pour vérifier l’équivalence de la surcharge réglementaire et des allégements ? Questions tellement difficiles que la circulaire ne hasarde aucune définition.
En revanche, elle indique que les abrogations ou simplifications gageant la norme nouvelle devront être « qualitativement de niveau équivalent et non pas simplement répondre à un objectif quantitatif ».
Par ailleurs, l’appréciation du bilan pour les bénéficiaires, en termes de contraintes, sera nécessairement subjective, pour ne pas dire « pifométrique », et confiée à la double intuition du secrétariat général du gouvernement et du cabinet du Premier ministre.
Il aurait été plus simple d’assumer franchement cette subjectivité en indiquant qu’un texte réglementaire introduisant des contraintes nouvelles doit être accompagné de mesures d’abrogation et de simplification (sans en fixer le nombre) telles que la pression normative globale sur chaque catégorie de personnes concernées n’augmente pas et si possible diminue, sous réserve toutefois des intérêts généraux en cause qui peuvent transcender ceux des catégories impactées.
Autre problème d’applicabilité que soulève la circulaire du 26 juillet 2017 : le périmètre dans lequel la circulaire entend que s’opère la compensation est flou. Doit-il y avoir compensation pour chaque catégorie de personnes concernées ?
La circulaire répond par l’affirmative pour les collectivités territoriales. Mais au sein des collectivités territoriales, la compensation peut-elle se faire entre des sous-ensembles différents (par exemple entre petites et grosses communes) ?
La rédaction de l’article 34 de la constitution, qui fixe « l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques », doit-elle être précisée ?
« Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques » dispose l’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la constitution.
L’équilibre des comptes des administrations n’est pas une obligation constitutionnelle « matérielle ». L’article 34, qui est un article de compétence et non de fond, ne prescrit qu’une chose : que les lois de programmation définissant des orientations pluriannuelles des finances publiques s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes.
Autrement dit : si loi de programmation pluriannuelle des finances publiques il y a, elle peut comporter des mesures de maîtrise des dépenses publiques. Ce n’est que dans sa partie prévisionnelle, laquelle est non normative, qu’elle doit contempler l’horizon de l’équilibre.
L’équilibre doit se trouver au bout de la trajectoire. La seule vraie contrainte, à cet égard, est le contrôle de sincérité de cette trajectoire par le haut conseil des finances publiques et, s’il en a la volonté et la capacité, par le Conseil constitutionnel.
On est loin d’une règle de fond imposant à bref délai l’équilibre des comptes. Et heureusement.
Compte tenu de la place des administrations publiques en France, du rôle attendu de l’État par la population, du degré de socialisation des dépenses de prévoyance et de santé, du retard accumulé dans la maîtrise des finances publiques, une règle d’or nous placerait dans un dilemme affreux :
-
soit s’obliger sans désemparer à la respecter, par des mesures d’austérité drastiques, inacceptables par l’opinion et produisant des effets sociaux, économiques et politiques imprévisibles et dévastateurs ;
-
soit laisser durablement béant l’écart entre la réalité et la constitution, décrédibilisant cette dernière et provoquant la censure répétitive des lois de finances.
Il serait naïf de croire qu’en plaçant une règle au faîte de la hiérarchie des normes, elle va s’imposer, par sa magie propre en quelque sorte. L’inscription dans le marbre constitutionnel n’a pas d’effet direct sur la réalité.
Des règles d’équilibre contraignantes sont d’ores et déjà inscrites dans le droit de l’Union européenne : pacte de stabilité et de croissance conclu au Conseil européen d’Amsterdam en juin 1997, semestre européen, two pack, six pack et, last but not least, le pacte budgétaire inclus dans le traité sur la stabilité, la gouvernance et la coopération (TSCG).
Certes, des déficits publics de 2,6 % en 2017 et 2018 nous permettent d’éloigner le spectre de la procédure de déficit excessif cette année.
Mais un mécanisme de sanction peut en cacher un autre. Il existe en effet une autre échéance européenne redoutable concernant cette fois le solde structurel des administrations publiques. Le traité sur la stabilité, la gouvernance et la coopération prévoit que le « solde structurel » – c’est-à-dire purgé des effets de la conjoncture – de chaque État membre ne doit pas dépasser 0,5 % du PIB. En cas de non-respect, la Commission pourra sanctionner le pays concerné à hauteur de 0,1 % du PIB. Seule une « majorité qualifiée inversée » pourra bloquer une telle décision.
Si impérieuse qu’elle soit – rappelons que le droit de l’Union a valeur supra législative – nous ne parvenons pas à respecter la règle d’or européenne. Cet écart avec nos engagements européens est déjà un « scandale juridique ». Bafouer la constitution serait plus scandaleux encore.
La loi organique n° 2012–1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques devrait-elle être modifiée pour renforcer la recherche de l’équilibre des comptes des différentes catégories d’administrations publiques ?
Pour les motifs exposés en réponse à la question précédente, il n’est pas souhaitable de rendre plus contraignante la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
Au demeurant, cette loi est d’abord une loi de procédure et de méthode. Elle comporte des définitions. Elle encadre la présentation des prévisions. Elle spécifie un calendrier. Elle organise un dialogue avec les institutions européennes et avec le haut conseil des finances publiques. Elle n’impose par elle-même aucune correction automatique en cas d’écart avec la trajectoire.
En revanche, elle habilite les lois de programmation des finances publiques à fixer des orientations pluriannuelles fort utiles. C’est ainsi que la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 conjure par avance la tentation de la cagnotte en disposant, en son article 7, que « lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l’article 3, l’intégralité de l’écart est affectée à la réduction du déficit ».
En outre, la loi organique permet (en son article 4) aux lois de programmation de « comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion ». Ces règles peuvent notamment avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. Elles doivent être présentées, au sein de la loi de programmation, de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques.
De telles règles de fond (regroupées sous le titre : « Dispositions relatives à la gestion des finances publiques et à l’information et au contrôle du Parlement ») sont susceptibles de couvrir un grand nombre de sujets intéressant directement la recherche de l’équilibre des comptes des différentes catégories d’administrations publiques.
Ainsi, l’article 4 de la loi organique du 17 décembre 2012 justifie la place, en loi de programmation des finances publiques 2018-2022, de la « contractualisation » de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales (article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022).
Il est vrai que les dispositions ainsi regroupées et distinguées des « orientations pluriannuelles des finances publiques » sont le plus souvent procédurales (remise de rapports).
Compte tenu des habilitations ainsi prévues par la loi organique du 17 décembre 2012, on ne voit pas très bien ce qu’on pourrait ajouter.
En revanche, il est impérieux de faire nos meilleurs efforts, dans les faits et les pratiques, pour maîtriser la dépense publique.
Il appartient notamment au gouvernement de documenter les économies annoncées d’ici la fin du quinquennat et de préciser les réformes structurelles qui permettraient d’atteindre les ambitieux objectifs affichés en loi de programmation 2018-2022 :
-
réduction des dépenses publiques de 3 points de PIB ;
-
réduction du déficit public de 2 points de PIB ;
-
réduction de la dette publique de 5 points de PIB ;
-
baisse des prélèvements obligatoires d’un point de PIB, au profit de l’augmentation du pouvoir d’achat, de la protection des plus modestes, et des investissements d’avenir ;
-
s’agissant particulièrement des collectivités territoriales, économie de 13 milliards en 5 ans sur l’évolution spontanée des dépenses.
Il revient également aux pouvoirs publics de faire la pédagogie de ces réformes et de faire comprendre quelles seraient les conséquences d’une crise de notre dette souveraine. C’est en effet la faible conscience du danger que représenterait une telle crise, plus qu’une allergie congénitale au changement, qui raidit la collectivité nationale contre les réformes. Beaucoup de nos compatriotes renâclent devant des efforts qui s’imposeraient pour des raisons purement comptables ou européennes. Il faut leur montrer que la négligence budgétaire menace leurs vies quotidiennes.
Faut-il inscrire dans la constitution la règle de l’équilibre réel du budget des collectivités territoriales qui figure aujourd’hui à l’article L. 1612–4 du Code général des collectivités territoriales ?
En plus de la sincérité des prévisions, l’article L. 1612-4 du Code général des collectivités territoriales impose une double discipline à chaque collectivité territoriale :
-
la section de fonctionnement doit dégager un excédent ;
-
cet excédent, ajouté aux recettes propres de la section d’investissement, non compris le produit des emprunts, doit fournir des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.
Avec cette règle de bon sens gestionnaire, bien intégrée par les élus, on vérifie – comme aurait dit Montesquieu – que ce sont les bonnes mœurs (et les bonnes lois qui les codifient) plutôt que le volontarisme constitutionnel qui font le bonheur des peuples.
Voilà une règle effectivement respectée, sans qu’il soit besoin de l’inscrire au sommet de notre édifice juridique.
Notons que le sous-secteur des APUL (administrations publiques locales) a dégagé un excédent budgétaire en 2016 et 2017. Notons également la modération, depuis 2015, des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales. Celles-ci affichaient un taux de progression alarmant depuis les années 1980, dépassant celui des autres administrations publiques et explicable seulement pour moitié par les transferts de compétences. À s’en tenir au passé récent, les collectivités territoriales ne sont donc pas le mauvais élève de la classe des administrations publiques locales, en termes de contention du déficit.
Dans sa version initiale, le projet de loi de programmation des finances publiques 2018–2022 créait (article 24) une nouvelle règle visant à encadrer le ratio d’endettement des collectivités territoriales, finalement supprimée au bénéfice de dispositions relatives à la contractualisation (article 29 de la loi n° 2018–32 du 22 janvier 2018). Qu’en pensez-vous ?
La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit que l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant.
Afin de tenir le cap de ce taux de croissance maximal, la loi de programmation pluriannuelle prévoit en son article 29 une contractualisation entre l’État et les 322 collectivités territoriales les plus importantes.
L’objet de cette contractualisation est de « consolider la capacité d’autofinancement » de ces collectivités et d’organiser leur « contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public ».
À cette fin, l’article 29 prévoit notamment la fixation, pour chaque collectivité, d’un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, sa modulation selon certains critères et l’application d’une « reprise financière » (75 % de l’écart constaté entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté et l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat) si l’exécution budgétaire ne respecte pas cet objectif.
Il est difficile d’apprécier comment cette procédure, et notamment la sanction de reprise dont elle est assortie, seront appliquées dans les faits. On peut s’interroger sur sa faisabilité, son effet utile et ses effets collatéraux.
On en voit bien l’aspect positif : contrairement à la politique unilatéraliste et brutale pratiquée au cours des années 2014 à 2017 dans le cadre de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques, aucune baisse des dotations ne sera opérée ex ante.
Mais comment ne pas trouver hypocrite le terme de contractualisation ? Si on lit bien le VI de l’article 29, le préfet imposera unilatéralement le plafonnement des dépenses de fonctionnement (et la menace de sanction dont il est assorti) aux collectivités non-signataires.
De même, comment ne pas être interpellé par le fait que le plafonnement de l’augmentation des dépenses de fonctionnement ne tienne pas compte de l’augmentation des recettes de fonctionnement ?
Le Conseil constitutionnel17 a dû être gêné par le caractère contraignant de l’obligation et par l’apparent automatisme de la sanction de « reprise », car il relève soigneusement tous les facteurs qui peuvent les tempérer :
-
le taux de variation annuel retenu pour chaque collectivité peut être modulé pour tenir compte de l’évolution de sa population ou du nombre de logements construits entre 2014 et 2016 ;
-
il peut également être modulé pour tenir compte de la variation du potentiel fiscal par habitant de la collectivité par rapport aux autres collectivités, de la proportion de sa population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et des efforts de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement réalisés entre 2014 et 2016 ;
-
la faculté de demander la conclusion d’un avenant modificatif est susceptible, le cas échéant, de permettre notamment la prise en compte des conséquences des évolutions législatives ou réglementaires affectant le niveau des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités contractantes ;
-
la sanction de reprise financière ne s’applique qu’à l’issue d’une procédure contradictoire avec le représentant de l’État. Sous le contrôle éventuel du juge administratif, le préfet doit prendre en compte les éléments susceptibles d’affecter la comparaison du niveau des dépenses réelles de fonctionnement de l’année en cause avec celui des exercices précédents. Il en va ainsi notamment des changements de périmètre des compétences des collectivités territoriales résultant de la loi ou du règlement, des transferts de compétences opérés entre collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale et de la survenance de certains « éléments exceptionnels » ;
-
enfin, le montant de la reprise ne peut, en aucun cas, excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée.
Quelles mesures complémentaires permettraient d’améliorer la capacité d’autofinancement des collectivités territoriales ?
La question de l’amélioration des capacités d’autofinancement des collectivités territoriales nous renvoie, côté recettes, à celle de la refonte de la fiscalité locale, de la fiscalité transférée et de la péréquation et, côté dépenses, à celle des économies à réaliser sur le fonctionnement en général et sur les frais de personnel en particulier.
Mais ces capacités d’autofinancement, il faut d’abord savoir les mesurer.
Il faudrait être très expert pour suggérer une amélioration des instruments déjà sophistiqués et constamment perfectionnés jusqu’ici, en matière de dotations et de péréquation, en vue de mesurer tant le potentiel fiscal que la richesse et l’effort contributif des collectivités territoriales. Ainsi, le réglage très fin opéré dans la loi de finances initiale 2012 pour définir les contributeurs et les bénéficiaires du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales paraît à l’abri des critiques de non spécialistes : il marie savamment revenu par habitant, potentiel financier, potentiel fiscal et effort fiscal18.
Notes de bas de pages
-
1.
V. L. n° 2004-758, 29 juill. 2004, loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales ; Cons. const., 29 déc. 2009, n° 2009-599 DC, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, cons. 61.
-
2.
Constitution, art. 72-2 :
-
3.
« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
-
4.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.
-
5.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
-
6.
Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
-
7.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. »
-
8.
-
9.
Cons. const., 29 déc. 2009, n° 2009-599 DC.
-
10.
Cons. const., 30 déc. 2005, n° 2005-1719, cons. 99.
-
11.
Cons. const., 29 juill. 2004, n° 2004-500 DC, cons. 20.
-
12.
CGI, art. 1414, pour les exonérations ; CGI, art. 1414 A, pour les dégrèvements.
-
13.
« Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
-
14.
Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l’État, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n’intervient que pour la partie de la charge qui n’est pas déjà compensée par l’accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l’article L. 1614-4. »
-
15.
« Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l’article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions. »
-
16.
V. Cons. const., 29 déc. 2003, n° 2003-439 DC, cons. 19 à 25.
-
17.
Cons. const., 28 déc. 2000, n° 2000-442 DC, cons. 10 : « (…) les dispositions critiquées, si elles réduisent encore la part des recettes fiscales des collectivités territoriales dans l’ensemble de leurs ressources, n’ont pas pour effet de restreindre la part de ces recettes (…) au point d’entraver leur libre administration ».
-
18.
Cons. const., 8 juill. 2011, n° 2011-146 QPC ; Cons. const., 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC, § 65 à 68.
-
19.
Cons. const., 29 juill. 2004, n° 2004-758.
-
20.
Cons. const., 30 juin 2011, n° 2011-143 QPC, cons 13 : « Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce pourcentage à un niveau qui permette, compte tenu de l’ensemble des ressources des départements, que la libre administration des collectivités territoriales ne soit pas entravée ».
-
21.
Arrêtés fixant le montant du droit à compensation, inscription en loi de finances, bilan annuel du coût des compétences transférées prévues par le troisième alinéa de l’article L. 1614-3 du Code général des collectivités territoriales : « Le bilan retrace, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, l’évolution du coût des compétences qui leur ont été transférées ou confiées au cours des dix dernières années. Il est effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l’exercice normal, au sens de l’article L. 1614-1, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales. »
-
22.
Cons. const., 9 avr. 2009, n° 2009-579 DC, cons. 12 et 13.
-
23.
Cons. const., 1er juillet 2014, n° 2014-12 FNR.
-
24.
Cons. const., 18 janv. 2018, n° 2017-760 DC, § 6 à § 16.
-
25.
Le fonctionnement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales repose sur les principes suivants :
-
26.
- une mesure de la richesse à l’échelon intercommunal agrégeant richesse de l’établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres par le biais d’un nouvel indicateur de ressources : le potentiel financier agrégé (PFIA) ;
-
27.
- un fonds national unique alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des groupements et des communes dont le potentiel financier agrégé est supérieur à un certain seuil ;
-
28.
- une redistribution des ressources de ce fonds en faveur des collectivités classées selon un indice synthétique tenant compte de leurs ressources, du revenu moyen de leurs habitants et de leur effort fiscal permettant de flécher les ressources du fonds vers les collectivités moins favorisées ;
-
29.
- une montée en charge progressive avec un montant initial en 2012 de 150 millions d’euros pour atteindre 2 % des ressources fiscales du secteur communal en 2016, soit plus d’un milliard d’euros ;
-
30.
- des marges de manœuvre importantes laissées aux exécutifs locaux pour répartir les charges ou les reversements librement entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ;
-
31.
- un traitement particulier des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ;
-
32.
- une articulation avec le fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF).
-
33.