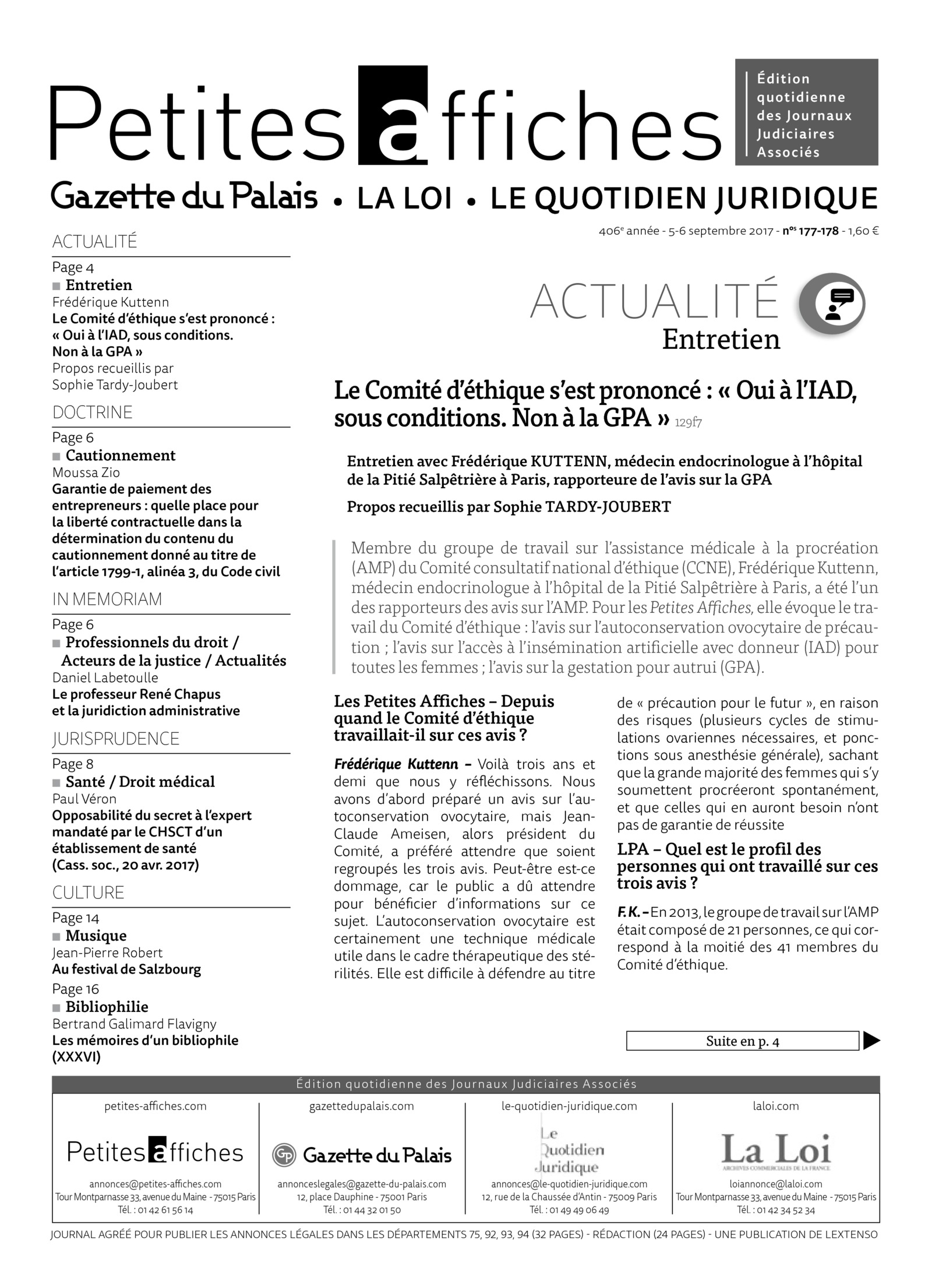Au festival de Salzbourg

Marianne Crebassa (sesto) et Florian Schuele (clarinette).
Ruth Walz
La Clémence de Titus
Sensation que la relecture radicale de La Clémence de Titus. On ne peut en dissocier les auteurs, Peter Sellars et Teodor Currentzis, dont il n’est pas exagéré de dire qu’ils partagent le qualificatif de « visionnaire ». On sait l’Américain iconoclaste et mystique. On connait aussi les partis drastiques du chef, ses lectures infiniment pensées. Fruit d’une analyse politico-philosophique perspicace, Peter Sellars en vient à démontrer que le dernier opéra de Mozart, même si composé en un court laps de temps, porte en lui beaucoup plus que la surface des mots ne le dit. Cette pièce est en fait plus un plaidoyer pour la recherche de la vérité et la réconciliation entre un souverain et son peuple qu’un simple manifeste de pardon et de magnanimité vis-à-vis de ceux qui en ont voulu à sa personne. Une profession de foi également contre l’absolutisme, que le vent de liberté qui soufflait alors sur l’Europe avec la Révolution française avait exacerbé. Peter Sellars repense l’histoire au-delà de la trame de Metastasio, mesurée à l’aune des conflits et à la vague d’attentats qui bouleversent le monde en ce début de XXIe siècle : un moyen de comprendre comment vivre avec ces peurs et faire en sorte que les gens se réconcilient, se réparent et aspirent de nouveau aux Lumières. Pour lui, les ensembles que compte l’opéra ont autant d’importance que les arias, aussi virtuoses qu’ils soient. Ce qui l’amène à inclure des morceaux de musique sacrée : des extraits de la Grande Messe KV 427 et la Musique funèbre maçonnique KV 477. Ces adjonctions peuvent surprendre les puristes ; mais elles apparaissent indéniablement en situation. Une mise en scène qui restitue l’œuvre dans son plein sens et non l’explicite au ras des mots. Aussi sa régie ne se satisfait-elle pas d’une illustration au premier degré ni d’époque, mais est tournée vers ces idées essentielles. Point de décor antique mais quelques sculptures modernes censées représenter le signifiant (des éléments calcinés lors de l’incendie de Rome, qui clôt le Ier acte). Et un intense travail sur les échanges on ne peut plus bouleversants. Ainsi de l’ultime confrontation entre Titus et Sesto, l’empereur confiné dans un lit médicalisé, le jeune homme entravé, tous deux de blanc vêtus, unis dans la même pitié. Quant aux ensembles, ils sont ménagés avec autant d’impact dramatique car pour Sellars, les chœurs forment un tout éloquent, qu’ils courent en tous sens ou se blottissent. Ainsi, au début du IIe acte, la foule qui a déposé fleurs et bougies, forme-t-elle un cercle poignant sur le Kyrie de la messe et clame la pitié de Dieu. Au finale, cette même foule est réunie dans une action de grâce sur la Musique funèbre maçonnique, transfigurée dans une vision de lumière éternelle.
L’exécution que donne Teodor Currentzis n’est pas moins étonnante. Dès l’ouverture et son tempo brusque et très articulé, on sent passer le vent de quelque dramatisme et une approche loin des habituels canons. Agitée, acérée, allégée, d’une vraie transparence, cette manière fait penser au jeune Harnoncourt et à sa soif de renouvellement. C’est qu’ici, le chef russe dispose d’un orchestre à sa main, musicAeterna, dont il fait ce qu’il veut en termes de nuances, proprement inouïes, en particulier des pianissimos d’une infinie douceur. Il en va de même du chœur musicAeterna de l’opéra de Perm dont Currentzis obtient un chant contrasté à l’extrême, avec là aussi des pianissimos à la limite de l’impalpable. Marianne Crebassa domine la distribution. La jeune française démontre des dons impressionnants : une puissance d’émission d’un mezzo clair et ductile qui n’a d’égale que la conviction qu’elle apporte au portrait de Sesto, à vrai dire un des points forts de la régie. L’aria « Parto, parto », avec clarinette obligée, est un moment magique : le dialogue avec l’instrumentiste, sur le plateau, renforcé par le tempo extrêmement lent et les silences évocateurs imposés par le chef, atteint le sublime. Russell Thomas est un Titus de belle allure, même si le chant privilégie plus l’expressivité que la finesse mozartienne. On remarque aussi la jeune Jeanine De Bique, un Annius attachant par un timbre de mezzo d’un grain remarquable et la Servilia de Cristina Ganz, délicat soprano. Seule la Vitellia de Golda Schultz déçoit par un soprano pas assez corsé et taxé, en particulier, dans le dernier air dont elle n’a manifestement pas les graves. En un mot, outre le formidable coup de poing que constitue cette représentation, voilà une vraie réévaluation d’un opéra qui ne passe pas pour le plus adulé de son auteur.
Wozzeck
Le festival a toujours porté sur le Wozzeck de Berg un regard attentionné. Cette fois, on a fait appel au metteur en scène William Kentridge et au chef Vladmir Jurowski. La vision de Kentridge est radicale en ce sens qu’il s’appuie sur la pièce de Georg Büchner, les Fragments du drame Woyzeck (1836/37) et sur sa propre expérience de leur mise en scène, alors pour un théâtre de marionnettes. Toute la violence du drame, en particulier du Capitaine et du Docteur vis-à-vis de Wozzeck, est imposée dans la vision d’un monde en décomposition, de terres meurtries par toutes sortes de catastrophes. Habituel chez Kentridge, le procédé de projection en arrière-plan d’images mouvantes permet ici de visualiser le background de l’œuvre. Le drame est vu à travers le regard du malheureux soldat : la militarisation de la société, sa violence, la désespérance de la pauvreté au cœur de l’œuvre. La décoration est à la fois unique – tous les éléments sont présents sur scène dès le début, plus ou moins visibles –, et multiformes grâce aux transformations qu’elle subit pour caractériser chaque scène en particulier. Le système de projections unifie le tout, laissant à voir ces visions elles-mêmes mouvantes de catastrophes ou de bonheur passé (cet enfant qui semble courir nulle part). Tout cela décrit l’univers étouffant du soldat, évoqué comme un petit monde en miniature, de même qu’est intégré le fameux découpage de l’opéra en ses diverses courtes scènes : elles sont parties d’un ensemble, comme le décor unique se livre lui-même en ses sous-parties. De celui-ci surgissent des niches, tel ce placard visualisant le minuscule cabinet du docteur, bardé d’instruments de torture, où le praticien et son cobaye occupent toute la place. Ou des espaces tout aussi étriqués, comme la chambre de Marie. L’avant-scène sera réservé à la taverne qui elle-même va se muer en dortoir des soldats à la fin du IIe acte. Tout semble procéder d’un vrai continuum, les interludes symphoniques étant complètement intégrés à la dramaturgie. Reste que cette constellation d’images en continu associées à une sorte de bric-à-brac envahissant le plateau sollicite beaucoup l’œil. La régie et le travail sur les personnages misent sur l’objectivité et fuient tout naturalisme. Une autre idée force est de représenter l’enfant de Marie et de Wozzeck par une marionnette, elle-même atrophiée par un masque, mue par une infirmière. Marie n’aura jamais de contact avec elle. Le parti pris trouve sa limite à la dernière scène de laquelle les autres enfants sont également lestés (et cantonnés dans la fosse), en contradiction avec le texte, éludant l’émotion qui doit alors étreindre le spectateur.
Vladimir Jurowski offre une lecture extrêmement contrastée surtout dans les passages chambristes où l’on peut détailler à loisir la richesse de l’écriture bergienne grâce à la finesse des instrumentistes des Wiener Philharmoniker. Le grand interlude de facture mahlérienne, à l’acte III, attendra une puissance tellurique. Le spectacle est dominé par Matthias Goerne, un immense Wozzeck. Son habituelle fréquentation du répertoire du Lied apporte ici un délié bienfaisant. L’humanité du personnage transpire dans un portrait aussi fouillé que naturel. La Marie de Asmik Grigorian est attachante dans sa frêle jeunesse insouciante et son chant assuré. On citera encore le Docteur de Jens Larsen, d’une diabolique élocution, le Capitaine de Gerhard Siegel, un peu forcé à la première scène, et le Tambour major de John Daszak, joliment caricaturé tous muscles dehors. Les chœurs de l’opéra de Vienne distinguent la scène de la taverne, rehaussés d’une bardée d’instrumentistes comme sortis d’une boîte de Pandore. Au final, 90 minutes de tension, souvent insoutenable, sans doute unique dans l’histoire de l’opéra.