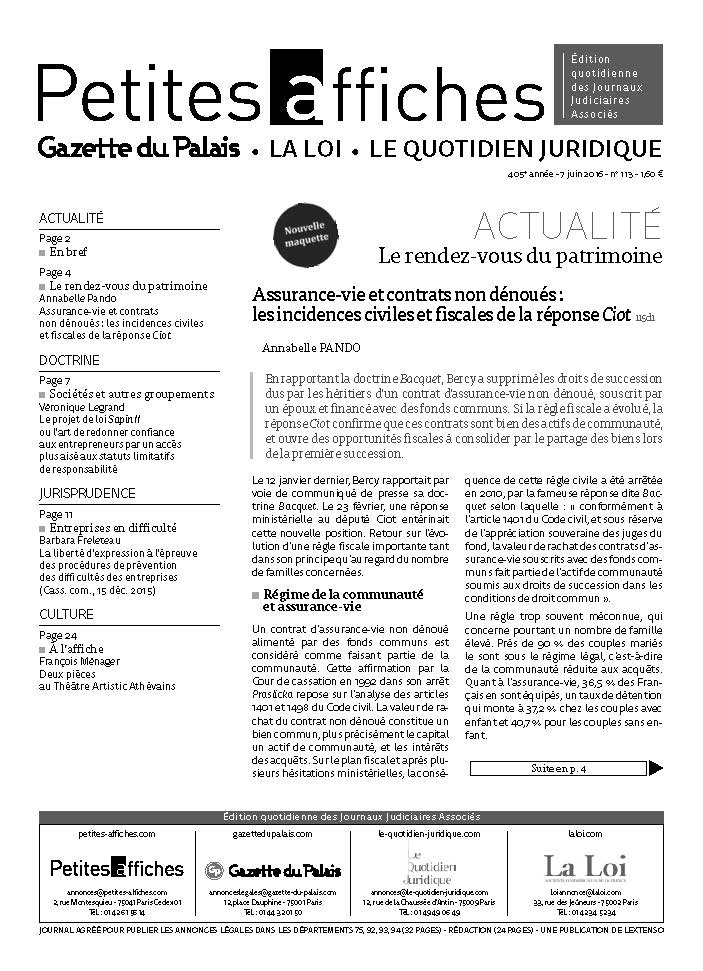Deux pièces au Théâtre Artistic Athévains

L’équipe des Cuisinières.
Charlotte Russo
Les Cuisinières
Écrite par Goldoni pour le carnaval de Venise en 1755, Les Cuisinières est, comme beaucoup de ses 200 œuvres, une fresque populaire et colorée, en « hommage aux petites gens ». Dans l’ambiance fébrile de la préparation du carnaval, les cuisinières ont travaillé dur pour prendre part elles aussi à cette fête exceptionnelle. Elles n’ont qu’un jour de congé par an, celui de la veille du carnaval et elles vont donc en profiter pleinement.
En ce jour de pleine liberté où tous les désirs et toutes les frustrations peuvent s’épancher au grand jour, les classes sociales se confondent et se rapprochent dans une même fête menée par les domestiques bien plus rusés et joyeux que leurs maîtres qui, ici, sont de pauvres bougres : vieillard libidineux, matrone maniaco-dépressive, joueuse de cartes compulsive dont les cuisinières pourront se moquer à leur aise avant de retourner à leur triste situation d’exploitées.
La modernité de Goldoni, que notre époque a redécouvert après un long purgatoire, est évidente. Construction autour d’une suite de scénettes rapides et entrelacées, quiproquos, accélérations du rythme, verdeur du langage.
Les onze comédiens des compagnies Bouquet de Chardons et La Suzanne mènent honorablement cette sarabande colorée, et si ce carnaval n’a pas le faste de la Sérénissime, il en a l’insolence, la légèreté et cette fureur de vivre un peu mélancolique.
Le Père Goriot
Didier Lesour et Frédérique Lazarini, qui met en scène, ont choisi de relooker Balzac façon commedia dell’arte ou théâtre élisabéthain. Et c’est tout à fait réussi. Ils sont parvenus à présenter le roman-fleuve, semé d’intrigues, du Père Goriot en l’enserrant dans le décor minimaliste d’un théâtre de marionnettes et en demandant à trois comédiens d’incarner l’ensemble des personnages, masculins et féminins. Le spectacle se présente comme une suite de tableaux où les protagonistes sont le plus souvent en buste, dans des « fenêtres », faisant penser aux autoportraits des musées, mais bien vivants et emportés dans une succession d’événements à un rythme précipité.
C’est évidemment la pension Vauquer qui est au centre du spectacle et autour des héros du roman que sont le père Goriot et Rastignac, on retrouvera la mère Vauquer, Vautrin, les deux filles élégamment monstrueuses : ici Delphine de Nucingen, là Anastasie de Restaud, et aussi l’étudiant en médecine Horace Bianchon ainsi que la vertueuse Victorine de Taillefer. Rien ne manque au déroulement du récit autour de l’égoïsme, la futilité et la vanité des filles mariées à l’aristocratie à l’égard de leur « père pélican » bourgeois enrichi par son travail qu’elles vont ruiner avant de l’abandonner, autour aussi de l’éducation sentimentale et sociale de Rastignac, le jeune provincial à l’innocence perdue. Et le coup de crayon qui miniaturise l’ensemble ainsi que la grâce des masques et des travestissements donnent au récit une poésie singulière. Quant à la peinture et à l’évolution des caractères dans l’atmosphère d’une époque – de toutes les époques – où le pouvoir et l’argent jouent irrésistiblement leur rôle corrupteur, elle reste sans doute un peu superficielle mais elle représente fort bien ce qui n’est après tout qu’une comédie humaine, un théâtre de poupées, une farce plus qu’une tragédie.