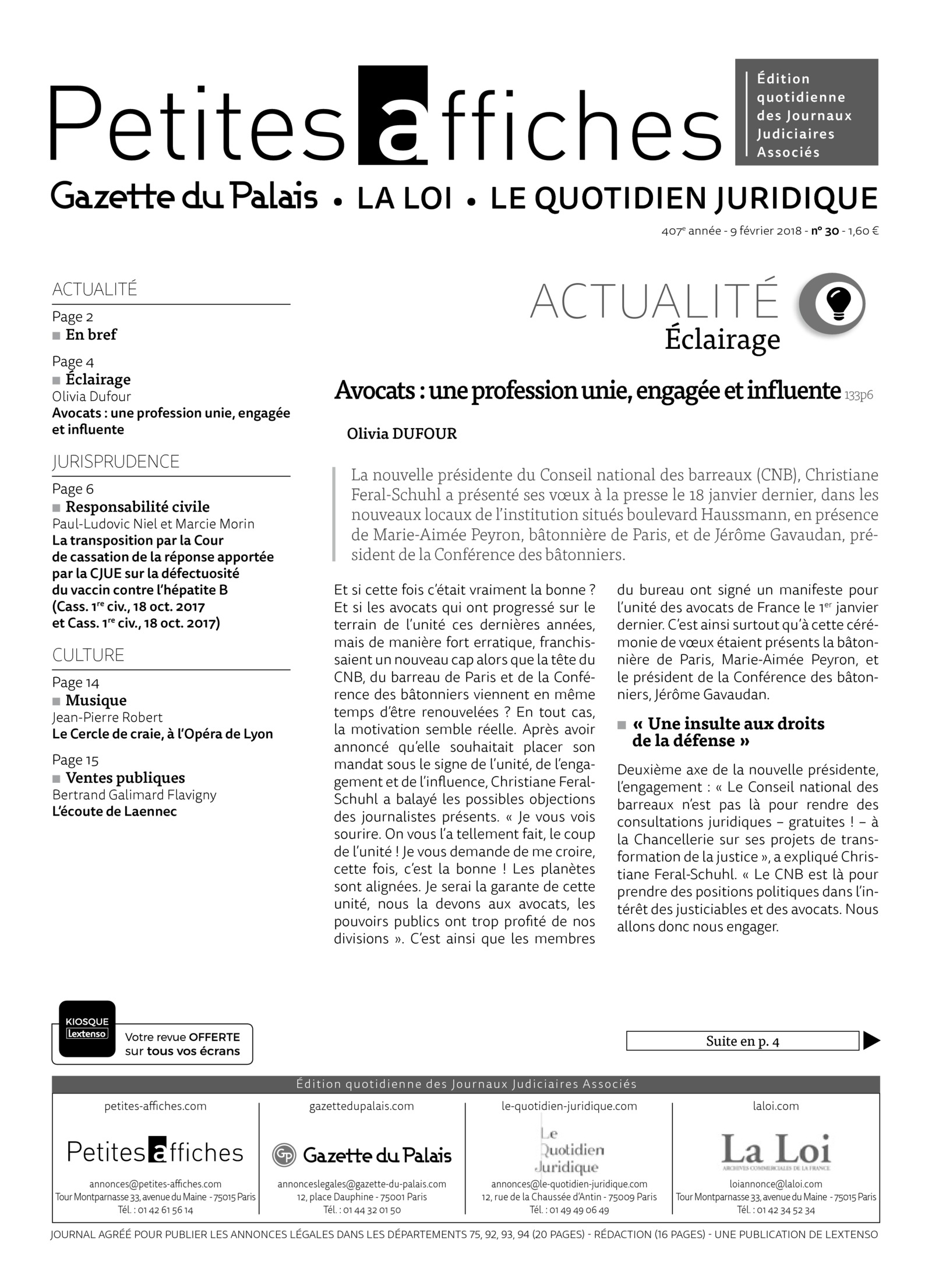Le Cercle de craie, à l’Opéra de Lyon

Jean-louis Fernandez
L’Opéra de Lyon frappe un grand coup en offrant la première française du Cercle de craie de Zemlinsky, créé en 1933. Compositeur et chef d’orchestre renommé, qui le mena de Vienne à Prague puis à Berlin, où il créera Erwartung de Schoenberg, Alexander von Zemlinsky (1871-1942) s’est beaucoup consacré à l’opéra. On lui doit notamment Une Tragédie florentine, Le Nain, et Le Roi Candaule. Son avant-dernier opéra, Le Cercle de craie, est l’adaptation d’une pièce de l’écrivain Alfred Henschke, dit Klabund.
Cet opéra présente plus d’une particularité : sa forme d’abord, proche du théâtre épique puisqu’elle combine chant, dialogues parlés et mélodrame ou parlé-chanté, à l’appui d’une œuvre qui prend ses distances avec le théâtre psychologique et s’inscrit dans le genre du Zeitoper ou théâtre d’actualité. Son écriture musicale ensuite, qui intègre le style de Hindemith et de Krenek, voire de Berg, fait penser à Kurt Weill, emprunte au jazz, et délivre souvent un lyrisme expressif tout en fuyant effet facile et couleur locale. Son contenu enfin, s’agissant d’une fable à valeur de critique sociale que Klabund avait lui-même puisée dans un vieux conte chinois du XIIIe siècle : une jeune fille pauvre, Haïtang, est vendue par sa mère au tenancier d’une maison de prostitution, au grand dam de son frère Tchang Ling, puis à M. Ma, un riche mandarin, auquel elle donne un fils, et qu’elle va métamorphoser par son amour. Accusée par la première femme de celui-ci de vol d’enfant et d’empoisonnement du mandarin, elle est condamnée à mort suite à de faux témoignages. Le nouvel empereur qui reconnaît celle sur laquelle il n’a pu surenchérir naguère mais dont il s’est épris, lui rend la liberté par un jugement de Salomon, suite à l’épreuve du cercle de craie : l’enfant de Haïtang est reconnu comme étant bien le sien. L’empereur se souvenant de leur première rencontre amoureuse la déclarera sa femme. Un happy end certes convenu, aux confins de l’utopie, et musicalement presque trop grandiose, qui clôt une pièce où se seront opposés bien et mal, richesse et pauvreté, probité et corruption, innocence trompée et humiliation rachetée. Et défiler une constellation de personnages fort bien dessinés dans une dramaturgie très ouverte.
Pour illustrer pareille parabole, la régie de Richard Brunel joue la carte de la lisibilité. Sa mise en scène épurée est centrée sur le personnage de Haïtang, omniprésente même lorsqu’elle ne participe pas directement à l’action. Le débit est lent, la direction d’acteurs plus suggestive que naturaliste. Ce qui se retrouve dans la décoration qui bien qu’inscrivant l’histoire dans la Chine d’aujourd’hui, ne cherche pas à dater les événements. La maison de thé, qui figure un bordel, ose quelques excentricités, rapidement remisée pour des points de repères plus intemporels. Les divers lieux sont là aussi suggérés par des éléments mouvants laissant place à des références récurrentes à l’enfance, berceau, peluches, cheval à bascule… Une impression d’austérité domine et le grotesque n’est pas évacué. Le tableau de la parodie de procès, transplanté du tribunal dans l’univers froid d’une prison, n’y échappe pas, les poncifs de la corruption judiciaire étant joliment soulignés.
L’onirisme dans lequel basculent les scènes finales abandonne le blanc immaculé jusqu’alors en vigueur pour un climat plus sombre, voire pesant. La traduction visuelle du cercle de craie, d’abord tracé par un dessin malhabile sur un mur, puis matérialisé par un vaste halo circulaire de lumière blanche projeté sur le sol, autour duquel sont réunis tous les protagonistes de l’audience impériale, est fort habile.
Musicalement, la réussite est totale. On a réuni une distribution en majorité allemande et de classe : Lauri Vasar, timbre de baryton héroïque bien projeté, Tschang-Ling, le frère révolutionnaire de Haïtang, Stephan Rügamer, quasi Heldentenor, capable de raffinement, dans le Prince Pao, et Martin Winkler, solide M. Ma. Elle est dominée par la prestation d’Else Eerens : un soprano vibrant pour une interprétation sensible de la pauvre fille ballottée d’avanie en avanie, qu’on ne peut toutefois réduire au silence, solide qu’elle est et reste dans ses convictions. Lothar Koenigs métamorphose l’Orchestre de l’Opéra de Lyon par les sonorités envoûtantes des vents dans le grave et une vraie transparence des cordes exhalant les bouffées de lyrisme de la partition. Les pages chambristes sont dessinées avec autant de finesse que les reliefs sonores creusés, là où tonnent les clusters d’un orchestre déchaîné au plus dramatique de l’histoire.