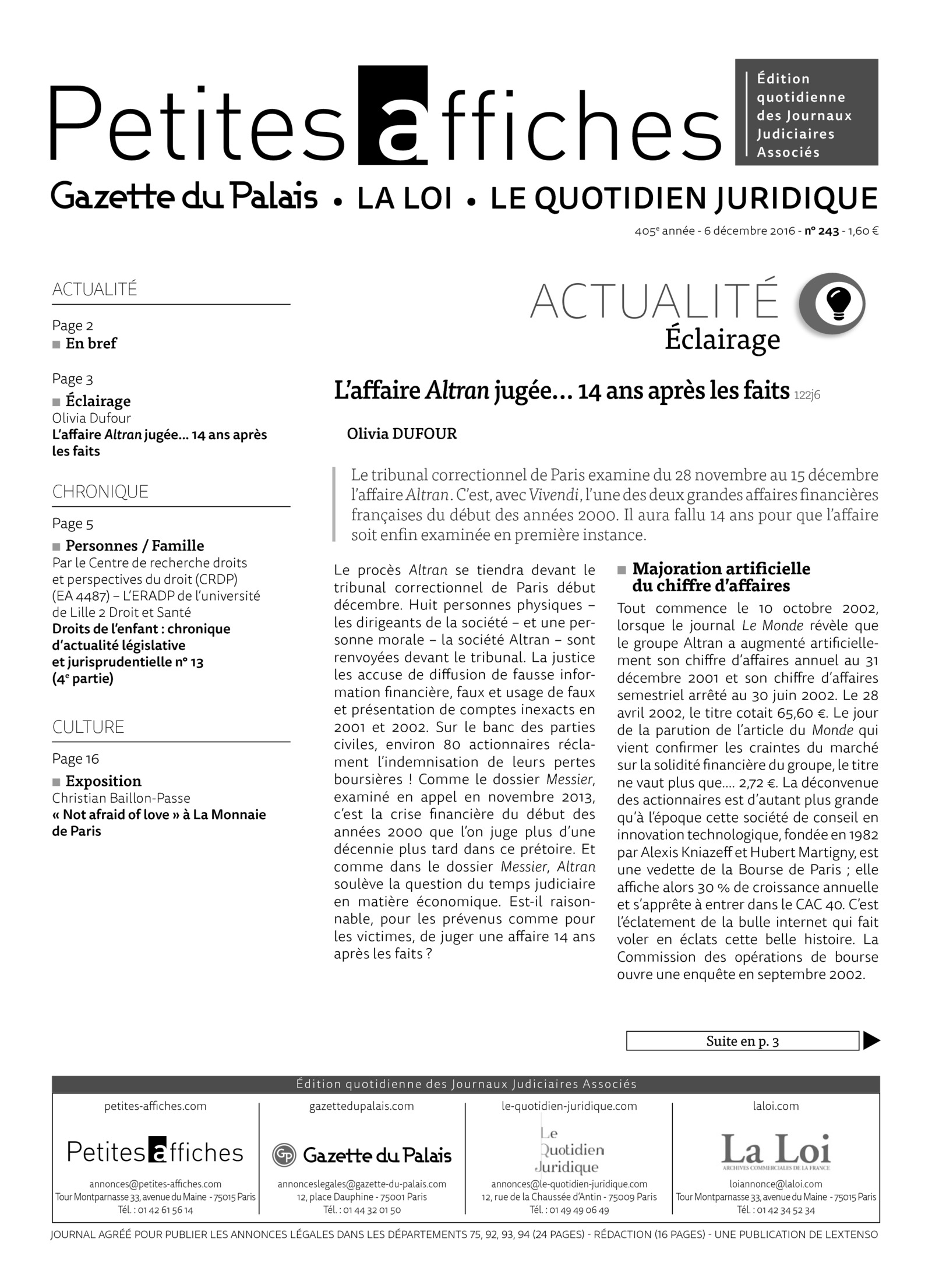L’affaire Altran jugée… 14 ans après les faits
Le tribunal correctionnel de Paris examine du 28 novembre au 15 décembre l’affaire Altran. C’est, avec Vivendi, l’une des deux grandes affaires financières françaises du début des années 2000. Il aura fallu 14 ans pour que l’affaire soit enfin examinée en première instance.
Le procès Altran se tiendra devant le tribunal correctionnel de Paris début décembre. Huit personnes physiques – les dirigeants de la société – et une personne morale – la société Altran – sont renvoyées devant le tribunal. La justice les accuse de diffusion de fausse information financière, faux et usage de faux et présentation de comptes inexacts en 2001 et 2002. Sur le banc des parties civiles, environ 80 actionnaires réclament l’indemnisation de leurs pertes boursières ! Comme le dossier Messier, examiné en appel en novembre 2013, c’est la crise financière du début des années 2000 que l’on juge plus d’une décennie plus tard dans ce prétoire. Et comme dans le dossier Messier, Altran soulève la question du temps judiciaire en matière économique. Est-il raisonnable, pour les prévenus comme pour les victimes, de juger une affaire 14 ans après les faits ?
Majoration artificielle du chiffre d’affaires
Tout commence le 10 octobre 2002, lorsque le journal Le Monde révèle que le groupe Altran a augmenté artificiellement son chiffre d’affaires annuel au 31 décembre 2001 et son chiffre d’affaires semestriel arrêté au 30 juin 2002. Le 28 avril 2002, le titre cotait 65,60 €. Le jour de la parution de l’article du Monde qui vient confirmer les craintes du marché sur la solidité financière du groupe, le titre ne vaut plus que…. 2,72 €. La déconvenue des actionnaires est d’autant plus grande qu’à l’époque cette société de conseil en innovation technologique, fondée en 1982 par Alexis Kniazeff et Hubert Martigny, est une vedette de la Bourse de Paris ; elle affiche alors 30 % de croissance annuelle et s’apprête à entrer dans le CAC 40. C’est l’éclatement de la bulle internet qui fait voler en éclats cette belle histoire. La Commission des opérations de bourse ouvre une enquête en septembre 2002. Dans sa décision de sanction du 29 mars 2007, l’ex-COB devenue en 2003 l’AMF constate : « il ressort de l’ensemble des pièces du dossier qu’un mécanisme de gonflement fictif du chiffre d’affaires avait été mis en place dans plusieurs filiales pour l’arrêté des comptes au 31 décembre 2001 et au 30 juin 2002 ; qu’il consistait essentiellement en une majoration artificielle du chiffre d’affaires et du résultat, par l’enregistrement de factures à établir fictives qui ne recouvraient aucune réalité économique en l’absence de prestation correspondante ». Alexis Kniazeff, président, Hubert Martigny, vice-président, et Frédéric Bonan, directeur général, écopent chacun de 1 million d’euros d’amende ; Michel Friedlander, directeur général en charge de la communication financière, de 500 000 €, la société Altran de 1,5 million et les deux commissaires aux comptes de 50 000 € chacun. Les intéressés font appel, la cour confirme le jugement excepté s’agissant des commissaires aux comptes qui sont mis hors de cause. Parallèlement à la procédure de sanction administrative, la justice a ouvert une information en janvier 2003, laquelle se termine par une ordonnance de renvoi signée le 29 novembre 2011.
Un mois de procès et… retour à l’instruction
En réalité, un premier procès s’est tenu en janvier 2014. À cette occasion, il est apparu clairement que la matérialité des faits n’était pas contestée. Le gonflement du chiffre d’affaires a été réalisé via le recours à des factures à établir (FAE), autrement dit des écritures comptables consistant à enregistrer dans le chiffre d’affaires les sommes concernant une prestation réalisée mais non encore facturée à la date de clôture. Le stratagème a consisté à demander aux patrons des filiales de gonfler un peu les résultats via les FAE, ce qui a mobilisé entre 80 et 100 personnes. Montant de la fraude ? Certains experts avancent la somme de 30 millions, d’autres 100 millions, preuve supplémentaire du flou régnant à l’époque dans les comptes du groupe. Une telle fraude est inhabituelle à plusieurs titres. D’abord, selon les experts, il est rare qu’une manipulation comptable implique autant de personnes. Ensuite, l’artifice est naïf car à la clôture suivante, les commissaires aux comptes auraient pointé les FAE et très vite constaté que les soi-disant prestations réalisées mais non encore facturées n’avaient jamais existé. En réalité, le premier procès a montré que la seule vraie question qui se pose à la justice est de déterminer qui a décidé cette fraude. Est-elle le fait d’un directeur commercial à qui on avait donné tous pouvoirs et qui a tenté en pleine crise de sauver son chiffre d’affaires ? C’est la thèse des dirigeants fondateurs qui nient être à l’origine des faits. La fraude a-t-elle au contraire été décidée au niveau du comité de direction ? Ou bien, hypothèse plus grise, est-on dans le non-dit, dans la pression qui ne laissait volontairement pas d’autre choix aux cadres que de frauder pour atteindre leurs objectifs ? Au terme d’un procès d’un mois, le tribunal a finalement décidé de renvoyer l’affaire à l’instruction, faisant droit à la défense qui pointait les erreurs et les imprécisions empêchant les prévenus d’organiser utilement leur défense.
Où l’on reparle de ne bis in idem
C’est dans ces conditions que le dossier revient devant le tribunal cette année. L’instruction n’a apporté aucun élément nouveau mais simplement précisé les points jugés incertains par le tribunal. C’est, semble-t-il, le premier dossier boursier qui arrive devant ses juges après l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 2016 qui, dans le prolongement de la décision du 18 mars du Conseil constitutionnel mettant fin aux doubles poursuites en matière boursière, a organisé un système de dialogue entre l’AMF et le parquet pour éviter les doubles poursuites. Une QPC contestant la conformité de cette loi à la Constitution, déposée par Nicolas Huc-Morel et Hervé Temime, avocats de Alexis Kniazeff, a déjà été rejetée par le tribunal en septembre dernier. Mais les avocats de la défense n’entendent pas renoncer à l’argument de la nécessité des peines dans un dossier où les prévenus ont déjà été, pour la plupart, sévèrement sanctionnés par l’AMF. Ils s’apprêtent donc à invoquer directement la décision du 18 mars puisque la loi du 21 juin met en place un mécanisme de dialogue entre AMF et parquet pour éviter les doubles poursuites mais ne dit rien sur les cas où ces doubles poursuites sont déjà engagées. À l’inverse, dans sa décision du 18 mars, le Conseil constitutionnel, après avoir déclaré les doubles poursuites contraires à la Constitution et abrogé les textes y afférant, a précisé que toutes les doubles poursuites en cours devaient cesser immédiatement. C’est ainsi que dans l’affaire EADS à l’origine de la QPC, le tribunal a constaté l’extinction des poursuites, de même que dans plusieurs autres affaires moins célèbres (Pechiney, Sacyr…). L’originalité de l’affaire Altran est d’être jugée sous l’empire du nouveau régime légal. Il serait discutable que les dossiers de la période intermédiaire entre la déclaration d’inconstitutionnalité et l’entrée en application de la réforme bénéficient d’un traitement plus favorable que ceux jugés après la réforme.
L’affaire Altran est donc intéressante à un double titre. D’abord, en ce qu’elle interroge sur le temps de la justice pénale dans les dossiers complexes (finance, mais aussi santé ou encore environnement). Ensuite, parce qu’elle représente un nouveau rebondissement dans la saga française du principe ne bis in idem. En janvier 2014, Jean-Daniel Bretzner, associé du cabinet Bredin, avait déjà plaidé au bénéfice de l’un des prévenus l’application de ne bis in idem. Sa demande avait été rejetée, mais il avait alors prévenu : « le fil qui permet encore de sanctionner deux fois les infractions boursières est en train de casser ». Et il a cassé en effet, deux mois après, lorsque la CEDH a prononcé son fameux arrêt Grande Stevens qui allait déclencher le revirement du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015, puis la réforme du 21 juin 2016.