Cette semaine chez les Surligneurs : E. Borne officialise la création de l’ « homicide routier »
Que va changer exactement le nouvel « homicide routier » ? Pas grand-chose, estiment Les Surligneurs. On vous explique pourquoi. Cette semaine, les spécialistes du legal checking se penchent également sur ce que le « mois des fiertés » doit à l’Europe ainsi que sur la possibilité ou non d’étendre la PMA aux hommes transgenres. Enfin, ils rappellent les règles du port de l’écharpe tricolore par les élus à l’occasion du débat soulevé par Grégory Doucet et son écharpe arc-en-ciel.
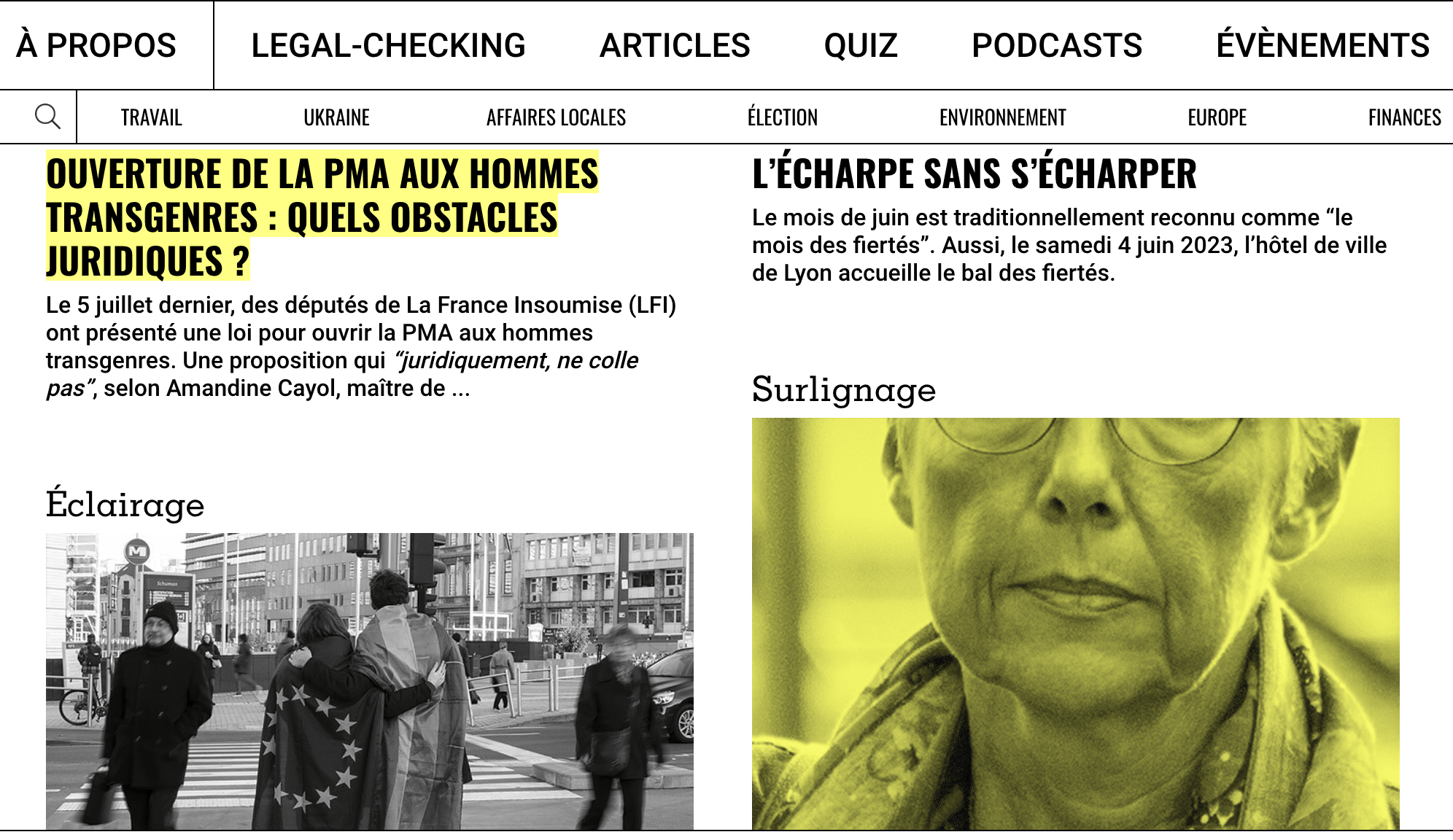
L’ « homicide routier », un concept flou à portée symbolique
À la suite du Comité interministériel de la sécurité routière, Elisabeth Borne, la Première ministre a annoncé la création de délit d’“homicide routier”, en remplacement de l’homicide involontaire commis à l’occasion d’un accident de la route. À l’instar de l’annonce faite par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, en février dernier dans “l’affaire Pierre Palmade”, ce délit concernera les accidents survenus sous l’emprise de stupéfiants ou d’alcool.
Cette annonce très floue pourrait bien n’avoir qu’une portée symbolique, à savoir écarter l’expression “homicide involontaire”, vécue comme une souffrance pour les familles des victimes et certaines associations. Le gouvernement n’a pas encore déposé de projet de loi à ce sujet. Sans plus de précisions, on peut supposer que l’exécutif entend reprendre une proposition de loi déposée par le groupe LIOT en novembre 2022 prévoyant également la création d’une infraction autonome appelée ”homicide routier”.
En réalité, il s’agit de renommer le délit existant d’”homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur”, prévu à l’article 221-6-1 du code pénal, en “homicide routier”. Cette modification de la loi serait seulement sémantique et ne modifierait pas les peines applicables à ce délit, entre cinq ans et dix ans selon qu’il y ait ou non circonstances aggravantes.
Contrairement toutefois à la proposition de loi du groupe LIOT, Elisabeth Borne a annoncé que seuls les accidents de la route commis sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool seraient qualifiés d’homicide routier. Si le gouvernement s’en tient à son annonce, un accident mortel dû, par exemple, à un excès de vitesse supérieur à 50 km/h resterait qualifié d’”homicide involontaire”, tandis que le délit d’”homicide routier” remplacerait celui d’homicide involontaire lorsqu’il est commis sous l’emprise de stupéfiants ou de l’alcool, avec la même peine.
Ainsi, cette réforme, bien que n’alourdissant aucune peine, satisferait certaines victimes moralement mais créerait de nouvelles frustrations. En effet, pourquoi le mot “involontaire“ serait-il plus supportable pour les victimes d’accidents ayant eu lieu en raison d’un grand excès de vitesse, que pour les victimes d’une consommation d’alcool ou de stupéfiants ?
En savoir plus ? Cliquer ici.
Le mois de juin était le “mois des Fiertés”, et l’Union européenne n’y est pas étrangère
Au mois de juin, les villes européennes ont été pavoisées aux couleurs arc-en-ciel, signe reconnaissable des personnes LGBTI, dans le cadre du “mois des Fiertés”. L’année 2023 marque également les dix ans de la loi sur le mariage pour tous en France.
Certaines avancées des droits des personnes LGBTI, comme l’amélioration de la protection des droits liés à l’orientation sexuelle (art. 7 de la Charte des droits fondamentaux), sont le fruit du droit de l’Union européenne, même si cette dernière reste parfois impuissante face à des États récalcitrants.
En effet, dès les années 2000, l’Union européenne, qui n’a pas la compétence pour imposer à la France une réforme dans le domaine du mariage, avait été très active pour améliorer l’égalité entre les personnes, en interdisant toute discrimination sur le terrain de l’emploi avec une “loi” européenne.
Depuis que la législation européenne interdit toute discrimination sur le fondement de l’orientation sexuelle, élus et exécutif européens ont pris des positions allant plus loin encore dans le but de protéger les personnes pouvant être victimes de haine et de discrimination du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
Ces modifications sont passées par des textes contraignants et non contraignants : en 2007 est adoptée une nouvelle obligation de lutte contre les discriminations sur l’orientation sexuelle dans le cadre de toutes les politiques publiques européennes (art. 10 TFUE) ; en 2019, le Parlement européen vote une résolution sur la sécurité des personnes LGBTI ; enfin, la Commission européenne vise une “Union de l’égalité” pour 2025. Toutefois, c’est aux États membres de légiférer au sein de leur territoire afin d’assurer la protection des droits de ces personnes, s’agissant d’appliquer les textes non contraignants.
Alors que l’Union européenne prône un respect des valeurs communes (art. 2 TUE) comme “le combat contre l’exclusion sociale et les discriminations”, tous les États membres n’y mettent pas la même énergie : les progrès sont à géométrie variable.
En 2021, la Commission a engagé une procédure de recours en manquement à l’encontre de la Hongrie, considérant qu’elle avait manqué à l’une ou plusieurs de ses obligations lorsqu’elle a adopté la loi visant à empêcher la promotion de l’homosexualité. La Commission a utilisé le fondement du marché intérieur – à savoir une directive interdisant toute discrimination à la télévision et à la radio – pour initier ce recours.
En savoir plus ? Cliquer ici.
Ouverture de la PMA aux hommes transgenres : quels obstacles juridiques ?
Le 5 juillet dernier, des députés de La France Insoumise (LFI) ont présenté une loi pour ouvrir la PMA aux hommes transgenres, mais cette proposition pourrait rencontrer des obstacles juridiques.
Selon le parti, cette loi viendrait pallier les “trop nombreux manquements et omissions, angles morts et oublis” inhérents à la “loi bioéthique” de 2021, qui avait ouvert la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules. Parmi ces “oublis”, l’accès à la PMA pour les hommes transgenres (devenus hommes selon l’état civil) nés biologiquement femmes mais ayant gardé leurs organes reproductifs. Autres “oublis”, la possibilité pour une femme de recevoir les ovocytes de sa partenaire (ROPA), ainsi que celle pour les couples d’hommes de reconnaître un enfant de façon anticipée.
Depuis 2016 et la loi de “modernisation de la justice du XXIème siècle”, le changement de sexe à l’état civil n’est plus soumis à l’engagement de traitements ou d’opérations médicales. Certains hommes selon l’état civil peuvent donc porter un enfant car ils ont gardé leurs organes génitaux féminins. Ils ne peuvent néanmoins pas recourir à la PMA, réservée par la loi aux femmes. Une situation conforme à la Constitution selon le Conseil constitutionnel soulignant que la différence de traitement était due aux différences des situations dans lesquelles se trouvaient les hommes et les femmes. De plus, le Conseil constitutionnel n’entend pas substituer son appréciation à celle du législateur, s’agissant des grandes évolutions sociétales.
Le système légal français est actuellement tel qu’il serait difficile d’y intégrer la PMA pour les hommes transgenres car ce n’est pas l’aspect biologique qui est pris en compte (la capacité à enfanter), mais l’état civil. Aujourd’hui le système est binaire à l’état civil : soit on est homme soit on est femme, l’homme transgenre n’existe pas. La proposition LFI reviendrait à mettre une personne juridiquement homme dans “couple de femmes” pour la PMA, parce qu’elle est restée biologiquement femme, alors même que cette personne a fait toutes les démarches pour être reconnue comme homme par l’état civil.
La solution la plus simple serait d’ouvrir la procréation à tous, c’est d’ailleurs la demande des personnes concernées. Mais, dans ce cas, la seule solution, pour beaucoup d’hommes, serait la gestation pour autrui (GPA).
Or, les conventions de mère porteuse ont été interdites en France par la loi de 1944 relative au respect du corps humain, codifiée à l’article 16-7 du code civil) et, depuis 2021, lorsqu’une GPA est réalisée à l’étranger, il n’y a plus de transcription à l’état civil en France pour la mère d’intention (art. 47 code civil), même lorsqu’elle donne ses propres gamètes et qu’elle est donc biologiquement la mère (CEDH 16 juill. 2020, D c. France). Ainsi, la mère reste aux yeux de la loi celle qui accouche, donc la mère porteuse, tandis que pour le père d’intention, qui en général est aussi biologiquement le père, la transcription est acceptée. La mère d’intention ne peut qu’adopter l’enfant de son conjoint. La filiation se fait de manière détournée.
Cette proposition laisse donc place à beaucoup d’interrogations tant sur la GPA que la PMA.
En savoir plus ? Cliquer ici.
L’écharpe sans s’écharper
Lors du “mois des Fiertés”, le maire écologiste Grégory Doucet arborait à cette occasion une écharpe arc-en-ciel et non la traditionnelle écharpe tricolore. Ce choix fait l’objet d’une critique véhémente des élus de l’opposition, pour qui le port de l’écharpe tricolore est obligatoire.
La question du port d’un insigne, d’un accessoire vestimentaire, d’un costume est une question récurrente tout au long des siècles. Ces éléments ont une fonction symbolique primordiale en ce qu’ils permettent d’identifier une personne, et ainsi de marquer son autorité. Le droit s’y intéresse lorsqu’il en prescrit le port ou lorsqu’il le proscrit.
Dès 1790, l’article 3 du décret du 20 mars imposait aux maires et officiers municipaux de porter “une écharpe aux trois couleurs de la nation, bleu, rouge et blanc, attachée d’un nœud, et ornée d’une frange couleur d’or pour le maire” dans le cadre de leurs fonctions.
Le préambule du décret du 1er au 20 mars 1852 du président de la République française “relatif au costume des fonctionnaires administratifs, des employés du ministère de l’Intérieur ou des administrations qui en dépendent” faisait mention de textes antérieurs qui comportent les indications précises sur le costume du maire comportant notamment une “écharpe tricolore avec glands à franges d’or”. Sous ce décret, la justice veillait tout particulièrement au respect de l’obligation de port de l’écharpe, ainsi que le montre un jugement du tribunal correctionnel de Marvejols en date du 17 juin 1903, affirmant que lorsqu’un maire ou un autre officier se rend sur le lieu d’un attroupement afin de faire les sommations prévues par la loi du 7 juin 1848, il doit porter l’écharpe tricolore, sous peine de nullité desdites sommations. Le respect des trois couleurs était également très profondément ancré dans l’opinion publique.
Le port de l’écharpe est aujourd’hui régi par l’article D. 2122-4 du Code général des collectivités territoriales. Cet article montre une grande similitude avec les textes antérieurs. Ainsi, le maire porte toujours, en écharpe ou en ceinture, “l’écharpe tricolore avec glands à franges d’or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice” de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité. Le maire de Lyon aurait donc dû porter son écharpe tricolore comme la loi le prévoit.
En savoir plus ? Cliquer ici.
Référence : AJU381349





