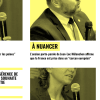Cette semaine chez les Surligneurs : la colère d’Anticor est-elle fondée ?
Le tribunal administratif de Paris a annulé le 23 juin dernier l’agrément de l’association Anticor. Les Surligneurs expliquent pourquoi ce n’est pas « une atteinte grave aux libertés associatives ». Cette semaine les spécialistes du legal checking se penchent également sur la possibilité pour Emmanuel Macron de réaliser un troisième mandat et sur l’idée d’Eric Piolle, maire de Grenoble, de supprimer les fêtes religieuses du calendrier.
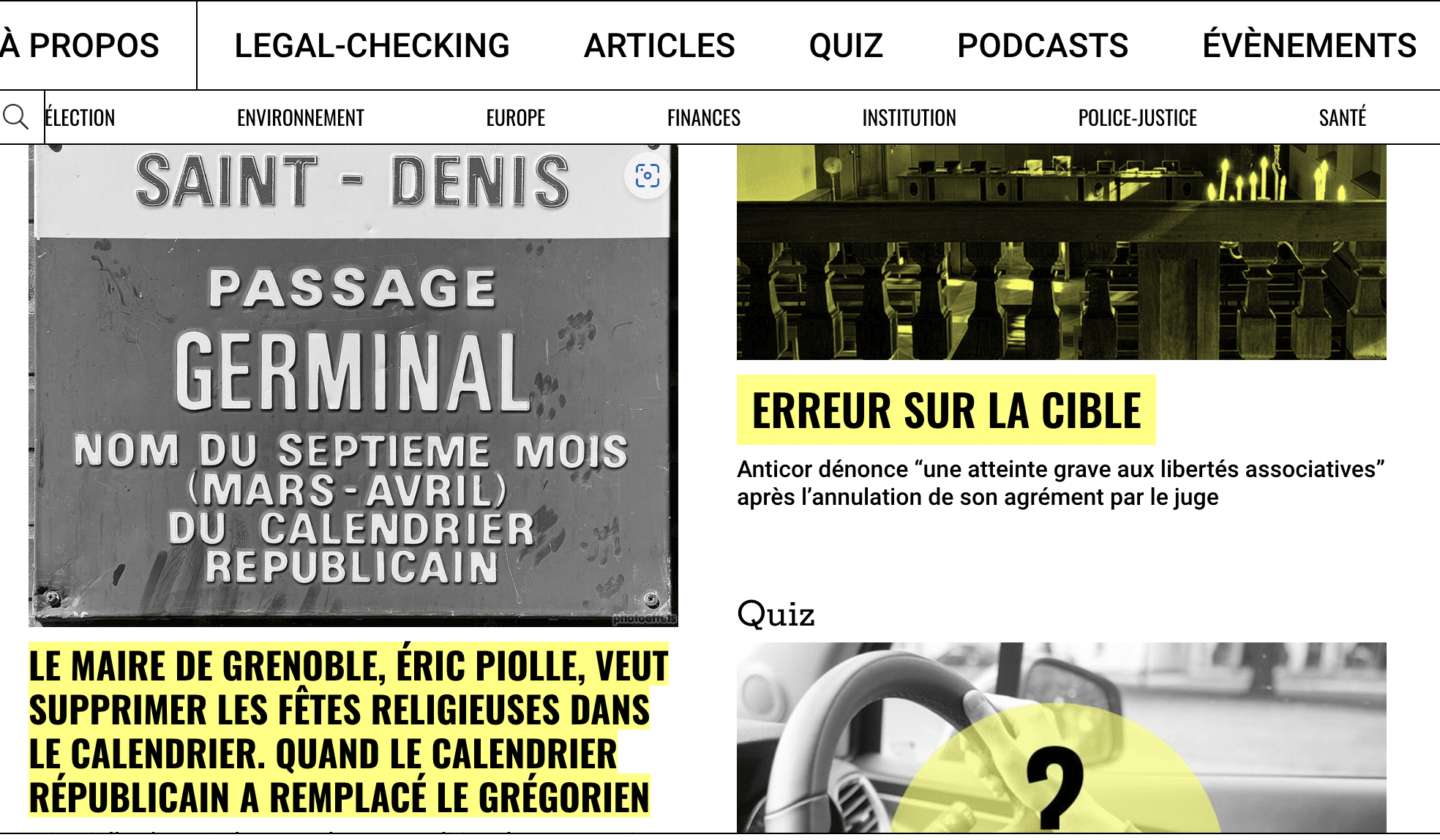
Anticor dénonce “une atteinte grave aux libertés associatives” après l’annulation de son agrément par le juge.
Le tribunal administratif de Paris a annulé par un jugement du 23 juin 2023 l’agrément ministériel de l’association Anticor accordé par arrêté et qui lui conférait une prérogative essentielle dans une démocratie : celle de se porter partie civile dans les affaires de corruption.
L’agrément accordé par le gouvernement à une association lui permet de se porter partie civile dans une affaire pénale si le fond de l’affaire relève de son objet associatif. Une plainte avec constitution de partie civile aboutit à saisir directement le juge d’instruction, sans passer par le parquet. Cela n’implique pas forcément un procès, mais cela contourne l’éventuelle inertie du parquet.
Peuvent être agréées par le gouvernement les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans qui se proposent, par leurs statuts, notamment lutter contre la corruption (art. 2-23 cpp). Sans cet agrément, ou si cet agrément est illégal, l’association ne peut que porter plainte sans constitution de partie civile (sauf si la loi prévoit que l’agrément n’est pas nécessaire).
La seule question à laquelle devait répondre le tribunal administratif portrait sur la légalité de l’agrément. Le décret du 12 mars 2014 (article 1) prévoit cinq conditions. L’une des conditions est “le caractère désintéressé et indépendant de (des) activités (de l’association), apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources”. Le tribunal relève une contradiction dans l’arrêté d’agrément, ce qui constitue une illégalité. Anticor reçoit selon l’arrêté des dons de provenance inconnue, ce qui pose un double problème : en termes de cohérence avec son objet même (la transparence), et surtout car il est possible qu’une association agréée puisse servir de paravent à un organisme tiers intéressé.
Le tribunal administratif a ensuite relevé une autre contradiction dans l’agrément : le Premier ministre relève le manque de transparence interne de l’association (or c’est une condition d’octroi), sans en tirer les conséquences. En raison de ces deux motifs sérieux, le gouvernement aurait dû refuser l’agrément, qui est donc illégal et doit être annulé par le juge.
Enfin, en principe, un acte administratif illégal est annulé “ab initio” et donc regardé comme n’ayant jamais existé, ce qui fait craindre en l’occurrence que les plaintes pour corruption déjà engagées grâce à Anticor soient désormais considérées comme irrecevables, menaçant toutes les enquêtes menées jusqu’à présent. Par exception, le tribunal aurait pu décider que l’annulation n’est pas rétroactive dans le cas “conséquences manifestement excessives”. Mais il n’a pas fait jouer cette exception et l’association Anticor a annoncé qu’elle ferait appel.
En savoir plus ? Cliquer ici.
Richard Ferrand souhaite modifier la Constitution pour permettre un troisième mandat présidentiel
Dans une interview, Richard Ferrand, ancien président de l’Assemblée nationale, a été interrogé sur la possibilité ou non pour Emmanuel Macron de se représenter à l’élection présidentielle de 2027. Il a exprimé son regret du fait que les mandats présidentiels soient limités à deux consécutifs. Or revenir sur cette limite semble bien compliqué.
La Constitution prévoit que “nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs”, une limitation introduite par la réforme constitutionnelle de 2008 mettant fin à la possibilité pour un Président de se présenter indéfiniment à sa succession, tous les cinq ans.
Un doute persiste cependant sur l’interprétation que l’on retient de l’expression « deux mandats consécutifs« . Faut-il comprendre un mandat complet, au sens où le Président doit avoir rempli ses deux mandats jusqu’à la tenue régulière de l’élection présidentielle suivante, pour être considéré comme ne pouvant plus se présenter ? Si c’est le cas, Emmanuel Macron pourrait démissionner avant la fin de son second mandat et se présenter à sa succession, son mandat actuel n’étant pas pris en compte puisqu’il n’a pas atteint son terme de cinq ans.
Une autre interprétation ouvrirait la voie à un troisième mandat non consécutif : Emmanuel Macron ayant été élu puis réélu consécutivement, il ne pourrait pas y prétendre une fois de plus à la suite. Pourrait-il cependant attendre l’élection présidentielle de 2032 ?
La Constitution pourrait être précisée sur ce point, à moins que le Conseil constitutionnel ne soit appelé à fournir son interprétation, si d’aventure Emmanuel Macron essayait de se représenter lors d’une élection anticipée provoquée par sa démission, et qu’un recours était formé contre cette candidature. Le Conseil d’État peut également rendre un avis si le gouvernement le sollicite.
Richard Ferrand semble suivre la première interprétation de la Constitution car il en souhaite la modification pour permettre au président Macron de se présenter une troisième fois consécutive à l’élection. Il est revenu sur ses propos depuis, accusant une mauvaise interprétation. La question est tout de même pertinente. La Constitution peut être réformée par la présentation d’un projet ou d’une proposition de loi constitutionnelle. Cette proposition, déposée par un parlementaire, doit d’abord être adoptée en des termes identiques par les deux chambres du Parlement, puis elle doit être approuvée par référendum. Le président de la République a le choix de soumettre la proposition au référendum, mais s’il ne le fait pas, la proposition n’ira pas plus loin.
La révision de la Constitution peut aussi passer par un projet de loi qui, après adoption par les deux chambres du Parlement, peut être soumis au Parlement réuni en Congrès. Le texte est adopté si la majorité des trois cinquièmes est réunie.
En savoir plus ? Cliquer ici.
Le maire de Grenoble, Éric Piolle, veut supprimer les fêtes religieuses dans le calendrier. Quand le calendrier républicain a remplacé le grégorien
Dans un tweet du 24 mai 2023, Éric Piolle, maire de Grenoble, veut supprimer les références aux fêtes religieuses dans notre calendrier républicain et déclarer fériées les fêtes laïques. Il s’inscrit dans une longue tradition de contestation du calendrier grégorien, notamment en raison de ses liens avec le christianisme et des nombreuses fêtes religieuses. Sa proposition consiste en un projet de réforme du calendrier qu’il qualifie avec ambiguïté de “calendrier républicain”.
C’est sous la Convention que le calendrier traditionnel fut pour la première fois remis en cause. Depuis 1789, l’œuvre de la Révolution pouvait apparaître comme une vaste entreprise de déchristianisation, et il fut tentant de substituer au calendrier rythmé par les fêtes chrétiennes, un calendrier républicain, même si cela n’était pas le seul objectif. Un décret du 5 octobre 1793 mit en usage le nouveau calendrier. Il commençait rétroactivement le 22 septembre 1792, jour de la proclamation de la république et qui se trouvait être également le jour de l’équinoxe d’automne. Ce faisant, l’Assemblée choisit la nomenclature Fabre prévoyant une année de 12 mois de 30 jours, les noms des mois s’accordant aux saisons. L’idée était de remplacer le temps chrétien et de faire émerger un calendrier français, rationnel, et surtout marqué par la nature : conçu par le poète Fabre d’Églantine, ce calendrier, par le nom des mois et des décades, se voulait une véritable ode aux saisons (fructidor, pluviôse, nivôse, frimaire, etc.) et à la paysannerie.
Ce mouvement de déchristianisation finit par indisposer la Convention elle-même en décembre 1793. Robespierre l’avait dénoncé et voulait ressouder dans une même foi et une même morale toutes les catégories sociales. Le décret du 18 floréal an II (7 mai 1794) prévoyait la reconnaissance de l’existence de l’Être suprême et l’immortalité de l’âme par le Peuple français. Surtout, il instituait des fêtes pour “rappeler l’homme à la pensée de la divinité et à la dignité de son être”. Ces fêtes, comprenaient par exemple le 14 juillet 1789 [prise de la Bastille].
Le calendrier républicain a été conservé lors de l’arrivée au pouvoir des opposants à Robespierre. Le Directoire en avait rappelé le caractère obligatoire avec l’entrée en vigueur de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795). Bien qu’ayant proclamé la séparation de l’Église et de l’État et la liberté des cultes par la loi du 3 ventôse an III (12 février 1795), le Directoire oscilla entre une politique d’apaisement et une politique de persécution avec l’Église catholique et il n’hésita pas à promouvoir des pratiques religieuses plus conformes à la république comme le culte de la théophilanthropie.
Enfin, Napoléon Bonaparte, en mettant fin à la période révolutionnaire, mit un terme au calendrier républicain. Il signa le Concordat le 26 messidor an IX (15 juillet 1801) établissant les relations entre la France et le Vatican. Logiquement, le calendrier républicain fut abrogé le 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805), et le calendrier romain (ou grégorien) fut rétabli. Face à ce précédent, on peut reprocher à Éric Piolle un certain manque d’audace. Pourquoi ne pas avoir proposé un véritable retour au calendrier républicain, authentique calendrier écologiste qui exalte les saisons ?
En savoir plus ? Cliquer ici.
Référence : AJU376207