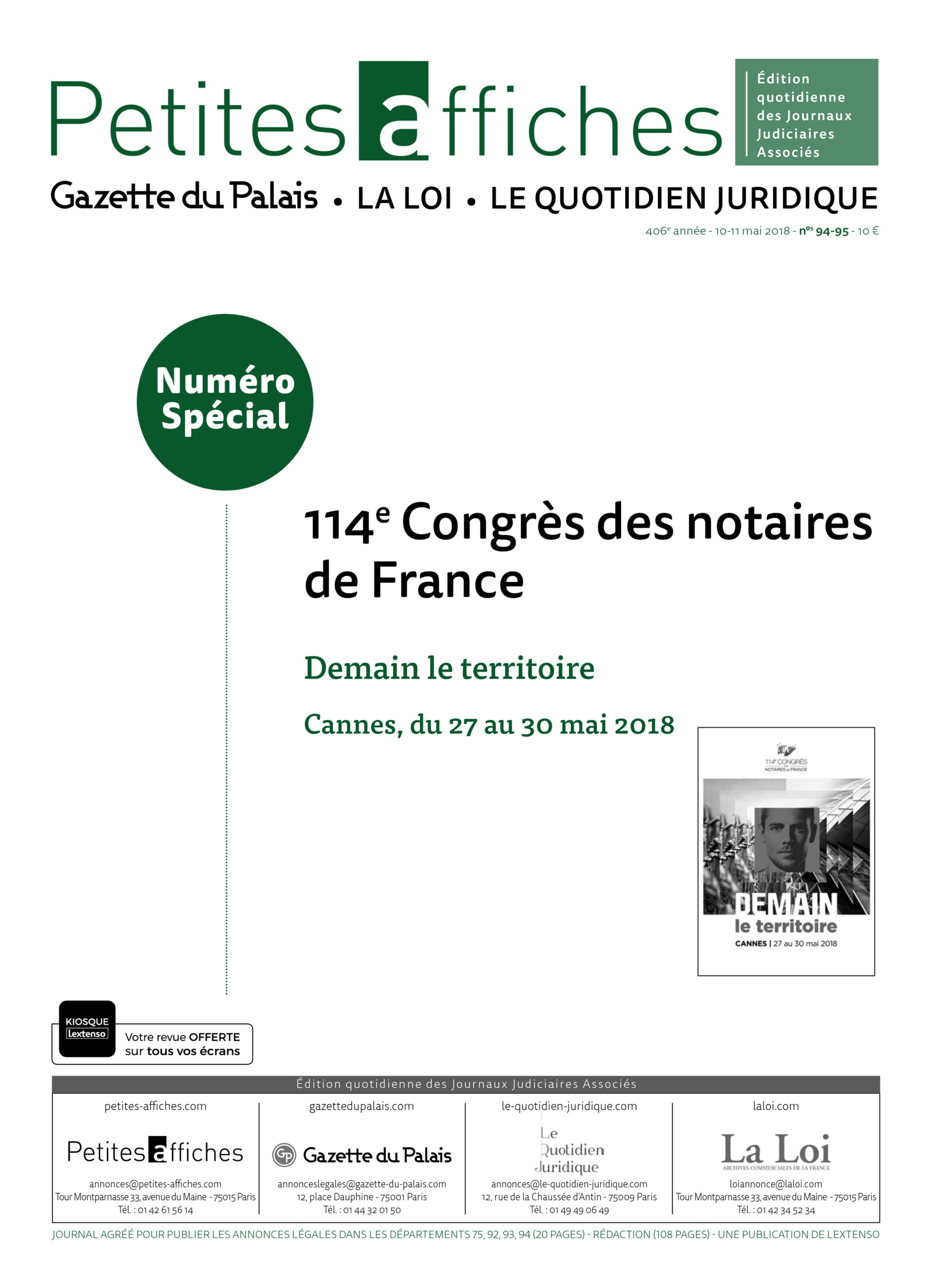« Il y a deux types de villes avec des besoins très dissemblables : les villes denses et compactes et les villes étendues »
À quoi ressemblera la ville du futur ? La question est capitale lorsqu’on sait que 80 % des Français vivent déjà en milieu urbain, soit un peu plus de 53 millions de personnes… Avec son binôme Me Antoine Teitgen, Me Christophe Sardot, président de la 3e commission : « Demain la ville », a essayé de dessiner les contours de cette ville de demain et d’imaginer dès aujourd’hui comment améliorer son partage. Densification, multifonctionnalité, revitalisation des centres-villes… Les défis à relever sont nombreux pour exploiter ce territoire urbain et faire face aux besoins croissants de ses occupants.
Les Petites Affiches
Quels étaient les objectifs de votre commission ?
Christophe Sardot
Dès le début, la première difficulté a résidé dans le titre du sujet de notre commission : il est formidable, car il permet d’aborder de nombreux thèmes, mais dangereux aussi pour la même raison. L’objectif initial a donc été de savoir de quoi nous souhaitions vraiment parler pour éviter de partir tous azimuts. Pour cela nous avons tenté de nous en remettre aux volontés et attentes que portent nos concitoyens sur la ville de demain. Il a fallu dresser un état des lieux des villes telles que nous les connaissons et une liste des nécessités individuelles et des besoins collectifs que nous aurons dans le futur. Nous sommes repartis à la base : la nourriture, le logement, les soins, etc. Avec l’avancement de nos travaux, nous avons réalisé que des besoins qui pouvaient être considérés comme accessoires sont devenus des nécessités absolues. Prenons l’exemple des loisirs : s’ils n’étaient quasiment pas pris en compte il y a cinquante ans, une ville qui ne peut en fournir à ses habitants aujourd’hui va immédiatement souffrir d’un lourd déficit d’attractivité.
Une fois ces objectifs et besoins définis, nous avons constaté avec l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme que les pouvoirs publics partageaient les mêmes visions. Cela nous a permis d’entamer une réflexion sur les moyens nécessaires pour que les villes arrivent à remplir tous ces desiderata. Notre seul regret provient de ce qu’il n’y avait pas assez de 250 pages pour traiter une matière aussi foisonnante. Malgré tout, je pense que nous avons couvert l’ensemble du territoire grâce à notre plan et que nous avons été aussi exhaustifs que cela était possible.
LPA
Comment avez-vous catégorisé les problématiques auxquelles sont confrontés les différents types de villes françaises ?
C. S.
Il est rapidement apparu comme primordial de prendre en compte la diversité des besoins en fonction de la densité et de la géographie des villes. On s’est rendu compte qu’il y a deux types de villes très dissemblables : les villes denses et compactes et les villes étendues. Avec mon binôme, Antoine Teitgen, nous avions la chance d’être complémentaires sur ce point : mon étude est basée à Lyon, une ville si dense que j’essaye toujours de prendre ma voiture le moins possible, alors que mon rapporteur travaille à La Chapelle-sur-Erdre et ne peut envisager une journée de déplacements sans sa voiture. Cette dichotomie était une bonne base de travail et nous a permis de répartir les chapitres sans redondance, comme la plupart des besoins de ces deux types de villes différents. Ensuite, nous avons divisé la partie consacrée aux villes étendues entre les villes à vivre toute l’année et les villes de saison qui sont à proximité de la montagne ou du littoral. Nous avons également consacré un chapitre à l’étalement urbain, un autre à la voiture et aux transports : impossible de parler de la ville sans les aborder. Enfin, en ce qui concerne la ruralité, nous avons constaté que la désertification continue et que les commerces et lieux de convivialité diminuent toujours plus.
LPA
Ces problématiques ont-elles connu des évolutions majeures avec le temps ?
C. S.
Oui, et pour le vérifier il suffit de voir les trois grandes parties que nous avons choisies pour organiser le chapitre consacré aux villes compactes : densifier la ville, la partager et la rendre vertueuse. Ces trois points sont tous des sujets que l’on ne retrouvait pas il y a deux ou trois décennies. La ville s’étalait alors sans que cela pose trop de questions et rendre les immeubles vertueux ne semblait pas un objectif particulièrement urgent. Évidemment, les problèmes de transport n’étaient pas ce qu’ils sont à l’échelle actuelle ; et en termes de partage on ne voyait pas beaucoup d’intérêt à la multifonctionnalité des quartiers et des immeubles ou à des concepts tels que le coworking et le coliving. L’ensemble des sujets que l’on traite sont donc plutôt contemporains. On peut aussi citer comme « thèmes modernes » la volonté de végétalisation de l’espace urbain, les villes intelligentes ou encore l’agriculture urbaine.
LPA
Qu’en est-il des villes moyennes ?
C. S.
C’est probablement celles pour lesquelles les solutions sont le plus difficile à trouver. Une vraie différence se crée, que cela soit sur le plan économique ou social et qui risque de n’aller qu’en s’amplifiant. Je peux citer l’exemple de la ville de Béziers, qui est particulièrement significatif. On s’aperçoit que la ville est trop loin de la grande ville la plus proche (Montpellier) pour avoir les avantages directs d’être dans sa banlieue périphérique, mais trop près pour en éviter tous les inconvénients. Les étudiants biterrois et les entrepreneurs quittent la ville pour Montpellier et l’on a une vacance commerciale en centre ville qui est passée à 25 % avec des logements de mauvaise qualité, des habitants paupérisés et des classes d’âge plutôt élevés. C’est un cercle vicieux pour la ville qui a du mal à voir une amélioration de sa situation se profiler à l’horizon. Cette situation pourrait se répéter dans de nombreuses villes moyennes françaises.
LPA
La verticalité est une des pistes fortes développées dans vos travaux, pourquoi cette solution peut faire sens dans la ville de demain ?
C. S.
Nous partons d’un constat simple : nous sommes de plus en plus nombreux. L’espérance de vie et la démographie augmentent, et les nouvelles situations familiales (divorce avec garde partagée et donc nécessité d’avoir une chambre chez chaque parent par exemple) font augmenter la demande d’espace. Pour répondre à ce besoin, nous ne voyons que deux possibilités. La première est de s’étendre sur les côtés, mais le souci est que l’on va empiéter sur les terrains agricoles et donc toucher à l’une des nécessités définies auparavant, celle de se nourrir. Comme s’enterrer ne nous semble pas une option viable dans un futur proche, l’autre possibilité est de s’étendre vers le haut et d’opérer une densification de l’espace urbain.
Là aussi cependant, il y a des difficultés à surmonter, notamment en termes de règles de copropriété qui n’ont clairement pas été pensées pour le multi-usage. Dans l’idéal, nous souhaiterions avoir des immeubles qui rassemblent commerces, crèches, bureaux et habitations, ce qui réduirait très fortement les besoins en transports et l’usage de la voiture. Réaliser cela en copropriété est très compliqué, sinon impossible, et toucher à ces règles est un sujet qui reste sensible. La question des volumes n’a été évoquée que dans une seule loi, la loi Alur, et c’était pour la traiter de manière restrictive. Au final, nous voyons tous où il faudrait aller, mais les moyens juridiques d’y accéder restent pour l’instant compliqués à mettre en œuvre.
LPA
Vous évoquez aussi le bail réel solidaire, comment cela fonctionne-t-il ?
C. S.
Le bail réel solidaire (BRS) est un produit pensé différemment des autres. On ne compte plus les lois qui ont voté des dispositifs qui ne sont jamais appliqués dans la vie réelle ou ont un usage marginal. La différence avec le BRS est qu’il est fondé sur une nouvelle logique : le droit réel au lieu du droit personnel. Jusqu’à maintenant, les aides données par les collectivités l’étaient pour qu’une personne avec des difficultés puisse acquérir un bien et devenir propriétaire. Mais une fois l’avantage acquis, le propriétaire revendait son bien avec une forte plus-value et montait dans l’échelle sociale. C’est très bien pour le couple qui a pu être « sorti de la pauvreté », mais c’est une aide qui ne fonctionne qu’une seule fois, pour une seule famille, et demande un investissement lourd de la part de la collectivité. Pour éviter cet écueil, le BRS s’attache au bien et non pas à la personne. L’aide qui permet d’avoir un logement à prix réduit s’applique évidemment au primo-acquérant, mais aussi aux futurs repreneurs, qui repartent sur un bail pouvant aller jusqu’à 99 ans, et ayant surtout la faculté de se régénérer à chaque changement de titulaire. En rechargeant successivement le bail, on peut aider un plus grand nombre de familles. L’aide est sans doute plus faible, et la montée à l’échelle sociale de chacun de ceux qui en profiteront plus réduite, mais ce défaut est compensé par le renouvellement. Et l’on évite de démultiplier les dépenses de la collectivité. De plus, ce dispositif répond à un objectif de mixité sociale, un élément essentiel du partage de la ville. Nous n’en sommes qu’aux prémices, mais cela pourrait, nous semble-t-il, être un outil d’avenir.
LPA
Comment avez-vous abordé la ville sous l’angle environnemental ?
C. S.
L’angle environnemental est abordé de manière disséminé dans notre rapport. Nous avons parlé directement de la pollution dans les paragraphes consacrés à la densification et à la construction en expliquant où l’on pouvait construire et pourquoi. On en parle de manière plus indirectement dans les chapitres sur la ville intelligente qui doit être vertueuse, économe en énergie, ou sur la végétalisation urbaine, qui absorbe une partie de cette pollution. Beaucoup de choses se font, mais il est vrai que les infrastructures vertueuses demandent des investissements et c’est le plus souvent les villes riches qui peuvent se permettre d’installer des capteurs pour que l’éclairage urbain soit adapté au passage en temps réel ou que les feux de circulation favorisent la circulation dans les heures de faible trafic.
L’environnement est aussi évoqué dans notre chapitre sur la voiture, où nous soulignons l’importance de réduire la circulation. Sur ce point, je tiens d’ailleurs à souligner notre scepticisme face à l’impact supposé des futures voitures autonomes. Beaucoup les vendent comme un outil qui nous permettra de moins rouler, de faire du covoiturage, etc. C’est la vision optimiste, mais on peut aussi se dire que lorsqu’on refuse de prendre sa voiture aujourd’hui, c’est pour éviter de perdre du temps dans les bouchons. Le jour où il sera possible de faire autre chose dans sa voiture (que cela soit travailler ou se détendre), il n’y aura aucune raison de ne plus la prendre. Et il y a peu de chance que cela motive le covoiturage.