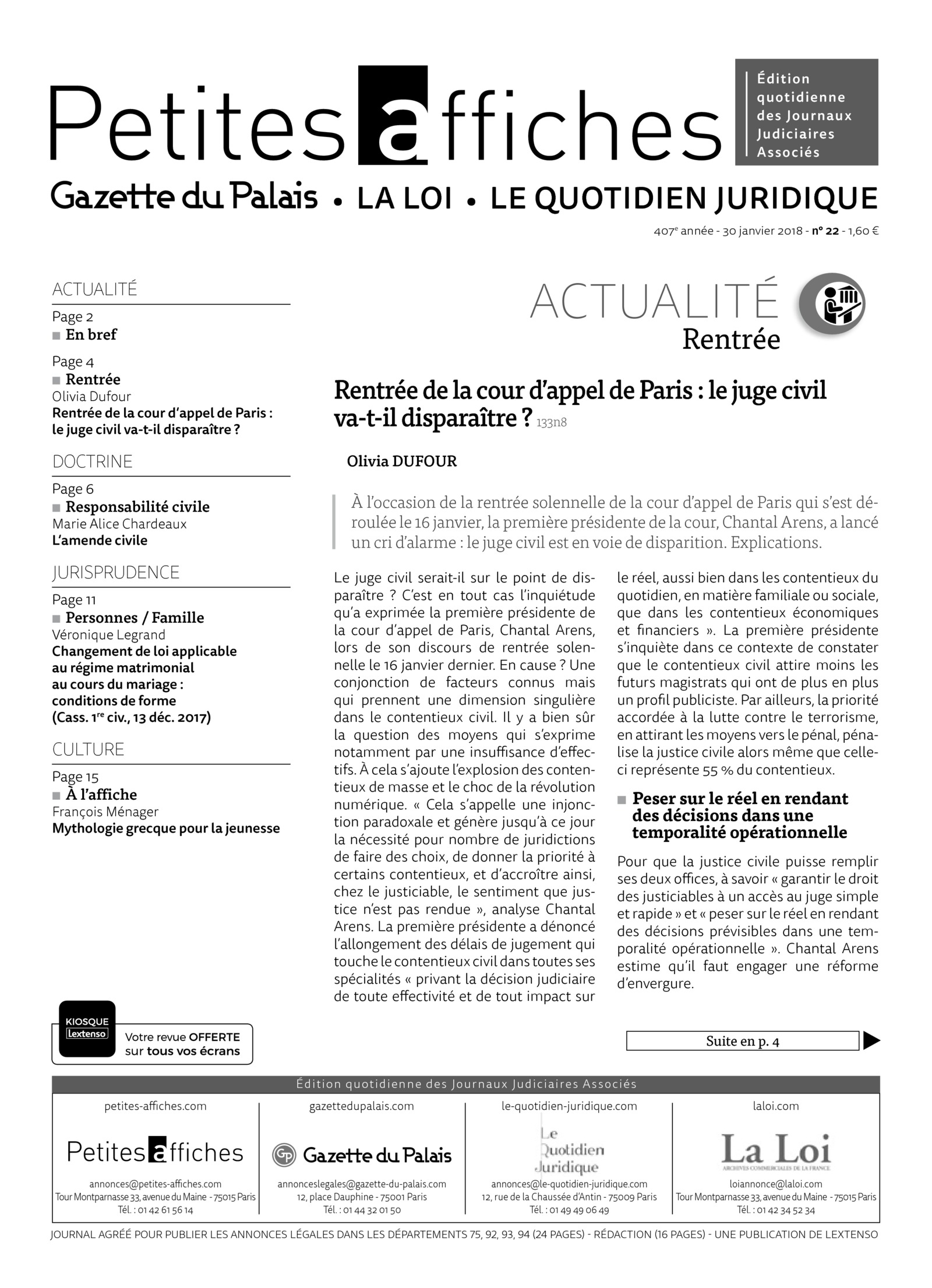Rentrée de la cour d’appel de Paris : le juge civil va-t-il disparaître ?
À l’occasion de la rentrée solennelle de la cour d’appel de Paris qui s’est déroulée le 16 janvier, la première présidente de la cour, Chantal Arens, a lancé un cri d’alarme : le juge civil est en voie de disparition. Explications.
Le juge civil serait-il sur le point de disparaître ? C’est en tout cas l’inquiétude qu’a exprimée la première présidente de la cour d’appel de Paris, Chantal Arens, lors de son discours de rentrée solennelle le 16 janvier dernier. En cause ? Une conjonction de facteurs connus mais qui prennent une dimension singulière dans le contentieux civil. Il y a bien sûr la question des moyens qui s’exprime notamment par une insuffisance d’effectifs. À cela s’ajoute l’explosion des contentieux de masse et le choc de la révolution numérique. « Cela s’appelle une injonction paradoxale et génère jusqu’à ce jour la nécessité pour nombre de juridictions de faire des choix, de donner la priorité à certains contentieux, et d’accroître ainsi, chez le justiciable, le sentiment que justice n’est pas rendue », analyse Chantal Arens. La première présidente a dénoncé l’allongement des délais de jugement qui touche le contentieux civil dans toutes ses spécialités « privant la décision judiciaire de toute effectivité et de tout impact sur le réel, aussi bien dans les contentieux du quotidien, en matière familiale ou sociale, que dans les contentieux économiques et financiers ». La première présidente s’inquiète dans ce contexte de constater que le contentieux civil attire moins les futurs magistrats qui ont de plus en plus un profil publiciste. Par ailleurs, la priorité accordée à la lutte contre le terrorisme, en attirant les moyens vers le pénal, pénalise la justice civile alors même que celle-ci représente 55 % du contentieux.
Peser sur le réel en rendant des décisions dans une temporalité opérationnelle
Pour que la justice civile puisse remplir ses deux offices, à savoir « garantir le droit des justiciables à un accès au juge simple et rapide » et « peser sur le réel en rendant des décisions prévisibles dans une temporalité opérationnelle ». Chantal Arens estime qu’il faut engager une réforme d’envergure. Elle la décrit ainsi : « une justice de proximité pour tous les contentieux familiaux et du quotidien, une justice spécialisée pour les contentieux d’une certaine complexité et une justice hyper spécialisée pour les contentieux les plus complexes en visant l’excellence avec une identification très en amont des affaires qui posent une question de principe, nouvelle ou aux implications économiques, sociales ou sociétales fortes ». Il faut aussi des magistrats d’excellence et des auxiliaires de justice performants, explique-t-elle. C’est une condition du rayonnement du système judiciaire français. Chantal Arens plaide en faveur d’une spécialisation des juridictions : « pour viser l’excellence en matière civile, un regroupement des ressources humaines s’impose dans des chambres spécialisées à compétence régionale ou nationale comme cela existe déjà dans plusieurs contentieux au tribunal de grande instance et à la cour d’appel de Paris ». Une réflexion qui n’est pas étrangère au projet de création de chambres du contentieux international à la cour d’appel de Paris. Cette décision, annoncée par le gouvernement au début de l’été, sera effective au mois de mars. L’idée est issue d’un rapport publié en janvier 2017 par le Haut comité juridique de la place de Paris présidé par Guy Canivet. Elle consiste à tirer avantage du Brexit pour tenter de récupérer une partie des 10 000 affaires financières internationales actuellement jugées à Londres chaque année. L’an dernier en effet le Haut comité a attiré l’attention sur le fait qu’après le Brexit les jugements londoniens seront soumis à exequatur au sein de l’Union ce qui les pénalisera considérablement dans un domaine : la finance, où la rapidité est particulièrement recherchée par les plaideurs. En pratique, il existe déjà des chambres internationales au tribunal de commerce de Paris. Il faut en revanche créer des chambres du même type à la cour d’appel de Paris et organiser la procédure de telle sorte que des plaideurs anglo-saxons ne soient pas trop dépaysés. Un groupe de travail a étudié ces questions à la Chancellerie à la fin de l’année dernière et c’est ce dispositif – chambres à la cour d’appel et procédure adaptée – qui sera opérationnel en mars.
« Éviter qu’une défense de rupture se transforme en stratégie d’obstruction du cours de la justice »
La procureur générale, Catherine Champrenault, a évoqué, quant à elle, les propositions faites par la cour d’appel dans le cadre de la réforme de la justice en vue d’instituer « une procédure d’appel revisitée à l’aune de l’efficacité juridique et répressive, tout en conservant un équilibre qui préserve les droits de la défense ». Elle a cité à titre d’exemples : l’indication obligatoire dans l’acte d’appel de l’objet du recours, l’instauration d’un circuit court permettant un audiencement dans les six mois des appels limités au quantum, l’audiencement devant un conseiller unique des contentieux qui relèvent en première instance du juge unique, ou encore la dépénalisation des contentieux qui n’intéressent pas l’ordre public, notamment les affaires de diffamation et d’injures. « Avec ces pistes nouvelles lancées par notre cour, à la suite de celles propres à la Direction des affaires criminelles et des grâces, nous pourrions accélérer le cours de la justice dont nous sommes redevables au titre du délai raisonnable, sans que la qualité de la réponse judiciaire n’en soit altérée », a-t-elle souligné.
Catherine Champrenault a également évoqué les nouveaux services mis en place l’an passé. Ainsi, en septembre 2017, le parquet général a créé un service dédié à la lutte contre la cybercriminalité. Il a déjà élaboré une plate-forme de textes de référence et de jurisprudence mis en ligne sur le site de la cour d’appel. Le parquet général de Paris a également engagé en matière de terrorisme un travail sur le degré de dangerosité des profils afin de mieux juger et de mieux appréhender le suivi post-sentenciel ; il a aussi institué une commission de vigilance sur l’état de la menace en détention, qui réunit périodiquement le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, le chef du bureau central du renseignement pénitentiaire, la direction de la sécurité pénitentiaire et le parquet de Paris. La procureure a indiqué que 20 dossiers de terrorisme seraient audiencés en 2018 devant la cour d’assises spécialement composée, c’est-à-dire entièrement composée de magistrats dont, a-t-elle souligné « le professionnalisme est d’autant plus nécessaire qu’on constate que ce contentieux fait désormais l’objet d’une défense acharnée voire agressive à l’image de celle que l’on connaissait déjà en matière de criminalité organisée ». Un reproche à peine voilé aux avocats qui a été suivi d’une véritable charge contre la défense pénale en général, ou à tout le moins une certaine forme de défense.
L’origine de cette colère du parquet ? À l’évidence, bien que la procureure ne le nomme à aucun moment, il s’agit de la défense d’Éric Dupond-Moretti dans le dossier Gorges Tron. Le procès, qui s’est déroulé au mois de décembre devant les assises de Paris, a donné lieu à une série d’incidents qui ont débouché sur le renvoi de l’affaire. « Il nous incombe, en effet, d’éviter qu’une défense de rupture se transforme en stratégie d’obstruction du cours de la justice, pénalisant par là même le justiciable. Parasiter l’audience de la cour d’assises par des incidents multiples qui amènent à un renvoi de l’affaire à une session ultérieure est contraire à l’essence même du débat judiciaire qui se nourrit de la confrontation pacifique des analyses et des convictions », a expliqué Catherine Champrenault. Et d’ajouter : « Le magistrat ne doit pas tolérer que les débats de l’audience se transforment en spectacle et se doit d’assurer la règle élémentaire du respect entre les parties ». Elle a annoncé qu’elle saisirait systématiquement le bâtonnier « de tout fait susceptible de constituer un manquement au principe de dignité entravant le bon déroulement des audiences pénales ». Les avocats présents dans la salle ont assez peu goûté ce qu’ils ont perçu comme une attaque générale contre la défense doublée d’une leçon sur la manière d’exercer leur métier. Peu de personnes ont relevé que dans des termes plus châtiés la première présidente Chantal Arens avait également quelques instants plus tôt dans son discours dénoncé des comportements qui visaient clairement les avocats : « Si l’objet du litige est la chose des parties, les exigences de la procédure doivent être au service d’une justice diligente et non l’occasion d’incidents parfois dilatoires au préjudice des plus faibles. La vérité doit s’imposer dans le procès civil sans être altérée par une production de pièces insuffisante. Les délais doivent être respectés sous peine de sanctions suffisamment dissuasives, tout comme les comportements dilatoires doivent être sanctionnés. Le principe de loyauté doit s’imposer au cœur du procès civil, trouvant notamment sa traduction dans la production de toutes les pièces nécessaires aux seuil du litige ».