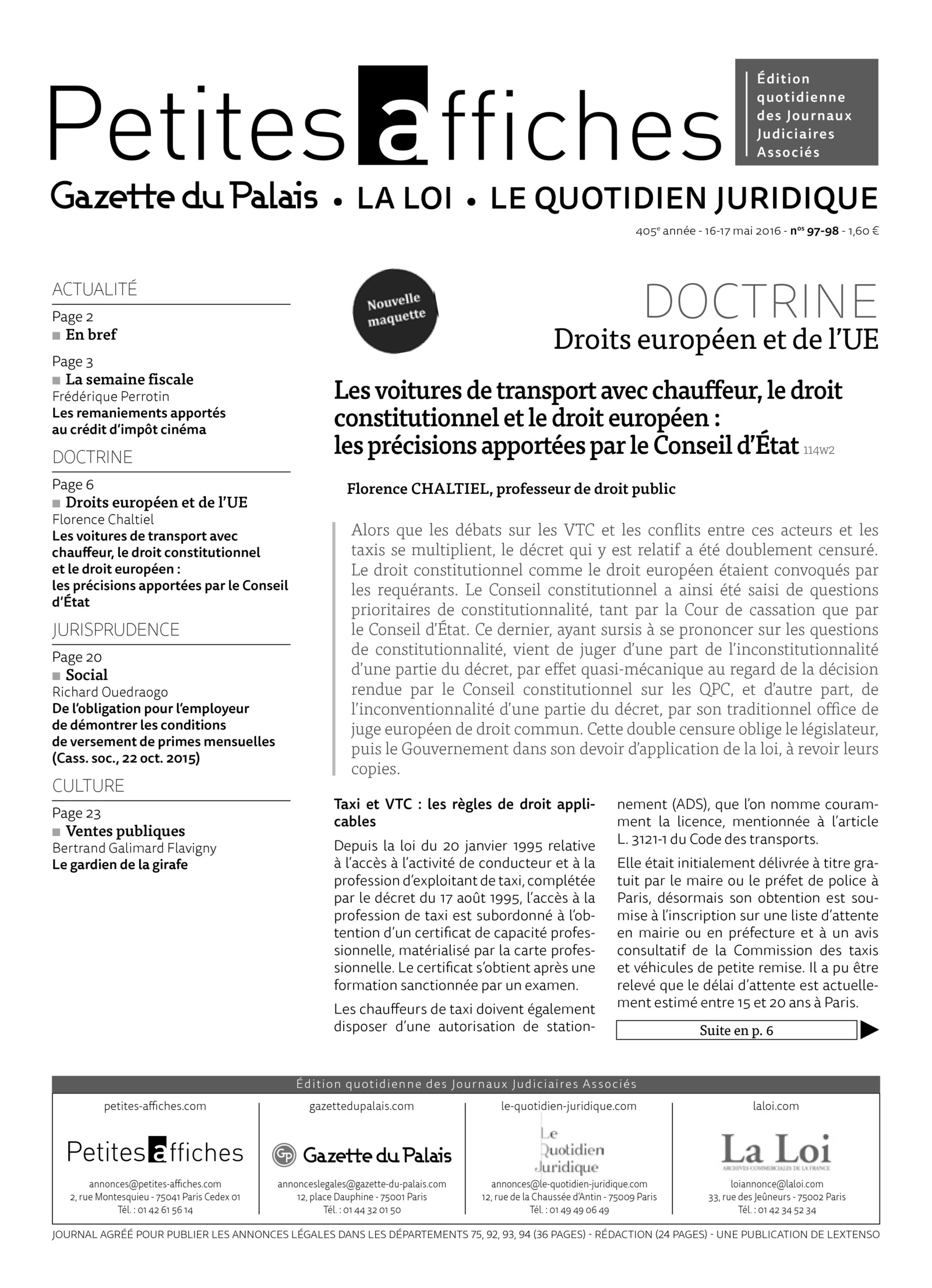De l’obligation pour l’employeur de démontrer les conditions de versement de primes mensuelles
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Cass. soc., 22 oct. 2015, no 14-21489, D
La question de la détermination de la prime à laquelle a droit le salarié suscite, depuis bien longtemps, un contentieux relativement dense. L’on sait par exemple que la Cour de cassation considère que, lorsqu’elle est instituée par un engagement unilatéral de l’employeur, une prime a toujours la qualité d’un salaire même si elle présente un caractère variable1. En revanche, la problématique de la charge de la preuve, en ce qui concerne précisément l’existence d’une obligation de versement d’une prime, n’avait jamais été abordée de manière très nette par la juridiction suprême. C’est désormais chose faite depuis cet arrêt inédit du 22 octobre 2015 qui s’inscrit, en quelque sorte, dans le « mouvement plus général de limitation de la potestativité et d’essor d’exigences d’objectivité dans le contrat de travail »2.
En l’espèce, une entreprise de sécurité contestait la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail d’une salariée ainsi que sa condamnation à payer à cette dernière différentes indemnités liées à la rupture dudit contrat. La salariée demandait en outre le paiement de primes mensuelles qui auraient dû lui être versées depuis son engagement dans la société, en 2003. Les juges du fond ont évalué à 2 250 euros le montant de ces sommes impayées. Se posait donc la question de savoir si cette prime revêt un caractère obligatoire pour l’employeur alors même qu’elle n’avait nullement été prévue dans le contrat initial de la salariée.
Sans réelle surprise, la Cour de cassation a abondé dans le sens de l’arrêt d’appel, lequel a, par une juste application de la règle Actori incumbit probatio (II), retenu l’obligation pour l’employeur de verser les primes à la salariée (I).
I – De l’obligation de verser une prime à la salariée…
De par la nature des tâches exercées par la salariée au sein de l’entreprise – rappelons qu’elle était agent d’exploitation –, on aurait pu discuter, devant les juges du fond, le bien-fondé de son droit à une prime « exceptionnelle ». En effet, on aurait pu donner tout de suite raison à l’employeur, et considérer que seuls ses collègues travaillant de nuit peuvent prétendre légitimement aux primes liées non seulement au risque du métier de la sécurité, mais aussi au critère de la pénibilité de l’emploi. Mais là n’était pas véritablement le nœud du problème.
Il faut reconnaître, d’emblée, que l’argumentaire de l’employeur manquait à la fois de clarté et de cohérence. Et pour cause…
Il aurait peut-être été judicieux, de sa part – même si cela n’aurait sans doute pas changé l’issue du litige – d’aborder la question des primes sous l’angle des avantages individuels des salariés de l’entreprise3. Cela lui aurait au moins permis de démontrer que les primes en question sont versées à une catégorie bien définie de travailleurs (de nuit), à laquelle n’appartient pas la salariée en question.
Néanmoins, ici, il est évident que la chambre sociale cherche juste à rappeler un principe simple : entre deux salariés occupant des fonctions similaires ou équivalentes, la différence de rémunération ne peut être fondée que sur des justifications objectives dont il appartient aux juges du fond de contrôler la réalité et la pertinence4. Ainsi, l’employeur ne peut écarter arbitrairement la salariée du bénéfice des primes mensuelles, sinon à assumer une intention discriminatoire. Et le choix de ne pas octroyer ces primes aux salariés travaillant de jour doit s’appuyer sur des conditions clairement définies et inscrites dans les dispositions de la convention collective. Or ce n’est visiblement pas le cas ici puisque l’employeur peine à justifier l’éviction de la salariée des bénéficiaires desdites primes mensuelles.
D’ailleurs, le rejet du pourvoi aurait très bien pu également s’appuyer sur l’exigence de bonne foi contractuelle contenue à l’article 1134 du Code civil5. En effet, l’indétermination initiale des primes desquelles la salariée a injustement été privée peut tout autant s’analyser en une absence de bonne foi de la part de l’employeur. Si les juges n’ont pas estimé utile d’abonder en ce sens, c’est sans doute parce que l’employeur reconnaissait lui-même le versement à certains salariés d’une prime dite de « poste ». Dès lors, il lui revenait d’apporter la preuve que l’obligation de verser à la salariée cette prime « exceptionnelle » ne reposait sur aucune clause contraignante.
II – … à celle de prouver son caractère non-contraignant
L’autre enseignement que l’on peut tirer de cet arrêt est son souci d’une juste lecture de l’article 1315 du Code civil relatif à la preuve des obligations. Tentant une lecture littérale de la règle selon laquelle c’est sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation que pèse la charge de la preuve, le pourvoi se fonde sur l’incapacité de la salariée à démontrer les conditions dans lesquelles la prime de poste avait été octroyée à seulement certains salariés de l’entreprise. C’est oublier qu’en matière de preuve, la jurisprudence en droit du travail repose essentiellement sur un principe fondamental d’équité.
Par exemple, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou lui demander d’ordonner la production des éléments de preuve qu’il soutient être détenus par une autre partie, sauf au juge à tirer toute conséquence de droit de l’abstention ou du refus de cette dernière de s’y soumettre6. Et dans le même temps, la chambre criminelle a récemment jugé qu’il est possible d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié qui se prétend victime d’une discrimination les éléments d’information concernant d’autres salariés, contrats de travail et bulletins de paie, susceptibles d’établir cette discrimination7.
On voit manifestement que, en matière de preuve, la jurisprudence a conscience du déséquilibre dans le rapport de force entre salarié et employeur ; ce dernier, très souvent, détient des documents auxquels n’a pas accès le salarié, et qui peuvent pourtant servir de pièces nécessaires à la détermination des obligations de chaque partie. Lorsque l’engagement contractuel du salarié ne précise pas – comme dans le cas d’espèce – les modalités de versement d’une prime, il peut apparaître délicat pour celui-ci de prouver le bénéfice d’un avantage auquel il prétend avoir droit.
C’est pour remédier à ce « déséquilibre contractuel » que la cour estime qu’une lecture littérale de l’article 1315 du Code civil n’est guère satisfaisante. D’ailleurs, lorsqu’un salarié fait l’objet d’une mesure disciplinaire, on voit mal comment il pourrait obtenir de ses collègues des documents (bulletins de paie) pouvant prouver, devant le juge, une situation discriminatoire dont il se plaint.
Confirmant par conséquent une position cohérente qu’elle avait dégagée auparavant8, la Cour de cassation rappelle ici que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire. Et il ne pourrait opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération9.
On ne peut qu’approuver une telle lecture de l’article 1315 du Code civil. S’il revient naturellement au salarié d’apporter la preuve de l’inexécution par l’employeur d’une obligation contractuelle, il ne saurait en revanche être tenu d’apporter des éléments de preuve que seul l’employeur peut en principe détenir.
En l’occurrence, ce dernier est le seul à même de démontrer les conditions objectives d’octroi des primes particulières aux salariés. Son incapacité à livrer une telle démonstration est une faute contractuelle, et prouve en réalité que l’obligation de verser les primes à la salariée revêt bel et bien à l’origine un caractère contraignant.
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. soc., 5 juin 1996 : Bull. civ. V, n° 225 ; Dr. soc. 1996, p. 573.
-
2.
J. Pélissier, A. Lyon-Caen, A. Jeammaud et E. Dockès, Les grands arrêts du droit du travail, Dalloz, 2008, 4e éd., p. 287.
-
3.
V., par ex., Cass. soc., 1er juill. 2008, n° 07-40799, où la Cour jugea que, bien que résultant d’un accord collectif dénoncé, la structure de la rémunération constitue un avantage individuel acquis qui doit être incorporé au contrat individuel des salariés employés par l’entreprise à la date de la dénonciation.
-
4.
F. Favennec-Héry et P.-Y. Verkindt, Droit du travail, LGDJ, 2014, 4e éd., n° 855.
-
5.
V. Cass. soc., 22 mai 1995 : Bull. civ. V, n° 161, où, au visa justement de l’article 1134 du Code civil, la Cour avait tranché que si le montant d’une rémunération variable doit normalement résulter d’un accord annuel des parties, il incombe au juge, à défaut d’un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction de critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.
-
6.
Cass. soc., 12 juin 2013 : Bull. civ. V, n° 156 ; D. 2013, p. 1555.
-
7.
Cass. crim., 19 déc. 2012 : Bull. civ. V, n° 341 ; D. 2013, p. 92.
-
8.
Cass. soc., 13 janv. 2004 : Bull. civ. V, n° 1 ; Dr. soc. 2004, p. 307, obs. C. Radé – Cass. soc., 28 sept. 2004 : Bull. civ. V, n° 228 ; Dr. soc. 2004, p. 1144, obs. C. Radé – Cass. soc., 25 mai : Bull. civ. V, n° 178.
-
9.
Cass. soc., 30 avr. 2009, Bull. civ. V, n° 121.