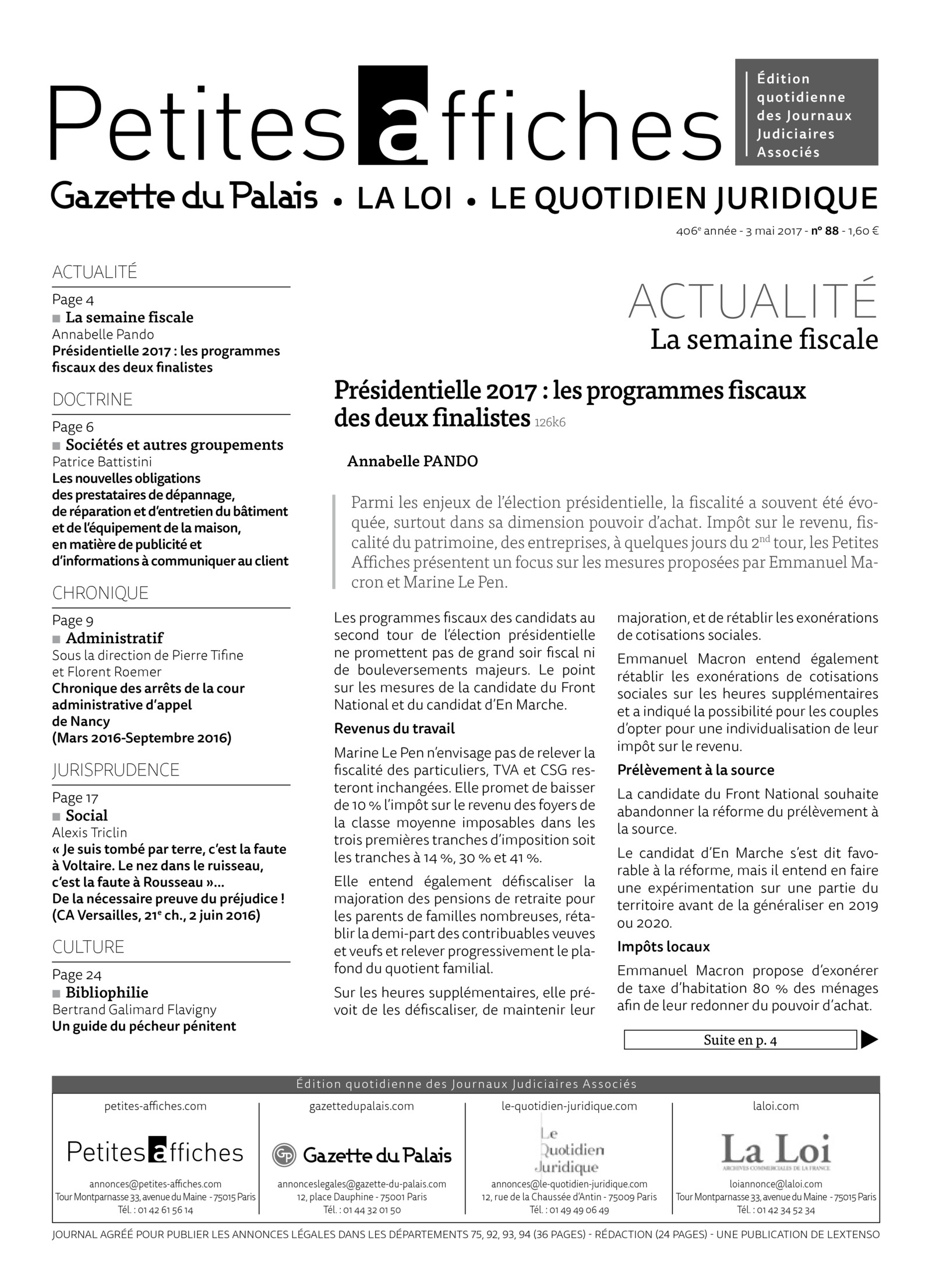« Je suis tombé par terre, c’est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c’est la faute à Rousseau »… De la nécessaire preuve du préjudice !
Il ne suffit pas d’invoquer un préjudice, encore faut-il en rapporter la preuve. Tel est le principal apport de cette décision de la cour d’appel de Versailles :
« Pour rejeter la demande ainsi que les demandes subséquentes, relatives au préavis et à l’indemnité de licenciement, la Cour retient que le salarié qui sollicite la requalification de son départ à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne produit aucun élément probant démontrant qu’à défaut, il aurait poursuivi son activité professionnelle ».
CA Versailles, 21e ch., 2 juin 2016, no 15/00992, Lucien X c/ SAS TF CHIMIE
Le présent arrêt rendu le 2 juin 2016 par la 21e chambre de la cour d’appel de Versailles mérite l’attention pour au moins deux raisons. Les faits étaient assez classiques.
Un salarié avait été licencié et une fois parti en retraite, il saisit alors le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la réparation de divers préjudices qu’il estimait avoir subis au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Il sollicitait notamment le paiement d’une indemnité au motif que son employeur ne lui aurait permis d’accéder à une formation que d’une manière très limitée : 2 jours de formation en 15 ans, ce qui est fort peu. À l’appui de cette demande, peut-être un peu opportuniste, le salarié soutenait qu’il ne savait pas lire et qu’il écrivait avec beaucoup de difficultés.
La cour rappelle que la violation de l’obligation de l’employeur de veiller à l’employabilité du salarié, suppose que celui-ci invoque un préjudice subi du fait de ce manquement.
Elle considère que l’illettrisme invoqué par l’appelant ne trouve pas sa cause dans le non-respect de cette obligation de l’employeur dès lors que le salarié ne soutient pas avoir été empêché d’occuper un autre emploi que celui qu’il a tenu jusqu’à son départ à la retraite.
La nécessaire preuve du préjudice.
La cour d’appel de Versailles fait ici, à notre connaissance, l’une des premières applications de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation quant à la preuve du préjudice. On sait en effet que la haute juridiction, par un arrêt du 13 avril 2016, vient de faire évoluer la notion du préjudice du salarié dit « préjudice nécessaire »1.
Par un attendu aussi bref que lapidaire, la Cour de cassation indique en effet que désormais : « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain de l’appréciation des juges du fond » et que « le conseil de prud’hommes qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ».
C’est ce qu’ont exactement décidé les juges versaillais, en estimant que le salarié qui sollicitait la requalification de son départ à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne produisait aucun élément probant démontrant qu’à défaut, il aurait poursuivi son activité professionnelle.
Cette évolution de la haute cour, rapidement relayée par la cour d’appel de Versailles, marque un retour, en matière sociale, aux règles de droit commun de la responsabilité civile, et notamment à la nécessité de démontrer la réalité du préjudice allégué.
Jusqu’à présent, seule la chambre sociale de la Cour de cassation, admettait l’existence d’un préjudice automatique, ne nécessitant pas une démonstration de son existence par celui qui l’invoque.
Toutes les autres chambres et notamment les chambres mixtes en matière de responsabilité civile, exigeaient que cette démonstration soit apportée et le vérifiaient auprès des juridictions du fond.
Cet arrêt marque la volonté de la Cour de cassation de se rapprocher du droit commun de la responsabilité tout en permettant l’unification de la jurisprudence des différentes chambres de la Cour de cassation.
Il appartient à présent aux juridictions du fond de vérifier que le salarié rapporte la preuve de l’existence de son préjudice. Cette inflexion de la position de la Cour de cassation a donc été très rapidement appliquée par la cour d’appel.
Par cet arrêt, la cour d’appel de Versailles invite aussi implicitement les conseils de prud’hommes à une certaine rigueur dans l’appréciation souveraine du préjudice. Cette décision doit aussi être replacée dans le contexte voulu par le législateur avec la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron2 : renforcement du niveau de connaissances juridiques des conseillers prud’homaux, rôle accru de la procédure et respect des délais notamment.
Une obligation d’adaptation du salarié réaffirmée.
Une lecture un peu rapide de cette intéressante décision pourrait conduire certains employeurs à se sentir déliés de toute obligation quant aux nécessaires actions à déployer pour encourager l’usage de la langue française et à lutter contre l’illettrisme. Ils auraient tort de le penser et de relâcher leurs efforts.
Cette décision confirme le maintien des obligations de l’employeur.
En effet, l’arrêt ne remet pas en cause la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation en ce qui concerne les obligations de l’employeur en matière de formation et d’adaptation.
On sait en effet que, dès 1992, la haute juridiction a dégagé une obligation d’adaptation. L’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi3.
Le législateur a introduit ce principe dans le Code du travail avec la loi du 19 janvier 2002 de modernisation sociale4.
Selon l’article L. 6321-1 du Code du travail, modifié à plusieurs reprises (notamment par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016), « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ».
La Cour de cassation a eu, à maintes reprises, l’occasion d’appliquer ces dispositions.
Ainsi dans un arrêt de 2007, où deux salariées présentes dans l’entreprise depuis respectivement 24 et 12 ans n’avaient bénéficié que d’un stage de formation continue de trois jours durant cette période5.
À cet égard, même en l’absence de toute procédure de rupture du contrat de travail, le manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation engage sa responsabilité. Il entraîne en effet pour le salarié un préjudice, distinct, le cas échéant, du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail6.
Sur la base de cette disposition et face à des affaires concernant souvent des salariés peu qualifiés, la jurisprudence impose d’ailleurs à l’employeur une véritable obligation de gestion de l’employabilité de leurs salariés, distincte de l’obligation d’adaptation au poste de travail7.
Dans un arrêt du 28 septembre 20118, la Cour de cassation rappelle même l’obligation assignée à l’employeur de veiller au maintien des capacités des salariés à occuper un emploi. Il s’agissait dans cette hypothèse, non pas de former les salariés en fonction de leurs besoins au regard de leur activité personnelle (employabilité interne, c’est-à-dire adaptation au poste), mais bien de former ces salariés même lorsque le poste de travail ne l’exige pas (employabilité externe, c’est-à-dire capacité à occuper un emploi).
Dans une autre espèce, des salariés, employés en qualité de « plongeurs » de restaurant par un hôtel, n’avaient suivi aucune formation pendant les 10 à 20 ans passés dans l’entreprise. Pour l’employeur, ces salariés, à qui aucun reproche n’avait été formulé dans le cadre de leur emploi et qui n’ont pas été licenciés, n’avaient subi aucun préjudice. Il considérait même qu’il ne lui revenait pas de donner à ces salariés qui maîtrisaient mal le français, la formation initiale qui leur faisait défaut. Cependant, en maintenant des salariés dans un emploi à faible contenu et non évolutif pendant une longue période, l’entreprise avait contribué à les déqualifier et n’avait pas compensé cette situation par la formation. Il en était résulté un préjudice que l’employeur devait indemniser9.
L’employeur, pour se dédouaner, invoque parfois le fait que l’intéressé n’a pas demandé à bénéficier d’une formation ou qu’aucune formation n’est nécessaire pour qu’il continue à occuper son poste de travail. La cour d’appel de Versailles reprend en tout point la position de la Cour de cassation et réfute cet argumentaire.
Ainsi, lorsque l’emploi occupé consiste en des tâches simples, répétitives, qui ne permettent pas le développement professionnel, ce qui était semble-t-il, le cas en l’espèce, il est indispensable de compenser par de la formation, quand bien même elle serait inutile par rapport aux fonctions exercées. L’employeur ne peut donc pas laisser ses salariés se déqualifier. L’employeur doit veiller à maintenir leur capacité à occuper un emploi, y compris en dehors de l’entreprise.
La nécessité de prouver un préjudice : l’illettrisme.
L’existence même d’un grand nombre d’illettrés en France ne doit pas être sous-estimée. Le terme peut choquer les bien-pensants et admettre l’existence même d’un important illettrisme en France, revient d’ailleurs à s’interroger sur la faillite des pouvoirs publics sur ce point, alors même que l’Éducation nationale représente toujours le premier budget de l’État. Mais, il s’agit là, on en conviendra, d’un autre problème…
On se souvient ici qu’un ancien ministre de l’Économie, appelé à s’exprimer à l’occasion de la fermeture de l’abattoir Gad à Ploërmel en Bretagne, avait cru bon de rappeler que la reconversion de ces salariés s’avérerait difficile car un grand nombre d’entre eux étaient illettrés. Ses propos avaient choqué et l’intéressé avait alors dû admettre qu’ils avaient été mal compris et les repréciser.
Selon les données de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (http://www.anlci.gouv.fr), on qualifie d’illettrisme la situation des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit, avec les formations de base. En revanche, l’analphabétisme désigne des personnes qui n’ont jamais été scolarisées. Il s’agit pour elles d’entrer dans un premier niveau d’apprentissage.
En 2017, selon les chiffres de l’ANLCI, on recensait 2,5 millions de personnes touchées par l’illettrisme pour la seule métropole. Cela correspond à 7 % des hommes et des femmes entre 18 et 65 ans et qui ont été scolarisés en France.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, il ne suffit pas d’invoquer l’illettrisme. Parce qu’ils jugent en droit, les magistrats versaillais ont rejeté la demande du salarié car la preuve du préjudice n’était pas rapportée. Il eût fallu démontrer concrètement les conséquences de cette carence, facteur d’exclusion dans la vie quotidienne du salarié et ce, avant même le départ en retraite du salarié (attestations, témoignages, bilan et entretien professionnel, démarches du salarié par exemple).
On ne peut que s’interroger sur ce que doit être le rôle de l’entreprise avec la mise en œuvre du compte personnel d’activité destiné à permettre à chacun de construire son parcours professionnel. Reprochera-t-on demain à un employeur de ne pas avoir accompagné un salarié illettré dans l’ouverture de ce compte ? Une clarification des droits et devoirs de chacun s’impose car tous les salariés ne peuvent être acteurs de leur parcours professionnel.
Cette décision de la cour d’appel de Versailles confirme dans tous les cas une jurisprudence établie. Si elle invite les employeurs à ne pas relâcher leurs efforts dans ce domaine, encore faut-il que le demandeur démontre le préjudice indemnisable.
La cour d’appel de Versailles incite donc les praticiens du droit à bien veiller à établir la preuve du préjudice, ce qui, dans l’arrêt commenté, n’avait pas été le cas.
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28293.
-
2.
JO, 7 août 2015.
-
3.
Cass. soc., 25 févr. 1992, n° 89-41634 ; Cass. soc., 18 déc. 2000, n° 98-41975.
-
4.
JO, 18 janv. 2002.
-
5.
Cass. soc., 23 oct. 2007, n° 06-40950.
-
6.
Cass. soc., 18 juin 2014, n° 13-14916.
-
7.
Cass. soc., 2 mars 2010, n° 09-40914.
-
8.
Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 09-43339.
-
9.
Cass. soc., 2 mars 2010, n° 09-40914.