Kevin Mention, l’avocat qui lutte contre l’ubérisation des services
Alors étudiant, Kevin Mention est salarié chez Orange-France Telecom, au moment de « la vague de suicides ». Nul doute que cette expérience forge une appétence certaine pour le droit du travail chez le futur avocat. Quand il rencontre des coursiers, en juillet 2016, au moment de la liquidation judiciaire brutale de la start-up belge Take Eat Easy, spécialisée en livraison de repas à domicile, c’est le choc : il constate qu’ils sont victimes d’un système qui contourne le droit du travail et ne fait que les précariser davantage.
Les Petites Affiches : Dans quelle mesure l’affaire Take Eat Easy a été le révélateur pour vous de la précarité impliquée par le statut des livreurs ?
Kevin Mention : La fermeture de la plate-forme Take Eat Easy en juillet 2016 a littéralement mis des gens à la rue, qui se sont retrouvés en incapacité de payer leur loyer et ont donc été obligés d’abandonner leur logement. La start-up les a volontairement encouragés à continuer à travailler jusqu’au dernier jour alors qu’elle se doutait qu’ils ne seraient pas payés. Elle est allée jusqu’à prétendre que les paiements qu’ils devaient recevoir début juillet étaient bloqués pour cause de fêtes nationales belge et française. Puis le 26 juillet, elle leur envoyait un simple e-mail pour leur dire que la « belle aventure » était terminée, sans le moindre paiement au titre du mois de juillet travaillé (ceux qui n’avaient pas encore pu s’immatriculer en tant qu’indépendants comme on le leur imposait avaient même plusieurs mois de travail impayés). Sur les réseaux sociaux, les dirigeants publiaient leurs photos de vacances de luxe. Compte tenu du statut, aucun droit au chômage du côté des coursiers. J’étais particulièrement choqué de la situation.
J’ai d’abord été contacté par deux coursiers, dont l’un avait été envoyé à Nice pour y ouvrir le service de livraison et en recruter d’autres sur place, sous ce statut d’autoentrepreneur. Et l’entreprise affirmait toujours qu’il n’existait aucun lien de subordination ! J’ai alors récolté toutes les preuves montrant ses liens constants avec le management, avec le responsable opérationnel et marketing. Quand j’ai commencé à me plonger dans le dossier, j’ai trouvé des documents très clairs : le vocabulaire était soigneusement choisi pour dissimuler un travail salarié. Par exemple, un dirigeant exigeait que l’on n’utilise plus le terme de « formation », mais plutôt de « shift d’essai », pour ne surtout pas sonner comme du salariat. De la même façon, le terme de recrutement était proscrit à la faveur de celui de « onboarding ». Même Ken Loach, dans son film « Sorry, we missed you » met en scène ce détournement de la sémantique qui est commune à toutes les plates-formes, en France ou à l’étranger. Alors que dans les faits, même si ce n’est plus souvent le cas aujourd’hui, des dizaines de livreurs étaient recrutés de la même manière, suivaient une formation, des quizz, des essais à faire sur le terrain. Ce genre de plate-forme est très bien conseillée par une armée d’avocats et ce jeu sur le vocabulaire n’est ni fortuit ni anodin. J’ai même trouvé sur le profil LinkedIn d’un membre de Take Eat easy la formulation suivante : « Chargé de se documenter en droit du travail afin de lutter contre les requalifications » !
LPA : Les livreurs semblent aujourd’hui mieux « armés » pour se défendre…
K.M. : Tout a commencé avec des groupes de livreurs, à Rennes et Nantes, de gros bastions, puis à Lyon, Lille, Paris… D’abord, il s’agissait de tout petits groupes, de deux coursiers, puis nous sommes passés à une grosse dizaine qui m’a également contacté. Pour Take Eat Easy, nous sommes partis de 50 pour atteindre environ 200 dossiers, sur 3 000 coursiers que comptabilisait la plate-forme à son apogée. Mais parmi les 3 000, il faut garder en tête que certains n’avaient eu le temps de faire qu’une ou deux courses.
LPA : D’autres sont-ils trop précaires pour entamer une action en justice ?
K.M. : Oui, la justice est toujours perçue comme étant trop chère. Parfois, quand il s’agissait de mineurs, les familles ne voulaient pas faire d’histoire. Mais ce genre de plate-forme joue sur cela, aussi. Par exemple, Staffme, une plate-forme qui ubérise l’intérim, pratique clairement une discrimination en refusant les candidats de plus de 30 ans. Ce faisant, elle exploite des gens qui n’ont généralement pas de connaissance du droit du travail, des règles relatives aux congés payés, des prud’hommes et manquent d’expérience. Les chiffres le disent : les jeunes et les ouvriers sont parmi ceux qui vont le moins aux prud’hommes.
Mais concernant Take Eat Easy, l’affaire était suffisamment importante : la faillite a entraîné des impayés qui montaient jusqu’à 25 000 euros pour l’un des livreurs.
Enfin, il existe aussi ceux qui craignent de voir leur contrat en cours rompu car les plates-formes se permettent de les rompre même sans donner de motifs… On a pu prouver que les plates-formes suivaient de près les personnes qui organisaient des grèves, et parfois même s’en débarrassaient. Et puis les plates-formes sont puissantes, elles lèvent des millions et se protègent entre elles. Par exemple, il est intéressant de constater que Take Eat Easy (qui n’existe plus) et Foodora, encore opérationnelle à l’étranger, avaient les mêmes investisseurs, Rocket Internet, donc des intérêts communs.
LPA : Que répondez-vous à ceux qui prétendent que ces plates-formes permettent à des personnes non qualifiées de renouer avec le travail ?
K.M. : Ça, c’est le discours d’Emmanuel Macron. Mais c’est plutôt l’inverse qui se passe. Ceux qui auraient eu une chance de se sortir de ce type de job – parce qu’il existe aussi des personnes très diplômées – se voient enfermées dans un système hyper précaire. Il n’y a pas de couverture d’accident du travail. Dès qu’il se produit un événement grave, c’est tout un équilibre qui est bouleversé. Pour travailler chez Uber Eats ou d’autres, il y en a même certains qui ont arrêté leurs études : ils ne déclaraient souvent rien, donc ce qu’ils touchaient, c’était des montants nets non négligeables dans la poche et faire des livraisons à scooter, ce n’était pas si désagréable. Mais en exerçant comme livreurs, ils ne bénéficient d’aucune formation professionnelle ni de possibilité d’évolution. Ce système les tire vers le bas. Dès qu’il y a un problème, que ce soit un vol de scooter, de portable ou un accident, cela devient assez terrible pour eux et leur discours change du jour au lendemain.
Et puis, le système les précarise : avec les statistiques et les classements, les tarifs ramenés à l’heure varient de 10-20 euros à 5 euros l’heure avec des chauffeurs ou des coursiers parfois obligés de faire des trajets dans des zones dont personne ne veut. Certains, des trentenaires, viennent me voir car ils ont fait, pendant des années, des semaines à 80 heures, et qu’ils ne peuvent plus faire de vélo ! Je me rappelle le cas d’un livreur qui a eu un accident et qui doit aujourd’hui payer 10 000 euros une opération pour sa cloison nasale, à qui l’on a fait miroiter qu’il pourrait bénéficier d’une assurance. Or les termes du contrat entre la plate-forme et l’assurance l’ont exclu de toute indemnisation.
LPA : Le 4 mars 2020, la Cour de cassation rendait un arrêt qui qualifie les relations entre la plate-forme Uber et ses chauffeurs, de « relations de subordination », donc reconnaît un salariat déguisé. Quelles peuvent être les conséquences d’une telle jurisprudence ?
K.M. : Uber a été assez réactif, suite à cette décision. Pas étonnant de la part d’une entreprise qui a combattu la loi qui reconnaît les chauffeurs VTC en tant que salariés. Ils essaient clairement de gagner du temps par rapport aux délais de prescription (un an pour les ruptures de contrat, trois ans pour les rappels de salaires et de congés payés, deux ans pour les remboursements de frais alors que Uber devrait prendre en charge jusqu’à 40 centimes par km, ce qui, pour des mois à 6 000 kms parcourus, peut monter jusqu’à 2 400 euros mensuels, pas rien !).
Depuis cette décision, on m’a remonté qu’apparemment la plate-forme faisait beaucoup moins usage de suspension pour refus de course. En Californie, où le modèle est aussi remis en cause, ils ont même proposé aux chauffeurs de moduler les prix de leur course. Il semble qu’ils aient adapté leurs pratiques pour que les nouveaux arrivants ne puissent pas un jour les attaquer pour ces raisons-là. Uber devra aussi faire face à l’Urssaf. Mais il est à prévoir que l’entreprise va se battre pour faire traîner en longueur et pour que les chauffeurs de VTC obtiennent le moins possible.
LPA : Le salariat est donc possible. Quid du statut d’indépendant ?
K.M. : Le salariat reste en effet possible, mais pas pour tout le monde, évidemment. Il existe ceux qu’on appelle les capacitaires, qui emploient déjà des salariés pour travailler sur la plate-forme. Certains VTC sont salariés, tout comme le sont parfois les taxi G7. Uber surpasse largement la simple mise en relation entre une plate-forme et des chauffeurs, ça a toujours été un service de transport à part entière. Si l’on veut respecter le statut d’indépendant, alors il faudrait que les chauffeurs jouissent d’une totale liberté, ce qui signifie l’arrêt des contrôles, plus de suspension de compte, plus non plus de convocation dans les bureaux. Il faut que le management de la terreur cesse : la quasi-totalité des chauffeurs VTC confient avoir été menacés ou même avoir subi une suspension. Ils vont au travail avec la boule au ventre, reçoivent des e-mails alors qu’ils sont en train de conduire pour leur signifier qu’ils sont suspendus car ont refusé trop de courses. Le système de notation des clients les prend également au piège. Il y a souvent des histoires où devant l’absence de bouteille d’eau, les clients ont brandi la menace de la mauvaise note et donc de la perte des cinq étoiles !
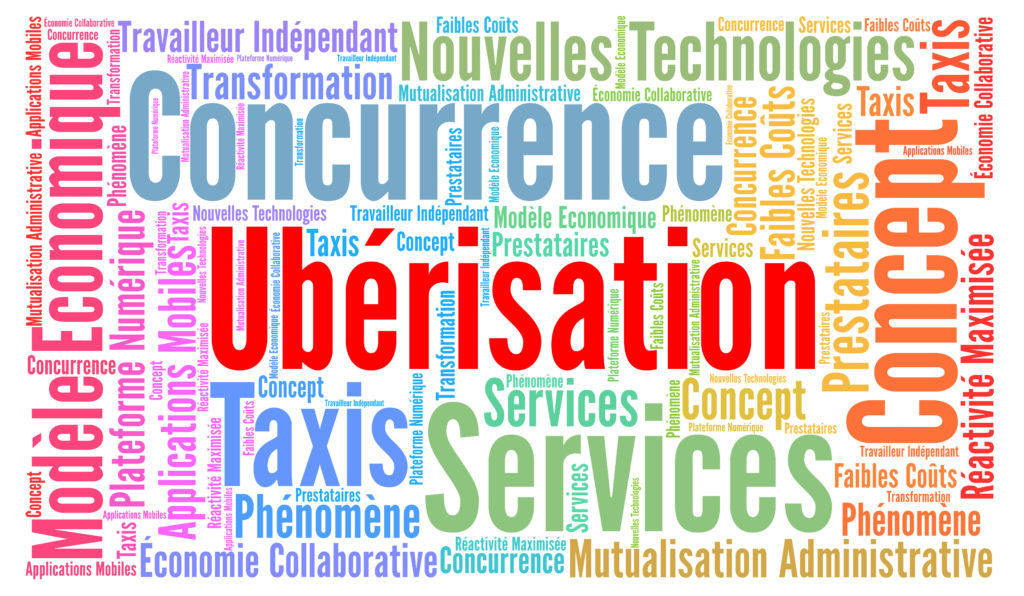
LPA : Deliveroo vient d’être condamné à verser plus de 30 000 euros à un ancien livreur. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur lui ?
K.M. : Il a travaillé six mois pour la plate-forme, et ayant quelques connaissances juridiques, il a conservé toutes les preuves de subordination dès ses débuts. Ses semaines ont été assez intenses, il travaillait jusqu’à 50 heures hebdomadaires. Puis tout d’un coup, son compte est résilié, après avoir été suspendu pour une semaine. La raison ? Il avait eu le tort de poster dans un groupe Whats’App une « pub » pour Uber Eats, concurrent qui débarquait sur le marché. Le motif officiel était qu’il avait refusé trop de courses… Le paradoxe, c’est que même dans les conclusions de la partie adverse, il était précisé que le coursier avait le droit de refuser des courses pour nier le lien de subordination !
La mauvaise foi de Deliveroo est allée très loin puisque la start-up a fourni de fausses attestations cherchant à montrer que la tenue de travail « était proposée et non imposée », ce qui n’était pas le cas. Ils ont également ajouté un numéro de Siret a posteriori sur un contrat pour laisser croire que le coursier s’était immatriculé de lui-même, avant de signer son contrat, ce qui n’était pas le cas…
LPA : Quelle est l’actualité juridique concernant Deliveroo ?
K.M. : Une première procédure va faire passer Deliveroo et ses dirigeants devant le tribunal correctionnel, même s’ils vont peut-être tenter un règlement à l’amiable, avec une reconnaissance de la culpabilité en passant par la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), qui leur permettra de dire « oui, nous avons eu des pratiques critiquables mais tout a changé maintenant ».
LPA : Pour vous, ces affaires revêtent un caractère très politique. Dans quel sens ?
K.M. : Il suffit de voir que le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi LOM qui aurait permis aux plates-formes d’être à l’abri d’une décision de justice requalifiant leur relation avec des chauffeurs ou des coursiers en contrat de travail. Nous vivons dans la start-up nation ! Contre Foodora, Deliveroo ou encore Take Eat Easy, seule une enquête pénale a été ouverte sans information judiciaire dirigée par un juge d’instruction malgré la gravité des faits, les rapports de discipline sur les coursiers, la tenue obligatoire, les sanctions sur le terrain.
On a appris dans la presse que Deliveroo avait fait l’objet d’une saisie conservatoire de plusieurs millions. Nous savons qu’une saisine similaire a eu lieu contre Foodora, sauf qu’un juge des libertés et de la détention, sur contestation de la saisie, a eu la prétention d’aborder le fond du dossier et a osé affirmer que la saisie n’avait pas lieu d’être, sachant que selon-lui, ce qui est en totale contradiction tant avec le dossier tel que je le connais ou avec la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’y avait pas de lien de subordination. Voir un JLD juger le fond du dossier est parfaitement inhabituel.
J’ai aussi souvenir d’un dossier – le seul que nous ayons perdu en première instance –, actuellement en appel. Nous avions toutes les pièces qui montraient des dizaines de preuves de subordination, comme le fait qu’un uniforme avait été imposé ou encore un téléphone portable fourni par l’employeur, et même un PV de l’inspection du travail qui considérait qu’il y avait eu du travail dissimulé… Et bien les juges prud’homaux ont écarté l’affaire sur le siège, en seulement dix minutes, considérant que les quelques décisions déjà rendues en défaveur d’autres coursiers, sur la base de dossiers bien moins volumineux, leur donnaient le droit de ne même pas prendre le temps d’analyser nos pièces.
En appel, la cour d’appel de Paris a rejeté par trois fois la qualité de salarié. Je suis intervenu dans l’un d’entre eux aux côtés d’une consœur, nous avions démontré que ce fameux uniforme obligatoire, le téléphone portable fourni, nous avions même démontré que 111 coursiers avaient été reconnus comme salariés par l’URSSAF et que le mandataire liquidateur refusait sans raison de communiquer le redressement de l’URSSAF qui listait tous les arguments retenus à l’encontre de la plate-forme… La cour d’appel n’a pas jugé bon d’obliger le mandataire liquidateur à fournir le redressement URSSAF (que nous avons depuis obtenu, non sans mal, par injonction de communiquer du conseil de prud’hommes qui a admis la résistance abusive du mandataire liquidateur) et n’a même pas abordé dans son jugement ces questions d’uniforme obligatoire ou de téléphone portable fourni. Cet arrêt d’appel sera prochainement cassé par la Cour de cassation, probablement fin 2020 ou début 2021.
LPA : Sur quoi se basait exactement la décision de la Cour de cassation ?
K.M. : Contre Take Eat Easy, elle a basé la reconnaissance du lien de subordination en s’appuyant sur le recours à un GPS et la possibilité de sanctions. Mais dans certains cas, le lien allait encore plus loin puisque la plate-forme allait jusqu’à imposer un planning, un classement entre coursiers, ou encore l’uniforme et le forfait mobile, dont nous avons déjà parlé. En face de nous, ce que plaident uniformément l’ensemble des plates-formes n’est pas aussi juridique. Elles se contentent de lister toutes les lois promulguées en leur faveur et leur intérêt économique. Elles pratiquent carrément du chantage à l’emploi devant les juges, en affirmant qu’une décision défavorable équivaut à la mort du modèle et la perte de nombreux emplois…
LPA : L’épidémie de coronavirus ne risque-t-elle pas encore davantage de pénaliser les livreurs ?
K.M. : Il apparaît que l’aide forfaitaire de 1 500 euros annoncée par le gouvernement pour les indépendants sera très difficile à obtenir. Les plates-formes laissent la possibilité de travailler, mais les commandes sont fortement revues à la baisse. Sinon il faut justifier d’une baisse de 70 % de son chiffre d’affaires par rapport à son mois de mars 2019, mais le confinement n’a débuté qu’en deuxième partie de mois.






