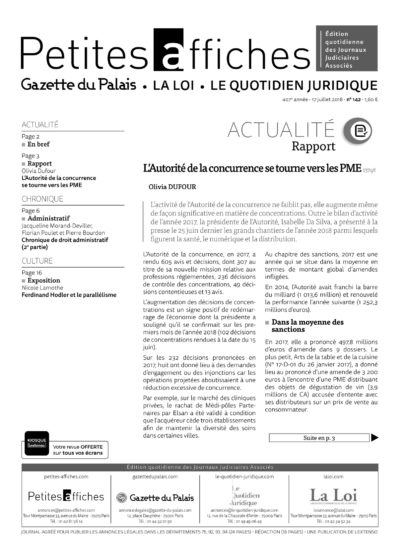Chronique de droit administratif (2e partie)
I – Droit administratif des biens
A – Réformes substantielles du droit de la propriété des personnes publiques
B – Modifications apportées au régime des biens culturels du domaine public mobilier
1 – Dispersion et sauvegarde du patrimoine
2 – Revendication des biens culturels appartenant au domaine public
3 – Transfert de propriété entre personnes publiques à titre gratuit
C – Le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité, sauf s’il résulte des stipulations que la convention doit en réalité être regardée comme un contrat de mandat
II – Responsabilité administrative
A – Le Conseil d’État précise les modalités d’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention
B – Confirmation du préjudice d’anxiété autonome. Caractère direct et certain du préjudice. Preuve
C – Négligence des services de police dans la surveillance des personnes susceptibles de commettre des actes de terrorisme. Faute lourde. Faute simple
D – La responsabilité sans faute de l’État peut être engagée à raison de la suspension, à titre conservatoire et pendant une durée de 8 ans, d’un chirurgien praticien hospitalier
III – Administration locale
A – Le principe de laïcité ne peut pas justifier la suppression des « menus de substitution » dans les cantines scolaires communales
B – Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un usage local et le caractère culturel, artistique ou festif de l’installation d’une crèche de Noël
CE, 14 févr. 2018, n° 416348, Fédération de la libre pensée de Vendée – CAA Nantes, 6 oct. 2017, n° 16NT03735, Dpt. de la Vendée. Il est plutôt rare que soit publiée (et commentée) une décision par laquelle le Conseil d’État n’admet pas d’instruire un pourvoi en cassation. C’est pourtant ce qu’il a fait à propos de sa décision Fédération de la libre pensée de Vendée du 14 février 2018. Et c’est notamment ce qui a motivé la présentation de cette décision et de ses implications dans ces pages.
Il faut rappeler brièvement les faits et la procédure qui ont conduit à cette décision du 14 février 2018.
En 2012 et comme chaque année depuis 22 ans, une crèche de Noël a été installée dans le hall de l’Hôtel du département de la Vendée. Une association vendéenne de défense de la laïcité, la Fédération de la libre pensée de Vendée, a demandé que cette crèche ne soit pas installée. À la suite du refus du président du département d’accéder à cette demande, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce refus, mais la cour administrative d’appel de Nantes a retenu une solution inverse1.
Par une première décision du 9 novembre 2016, l’assemblée du contentieux du Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel. Cette solution pouvait sembler favorable à l’association de défense de la laïcité. D’autant plus que le département de la Vendée était « la partie perdante » au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, ce qui avait justifié que le Conseil le condamne au versement d’une somme de 3 000 € – assez élevée en comparaison avec d’autres affaires – au profit de l’association2. Toutefois, dans ses conclusions, le rapporteur public Aurélie Bretonneau avait hésité à proposer l’annulation de l’arrêt de la cour. Tout en la proposant, Mme Bretonneau avait conclu au « rejet (…) de l’ensemble des conclusions » présentées au titre de l’article L. 761-1. La solution prise par le Conseil d’État n’était donc pas si favorable à l’association de défense de la laïcité.
Quoi qu’il en soit, le dossier est retourné devant la cour administrative d’appel qui a de nouveau rendu un arrêt favorable à l’installation de la crèche3.
Dans sa première décision du 9 novembre 2016, le Conseil d’État avait reproché à la cour administrative d’appel d’avoir admis l’installation de la crèche « sans rechercher si cette installation résultait d’un usage local ou s’il existait des circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif » (point 8 de la décision).
Dans son arrêt du 6 octobre 2017, la cour administrative d’appel s’est prononcée, et sur l’« usage local » qu’elle a qualifié – ce qui n’était pas nécessaire – de « culturel », et sur le caractère « festif » dans lequel elle a vu – ce qui n’était pas non plus nécessaire – une « tradition ». La cour a en effet estimé que :
-
« la crèche était installée depuis plus de 20 ans à la date de la décision contestée ;
-
elle est mise en place au début du mois de décembre et est retirée aux environs du 10 janvier, dates qui sont exemptes de toute tradition ou référence religieuse ;
-
son installation est dépourvue de tout formalisme susceptible de manifester un quelconque prosélytisme religieux ;
-
cette crèche de 3 mètres sur 2 mètres est située dans un hall d’une superficie de 1 000 m² ouvert à tous les publics et accueillant, notamment, les manifestations et célébrations laïques liées à la fête de Noël, en particulier l’arbre de Noël des enfants des personnels départementaux et celui des enfants de la DDASS ».
Après avoir énoncé ces circonstances de fait, la cour a estimé « que, dans ces conditions particulières, son installation temporaire, qui résulte d’un usage culturel local et d’une tradition festive, n’est pas contraire aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques » (point 4 de l’arrêt).
Dans sa seconde décision du 14 février 2018, le Conseil d’État a confirmé cette solution de la cour administrative d’appel de Nantes en écartant le pourvoi de l’association en raison de l’absence de moyens sérieux dirigés contre l’arrêt de la cour. Pourtant, l’un des moyens du pourvoi en cassation présenté par l’association de défense de la laïcité pouvait apparaître particulièrement sérieux.
Dans son pourvoi en cassation, l’association de défense de la laïcité soutenait que la cour avait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier. Cependant, comme cela ressort du communiqué publié sur le site internet du Conseil, « le Conseil d’État a estimé que les moyens du pourvoi qui tendaient à remettre en cause directement ou indirectement l’appréciation souveraine des juges du fond n’étaient pas de nature à justifier son admission ».
Sans être choquante, cette position du Conseil d’État dans cette affaire peut étonner. L’appréciation du juge d’appel concernait essentiellement des faits, dont on sait qu’il faut, en principe, qu’ils aient été dénaturés pour que le juge de cassation censure leur qualification juridique. Certes, l’on n’est pas choqué de lire que la cour n’a pas dénaturé les faits en constatant un usage local et un double caractère culturel et festif. Néanmoins, d’une part, le Conseil d’État aurait pu décider de contrôler cette appréciation, même sans dénaturation, comme il le fait parfois pour les problématiques particulièrement importantes. Mais l’installation d’une crèche n’est sûrement pas aussi grave qu’une nomination pour ordre par exemple4. D’autre part, en amont de cette appréciation des faits, l’on pouvait considérer que l’application de la règle de droit était erronée. En effet, la cour paraît avoir surtout retenu l’ancienneté de la pratique de l’installation d’une crèche au sein de l’hôtel du département pour estimer qu’il y avait un usage local. Le même usage existe-t-il dans les sièges voisins des collectivités publiques (par ex., les communes) ? Si tel n’est pas le cas, l’existence même d’un usage local n’est-elle pas discutable ?
Ce n’est toutefois pas ce qu’a estimé le Conseil d’État qui apporte ainsi une précision à sa décision du 9 novembre 2016. Peut-être aussi que l’association n’avait pas suffisamment insisté sur cette prétendue erreur de droit.
Finalement, l’on peut éventuellement voir dans cette décision une volonté du Conseil d’État de chercher à clore le débat sur l’installation des crèches. En tout cas, la décision souligne la marge d’appréciation laissée aux juges du fond et la confiance du Conseil à leur égard. En publiant cette décision accompagnée d’un communiqué sur son site internet, le Conseil d’État a voulu le faire savoir. De là à dire que le Conseil ne prendra plus jamais la parole dans ce débat, c’est certainement excessif.
PB
IV – Contrats administratifs
A – Le nouveau recours des tiers tendant à « mettre fin à l’exécution du contrat »
CE, sect., 30 juin 2017, n° 398445, Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche (SMPAT): Lebon, à paraître. La décision SMPAT rendue par le Conseil d’État quelques jours après le début de l’été 2017 poursuit l’œuvre de recomposition du contentieux des contrats administratifs. Jusqu’à cette décision, les tiers pouvaient demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la décision de l’Administration refusant de résilier un contrat5.
C’est sur le fondement de cette jurisprudence que deux sociétés, France-Manche et The Channel Tunnel Group, avaient demandé au syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche (SMPAT) qu’il résilie la concession dont la société Louis Dreyfus Armateurs SAS était titulaire. La concession en question portait sur l’exploitation d’une liaison maritime entre Dieppe et Newhaven. Le SMPAT avait refusé et le tribunal administratif avait rejeté le recours pour excès de pouvoir des deux sociétés dirigé contre ce refus. Mais la cour administrative d’appel de Douai, après avoir considéré que la concession devait être résiliée, avait enjoint le SMPAT de résilier ce contrat. Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation, a cassé l’arrêt de la cour et rejeté la demande des deux sociétés pour défaut d’intérêt à agir. À cette occasion, le Conseil a fait évoluer sa jurisprudence.
Depuis plusieurs années maintenant, le Conseil d’État s’est lancé dans le transfert du contentieux contractuel du juge de l’excès de pouvoir vers le juge de plein contentieux. La toute première décision en la matière, la décision Société Tropic6, a été complétée par plusieurs autres, l’une des dernières en date étant la décision Département de Tarn-et-Garonne7.
Cette seule circonstance appelait à s’interroger sur le devenir de la jurisprudence Société LIC précitée. Le contenu de la seule décision Tarn-et-Garonne rendait presque inévitable l’abandon de la jurisprudence LIC. D’autant plus inévitable que le recours LIC permettait de contourner les conditions parfois strictes du recours Tarn-et-Garonne (intérêt à agir, contenu des moyens), voire l’issue éventuelle de ce recours (l’annulation du contrat par exemple).
C’est l’option retenue par le Conseil d’État dans la décision SMPAT. Tout en abandonnant la jurisprudence LIC, le Conseil a élaboré un nouveau recours de plein contentieux des tiers leur permettant de demander que l’Administration mette fin à l’exécution d’un contrat administratif. Le Conseil a très nettement tenu compte de la jurisprudence Tarn-et-Garonne.
Désormais, « 2. (…) un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat ; que s’agissant d’un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département ;
3. Considérant que les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général ; qu’à cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général ; qu’en revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise ; qu’en outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’État dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut ;
4. Considérant que, saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé ;
5. Considérant que ces règles, qui ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers, sont d’application immédiate ».
Il existe plusieurs points de convergence entre le recours SMPAT et le recours Tarn-et-Garonne :
1) le recours SMPAT est un recours de pleine juridiction formé devant le juge du contrat ;
2) un tiers est « recevable » s’il est « susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine » ;
3) parmi les tiers, sont traités différemment les « tiers titrés » que sont les élus locaux et le préfet ;
4) contrairement aux autres tiers, les tiers titrés n’ont à démontrer, ni qu’ils sont susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts, ni que chaque moyen soulevé concerne l’intérêt lésé dont ils se prévalent ;
5) si un moyen est fondé, le juge peut ordonner qu’il soit mis fin à l’exécution après avoir vérifié qu’elle « ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général ».
C’est en raison de cette convergence générale que certains silences de la décision SMPAT peuvent être interprétés à la lumière de la décision Tarn-et-Garonne.
D’une part, l’éventualité d’un référé n’est pas mentionnée dans la décision SMPAT. Elle demeure envisageable dans les conditions précisées par la décision Tarn-et-Garonne. Autrement, le Conseil d’État l’aurait exclue très explicitement. Le rapporteur public Gilles Pélissier a d’ailleurs envisagé l’hypothèse du référé dans ses conclusions sur la décision SMPAT (Gilles Pélissier doit être remercié pour leur transmission). Il reste toutefois délicat pour le juge de mettre fin provisoirement à l’exécution d’un contrat, d’autant plus que le début de cette exécution peut remonter à très longtemps.
D’autre part, les alternatives à la fin de l’exécution du contrat (par ex., validation, modification ou indemnisation) ne sont pas indiquées dans la décision SMPAT. Pourquoi seraient-elles exclues ? Dans ses conclusions sur cette affaire, Gilles Pélissier les a envisagées dans une hypothèse précise, celle où le tiers exercerait un recours SMPAT au motif de l’irrégularité du contrat : « Il [le juge] devra tout d’abord vérifier si elle est régularisable, ce qui est par exemple le cas d’un contrat conclu sans que l’assemblée délibérante l’ait approuvé, expressément ni implicitement. (…) Il pourra alors inviter la personne publique à procéder à cette régularisation dans un délai déterminé ». L’on ne voit toutefois pas pourquoi les alternatives à la fin de l’exécution du contrat ne pourraient pas également être mises en œuvre dans les autres hypothèses justifiant un recours SMPAT. Certes, il s’agirait, dans certains cas, de petites révolutions. Quoi qu’il en soit, la décision SMPAT offre ici de nouvelles perspectives contentieuses très intéressantes, notamment pour les tiers.
Malgré cette convergence globale, certains passages de la décision SMPAT sont dissonants par rapport à la décision Tarn-et-Garonne. C’est parce que les deux décisions se complètent aussi. Le recours SMPAT permet de traiter des événements survenus, non pas au cours de la formation du contrat comme Tarn-et-Garonne, mais au cours de son exécution :
1) lorsqu’il est manifeste que le contrat doit être résilié pour un motif d’intérêt général ;
2) lorsqu’il peut être reproché au cocontractant de l’Administration une faute contractuelle particulièrement grave ;
3) lorsque des dispositions législatives ont été prises au cours de l’exécution du contrat, lui sont applicables et impliquent qu’il soit mis fin à son exécution.
C’est là une bonne raison pour le Conseil d’État d’avoir évité d’évoquer la « résiliation » du contrat – que l’on trouve pourtant dans Tarn-et-Garonne – et préféré l’expression – plus large – « fin de l’exécution ». L’on peut d’ores et déjà mentionner certaines notions pour éclairer cette expression. Outre l’hypothèse de la résiliation, l’on peut aussi évoquer celle de la caducité8. Et pourquoi la résolution (rétroactive) ne serait-elle pas envisageable en cas de faute contractuelle grave du cocontractant de l’Administration ?
Une autre dissonance paraît a priori difficilement explicable. Le recours SMPAT est « d’application immédiate ». En revanche, le recours Tarn-et-Garonne a été applicable « à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de la (…) décision » – sauf pour les concurrents évincés9. Cependant, un délai de recours a été spécifiquement prévu pour le recours Tarn-et-Garonne : « Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ». Faute d’applicabilité du recours Tarn-et-Garonne pour le futur seulement, des contrats signés depuis longtemps risquaient d’être remis en cause au contentieux (et peut-être annulés) du seul fait de la création de ce recours. En revanche, aucun délai de recours spécifique n’est prévu dans la décision SMPAT. Les dispositions classiques du Code de justice administrative sont donc normalement applicables. En outre, le recours SMPAT prend le relai de l’ancien recours LIC. Il ne crée donc pas un risque de remise en cause au contentieux comparable à celui du recours Tarn-et-Garonne. Pour reprendre la formule du Conseil d’État dans sa décision SMPAT : « ces règles (…) ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers ».
Finalement, l’œuvre de recomposition du contentieux des contrats administratifs est-elle achevée ? Rien n’est moins sûr. Outre les nouvelles perspectives contentieuses citées plus haut, les précisions jurisprudentielles qui seront ultérieurement apportées par le Conseil d’État seront sans doute l’occasion de retouches sur le recours SMPAT. Quid par ailleurs du recours pour excès de pouvoir des tiers contre la décision de résiliation du contrat10 ? Enfin, l’œuvre de recomposition a pour l’instant plutôt épargné le contentieux des contrats de la fonction publique et des clauses réglementaires. Pour l’instant.
PB
B – Les clauses Molière ne devraient pas prendre racine
CE, 4 déc. 2017, n° 413366, Min. d’État, min. de l’Intérieur c/ Région Pays-de-la-Loire : Lebon T., à paraître – TA Lyon, 13 déc. 2017, n° 1704697, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est au cours de l’hiver 2016/2017 qu’est soudainement apparu le besoin pour certaines collectivités d’insérer dans leurs marchés et concessions de travaux une clause qui, dans son contenu le plus exigeant, oblige les ouvriers des entreprises titulaires de ces contrats et leurs sous-traitants à comprendre la langue française sur les chantiers.
L’idée a été médiatisée par des amendements déposés à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, d’abord par le député Yannick Moreau, ensuite par le sénateur Mathieu Darnaud dans le cadre de la discussion du projet de loi qui deviendra la loi n° 2016-188 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi El Khomri. Les amendements ont été rejetés, mais les collectivités ont persisté.
Dans le but de légitimer cette clause, ses défenseurs lui ont donné l’un des plus beaux noms du théâtre : Molière. Un jugement du tribunal administratif de Lyon et une décision du Conseil d’État rendus à quelques jours d’intervalle en décembre 2017 permettent de mieux cerner la légalité – ou plutôt l’illégalité – de cette clause.
La lecture comparée de cette décision du 4 décembre et de ce jugement du 13 décembre montre qu’il existe différents types de clauses relatives à la francophonie :
-
celle imposant aux ouvriers de maîtriser la langue française est la plus exigeante ;
-
déjà plus réaliste est la clause d’interprétariat, c’est-à-dire celle imposant qu’un interprète assiste les ouvriers ne maîtrisant pas la langue française.
Les administrations qui ont souhaité intégrer l’une et/ou l’autre de ces clauses ont avancé plusieurs motifs concernant à peu près tous l’intérêt des ouvriers. L’utilisation de la langue française permettrait le renforcement de la sécurité des ouvriers, la protection de leur santé et une meilleure connaissance de leurs droits sociaux.
Certes, des textes récents peuvent laisser penser que de telles clauses sont légales dans les marchés publics :
-
transposant la directive n° 2014/67/UE du 15 mai 2014 (art. 5), l’article L. 1262-4-5 du Code du travail dispose que « sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil (…), le maître d’ouvrage porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d’affichage sur les lieux de travail, les informations sur la réglementation qui leur est applicable (…). L’affiche est facilement accessible et traduite dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États d’appartenance des salariés détachés » ;
-
transposant la directive n° 2014/24/UE du 26 février 2014 (art. 70), l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dispose que « les conditions d’exécution d’un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives (…) au domaine social ou à l’emploi, à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché public » (art. 38).
Cependant, il est évident que l’utilisation de la langue française sur les chantiers constitue, pour les ouvriers non francophones et les entreprises les employant, une entrave aux libertés de travailler et de proposer des services en France. Elle protège, en revanche, les entreprises qui emploient des ouvriers francophones et qui sont plutôt des entreprises françaises.
L’on ne voit pas non plus en quoi la maîtrise de la langue française par des ouvriers est à ce point nécessaire pour leur sécurité et leurs droits sociaux, sauf à estimer que tout travailleur en France doive maîtriser le français, ce qui n’est pas du tout le sens des dispositions contenues, notamment, dans les directives précitées.
Dès une instruction interministérielle du 27 avril 2017, les préfets ont été avertis de l’avis du gouvernement à propos de ces clauses : « les “clauses” précédemment décrites sont illégales et vous les traiterez comme telles ».
De son côté, le Conseil d’État a implicitement considéré comme illégales les clauses de francophonie les plus exigeantes dans sa décision du 4 décembre 2017. Autrement, un considérant de principe serait venu consacrer explicitement leur légalité et, très certainement, les conditions de cette légalité. Quelques jours plus tard, le tribunal administratif de Lyon a explicitement considéré comme illégales ces mêmes clauses par un jugement du 13 décembre 2017.
Toutefois, le Conseil d’État a constaté la légalité de certaines clauses de francophonie, en l’occurrence des « clauses d’interprétariat » (c’est la qualification retenue par le Conseil d’État lui-même).
Ainsi, d’une part, « l’intervention d’un interprète qualifié peut être demandée, aux frais du titulaire du marché, afin que la personne publique responsable puisse s’assurer que les personnels présents sur le chantier et ne maîtrisant pas suffisamment la langue française, quelle que soit leur nationalité, comprennent effectivement le socle minimal de normes sociales » (point 7 de la décision).
D’autre part, « lors de la réalisation de tâches signalées comme présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens, une formation est dispensée à l’ensemble des personnels affectés à l’exécution de ces tâches, quelle que soit leur nationalité ; que cette formation donne lieu, lorsque les personnels concernés par ces tâches ne maîtrisent pas suffisamment la langue française, à l’intervention d’un interprète qualifié » (point 11 de la décision).
Pourtant, le rapporteur public, Gilles Pélissier, n’avait pas manqué de souligner dans ses conclusions – très argumentées – que « la clause litigieuse est susceptible de produire un effet discriminatoire à l’égard de certains candidats et de constituer de ce fait une restriction à la libre prestation de services, contraire à l’article 56 du TFUE [traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] ».
Finalement, les clauses d’interprétariat sont loin d’avoir un caractère aussi exigeant que celles qui, purement et simplement, imposent aux ouvriers de maîtriser la langue française. Elles sont aussi assez complexes dans leur contenu en raison des conditions qu’elles prévoient. Il est probable que les collectivités publiques ne les mettront pas souvent en œuvre. Faute d’utilité réelle, ces clauses Molière ne devraient pas prendre racine.
PB
C – Précisions sur l’indemnité de résiliation en ce qui concerne les biens de retour
CE, 25 oct. 2017, n° 402921, Cne du Croisic : Lebon T., à paraître. Depuis quelques années, la jurisprudence a apporté des précisions sur l’indemnisation du cocontractant de l’Administration en cas de résiliation. Et cette jurisprudence, il faut bien le dire, cherche à protéger l’Administration. Le Conseil d’État veut en particulier :
-
empêcher qu’une personne publique ne paye une somme qu’elle ne doit pas11 ;
-
et, corollairement, empêcher qu’on ne paye pas à une personne publique une somme qui lui est due.
Autrement dit, il faut empêcher que les personnes publiques consentent une « libéralité », ce qui leur est interdit depuis maintenant fort longtemps12. L’Administration ne peut pas, par exemple, verser une indemnité en vue de réparer un préjudice, alors qu’elle n’en est pas responsable13.
Ce sont ces restrictions qui ont été rappelées dans la décision Commune du Croisic rendue par le Conseil d’État le 25 octobre 2017. En l’espèce, le département de Loire-Atlantique avait résilié pour motif d’intérêt général la concession du port de plaisance du Croisic dont la commune était titulaire. En conséquence, ladite commune avait réclamé au département le versement d’une indemnité.
Au titre de cette indemnité de résiliation, le département avait accepté de verser à la commune une somme de 45 367 €. Cette indemnité ne couvrait pas la totalité de la part non amortie des biens de retour de la concession estimée par la cour administrative d’appel de Nantes à la somme de 200 039 €. Cependant, la cour avait estimé que la somme de 45 367 € était conforme à l’étendue et aux modalités de l’indemnité de résiliation prévues par le cahier des charges de la concession.
L’on sait en effet que les parties au contrat peuvent déterminer l’étendue et les modalités de l’indemnité de résiliation dans les clauses de leur contrat. La jurisprudence n’avait fixé jusqu’à présent qu’une seule réserve à cette liberté des parties. Les personnes publiques ne peuvent pas consentir à verser une indemnité manifestement supérieure et disproportionnée par rapport au préjudice réel. À l’inverse, elles ne peuvent pas recevoir de leur cocontractant une indemnité manifestement inférieure et disproportionnée. Cette réserve concerne les seules personnes publiques. Les personnes privées ne bénéficient pas de cette protection14.
Dans le cas particulier de l’indemnisation de la part non amortie des biens de retour, les personnes publiques ne peuvent jamais verser à leur concessionnaire une somme supérieure à cette part non amortie, quand bien même cette somme ne serait pas manifestement disproportionnée15.
La décision Commune du Croisic du 25 octobre 2017 protège encore mieux l’Administration cocontractante dans le cas particulier de l’indemnisation des biens de retour. Les personnes publiques concessionnaires ne peuvent jamais recevoir une somme inférieure à la part non amortie des biens de retour, quand bien même cette somme ne serait pas manifestement disproportionnée.
Le considérant de principe de la décision Commune du Croisic du 25 octobre 2017 est ainsi formulé :
« Si les parties à un contrat administratif peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d’intérêt général, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le préjudice subi, la fixation des modalités d’indemnisation de la part non amortie des biens de retour dans un contrat de concession obéit, compte tenu de la nature d’un tel préjudice, à des règles spécifiques ; que lorsqu’une personne publique résilie une concession avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis ; que lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, sous réserve que l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne puisse, en toute hypothèse, excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus, il est exclu qu’une telle dérogation, permettant de ne pas indemniser ou de n’indemniser que partiellement les biens de retour non amortis, puisse être prévue par le contrat lorsque le concessionnaire est une personne publique » (point 3 de la décision).
En conséquence, le Conseil d’État a constaté l’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel qui avait admis que les biens de retour de la concession soient indemnisés pour à peine le quart de leur part non amortie16. L’arrêt de la cour a été annulé et l’affaire lui a été renvoyée.
PB
V – Relations entre le public et l’Administration
A – Il incombe à l’autorité administrative qui organise, à titre facultatif, une consultation du public d’en déterminer les règles d’organisation conformément aux textes applicables et dans le respect des principes d’égalité et d’impartialité
CE, ass., 19 juill. 2017, nos 403928 et 403948, Assoc. citoyenne pour Occitanie Pays Catalan et a., A. On le sait, la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, a refondu la carte des régions françaises, notamment en procédant à des regroupements de plusieurs régions existantes. Or le législateur a expressément prévu que lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs entités régionales existantes, son nom, notamment, est fixé par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil régional de la région concernée.
Dans le Sud-Ouest, l’organe délibérant de la nouvelle région constituée par regroupement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées a fait le choix de l’originalité, en décidant d’engager un « processus de détermination du nom » conçu de la façon suivante : dans un premier temps, un comité du nom de la région, constitué pour l’occasion, a été chargé, après le recueil de l’avis de divers institutions et organismes régionaux, tel le conseil économique, social et environnemental régional, d’élaborer une liste de huit propositions de nom possible ; puis, dans un second temps, le conseil régional a décidé de soumettre à une consultation publique, ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 15 ans habitant la région ou déclarant y avoir leur attache, une liste de cinq propositions de nom issues des huit propositions transmises par le comité du nom de la région. Dans le cadre de cette consultation, les personnes intéressées ont pu, du 9 mai au 10 juin 2016, faire connaître leur ordre de préférence entre les cinq noms proposés sur un formulaire papier envoyé à la région par voie postale ou sur un formulaire figurant sur le site internet de la région. À l’issue de la consultation, dont les résultats ont été publiés sur le même site, le nom « Occitanie » a été placé au premier rang par 44,90 % des avis exprimés, un pourcentage plus de deux fois supérieur au nom « Languedoc-Pyrénées », arrivé en deuxième position. Par une délibération du 24 juin 2016, le conseil régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a proposé au gouvernement de dénommer la nouvelle collectivité : « Région Occitanie », ce que le décret du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie17 a entériné.
Porteur de forts enjeux, en termes d’identité, de symbole et d’affect, le choix du nom donné à une personne, qu’elle soit physique ou morale, de droit privé ou de droit public, n’est jamais chose aisée : le conseil régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées en avait bien conscience puisqu’il a recherché, dès le début, à conférer à son « processus de détermination du nom » la plus grande légitimité possible. Mais parce que l’unanimité était, en l’espèce, impossible à obtenir, le nom Occitanie a été contesté par certains qui, déplorant l’absence de référence à la Catalogne, ont saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 28 septembre 2016 précité.
Signe que la contestation portée devant la haute juridiction administrative a été rude, les requérants ont invoqué pléthore de moyens et d’arguments à l’appui de leurs conclusions en annulation, allant même jusqu’à soulever, à l’encontre de la loi du 16 février 2015, une question prioritaire de constitutionnalité que le Conseil d’État a, fort logiquement, refusé de transmettre au Conseil constitutionnel18. Et signe que la contestation a suscité un fort intérêt, près d’une quinzaine de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale sont intervenus au soutien des conclusions en annulation.
Sans surprise, une partie substantielle de la discussion engagée devant le Conseil d’État a porté sur la consultation publique qu’a organisée le conseil régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées afin d’associer, selon des modalités qu’il a lui-même définies, le public à l’élaboration de l’avis relatif à la fixation du nom de la région par décret. Deux questions principales étaient posées au juge administratif.
La première concernait le choix du recours à une telle procédure : disposait-il d’une base légale ? Certes, une telle procédure ne constituant ni un référendum local ni une consultation des électeurs sur un projet de décision, elle ne pouvait pas prétendre relever des dispositions des articles LO. 1112-1 et L. 1112-15 du Code général des collectivités territoriales. En revanche, il était parfaitement possible de fonder cette procédure sur les récentes dispositions de l’article L. 131-1 du Code des relations entre le public et l’Administration (CRPA), directement issues de l’ordonnance du 23 octobre 201519, qui offrent la possibilité à l’Administration, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales, « d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte ». Comme l’indique à juste titre le Conseil d’État, il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont la faculté, pour concevoir une réforme ou élaborer un projet ou un acte qui relèvent de leur compétence, de procéder à la consultation du public, notamment sur un site internet. La procédure mise en œuvre par le conseil régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées pouvait donc se réclamer de ce fondement légal.
La seconde question, non moins importante, intéressait les modalités de la consultation : cette dernière a-t-elle été réalisée dans des conditions régulières ? En effet, la circonstance que la consultation ouverte qu’a décidé d’organiser l’Administration ne revête pas un caractère obligatoire, ne dispense pas cette dernière d’y procéder dans des conditions régulières. Or, l’un des précieux apports de la présente décision rendue par le Conseil d’État, réuni en formation d’assemblée, est qu’elle offre, aux autorités administratives intéressées, un véritable mode d’emploi à suivre pour garantir la régularité des consultations ouvertes facultatives qu’elles pourraient vouloir organiser.
D’une façon générale, la haute juridiction administrative affirme ainsi qu’il « incombe à l’autorité administrative qui organise une consultation dans les cas qui relèvent de l’article L. 131-1 du Code des relations du public et de l’Administration d’en déterminer les règles d’organisation conformément aux dispositions de cet article et dans le respect des principes d’égalité et d’impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère ». Afin de garantir le respect des dispositions de l’article L. 131-1 du CRPA, il revient à l’Administration de mettre à disposition des personnes consultées, une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, de leur laisser un délai raisonnable pour y participer et de veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. Afin de garantir le respect des exigences d’égalité et d’impartialité, dont il découle la nécessaire sincérité de la consultation, l’Administration doit, d’une part, s’assurer que la définition du périmètre du public consulté est pertinente au regard de son objet, et, d’autre part, prendre, en fonction de cet objet et du périmètre du public consulté, toute mesure relative à son organisation de nature à empêcher que son résultat soit vicié par des avis multiples émanant d’une même personne ou par des avis émis par des personnes extérieures au périmètre délimité.
C’est à l’Administration de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu’elle a elle-même fixées, sous le contrôle du juge administratif. Or ce dernier, saisi le cas échéant d’une contestation, se réserve le droit, dans l’hypothèse où il relèverait l’existence d’une irrégularité, d’apprécier, conformément à sa jurisprudence Danthony et autres20, si elle a privé les intéressés d’une garantie ou a été susceptible d’exercer une influence sur l’acte attaqué.
Au cas présent, après un examen minutieux des conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation litigieuse, le Conseil d’État conclut à l’absence d’irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation du décret attaqué.
En tant qu’elle confirme la légalité du choix, fait par le conseil régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, de procéder à une consultation ouverte dans un cas où celle-ci n’était pas obligatoire, cette solution encourage l’Administration à associer le public à l’élaboration de ses décisions. Il est vrai que la procédure de consultation du public organisée, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 131-1 du CRPA n’a, juridiquement, aucune portée décisionnelle : elle a seulement pour objet d’éclairer l’Administration dans sa prise de décision. Néanmoins, il ne saurait être nié que ce type de consultation ouverte influe nécessairement, dans la pratique, sur le sens des actes édictés par l’Administration. Les faits à l’origine de la présente espèce l’attestent avec force : après la publication des résultats plaçant au premier rang par 44,90 % des avis exprimés, un pourcentage plus de deux fois supérieur au nom « Languedoc-Pyrénées », arrivé en deuxième position, le conseil régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées pouvait-il raisonnablement ne pas proposer le nom « Occitanie » ? Juridiquement, oui ; politiquement, la réponse est moins évidente… Or, c’est précisément parce que ce genre de consultation ouverte n’est pas, dans les faits, sans conséquence sur les actes de l’Administration que le Conseil d’État a pris soin de subordonner la régularité d’une telle procédure au respect de strictes conditions. Loin de constituer des obstacles pour les consultations ouvertes, ces dernières sont de nature, au contraire, à renforcer leur attrait.
FP
(À suivre)
B – Les motifs pour lesquels une personne demande la communication d’un document administratif sont sans incidence sur sa communicabilité
C – Un avis sur un projet d’acte réglementaire peut être sollicité et recueilli avant la promulgation de la loi pour l’application de laquelle cet acte doit être pris
VI – Justice administrative
A – L’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de recours a pour effet d’interrompre le délai d’application de la règle de l’irrecevabilité des moyens relevant d’une cause juridique nouvelle
B – L’auteur d’un recours juridictionnel ne saurait conditionner son désistement ni aux motifs ni au dispositif de la décision que le juge est amené à rendre
C – Une mesure de cristallisation des moyens prise par le juge de première instance dans un litige d’urbanisme continue à produire ses effets devant le juge d’appel
Notes de bas de pages
-
1.
CAA Nantes, 13 oct. 2015, n° 14NT03400.
-
2.
Les références de cette première décision du Conseil d’État, commentée dans notre précédente chronique, figurent supra dans la présente chronique.
-
3.
CAA Nantes, 6 oct. 2017, n° 16NT03735.
-
4.
En droit de la fonction publique, le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l’appréciation des juges du fond qui ont constaté qu’une nomination avait le caractère de nomination pour ordre (CE, 21 juill. 2006, n° 279527, aff. Gastinel : Lebon T., p. 915).
-
5.
CE, sect., 24 avr. 1964, n° 53518, Sté anonyme de Livraisons Industrielles et Commerciales (LIC) : Lebon, p. 239)
-
6.
CE, ass., 16 juill. 2007, n° 291545, Sté Tropic Travaux Signalisation : Lebon, p. 360.
-
7.
CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Dpt de Tarn-et-Garonne : Lebon, p. 70.
-
8.
Sur cette dernière notion, l’on se permet de renvoyer à Bourdon P., Le contrat administratif illégal, thèse Paris 1, 2014, Dalloz, nos 944 et s., not. n° 949.
-
9.
Ces tiers ont bénéficié immédiatement du recours Tarn-et-Garonne car ils disposaient déjà d’un recours similaire depuis la décision Tropic de 2007.
-
10.
CE, ass., 2 févr. 1987, n° 81131, Sté TV6 : Lebon, p. 29.
-
11.
Restriction consacrée en termes généraux par CE, sect., 19 mars 1971, n° 79962, Mergui : Lebon, p. 235.
-
12.
CE, sect., 16 févr. 1934, n° 21479, Conseil général de la Martinique : Lebon, p. 232.
-
13.
CE, 8 avr. 1921, nos 44195 et 70089, Compagnie de la N’Goko-Sangha : Lebon, p. 351.
-
14.
CE, 4 mai 2011, n° 334280, CCI de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan : Lebon, p. 205 – v. égal. CE, 22 juin 2012, n° 348676, CCI de Montpellier et Sté Aéroport de Montpellier-Méditerranée : Lebon, p. 851.
-
15.
CE, ass., 21 déc. 2012, n° 342788, Cne de Douai : Lebon, p. 479.
-
16.
V. supra.
-
17.
D. n° 2016-1264, 28 sept. 2016, portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie : JO n° 0227, 29 sept. 2016.
-
18.
CE, 28 déc. 2016, n° 403928, Assoc. citoyenne pour Occitanie Pays Catalan et a. : inédit au Lebon.
-
19.
Ord. n° 2015-1341, 23 oct. 2015, relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l’Administration : JO n° 0248, 25 oct. 2015.
-
20.
CE, ass., 23 déc. 2011, n° 335033, Danthony et a. : Lebon, p. 649.