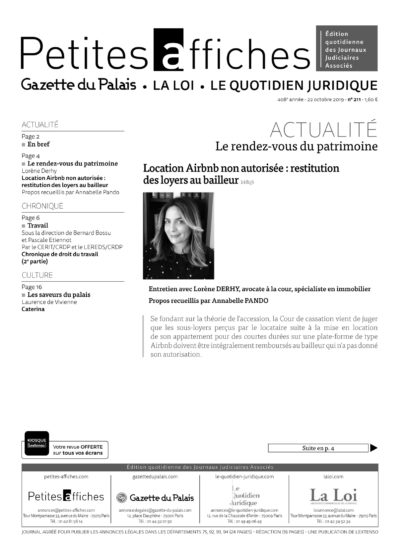Chronique de droit du travail (2e partie)
Cette nouvelle chronique de droit du travail, dirigée par le professeur Bernard Bossu et Pascale Etiennot, maître de conférences, couvre l’année 2018.
I – Droits et libertés fondamentaux
II – Relations individuelles de travail
A – Le contrat de travail
1 – Formation et exécution du contrat de travail
a – L’« ubérisation » est soluble dans le droit du travail
b – Précisions sur les péripéties liées à l’application d’une clause de mobilité géographique
2 – Rupture du CDI
a – Le contrôle administratif du PSE : entre ajustement et perfectionnement. Retour sur les décisions marquantes de l’année 2018
CE, 7 févr. 2018, n° 407718 : Lebon – CE, 7 févr. 2018, nos 403989 et 404077 : Lebon – CE, 7 févr. 2018, n° 403001 : Lebon – CE, 7 févr. 2018, n° 397900 : Lebon – CE, 13 avr. 2018, n° 404090 ; CE, 10 oct. 2018, n° 395280 ; CE, 24 oct. 2018, n° 397900 ; Cass. soc., 21 nov. 2018, nos 17-16766 et 17-16767, PB. Après avoir posé les fondamentaux du contrôle administratif du PSE, le Conseil d’État se livre à un travail d’orfèvre en procédant, d’une part, aux ajustements nécessaires à une maîtrise harmonieuse des champs de compétences juridictionnelles et de leur articulation (I) et, d’autre part, à un perfectionnement des modalités du contrôle administratif (II).
I. Le champ de compétences du juge administratif : le temps des ajustements
Au fil des décisions, le Conseil d’État, suivi dans cette démarche par la Cour de cassation, explicite la clef de répartition des compétences juridictionnelles, tant en ce qui concerne l’étendue du « bloc de compétence » (A) que l’articulation des champs de compétences avec le juge du licenciement (B).
A. L’étendue du « bloc de compétence » du juge administratif
Le législateur a assorti le contrôle administratif du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) d’un « bloc de compétence » en faveur des juridictions administratives1. Le Conseil d’État en a très vite tiré les conséquences en décidant qu’il appartient au juge administratif de trancher, sans renvoi préjudiciel, les questions conditionnant la légalité de la décision administrative, quand bien même ces questions relèvent normalement de la compétence de l’ordre judiciaire. Ainsi en est-il de la validité d’un mandat de délégué syndical2 comme de la régularité de la procédure de négociation3 pour autant que ces questions commandent la validité de l’accord collectif fixant le PSE et relèvent bien du domaine de compétence de l’administration. Les premières lignes de force tracées, le Conseil d’État poursuit dans cette voie, comme l’illustre un arrêt du 13 avril 20184 portant sur l’interprétation des stipulations d’un accord de branche.
Dans cette affaire, le litige concernait la conformité du plan de reclassement d’un PSE homologué à un accord de branche prévoyant des obligations de reclassement externe particulières. Dans un premier temps, la lecture combinée des articles L. 1233-57-3 et L. 1233-62, 3°, du Code du travail conduit le Conseil d’État à affirmer la compétence de l’administration. Celle-ci doit vérifier la conformité du document unilatéral aux stipulations conventionnelles applicables5. Encore faut-il, indique le Conseil d’État, que de telles stipulations s’imposent à l’employeur au stade de l’élaboration du PSE6. C’est ainsi que le Conseil d’État est amené, dans un second temps, à interpréter les stipulations conventionnelles litigieuses. Privilégiant une lecture littérale, il relève que seuls sont visés les salariés « dont le licenciement aura dû être décidé » pour exclure l’application des textes litigieux au stade de l’élaboration du plan et rejeter en conséquence la demande d’annulation. La solution aurait-elle été la même en présence d’un accord collectif soumis à validation ? Bien que l’article L. 1233-57-2 du Code du travail prévoie un contrôle administratif restreint7, la question de la conformité à un accord de branche pourrait renaître sur le terrain de l’article L. 2253-3 du Code du travail régissant les rapports entre accords d’entreprise et de branche8.
Les précisions apportées sur l’étendue du bloc de compétence dessinent en creux la sphère de compétences du juge du licenciement.
B. L’articulation des champs de compétences avec le juge du licenciement
À la suite de la loi du 14 juin 2013, la crainte d’une approche extensive de la compétence du juge administratif a pu s’élever ; elle s’est depuis dissipée. Le Conseil d’État adopte une position mesurée9 à laquelle se joint la Cour de cassation comme en témoigne un arrêt du 21 novembre 201810 portant sur la compétence du juge judiciaire en matière de reclassement. Au visa de « l’article L. 1235-7-1 du Code du travail et ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs », elle décide dans un attendu de principe que « si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi ».
L’obligation de reclassement se disloquerait-elle désormais entre deux ordres de juridiction ? Assurément, non. C’est seulement rappeler que l’obligation de reclassement n’est pas faite d’un seul tenant. L’obligation de reclassement de l’article L. 1233-4 du Code du travail ne saurait en effet se confondre avec l’obligation d’établir un plan de reclassement au sens de l’article L. 1233-62 du Code du travail. Tout d’abord, la première suppose une recherche personnalisée en considération de la situation individuelle d’un salarié déterminé tandis que la seconde, à la dimension collective marquée, vise l’ensemble des salariés concernés par le projet de licenciement. Ensuite, bien que complémentaires, ces deux obligations peuvent être appréhendées de manière autonome. Le plan de reclassement ne dispense pas l’employeur de poursuivre les recherches individuelles de reclassement11. Mieux, l’obligation individuelle de reclassement s’impose indépendamment de la mise en place d’un PSE. Enfin, ces deux obligations s’inscrivent dans deux temporalités différentes : l’obligation individuelle de reclassement intervient postérieurement au contrôle administratif du PSE, tandis que le plan de reclassement est défini au cours de l’élaboration du PSE.
C’est bien cet élément temporel qui donne la clef de répartition des champs de compétences : au juge judiciaire, le contrôle de l’obligation individuelle de reclassement ; au juge administratif, le contrôle par l’administration du contenu du PSE. Précisément, si une contestation s’élève sur le contrôle du plan de reclassement exercé par l’administration, il appartient au requérant de saisir la juridiction administrative. À défaut, la décision administrative ne peut plus être contestée et s’impose, y compris au juge judiciaire, sous peine de « méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ». C’est la raison pour laquelle la cour d’appel ne pouvait en l’espèce se fonder sur l’insuffisance du PSE : « Le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ». Depuis, la Cour de cassation a adopté une solution similaire à propos de l’obligation de recherche d’un repreneur12. Malgré ces clarifications, des points d’achoppement subsistent ; ainsi du juge compétent pour connaître d’une demande de suspension d’un projet de restructuration fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux13.
Si le Conseil d’État ajuste au mieux les champs de compétences juridictionnelles ; il s’emploie aussi à affiner les modalités du contrôle administratif vers un plus grand perfectionnement.
II. Le contrôle exercé par l’administration : le temps des perfectionnements
Les précisions du Conseil d’État concernent principalement le contrôle de l’ordre des licenciements (A) et celui du PSE au regard des moyens du groupe (B).
A. Le contrôle de l’ordre des licenciements
La détermination de l’ordre des licenciements est en principe un préalable au licenciement économique destiné à objectiver le processus d’identification des salariés menacés de licenciement. Il est dès lors essentiel d’en circonscrire les exceptions ; tout comme il est essentiel de préciser le contrôle des catégories professionnelles14, lorsqu’un PSE s’impose. Sur ces deux points, le Conseil d’État apporte des éclaircissements.
Au titre des exceptions connues, les critères de l’ordre des licenciements ne s’appliquent pas lorsque le salarié est le seul de sa catégorie professionnelle15 ou que tous les salariés d’une même catégorie sont licenciés16. Dans une décision du 10 octobre 201817, le Conseil d’État complète le tableau. En l’espèce, par le jeu de départs volontaires et de propositions de modification de contrat pour cause économique, aucune suppression d’emploi n’était envisagée. En cas de refus par les salariés de la proposition de modification de leur contrat, un PSE s’impose-t-il ? Et, dans l’affirmative, l’employeur doit-il fixer l’ordre des licenciements ? Pour le Conseil d’État, un PSE s’impose bien à l’employeur dès lors que le projet de compression d’effectifs prévoit de licencier les salariés ayant refusé la proposition de modification de leur contrat18. Toutefois, l’employeur n’a pas à prévoir d’ordre des licenciements, « lorsque l’employeur envisage seulement de proposer à des salariés une modification de leur contrat et ne prévoit leur licenciement qu’en cas de refus ». Si le PSE prévoit de soumettre les propositions de modification de contrat à des règles particulières, l’administration doit alors exercer un contrôle de légalité.
En dehors de ces exceptions, les critères de l’ordre des licenciements doivent être fixés, ce qui, en présence d’un PSE, pose la question de la définition des catégories professionnelles et de la nature du contrôle administratif s’y rapportant. Dans un arrêt Fnac du 30 mai 201619, le Conseil d’État reprend en substance la définition dégagée par la Cour de cassation20, faisant de la compétence professionnelle le critère distinctif des catégories professionnelles. Restait à préciser le contrôle administratif. Par trois arrêts du 7 février 201821, le Conseil d’État pose les jalons d’un régime dual, variant selon que l’ordre des licenciements est unilatéralement déterminé par l’employeur ou négocié.
En présence d’un document unilatéral, le Conseil d’État pose deux limites à l’homologation. La première limite tient aux raisons objectives mobilisées pour définir les catégories professionnelles. L’employeur s’est-il fondé sur les compétences professionnelles des salariés pour les regrouper au sein d’une même catégorie professionnelle ou bien « sur des considérations (…) étrangères » ? Dans cette dernière hypothèse, une décision de refus s’impose. La seconde limite tient à la finalité recherchée. Une ou plusieurs catégories ont-elles été définies « dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personnel ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée » ? Dans l’affirmative, là aussi, un refus d’homologation s’impose. Dans l’un et l’autre cas, l’administration exerce son contrôle « au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir ». Cette dernière précision éclaire l’approche du Conseil d’État. C’est en considération de la teneur des discussions engagées au cours de la procédure d’élaboration du document unilatéral que l’administration est en mesure de vérifier les raisons et finalités présidant au découpage des catégories professionnelles. L’objet du contrôle se déplace22, ce qui ne manque pas de rejaillir sur la nature du contrôle, comme l’illustre parfaitement l’arrêt AEG Power Solutions.
Dans cette décision, le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel qui s’était fondé sur le caractère « trop restrictif » des catégories professionnelles pour annuler la décision d’homologation. L’administration comme le juge administratif, en cas de litige, n’ont pas à exercer un contrôle substantiel du critère de la compétence professionnelle retenu par l’employeur. Plus avant, lorsque l’employeur se fonde bien sur les compétences professionnelles, le contrôle ne peut porter que sur la finalité poursuivie. C’est sur cet élément du contrôle que le Conseil d’État, appelé à statuer23, annule la décision d’homologation. En effet, au cours des échanges, le comité d’entreprise avait critiqué le découpage des catégories professionnelles : sur les 25 catégories professionnelles, 18 ne comportaient qu’un seul salarié alors que l’employeur avait, lors d’un précédent PSE, défini pour les mêmes services et fonctions un nombre bien inférieur de catégories professionnelles. Or, à aucun moment, l’employeur n’a apporté les justifications nécessaires que ce soit devant le comité d’entreprise, l’administration ou encore le juge administratif. Le Conseil d’État en déduit que plusieurs catégories professionnelles ont été définies dans le but de licencier les salariés au seul motif de leur affectation sur un emploi dont la suppression était recherchée.
Ce qui vaut pour le contrôle de l’homologation, ne vaut pas nécessairement pour le contrôle de la validation. Lorsque les catégories professionnelles sont définies par un accord collectif, les limites posées à l’homologation ne sont pas « par elles-mêmes » opérantes. Le refus de validation d’un accord collectif qui fixe les critères d’ordre des licenciements est réservé à la nullité des stipulations de l’accord24. Dans un arrêt du 10 octobre 201825, le Conseil d’État généralise cette solution. L’accord collectif fixant le contenu du PSE « ne peut (…) faire l’objet d’un refus de validation par l’autorité administrative que s’il méconnaît [les dispositions de l’article L. 1233-57-2 du Code du travail] ou s’il comporte des clauses qui l’entachent de nullité, en raison notamment de ce qu’elles revêtiraient un caractère discriminatoire ». Se confirme le mouvement général de retrait du juge face à l’accord collectif26.
Le contrôle administratif du PSE au regard des moyens du groupe constitue l’autre terrain sur lequel le Conseil d’État affine sa position.
B. Le contrôle du PSE au regard des moyens du groupe
Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du Code du travail, l’administration, saisie d’une demande d’homologation27, apprécie le contenu du PSE à l’aune « des moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ». Encore faut-il s’entendre sur ce qu’il est convenu d’appeler le « groupe de moyens ». Car, selon sa composition, l’appréciation des mesures du PSE peut très bien basculer ; de surcroît, un contrôle des moyens exercé dans un périmètre inadéquat rend l’homologation illégale. Resté dans l’angle mort des ordonnances Macron, le « groupe de moyens » n’a jamais été défini par le législateur. L’affaire Tel and Com28 donne précisément l’opportunité au Conseil d’État de se positionner. Par une référence expresse à l’article L. 2331-1, I, du Code du travail, le « groupe de moyens » désigne l’ensemble formé par une entreprise dominante et les entreprises placées sous son contrôle « dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce », « quel que soit le lieu d’implantation du siège de ces entreprises », précise le Conseil d’État. Cette décision appelle deux observations.
Premièrement, en recentrant le « groupe de moyens » autour de la détention majoritaire de capital et des relations de contrôle, le Conseil d’État s’inscrit dans le sillage des ordonnances Macron, tout en affirmant l’autonomie de la notion eu égard au périmètre géographique retenu29. Cette approche autonome est également manifeste à l’égard de la définition du groupe pour la mise en place d’un comité de groupe : « Le groupe de sociétés auquel fait référence [l’article L. 1233-57-3] n’est pas nécessairement identique à celui pour lequel l’article L. 2331-1 prévoit la constitution d’un comité de groupe ». C’est ce qui conduit le Conseil d’État à exclure l’application de l’article L. 2331-4 du Code du travail30 et lui permet d’inclure, cet obstacle levé, la société holding dans le « groupe de moyens ». Deuxièmement, le « groupe de moyens » doit permettre d’apprécier le caractère suffisant du PSE au regard des moyens, notamment financiers, du groupe. Il ne se confond pas avec le périmètre d’appréciation du plan de reclassement. Ce dernier inclut les entreprises du groupe avec lesquelles des possibilités de permutation du personnel existent, dans le but de faciliter le reclassement des salariés31.
Ainsi, le Conseil d’État conforte les jalons posés dans les arrêts d’assemblée du 22 juillet 201532 en les ajustant, en les perfectionnant pour déployer et donner à voir sa conception du contrôle administratif du PSE.
Marguerite KOCHER
b – Résiliation judiciaire et protection de la maternité
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 15-29330. Une infirmière embauchée par une société d’ambulances à temps partiel avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle reprochait à ce dernier de ne pas lui avoir fourni de travail à la hauteur de la durée contractuelle et de ne pas lui avoir de sorte versé le salaire contractuellement prévu.
Entre l’introduction de l’instance en justice et la décision du juge judiciaire, la salariée avait transmis à l’employeur une déclaration de grossesse et l’employeur l’avait licenciée quelques jours plus tard pour faute grave. Se posait la question des conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail.
Pour résoudre cette question, les juges durent mener leur raisonnement en deux temps. Il leur fut en premier lieu nécessaire de déterminer quel mode de rupture du contrat de travail devait prévaloir. La position de la Cour de cassation est constante sur ce point et est bien connue. Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu’il est licencié ultérieurement, les juges doivent d’abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée33. Si tel est le cas, ils prononcent la rupture du contrat mais fixent la date de rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement34. En revanche, s’ils estiment la demande de résiliation judiciaire non fondée, ils doivent statuer sur le licenciement.
Sans surprise dans cette affaire, dès lors que les juges du fond considérèrent la demande de résiliation fondée, ils n’eurent pas à statuer sur le licenciement.
Mais un deuxième problème de droit découlait du premier et c’est ce point qui fit débat dans la présente décision commentée. Il portait sur les effets attachés à la résiliation judiciaire. Convenait-il de faire produire à la résiliation judiciaire les effets d’un licenciement nul prononcé en violation de la protection liée à la maternité, ou convenait-il de lui faire produire les effets d’un simple licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
La Cour de cassation répond à cette question dans l’arrêt du 28 novembre 201835 en posant une solution nouvelle mais pour autant non surprenante.
I. Une solution nouvelle mais pour autant non surprenante
A. Une solution nouvelle
Le mécanisme de la résiliation judiciaire dissocie fortement le moment de la saisine du juge et le moment de la rupture éventuelle du contrat de travail. Le fait juridique maternité peut parfois être antérieur à la saisine du juge mais il peut aussi être constaté en cours d’instance.
Aucune difficulté particulière d’articulation ne semble posée lorsque la salariée bénéficie de la protection au moment de l’introduction de l’action en justice. Si la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement nul avec les conséquences spécialement attachées à la nullité du licenciement pour maternité.
Mais une question plus délicate se pose lorsque la femme fait état de sa maternité entre l’introduction de la demande en justice et le jour de la rupture du contrat. La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit-elle les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Telle était la question posée dans la présente affaire. Les juges de la cour d’appel de Paris s’étaient en l’espèce référés à la situation juridique de la femme au moment de la rupture du contrat de travail. Dès lors que l’état de grossesse de la femme était avéré et connu de l’employeur au moment de la rupture du contrat, ils en avaient déduit que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement nul.
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Au visa des articles 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et des articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du Code du travail, elle énonce pour la première fois en ce domaine que « lorsqu’au jour de la demande de résiliation judiciaire, la salariée n’a pas informé l’employeur de son état de grossesse, la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Par cette décision, la Cour de cassation fait ainsi primer la situation juridique de la salariée au moment de sa prise d’initiative de la rupture du contrat, sur sa situation juridique au jour du prononcé de la rupture.
En d’autres termes, la protection de la salariée ne peut jouer que si elle est acquise au moment de l’introduction de l’instance qui débouchera sur le prononcé d’une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Le changement de situation de la salariée entre l’introduction de l’instance et le jugement du conseil de prud’hommes n’a pas d’effet sur la sanction attachée à la reconnaissance de la résiliation judiciaire. Prononcée aux torts de l’employeur, la résiliation judiciaire ne peut produire les effets d’un licenciement nul, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B. Une solution somme toute non surprenante
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation statue dans un tel sens. Elle reprend ici une solution déjà posée à l’endroit des salariés protégés titulaires d’un mandat. Dans une décision du 26 octobre 201636, elle avait en effet considéré que lorsqu’au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur de conseiller prud’homal (celui ayant été acquis au cours de l’instance), la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur ne s’analysait pas comme un licenciement nul mais comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réalité, sous une forme solennelle, la Cour de cassation confirmait en 2016 des solutions précédemment posées envers un délégué syndical désigné après l’introduction de sa demande de résiliation judiciaire37 et confirmait aussi une solution implicitement posée dans laquelle un délégué du personnel avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire, après laquelle il avait été réélu. Dans cette dernière affaire, la Cour de cassation38 avait dès 2009 retenu que « le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ».
La solution posée par la Cour de cassation en 2016 était par ailleurs en parfaite cohérence avec d’autres jurisprudences de la Haute cour selon lesquelles la protection ne s’applique que lorsqu’au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, l’employeur a eu connaissance de la candidature d’un salarié aux élections professionnelles39 ou selon lesquelles le salarié investi d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de la protection contre la rupture de son contrat, que s’il est établi qu’il a informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement de l’existence de son mandat40. Cette dernière solution constitue la reprise même d’une position affirmée quelques mois auparavant par le Conseil constitutionnel41 qui avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Si ces solutions peuvent parfois conduire à exclure de la protection un salarié au moment où la rupture est prononcée, elles font dépendre le statut protecteur de la date à laquelle la rupture a été initiée et non de la date à laquelle le contrat est juridiquement rompu.
II. La fourniture postérieure d’un certificat attestant de l’état de grossesse : utilité ou inutilité ?
Une question se pose toutefois. La fourniture d’un certificat médical attestant de l’état de grossesse postérieurement à l’introduction en justice de la demande de résiliation judiciaire est-elle dénuée d’intérêt en toute hypothèse ? Assurément non. L’introduction d’une demande de résiliation judiciaire ne préjuge pas de la solution juridique posée par le juge. Si contrairement à l’hypothèse objet de ce commentaire, le juge estimait la demande de résiliation judiciaire non fondée, le contrat de travail devrait être maintenu ou pourrait être rompu par un autre mode de rupture.
Si le contrat était maintenu, la fourniture d’un certificat médical attestant de l’état de grossesse déclencherait au bénéfice de la salariée la protection applicable en matière de maternité. Elle bénéficierait des règles spécifiques applicables de changement temporaire d’affectation, d’autorisation d’absence et de congé de maternité.
La salariée bénéficierait en outre d’une protection de son emploi. Pendant la période de protection relative, c’est-à-dire pendant la période qui précède son congé de maternité et pendant la période de 10 semaines qui fait suite à son congé de maternité, son contrat de travail ne pourrait être rompu que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif extérieur à la maternité. Pendant la durée du congé de maternité, son contrat ne pourrait être rompu pour aucune cause que ce soit. Le non-respect de ces règles entraînerait la nullité du licenciement de la salariée, ce qui ouvrirait droit soit à sa réintégration dans son emploi précédent, soit à une indemnisation financière plus conséquente que l’indemnisation accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La protection de la salariée vaudrait encore si l’employeur en ignorance de son état de grossesse engageait une procédure de licenciement à l’encontre de la salariée et que la salariée fournissait un certificat médical attestant de son état de grossesse dans un délai maximal de 15 jours. Elle bénéficierait d’une protection relative et son licenciement ne pourrait être admis que si l’employeur pouvait invoquer une faute grave de la salariée ou une impossibilité de maintenir le contrat de la salariée.
Dans la présente affaire, l’employeur avait procédé au licenciement pour faute grave de la salariée peu de temps après avoir eu connaissance de son état de grossesse. Si la résiliation judiciaire n’avait pas abouti, les juges auraient, par application des règles précédemment énoncées, été amenés à analyser le licenciement prononcé par l’employeur. À supposer le licenciement prononcé hors de la période de suspension du contrat pour congé de maternité ou de la période de congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, le débat judiciaire aurait alors porté sur l’existence ou non de la faute grave commise par la salariée telle qu’invoquée par l’employeur. En cas d’admission par les juges de la faute grave, le licenciement aurait été légitime. En cas de rejet de celle-ci, le licenciement aurait été frappé de nullité. En application des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du Code du travail, la salariée aurait eu droit outre les indemnités attachées à la rupture de son contrat de travail à une indemnité qui n’aurait pu être inférieure à 6 mois de salaires et au paiement du salaire qui aurait dû lui être versé pendant toute la période couverte par son statut protecteur.
La protection de la maternité n’est donc pas totalement niée en cas de demande de résiliation judiciaire. Fort logiquement, elle ne peut en quelque sorte rétroagir, c’est-à-dire qu’elle ne peut conférer une protection financière spéciale à une salariée qui introduit, à un moment où l’état de grossesse n’existe pas ou n’est pas connu, une demande de rupture du contrat de travail qui sera jugée ultérieurement légitime.
En revanche, dès lors que la demande de résiliation judiciaire ne peut aboutir à la rupture du contrat et que le contrat de travail a vocation à se poursuivre ou est rompu par la suite par l’employeur par un licenciement, la protection liée à la maternité opère ses pleins effets à partir de la production du certificat médical.
Agnès ETIENNOT
3 – Les contrats spéciaux
Les voies étroites de la requalification des CDD de remplacement successifs
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-17966. L’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 201842 est relatif à la régularité des CDD de remplacement successifs. Une salariée est engagée en CDD par une association en qualité d’agent de service pour remplacer une personne en congé maternité. Après deux contrats respectivement conclus du 8 au 29 juillet 2010 et du 1er au 29 août 2010, elle est de nouveau sollicitée, d’abord en avril 2011, puis pour une période plus longue comprise entre le 26 avril 2011 et le 27 février 2014. Après 104 CDD, elle saisit le conseil de prud’hommes en requalification de ces contrats en un CDI. Par arrêt confirmatif, la cour d’appel accueille sa demande au motif que l’association en tant qu’entreprise disposant « d’un nombre de salariés conséquent est nécessairement confrontée à des périodes de congés, maladie, stage, maternité qui impliquent un remplacement permanent des salariés absents pour diverses causes ponctuelles ». Dès lors que les remplacements prévisibles et systématiques assurés par l’intéressée pendant trois années ont constitué « un équivalent à un plein-temps pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre », la requalification devait être confirmée même si ces contrats étaient formellement réguliers.
L’arrêt est cassé pour insuffisance de motifs. Appuyant très largement son argumentation sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)43, la Cour de cassation censure les juges du fond au motif que « le seul fait pour l’employeur (…) de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux CDD pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale de l’entreprise ». Elle en conclut que la cour d’appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail tel que la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, permet aujourd’hui de les interpréter. Elle aurait dû « caractériser, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l’association, que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association ». Mais un arrêt du 23 janvier 201944 vient brouiller les pistes. Il confirme la requalification en CDI de 60 CDD « séparés de courtes périodes d’interruption, pendant trois années, pour occuper, moyennant une rémunération identique, le poste d’infirmier et occasionnellement celui d’aide-soignant ». Si l’arrêt du 14 février 2018 ne constitue pas en tant que tel un revirement de jurisprudence mais un signal envoyé aux juridictions du fond pour motiver plus précisément les décisions requalifiant en CDI les successions de CDD de remplacement (I), il est néanmoins le signe du climat de libéralisation qui entoure le régime juridique des CDD conclus pour ce motif (II).
I. Une requalification soumise à l’examen de toutes les circonstances de la cause
L’examen de la régularité des CDD de remplacement successifs est un exercice délicat. Comment en effet concilier des dispositions autorisant à enchaîner ces contrats et celles interdisant d’y recourir pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ? La Cour de cassation a depuis longtemps donné les clés pour résoudre cette apparente contradiction45. La requalification est encourue dès lors que ces contrats répondent durablement à un besoin structurel de main-d’œuvre46. Elle est en revanche écartée si les contrats conclus n’ont d’autres buts que de procéder aux remplacements des salariés absents. La Cour de cassation rappelle cette ligne directrice lorsqu’elle censure les juges du fond qui n’ont pas étudié la nature des emplois successifs occupés et la structure des effectifs de l’association, seuls éléments à même de caractériser, le cas échéant, un abus manifeste de l’employeur47. Elle réaffirme ainsi l’absence d’automaticité de la requalification, le nombre de contrats, leur durée cumulée, fussent-ils importants, n’étant pas des facteurs à même de démontrer l’existence d’un besoin permanent en personnel. La demande de requalification n’est susceptible de prospérer qu’à partir du moment où les intéressés ont exercé leurs fonctions sur des emplois identiques, peu important qu’ils aient été embauchés de manière discontinue48. Mais une fois cette condition posée qui, bien que nécessaire, ne serait plus suffisante, de nouveaux éléments d’appréciation doivent être intégrés. En s’inscrivant dans le sillage de la CJUE qui invite à « prendre en compte toutes les circonstances de la cause » et en particulier les nécessités de remplacement, la Cour de cassation impose aux juges du fond de procéder à un examen global de la situation ayant conduit à la succession de CDD. De ce supplément de motivation découle le durcissement de la jurisprudence49. L’interprétation de la jurisprudence administrative est d’ailleurs assez proche, le juge étant tenu de « prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause »50.
L’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2019 jette toutefois un trouble. Les juges du fond ont requalifié en CDI des CDD de remplacement successifs tout en continuant à procéder comme précédemment, la décision attaquée ayant été rendue avant l’arrêt du 14 février 2018 (CA Bourges, 26 mai 2017, rectifié par arrêt du 20 octobre 2017). Pourtant dans cette espèce, les contrats conclus, séparés en outre de courtes périodes d’interruption, étaient moins nombreux (60 contre 104), la période couverte plus courte (3 ans contre près de 4 ans), et la fonction exercée l’avait été sur un poste d’infirmier et occasionnellement d’aide-soignant. Mais les juges du fond ont, contrairement à leurs homologues dont la décision a été censurée, relevé que les emplois pourvus correspondaient presque toujours à la même qualification. Ils ont en outre caractérisé la situation à l’origine de la succession de CDD en établissant d’une part que les remplacements étaient proposés au dernier moment au salarié, ce qui le conduisait à rester à disposition de l’employeur, et d’autre part que le « registre du personnel faisait apparaître que le recours aux contrats à durée déterminée était un mode habituel de gestion du personnel au sein de la clinique ». Cet arrêt brouille les pistes sur la direction que souhaite finalement emprunter la Cour de cassation. Constitue-t-il une décision isolée, ce que l’absence de publication tendrait à confirmer, ou un coup d’arrêt à la jurisprudence visant à renforcer le contrôle sur la motivation des juges du fond et à réduire les perspectives de requalification ? Il n’en demeure pas moins que l’arrêt du 14 février 2018 s’inscrit dans un mouvement de libéralisation du régime juridique des CDD de remplacement.
II. Une libéralisation du régime juridique des CDD de remplacement
La reprise du dispositif de l’arrêt de la CJUE et certains de ses motifs dans les attendus de la décision du 14 février 2018 est loin d’être neutre. La Cour de cassation a d’abord rendu de nombreux arrêts depuis 201251 sans jamais s’y référer jusqu’ici. Il n’était en outre pas impérieux de l’intégrer pour justifier la solution retenue52. Recourir à cet arrêt est d’autant plus problématique qu’il ne permet pas de concilier protection des salariés en CDD et contraintes organisationnelles de l’entreprise. Ainsi selon la CJUE, un besoin permanent de salariés en CDD n’imposerait pas nécessairement la requalification en CDI, quand bien même les emplois occupés auraient toujours été identiques. Les contrats conclus avec la même personne ou aux fins de l’accomplissement d’un travail identique peuvent ne pas caractériser un abus de l’employeur, le besoin en personnel étant susceptible de demeurer temporaire dès lors que « le travailleur remplacé est censé reprendre son activité à la fin de son congé »53.
L’article 53 de la loi du 5 septembre 201854 confirme la tendance à l’allègement des contraintes sur les CDD de remplacement. Pourront être conclus à titre expérimental pour les années 2019 et 2020 des contrats destinés à remplacer en même temps plus d’un salarié dans des secteurs déterminés par décret. Un salarié sera désormais autorisé à remplacer simultanément plusieurs salariés à temps partiel ou à pallier des absences successives par un contrat unique, prenant ainsi le contre-pied de la Cour de cassation qui avait toujours interdit ces pratiques55. Cet assouplissement dont l’ampleur dépendra des domaines d’activités concernés vient s’ajouter aux modifications plus générales qui, par convention ou accord de branche étendu, permettent de fixer la durée totale du CDD, le nombre maximal de renouvellements et les cas dans lesquels le délai de carence n’est plus applicable56.
L’arrêt du 14 février 2018 surprend d’autant plus aujourd’hui qu’il est en décalage avec les négociations qui ont eu lieu dans le cadre de l’assurance chômage pour minorer ou majorer le taux de contribution de chaque employeur en fonction « de la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours… »57. Si le remplacement d’un salarié absent devrait être légitimement exclu de ce mécanisme de modulation, il n’en demeure pas moins que la question de la taxation de la succession des CDD courts reste d’actualité. Les entreprises ont d’autres alternatives pour faire face à « l’indisponibilité d’employés bénéficiant de congés maladie, de congés de maternité ou de congés parentaux ou autres… », particulièrement celles qui ont un effectif important et dans lesquelles pour reprendre l’attendu de la Cour de cassation issu de l’arrêt de la CJUE « il est inévitable que les remplacements temporaires soient fréquemment nécessaires… ». Elles peuvent par accord d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, également applicable aux salariés à temps partiel, définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine dans la limite d’1 an voire 3 ans58. Des contrats de travail intermittent sont aussi envisageables dans les entreprises couvertes par un accord d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu59.
Au-delà du respect de l’orthodoxie juridique qui peut amener les juges du droit à enjoindre les juges du fond à mieux motiver leur décision, l’arrêt du 14 février 2018 laisse planer un doute sur les perspectives d’obtenir une requalification en CDI d’une succession de CDD de remplacement. Ce sentiment est d’autant plus pesant que l’examen des seuls faits (104 CDD sur 4 ans) amènerait à présumer un abus manifeste de l’employeur. La Cour de cassation semble néanmoins avoir réactivé dans l’arrêt du 23 janvier 2019 sa jurisprudence antérieure. La cour d’appel de renvoi sera ainsi encouragée à procéder à la requalification qui a toujours constitué, malgré la cassation, une option envisageable.
Romain MARIÉ
(À suivre)
4 – La surveillance du salarié
a – Ouverture du disque dur dénommé « données personnelles » de l’ordinateur professionnel du salarié : pas de violation de l’article 8 de la Convention EDH
b – Propos injurieux tenus sur un compte Facebook sécurisé et pouvoir disciplinaire
c – Géolocalisation des salariés : la Cour de cassation et le Conseil d’État au diapason
B – Durée du travail, salaire
1 – Rester joignable par téléphone hors du temps de travail constitue une astreinte
2 – La caractérisation de l’abus de confiance par le salarié qui détourne son temps de travail des fins pour lesquelles il perçoit une rémunération
3 – L’opposition de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires est inefficace, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié
C – Santé et sécurité au travail
D – Le contentieux du travail
III – Relations collectives de travail
A – La définition de l’établissement distinct après les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 : la fin de l’approche fonctionnelle
B – Parité femmes-hommes : application effective pour les syndicats
C – Revirement de jurisprudence à propos de l’assiette de calcul des subventions et contributions du comité d’entreprise
D – Contestation de la régularité de la désignation de l’expert-comptable du comité d’entreprise
Notes de bas de pages
-
1.
C. trav., art. L. 1235-7-1.
-
2.
CE, ass., 22 juill. 2015, n° 385668, Pages jaunes : Lebon.
-
3.
CE, 7 déc. 2015, n° 383856, Darty : Lebon.
-
4.
CE, 13 avr. 2018, n° 404090 : JCP S 2018, n° 24, p. 33-37, note Poncet S. ; JSL, n° 455, p. 13, note Hautefort M. ; SSL n° 1818, p. 6, concl. Dieu F. ; RDT 2018, p. 452, obs. Géa F.
-
5.
CE, ass., 22 juill. 2015, n° 383481 : Lebon.
-
6.
Par ex. : procédure d’élaboration, contenu du plan.
-
7.
Absence de contrôle de conformité aux stipulations conventionnelles de prévu.
-
8.
Sur ce point : Géa F., « À l’ombre de la branche », RDT 2018, p. 452 et s. ; Hautefort M., note sous CE, 13 avr. 2018, n° 404090 : JSL, n° 455, p. 13.
-
9.
Relèvent de la compétence du juge judiciaire le contrôle de la cause économique (CE, ass., 22 juill. 2015, n° 385816, Heinz France : Lebon), l’application des critères d’ordre des licenciements (CE, 1er févr. 2017, n° 387886, Avinov : Lebon), la mise en œuvre individuelle des mesures du PSE ou encore l’indemnisation du salarié à la suite de l’annulation de la décision administrative.
-
10.
Cass. soc., 21 nov. 2018, nos 17-16766 et 17-16767, PB : Gaz. Pal. 15 janv. 2019, n° 339r2, p. 80, note Gailhbaud C. ; JSL, n° 467, p. 13-15, note Nasom-Tissandier H. ; RDT 2019, p. 41-42, obs. Ranc S. ; JCP S 2018, n° 51, p. 29-30, note Bugada A. ; D. 2018, p. 2240.
-
11.
Cass. soc., 22 févr. 1995, n° 93-43404, PB.
-
12.
Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-20969, PB.
-
13.
Lorsqu’un PSE a été validé ou homologué. Sur des positions divergentes : CA Versailles, 18 janv. 2018, n° 17/06280 contra CAA Nancy, 16 oct. 2014, n° 14NC01417.
-
14.
Le découpage des catégories professionnelles délimite le champ d’application professionnel des critères d’ordre des licenciements.
-
15.
Cass. soc., 8 juin 1999, n° 97-40739, D.
-
16.
Cass. soc., 14 janv. 2003, n° 00-45700, D.
-
17.
CE, 10 oct. 2018, n° 395280, LCL : SSL, n° 1833, p. 5, concl. Lieber S.-J.
-
18.
Position similaire de la Cour de cassation : Cass. soc., 9 oct. 2012, n° 11-23142, PB.
-
19.
CE, 30 mai 2016, n° 387798, Fnac, PB.
-
20.
Cass. soc., 13 févr. 1997, n° 95-16648, PB ; Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11688, PB.
-
21.
CE, 7 févr. 2018, n° 407718, AEG Power Solutions : Lebon – CE, 7 févr. 2018, nos 403989 et 404077, Sté Polymont : Lebon – CE, 7 févr 2018, n° 403001, Sté Altuglas Int. : Lebon. Sur ces arrêts : JCP S 2018, n° 10, p. 21, note Poncet S. et Renaud J. ; BJT 2018, n° 305, p. 140, note Icard J. ; RDT 2018, p. 213, obs. Géa F. ; SSL, n° 1803, p. 6, Piveteau D. et p. 9, Lieber S.-J.
-
22.
Géa F., « Catégories professionnelles : le Conseil d’État affine sa doctrine (procédurale) », RDT 2018, p. 213 et s.
-
23.
C. trav., art. L. 1235-7-1.
-
24.
CE, 7 févr. 2018, nos 403989 et 404077, Sté Polymont.
-
25.
CE, 10 oct. 2018, n° 395280 : SSL, n° 1833, p. 5, concl. Lieber S.-J.
-
26.
Le législateur y incite dans le cadre du contrôle restreint de la validation. C. trav., art. L. 1233-57-2.
-
27.
Le contrôle de la validation ne porte pas sur cet objet.
-
28.
CE, 7 févr. 2018, n° 397900 : Lebon ; JCP E 2018, n° 17, p. 48, note Terrenoire C. ; Lexbase Hebdo n° 732, 2018, note Gadrat M. ; SSL, n° 1803, p. 14, conc. Dieu F. – CE, 24 oct. 2018, n° 397900 : SSL, n° 1844, p. 8, concl. Dieu F. ; RDT 2018, p. 851, obs. Mihman N.
-
29.
Le périmètre d’appréciation de la cause économique (C. trav., art. L. 1233-3) et du reclassement (C. trav., art. L. 1233-4) se limite aux entreprises situées sur le territoire national. Précisons qu’à la différence de la Cour de cassation, le Conseil d’État exclut la notion d’influence dominante définie à l’article L. 2331-1, II, du Code du travail. Cass. soc., 16 nov. 2016, nos 15-15190 à 15-15287, PB ; Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-23223, PB.
-
30.
C. trav., art. L. 2331-4 : « Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes, les entreprises mentionnées aux points a et c du paragraphe 5 de l’article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations ».
-
31.
Limité au territoire national pour les procédures engagées postérieurement à la publication des ordonnances du 22 septembre 2017. C. trav., art. L. 1233-61. Le contrôle de l’administration porte sur le caractère suffisant du plan de reclassement à partir d’une appréciation d’ensemble de ses mesures. Les recherches de postes disponibles dans ce périmètre doivent être sérieuses. Il est attendu de l’employeur une fois les postes disponibles identifiés, d’indiquer dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
-
32.
CE, ass., 22 juill. 2015, nos 385668, 383481 et 385816, PB.
-
33.
Cass. soc., 16 févr. 2005, n° 02-46649.
-
34.
Cass. soc., 15 mai 2007, n° 04-43663 : Bull. civ. V, n° 76.
-
35.
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 15-29330.
-
36.
Cass. soc., 26 oct. 2016, n° 15-15923.
-
37.
Cass. soc., 28 oct. 2014, n° 13-19527.
-
38.
Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-45344 : Bull. civ. V, n° 58.
-
39.
Cass. soc., 28 janv. 2009, n° 08-41633.
-
40.
Cass. soc., 14 sept. 2012, n° 12-12179.
-
41.
Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC.
-
42.
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-17966, PB.
-
43.
CJUE, 26 janv. 2012, n° C 586/10, Bianca Kücük c/ Land Nordrhein-Westfalen : RJS 2012, p. 26, obs. Lhernould J.-P.
-
44.
Cass. soc., 23 janv. 2019, n° 17-21796, D.
-
45.
Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-41891 : Bull. civ. V, n° 414.
-
46.
Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02-45342 : Bull. civ. V, n° 21 – Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-17705.
-
47.
Baugard D., « Requalification des successions de contrats de remplacement : une exigence de motivation renforcée », RDT 2018, p. 286.
-
48.
Cass. soc., 4 déc. 2013, n° 11-28314 : Bull. civ. V, n° 298.
-
49.
Aubert-Monpeyssen T., « Conditions de recours récurrent à des CDD de remplacement : la Cour de cassation précise sa jurisprudence », JCP E 2018, 1126.
-
50.
TA Melun, 14 mars 2019, n° 1703198.
-
51.
Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-17705 : Bull. civ. V, n° 114.
-
52.
Mouly J., « Les suites de CDD de remplacement : simple aggiornamento européen ou recul de la protection des salariés », Dr. soc. 2018, p. 364.
-
53.
CJUE, 26 janv. 2012, n° C-586/10, pt 38.
-
54.
JO, 6 sept. 2018.
-
55.
Cass. soc., 11 juill. 2012, n° 11-12243 : Bull. civ. V, n° 216.
-
56.
C. trav., art. L. 1242-8 ; C. trav., art. L. 1243-13 et C. trav., art. L. 1244-4.
-
57.
C. trav., art. L. 5422-12.
-
58.
C. trav., art. L. 3121-44.
-
59.
C. trav., art. L. 3123-33.