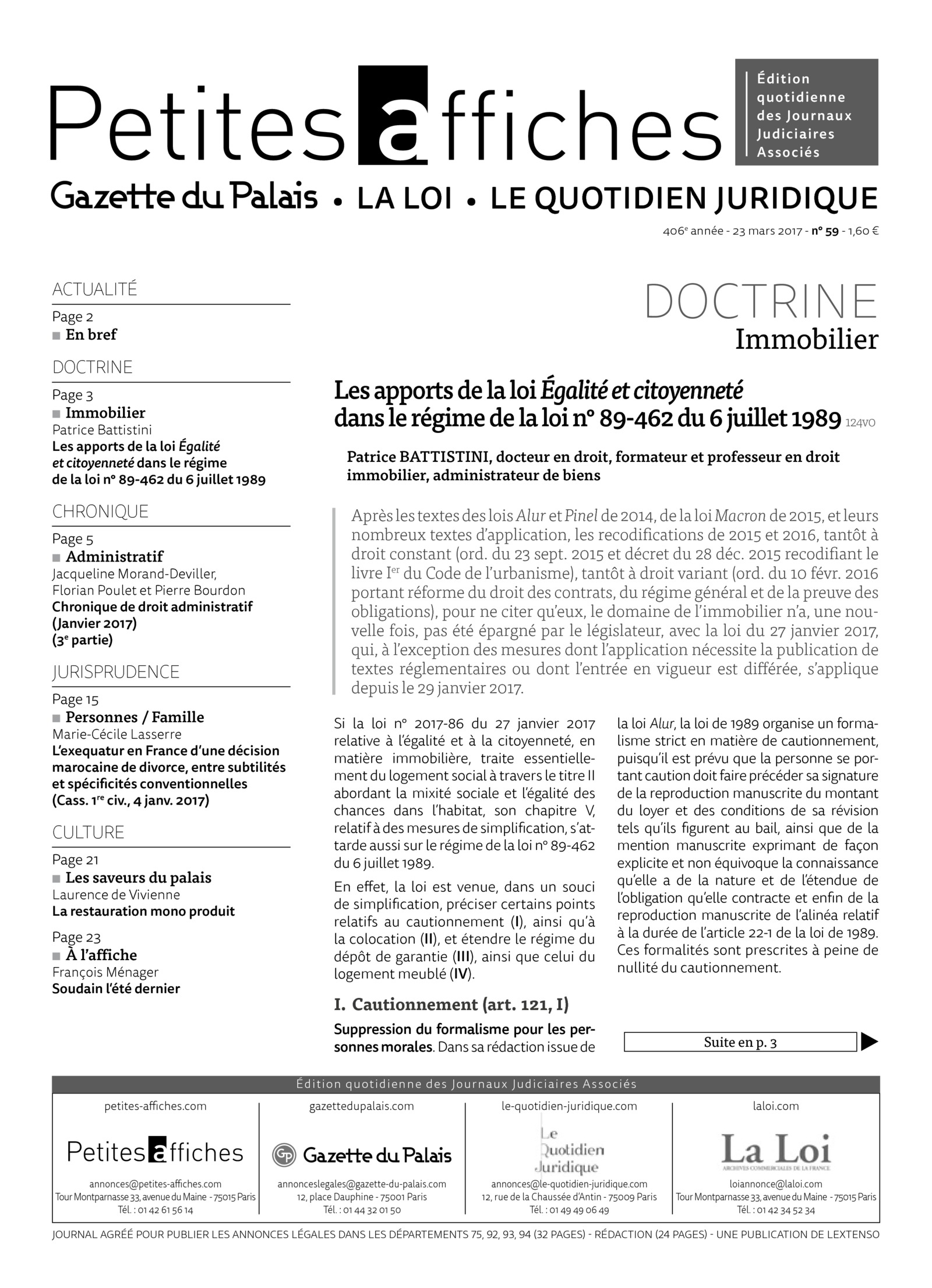Chronique de droit administratif (Janvier 2017) (3e partie)
I – Droit administratif des bien
II – Responsabilité administrative
III – Administration locale
IV – Contrats administratifs
V – Relations entre le public et l’Administration
Le droit de se faire représenter par un avocat lors d’une procédure administrative non juridictionnelle ne peut être limité sans texte
CE, 3 oct. 2016, n° 390726, B. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l’Administration ne peut pas faire obstacle à la représentation d’un administré par son avocat au cours d’une procédure administrative non juridictionnelle. C’est ce que le Conseil d’État est venu rappeler à la faveur de cette affaire. Par une lettre réseau du 10 juin 2014, valant circulaire, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a donné instruction aux directeurs des différentes caisses de sécurité sociale d’adresser les courriers relatifs à la procédure d’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie à l’employeur, même lorsque ce dernier a mandaté un avocat pour le représenter durant la procédure. Considérant que cette décision était de nature à porter atteinte à ses intérêts professionnels, un avocat a demandé son abrogation à la CNAMTS. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, l’intéressé a saisi le Conseil d’État, compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les circulaires et instructions de portée générale des autorités à compétence nationale, de conclusions tendant à l’annulation du rejet implicite de sa demande d’abrogation et à ce qu’il soit enjoint à la CNAMTS de procéder à cette abrogation. La recevabilité du recours ne faisait pas de doute : dès lors qu’elle constituait bien une disposition impérative à caractère général au sens de la jurisprudence Duvignères1, la lettre réseau litigieuse devait être regardée comme faisant grief et, par suite, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Du reste, à partir du moment où la décision concernait les conditions dans lesquelles s’exerce le mandat de représentation d’un employeur à l’occasion d’une procédure administrative, le requérant, avocat spécialisé en droit social, justifiait bien d’un intérêt pour agir. Au fond, le recours reposait principalement sur un texte : l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, aux termes duquel « les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires (…) ». Pour se prononcer sur le bien-fondé du recours, le Conseil d’État était donc appelé à appréhender deux questions successives : d’abord, est-ce que les caisses de sécurité sociale peuvent être qualifiées d’administration publique au sens de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 ? Puis, est-ce qu’une disposition législative ou réglementaire a apporté, en l’espèce, des réserves à la représentation de l’employeur par son avocat ? La première question a pu être réglée assez rapidement : comme le précisait l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et comme le confirme l’actuel article L. 100-3 du Code des relations entre le public et l’Administration (CRPA), la notion d’administration publique comprend bien les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, tels que les caisses de sécurité sociale. La reconnaissance de l’applicabilité de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 au cas présent n’a donc exigé aucun effort d’interprétation particulier (au demeurant, le Conseil d’État pouvait s’appuyer sur une précédente décision dans laquelle il avait implicitement admis l’applicabilité de cet article à la procédure suivie devant le service du contrôle médical des professionnels de santé2). Quant à la seconde question, il fallait, pour la résoudre, se rappeler que seule une disposition expresse peut exclure ou restreindre la possibilité de se faire représenter par un avocat3. Or, au cas présent, si les articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale prévoient les conditions dans lesquelles la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, ni ces dispositions, ni aucune autre n’excluent expressément la possibilité, pour l’employeur, de se faire assister ou représenter par un avocat. Par conséquent, comme le relève la décision, « le directeur général de la CNAMTS n’était pas compétent, dans le silence des dispositions réglementaires applicables, pour imposer aux caisses de sécurité sociale des règles qui, en ce qu’elles prescrivent de correspondre avec le seul employeur y compris lorsque celui-ci a fait le choix de se faire représenter par un avocat, sont susceptibles de faire obstacle à la représentation de cet employeur ». Ni la circonstance que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’information de l’employeur suffit à assurer la régularité de la procédure contradictoire, ni celle tirée de ce que, selon la lettre réseau litigieuse, les caisses peuvent, « dans le cadre d’une gestion attentionnée », envoyer un double des courriers à l’avocat, dans les formes assouplies (lettre simple, fax, mail, etc.), n’ont permis, à juste titre, d’éviter l’annulation demandée par le requérant et l’injonction, faite au directeur général de la CNAMTS, d’abroger le passage litigieux de sa circulaire. Si cette décision est une bonne nouvelle pour les avocats, qui voient ainsi le champ de leur activité professionnelle protégé, elle l’est aussi et surtout pour les administrés : grâce à elle, il est ainsi rappelé que la représentation par un avocat constitue une garantie du public dans ses relations avec l’Administration, y compris au stade de la procédure administrative non juridictionnelle. En l’absence de dispositions spéciales, l’Administration ne peut entraver l’exercice par l’avocat de sa mission de représentation, laquelle implique, notamment, que le mandataire puisse être l’interlocuteur privilégié de l’autorité concernée, conformément à la volonté du mandant.
FP
Les décisions orales de l’Administration échappent aux mentions obligatoires propres aux décisions écrites
CE, 12 oct. 2016, n° 395307, B. Récurrent dans la jurisprudence, le sujet de la formalisation des actes administratifs interroge, à chaque fois, le difficile équilibre à ménager entre, d’un côté, les garanties devant être accordées au public dans ses relations avec l’Administration et, de l’autre, les impératifs d’efficacité et de réalisme pesant sur cette dernière. Les faits à l’origine de l’affaire sont d’une rare banalité : un candidat se voit refuser, par le jury de la fédération française d’études et de sports sous-marins, la délivrance du brevet de moniteur fédéral du 1er degré. Mécontent des notes qui lui ont été communiquées à l’oral par le jury, l’intéressé décide de s’engager dans une série de recours, administratifs et juridictionnels, devant les instances compétentes de la fédération, puis le juge administratif. Dans la mesure où l’appréciation portée par un jury sur les mérites d’un candidat à un examen revêt un caractère souverain et s’avère donc très difficilement critiquable4, le requérant fait preuve d’une certaine ingéniosité : en plus de contester le bien-fondé de cette appréciation – sait-on jamais –, il entreprend de critiquer la forme prise, au cas présent, par cette appréciation. Son moyen est le suivant : aux termes du dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vigueur à l’époque des faits et aujourd’hui codifié à l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’Administration (CRPA), « toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Or, en l’espèce, l’appréciation des mérites de l’intéressé, qui constitue bien une décision, a présenté un caractère oral et n’a donc pas, par définition, comporté les mentions attendues d’une décision écrite. Les juges d’appel n’ayant pas répondu à ce moyen, le requérant se plaint, en cassation, d’une irrégularité de l’arrêt attaqué. Toutefois, la critique ne convainc pas le Conseil d’État qui la rejette à l’issue d’un raisonnement en trois étapes. Dans un premier temps, la haute juridiction donne son interprétation de l’actuel article L. 212-1 du CRPA : « si ces dispositions imposent qu’une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite ». Conforme à l’esprit du texte, cette lecture permet, bien heureusement, de préserver l’existence des décisions administratives orales. Dans un deuxième temps, le Conseil d’État approuve la cour qui a constaté qu’aucune des dispositions du règlement et de la charte des examens de la fédération concernée n’imposait de donner une forme écrite à l’appréciation des mérites des candidats aux épreuves du brevet de moniteur fédéral du 1er degré. Dans un troisième temps, la haute juridiction tire les conclusions qui découlent des deux étapes précédentes : dès lors qu’elle était orale, et qu’elle n’avait pas à être écrite, la décision litigieuse n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 212-1 du CRPA. Le moyen soulevé par le requérant était donc inopérant et, en s’abstenant d’y répondre, la cour n’a pas entaché son arrêt d’irrégularité. Bien que cette solution repose sur de solides justifications, qui doivent être approuvées, il est à noter qu’une autre réponse, plus sophistiquée, aurait pu être apportée au moyen invoqué par le candidat déçu. La solution retenue repose, en effet, sur le postulat que seules les décisions écrites entrent dans le champ de l’article L. 212-1 du CRPA. Ce postulat est logique : bien sûr, il ne saurait être exigé des décisions orales qu’elles comportent des mentions écrites ! Néanmoins, il n’aurait pas été impossible d’envisager une solution alternative, construite sur le modèle des règles de motivation applicables aux décisions administratives implicites. Selon ces règles, aujourd’hui prévues par l’article L. 232-4 du CRPA, « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Or, le Conseil d’État aurait pu appliquer la logique de ce dispositif aux décisions orales, en affirmant qu’une décision orale ne serait pas illégale du seul fait qu’elle ne comporterait pas les mentions obligatoires prévues par l’article L. 212-1 du CRPA, mais que, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours juridictionnel, une décision écrite confirmant la décision orale et comportant lesdites mentions devrait lui être communiquée dans le mois suivant cette demande, étant précisé que le délai de recours contre la décision initiale se trouverait alors prorogé. Cette solution, on en convient volontiers, aurait été audacieuse. Elle aurait supposé que le juge créât de toutes pièces un régime spécifique non envisagé par le législateur. Surtout, cette solution aurait été synonyme d’un accroissement du formalisme entourant les décisions administratives. En excluant purement et simplement les décisions orales du champ de l’article L. 212-1 du CRPA, le Conseil d’État s’inscrit ainsi dans la tendance jurisprudentielle actuelle caractérisée par le desserrement de la contrainte formaliste qui pèse sur l’Administration ; et, en relevant que seules les décisions qui sont ou doivent être écrites entrent dans le champ de l’article L. 212-1 du CRPA, il renvoie aux auteurs de décisions administratives ou, le cas échéant, aux autorités législatives et réglementaires, la responsabilité de déterminer les décisions qui, eu égard à leur nature ou à leur portée, mériteraient d’être soumises au formalisme prévu par cet article.
FP
Le droit de saisir l’Administration par voie électronique désormais effectif, quelle que soit l’autorité compétente
D. n° 2016-1411, 20 oct. 2016, relatif aux modalités de saisine de l’Administration par voie électronique. Si l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 avait déjà ouvert la voie aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, celle du 23 octobre 2015, relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l’Administration (CRPA), a apporté d’importants progrès dans ce domaine. Désormais, ce code consacre, au profit du public, un véritable « droit de saisine par voie électronique » de l’Administration (tel est l’intitulé de la sous-section au sein de laquelle s’insèrent les dispositions du présent décret). Ce droit comporte deux volets. D’une part, « toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut (…) adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie »5. L’Administration est alors régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information, sans pouvoir exiger de la personne intéressée la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. D’autre part, l’Administration est invitée à mettre « en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d’interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 »6. Ces téléservices (ou téléprocédures) visent l’échange dématérialisé de formalités entre les autorités administratives et les usagers : on peut penser, par exemple, aux téléservices qui permettent déjà d’effectuer, en ligne, la déclaration d’une association, une demande d’inscription sur les listes électorales, un signalement de faits illicites constatés sur le réseau internet ou encore une demande de subvention à l’échelle locale. Depuis l’origine, la mise en œuvre de ce nouveau droit est subordonnée à l’intervention d’un décret en Conseil d’État, destiné à en déterminer les conditions d’application. Quelques jours seulement après l’adoption de l’ordonnance relative aux dispositions législatives du CRPA, le gouvernement avait pris un premier texte d’application7. Toutefois, et c’était l’une de ses faiblesses principales, ce décret de novembre 2015 avait retenu une définition excessivement restrictive de l’« Administration » susceptible d’être saisie par voie électronique : selon son article 1er, en effet, le texte n’était applicable qu’« aux services de l’État et à ses établissements publics à caractère administratif ». Toutes les autres composantes de l’Administration se trouvaient ainsi exclues du champ du décret et les administrés ne pouvaient donc pas, faute de texte d’application, faire valoir auprès d’elles leur droit de saisine électronique. Procédant à l’abrogation du décret du 5 novembre 2015, le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 20168 comble, à compter du 7 novembre 2016, cette lacune préjudiciable. Dès lors qu’il organise la codification, au sein du CRPA, de ses propres dispositions, et qu’il ne prévoit pas de règles spéciales restreignant son champ d’application, le nouveau décret s’applique à l’Administration telle que la définit précisément le CRPA, à savoir : « les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale »9. Ainsi, le décret de 2016 détermine, et ce n’est pas rien, le régime commun du droit de saisir l’Administration par voie électronique : quelle que soit l’administration concernée, ce droit devra être exercé selon les mêmes modalités. Il faut le souligner, ce régime, tel qu’il résulte du décret de 2016, a très largement atteint l’objectif de simplification qu’il recherchait. Les conditions de mise en œuvre du droit de saisir l’Administration par voie électronique sont présentées clairement dans le texte et apparaissent tout à fait raisonnables. Parmi ces conditions, figure, par exemple, l’identification de l’usager auprès de l’administration saisie : selon le décret, celle-ci s’effectue simplement par le biais du numéro d’inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, s’il s’agit d’une entreprise, du numéro d’inscription au répertoire national des associations, s’il s’agit d’une association, ou des nom et prénom et des adresses postale et électronique, dans les autres cas. De même, sont précisées les mentions que doit comporter l’accusé de réception électronique, à savoir : la date de réception de l’envoi électronique effectué par la personne ; la désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone ; et, si la saisine constitue une demande, l’information selon laquelle cette demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou, à l’inverse, de rejet, ainsi que la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. Les autres éléments de ce régime commun n’apparaissent pas moins intelligibles. Il ne restera donc plus qu’à observer, dans les mois qui viennent, si et dans quelle mesure les administrés s’approprient ce nouveau droit, désormais opposable à toutes les composantes de l’Administration.
FP
VI – Justice administrative
Les dispositions législatives réservant un monopole aux avocats aux Conseils devant le Conseil d’État ne portent pas atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit
CE, 28 sept. 2016, n° 397231, B. Si les critiques contre l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont anciennes, elles se font de plus en plus fréquentes et de plus en plus vives depuis plusieurs années. La discussion et l’adoption de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ont constitué, bien sûr, l’un des moments forts de cette contestation. Mais, le vote de ce texte n’a pas pour autant fait taire toutes les critiques. La décision du 28 septembre dernier en témoigne. Les faits sont les suivants : comme d’autres avant lui, un avocat parisien a considéré que les avocats au barreau devraient être traités, devant le Conseil d’État, de la même façon que les avocats aux Conseils. Il a donc sollicité du Premier ministre l’abrogation de l’article R. 432-1 du Code de justice administrative (CJA), aux termes duquel, devant le Conseil d’État, les écritures des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentées par un avocat au Conseil d’État lorsque le ministère d’un avocat est obligatoire, et des articles R. 613-5 et R. 733-1 du même code, en tant qu’ils réservent aux seuls avocats au Conseil d’État la faculté de présenter, pour les parties qu’ils représentent, des observations orales à l’audience devant le Conseil d’État. Le Premier ministre n’ayant pas répondu à cette demande d’abrogation, l’intéressé a saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus implicite qui lui a été ainsi opposé. Or, à l’appui de ses conclusions, le requérant a entrepris de soulever une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’il a dirigée contre pas moins de trois séries de dispositions : les dispositions législatives de l’ordonnance royale du 10 septembre 1817 relative à l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. C’est cette QPC qui est étudiée par le Conseil d’État à l’occasion de la présente affaire. Les critiques dirigées contre l’ordonnance de 1817 et l’article 5 de la loi de 1971 ne retiennent pas très longtemps l’attention du juge, dès lors qu’elles ne répondent pas aux conditions de transmission des QPC. S’agissant des dispositions de l’ordonnance de 1817, il est reproché au requérant, notamment, de ne pas avoir assorti sa QPC des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé10. En ce qui concerne l’article 5 de la loi de 1971, il est décidé que, dès l’instant où ces dispositions ont été reprises par d’autres dispositions législatives postérieures (en l’occurrence l’article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée) et que ces dernières ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (dans sa décision Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC), le requérant, qui n’invoque aucun changement de circonstances, ne peut plus utilement contester la constitutionnalité des dispositions de l’article 5 ; à cet égard, c’est la première fois que le Conseil d’État formule explicitement cette cause de non-examen des QPC, venant ainsi clarifier encore davantage les conditions de transmission de ces dernières. Finalement, les seules critiques qui font l’objet d’un examen au fond sont celles dirigées contre l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ». Reprenant une interprétation dégagée en 201411, le Conseil d’État affirme que « ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, ont pour effet de réserver aux seuls avocats de l’ordre des avocats, au Conseil d’État et à la Cour de cassation la représentation des parties devant le Conseil d’État lorsque le ministère d’avocat est rendu obligatoire par les règles de procédure applicables, ainsi que la faculté de plaider à l’audience devant le Conseil d’État ». Compte tenu de la rédaction de ce texte et du caractère normalement réglementaire de la procédure juridictionnelle administrative, une telle lecture ne va pas de soi. Néanmoins, celle-ci semble faire l’objet d’un certain consensus au sein du Conseil d’État12 et sa confirmation en l’espèce permettait, de façon opportune, de regarder l’article 4 comme « applicable au litige », ce qui était nécessaire pour examiner le bien-fondé de la QPC. S’agissant de ce bien-fondé, précisément, le requérant soutient que l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 méconnaît le principe d’égal accès aux dignités, places et emplois publics. Toutefois, après avoir relevé que les dispositions de cet article « n’ont ni pour objet, ni pour effet, de régir l’accès aux fonctions d’avocat au Conseil d’État », le juge décide que le requérant n’est pas, « en tout état de cause », fondé à invoquer une violation de l’article 6 de la Déclaration de 1789. L’emploi du syntagme « en tout état de cause » fait certainement référence à l’idée selon laquelle, à l’instar des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce, les avocats aux Conseils ne peuvent pas être regardés comme occupant des dignités, places ou emplois publics au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789. Ensuite et surtout, le requérant soutient que l’article 4 est contraire au droit à un procès équitable, à l’égalité des requérants devant la justice, à l’égalité de traitement entre avocats, ainsi qu’à la liberté d’entreprendre de ces derniers dans l’exercice de leur profession. Or le Conseil d’État balaie d’un revers de main ces griefs, au motif « qu’eu égard aux spécificités des règles de procédure devant le Conseil d’État, juridiction suprême de l’ordre administratif, le monopole de la représentation et de la prise de parole par des avocats spécialisés (…) répond à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et vise à garantir l’exercice effectif de leurs droits par les parties ». Si cette réponse peut se prévaloir de solides acquis dans la jurisprudence, tant administrative13 que judiciaire14 et européenne15, elle apparaît quelque peu décevante. Certes, la solution qui consiste à octroyer un brevet de constitutionnalité au monopole législatif de représentation et de parole des avocats aux Conseils devant le Conseil d’État, statuant en cassation, doit être approuvée. Alors même qu’elle comporte l’inconvénient, non négligeable, d’obliger les requérants dont le procès va jusqu’au stade de la cassation à changer d’avocats et donc à quitter ceux qui les ont accompagnés, parfois depuis le début et pendant longtemps, une telle solution assure les justiciables de bénéficier de l’aide de professionnels spécialisés, maîtrisant pleinement la technique de cassation. Cependant, on regrette que le Conseil d’État ait rejeté en bloc les critiques soulevées par le requérant, sans distinguer selon le type de recours formé devant le Conseil d’État. Citant l’article L. 111-1 du CJA, la décision rappelle pourtant que le Conseil d’État ne se contente pas, contrairement à son homologue judiciaire, de statuer sur les recours en cassation, mais se prononce aussi sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d’appel. Or si le monopole des avocats aux Conseils apparaît justifié en cassation pour les raisons évoquées à juste titre par la décision, l’est-il de la même façon et pour les mêmes motifs lorsque le Conseil d’État statue en qualité de juge de premier ressort, de juge d’appel et, en première instance ou en appel, de juge des référés ? On aurait également pu attendre une réponse plus raffinée au grief tiré, en particulier, de l’atteinte à l’égalité de traitement entre les avocats, dès lors que si les avocats au barreau ne peuvent pas accéder au Conseil d’État, les avocats aux Conseils peuvent, quant à eux, accéder aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel… Bien que cette décision du 28 septembre 2016 soit favorable aux avocats aux Conseils, elle ne saurait les rassurer totalement sur les évolutions susceptibles d’affecter, à l’avenir, la profession. En effet, le 10 octobre 2016, soit quelques jours après cette affaire, l’Autorité de la concurrence, agissant au titre de l’article 57 de la loi du 6 août 2015, a rendu un avis dans lequel elle dénonce, notamment, la « forte concentration de l’offre sur un petit nombre d’offices très rentables » et la possibilité, pour l’ordre, de « réguler, voire restreindre l’accès à la profession », via l’Institut de formation et de recherche des avocats aux Conseils16. Adoptant, pour l’heure, une attitude prudente et progressive, l’Autorité a recommandé au ministre, qui l’a aussitôt suivie17, la création de (seulement) quatre nouveaux offices d’avocat aux Conseils. C’est donc dans ce contexte tendu que le Conseil d’État, après avoir rejeté la QPC qui lui était posée, devra statuer sur la légalité du refus d’abroger les dispositions, cette fois-ci réglementaires, relatives au monopole dont bénéficient devant lui les avocats aux Conseils.
FP
Dès lors que le référé précontractuel a été mis à disposition du pouvoir adjudicateur dans l’application Télérecours, la faculté de signer le contrat est suspendue
CE, 17 oct. 2016, n° 400791, B. Les contentieux formés, en urgence, aux fins de prévenir ou rattraper la violation des obligations de publicité et de mise en concurrence pesant sur les pouvoirs adjudicateurs sont souvent délicats à appréhender, tant il est parfois difficile de faire le départ entre ce qui relève de la manœuvre frauduleuse et de la réelle bonne foi. La présente affaire n’échappe pas à ce constat. En l’espèce, une plate-forme d’achats, située à Brest et relevant du ministère de la Défense, a lancé, en janvier 2016, une procédure d’appel d’offres, ayant pour objet, notamment, la gestion des zones de regroupements de déchets des formations de la base de défense de Brest-Lorient. Le 15 avril 2016, le pouvoir adjudicateur a informé l’une des sociétés candidates, la société Tribord, que son offre avait été rejetée. Le 25 avril 2016, cette société a décidé de déposer devant le tribunal administratif de Rennes, sous une forme non dématérialisée, un référé précontractuel, sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative (CJA). Le greffe du tribunal a alors mis à disposition du ministre de la Défense ce référé précontractuel, en utilisant l’application informatique Télérecours à laquelle son administration s’était inscrite. Mais, le même jour, environ cinq heures plus tard, le ministre a signé le contrat litigieux. La société Tribord s’est alors désistée de son référé précontractuel et a présenté au juge, sur le fondement de l’article L. 551-13 du CJA, une demande de référé contractuel, tendant à l’annulation du contrat. Le juge des référés ayant fait droit à cette demande d’annulation, le ministre de la Défense s’est pourvu en cassation contre son ordonnance. Le pourvoi reproche au juge des référés du tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que la voie du référé contractuel était ouverte à la société Tribord, alors que cette dernière avait déjà formé un référé précontractuel. D’après le pourvoi, le juge des référés aurait méconnu l’article L. 551-14 du CJA, suivant lequel le recours en référé contractuel « n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours [en référé précontractuel] dès lors que le pouvoir adjudicateur (…) a respecté [l’obligation de suspendre la signature du contrat] prévue à l’article L. 551-4 (…) et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». Cette démonstration ne pouvait toutefois pas convaincre le Conseil d’État. En effet, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-8-2 du CJA que, lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification d’une requête doit être réputée avoir été reçue par la partie défenderesse dès sa mise à disposition dans l’application Télérecours. Or ces dispositions sont bien applicables à la procédure de référé précontractuel engagée en l’espèce, dès lors, d’une part, que le juge saisi d’un tel référé est tenu de statuer dans un délai inférieur à un mois et, d’autre part, que l’administration du ministre de la Défense avait pris l’initiative de s’inscrire à l’application. Dans ces conditions, le Conseil d’État approuve le juge des référés du tribunal administratif d’avoir jugé que le pouvoir adjudicateur avait méconnu les dispositions de l’article L. 551-4 du CJA en signant le contrat postérieurement à la réception du référé précontractuel et que, de ce fait, la voie du référé contractuel était ouverte à la société Tribord en application de l’article L. 551-14. Cette décision n’est pas une surprise : elle s’inscrit dans la jurisprudence récente relative aux conséquences de l’inscription à l’application Télérecours. En particulier, elle confirme, dans le contentieux précontractuel, ce que le Conseil d’État avait déjà décidé dans le contentieux administratif général : dès lors que tout justiciable inscrit à cette application est en capacité de « consulter les communications et notifications relatives aux requêtes (…), quelle que soit la forme sous laquelle [ces dernières ont été] introduites et quelle que soit la date à laquelle il s’est inscrit dans l’application », « la circonstance qu’une requête ait été introduite sous une forme non dématérialisée ne fait pas obstacle à ce que, à tout moment de la procédure, soient adressées sous forme dématérialisée, dans le cadre de cette application, des communications et notifications relatives à cette procédure à toute partie ou tout mandataire inscrit »18. Finalement, l’apport sans doute le plus important de la présente affaire réside dans le moment où elle est intervenue, à savoir quelques jours seulement avant la signature du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs19. Annoncé à de multiples reprises et consolidant un processus de déploiement engagé il y a désormais plusieurs années, ce décret rend obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, l’utilisation de Télérecours pour les avocats au barreau, les avocats aux Conseils, les personnes morales de droit public autres que les communes de moins de 3 500 habitants et les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Pour ce qui concerne ces usagers de la justice administrative, l’obligation d’utiliser Télérecours les concerne, naturellement, lorsqu’ils occupent la position de demandeur à l’instance : selon le décret, cette obligation est prescrite « à peine d’irrecevabilité » de la « requête » et des « autres mémoires du requérant ». Mais elle les intéresse tout autant lorsqu’ils occupent la place de défendeur ou, le cas échéant, d’intervenant, puisque l’utilisation de l’application s’impose alors à « tous leurs mémoires », « sous peine de voir leurs écritures écartées des débats ». D’une certaine manière, le fait que l’utilisation de Télérecours soit rendue obligatoire à tous ces usagers-là sécurise quelque peu leur situation : dorénavant, ils auront au moins la certitude qu’ils sont soumis, d’une façon générale, à cette application, ce qui évitera la répétition d’affaires passées dans lesquelles certains usagers avaient cru, de bonne foi, pouvoir ne pas utiliser Télérecours, notamment en raison du caractère facultatif de cette application, alors que leur inscription volontaire avait finalement, dans les faits, rendu nécessaire son utilisation20. Pour autant, à partir du moment où le décret assortit au non-respect de l’obligation d’utiliser Télérecours de lourdes sanctions procédurales, les usagers intéressés doivent veiller à maintenir entière leur vigilance. De ce point de vue, la décision du 17 octobre 2016 constitue une piqûre de rappel bienvenue : à une baisse de vigilance à l’égard de Télérecours, correspond nécessairement des conséquences contentieuses, souvent pénalisantes.
FP
Justice administrative de demain et modernisation de la justice du XXIe siècle : quels changements, pour quels progrès ?
D. n° 2016-1480, 2 nov. 2016, portant modification de la partie réglementaire du CJA et L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle. Régulièrement modifiées à la marge, les dispositions du Code de justice administrative (CJA) font rarement l’objet d’une réforme d’ampleur. Celle que traduisent le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 201621 et la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 201622 en est une. Cette réforme trouve son origine, en grande partie, dans l’installation par le vice-président du Conseil d’État, en mars 2015, d’un groupe de travail chargé de mener une réflexion d’ensemble sur les perspectives d’évolution de la justice administrative dans un contexte marqué par deux tendances contradictoires : d’un côté, un nombre de requêtes qui ne cesse d’augmenter (de 3 à 6 % par an) et de l’autre, des moyens, notamment humains, qui stagnent et une productivité qui ne saurait croître encore davantage sous peine d’altérer la qualité de la justice rendue. C’est donc à la délicate question suivante que le groupe de travail a dû répondre : comment faire face, dans les mois et années à venir, à la croissance du contentieux avec des moyens constants ? Intitulé Réflexions sur la justice administrative de demain, le rapport du groupe a été remis à son commanditaire en novembre 2015. Une première partie importante des propositions de ce rapport ont été mises en œuvre par voie réglementaire, à la faveur de l’édiction du décret n° 2016-1480. Une autre partie, qui nécessitait l’intervention du législateur, a été intégrée dans la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en même temps que d’autres mesures évoquées de longue date.
S’agissant, en premier lieu, du décret. Prolongeant l’intitulé officiel du rapport de 2015 et souhaitant probablement insister sur les innovations apportées par la réforme, les promoteurs du texte lui ont donné un nom, ou plutôt un prénom : Jade, pour justice administrative de demain. Ou quand le marketing se voit appliqué au contentieux administratif… En plus de bénéficier d’une large communication dans les revues spécialisées, le décret a eu droit à un communiqué publié, le jour de sa parution au Journal officiel, sur le site internet du Conseil d’État ; le texte y est présenté comme permettant d’« accélérer le traitement de certaines requêtes, de renforcer les conditions d’accès au juge, de dynamiser l’instruction et d’adapter l’organisation et le fonctionnement des juridictions administratives à de nouveaux défis ». À en croire le communiqué donc, le décret n’apporterait que des progrès à la justice administrative. S’il est impossible d’analyser ici toutes les dispositions du texte, tant les apports de celui-ci sont nombreux, l’attention peut néanmoins être portée sur quelques mesures, parmi les plus significatives, aux fins de déterminer si le produit est conforme à la publicité qui en est faite. Des progrès, il y en a, incontestablement. Parmi les mesures allant dans ce sens, peuvent être mentionnées, par exemple : l’extension de la dispense d’avocat à tous les contentieux sociaux ; la possibilité, pour le juge, d’adresser aux parties une mesure d’instruction à l’objet et au champ limités, sans qu’y fasse obstacle la clôture de l’instruction ; la clarification des actions indemnitaires sur lesquelles peut statuer un juge unique ; ou encore la suppression de la dérogation à l’obligation de lier le contentieux par une décision administrative préalable dont bénéficiaient, au titre d’une survivance historique difficilement justiciable aujourd’hui, les litiges de travaux publics. En tant qu’elles renforcent les droits des justiciables ou qu’elles servent l’objectif de bonne administration de la justice sans porter atteinte à ces droits, ces mesures doivent être saluées. D’autres mesures, en revanche, si elles apportent leur part de progrès, comportent néanmoins des lacunes. Tel est le cas, en particulier, de la modification du montant de l’amende susceptible d’être infligée à l’auteur d’une requête que le juge estime abusive : ce montant est porté de 3 000 à 10 000 €. Certes, cette réévaluation tient compte d’une réalité : le risque d’une amende de 3 000 € n’effraie plus certains requérants. Toutefois, l’hétérogénéité des profils des demandeurs et les disparités de leur situation économique sont une autre réalité qui s’impose : or le nouveau montant maximum de 10 000 € revêt un caractère excessivement dissuasif pour les requérants les plus vulnérables. Il ne s’agit que d’un plafond, naturellement, mais il ne saurait être oublié que l’appréciation portée sur le montant de l’amende par les juges inférieurs revêt un caractère souverain. On aurait donc apprécié voir le décret encadrer le pouvoir souverain des tribunaux et des cours, par exemple en distinguant, au sein des requérants, entre les personnes physiques et les personnes morales, ou en prévoyant expressément, à l’image de l’article L. 761-1 du CJA, que le juge doit tenir compte de la situation économique du requérant (le mentionner aurait permis de rassurer le demandeur potentiel ou d’aider son avocat à le faire). Du reste, le décret aurait pu également saisir l’occasion pour créer, en contrepartie de l’amende pour recours abusif, une amende pour défense abusive. Il est en effet acquis que l’Administration, qui occupe en règle générale la position de défendeur, peut faire montre d’une mauvaise foi tout aussi manifeste que celle des requérants abusifs. Cette mauvaise foi, qui nuit à la bonne administration de la justice, devrait pouvoir être sanctionnée. Autre mesure qui mériterait d’être complétée : la possibilité, pour le juge, de fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens. Ce pouvoir de cristalliser les moyens en discussion, sans clore l’instruction, est directement inspiré de l’article R. 600-4 du Code de l’urbanisme : preuve, s’il en fallait une, que le contentieux de l’urbanisme constitue, à bien des égards, un vivier d’idées et d’expériences pour le contentieux administratif général. Il est vrai que cette mesure donne au juge les moyens de mieux maîtriser le déroulement de l’instruction, en évitant que les parties ne sortent tardivement de leur chapeau un ou plusieurs moyens jusque-là non invoqués. Toutefois, elle est également de nature à priver les parties de la possibilité de revendiquer le bénéfice de moyens que seule une longue discussion, arrivée à maturation, permet parfois de faire apparaître. Dès lors, afin de rééquilibrer la situation, cette nouvelle mesure gagnerait à être complétée, dans un avenir proche, par un abandon de la jurisprudence, baptisée abusivement Intercopie23, en vertu de laquelle le requérant n’est plus recevable, après l’expiration du délai de recours, à invoquer de nouveaux moyens qui ne se rattacheraient pas à une cause juridique ouverte dans ce délai. Puisque le juge pourra désormais cristalliser les moyens en débat, il n’est plus nécessaire de maintenir cette jurisprudence dont le caractère contre-productif a pu être établi. Enfin, au-delà de ces mesures incomplètes, on découvre derrière l’emballage publicitaire du décret certaines dispositions synonymes, malheureusement, de régressions pour les justiciables. Il en va ainsi, d’abord, de la suppression de la possibilité de lier le contentieux en cours d’instance24. Désormais, un nouvel alinéa inséré à l’article R. 421-1 du CJA dispose que « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’Administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Certes, cette solution vise à revaloriser le rôle qui est donné, aujourd’hui, à la décision préalable, à savoir favoriser un règlement amiable des litiges. Néanmoins, en plus d’allonger la procédure, la règle de la liaison préalable constitue, dans un certain nombre de contentieux, une véritable chausse-trappe pour les requérants les moins avertis. La faculté, ouverte par la jurisprudence, de lier le contentieux en cours d’instance permettait de limiter les risques attachés à cette cause d’irrecevabilité, sans anéantir toute chance de règlement amiable du litige. Peuvent être également mentionnées, parmi les dispositions régressives, celles qui offrent la possibilité de décider, par ordonnance, du rejet des requêtes d’appel ou de la non-admission des pourvois « manifestement dépourvus de fondement ». Si l’objet de la nouvelle mesure était, comme il l’a été annoncé, de permettre de rejeter les requêtes d’appel ou de ne pas admettre les pourvois qui n’ont aucune chance d’aboutir compte tenu du caractère constant de la jurisprudence sur la question posée, il aurait fallu le dire dans le texte, par exemple en visant les hypothèses de recours ne comportant que des moyens de légalité interne manifestement infondés ou dont le rejet est certain au vu d’une jurisprudence établie. À la place de cela, le décret crée un nouveau cas d’ouverture de la procédure d’ordonnances de tri qui vient s’ajouter au cas dans lequel le recours ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Or, il est difficile de ne pas voir que, dans ce dernier cas précisément, le recours constitue déjà un recours manifestement dépourvu de fondement, en sorte que la cohérence de l’ensemble se trouve désormais atteinte. De surcroît et surtout, cette nouvelle mesure conduit à conférer un pouvoir d’appréciation excessif au juge. Le texte ne donne, en effet, aucun critère permettant d’encadrer l’appréciation portée par le juge sur le point de savoir si la requête d’appel ou le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement. Certes, si l’ordonnance concerne une requête d’appel, un contrôle du juge de cassation sera possible, mais au regard de quels critères le Conseil d’État exercera-t-il ce contrôle ? Par ailleurs et en tout état de cause, lorsque l’ordonnance concernera un pourvoi, aucun contrôle, par définition, ne pourra être réalisé. Les risques de dérive dans l’usage de ce dispositif sont donc possibles.
S’agissant, en second lieu, de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Parce que la justice du XXIe siècle, précisément, ne saurait se limiter aux justices civile et pénale, ce texte, composé d’une centaine d’articles, intéresse la justice administrative. Trois séries de dispositions la concernent directement. Deux d’entre elles ont vocation à créer de nouvelles voies de recours offertes aux usagers de la justice administrative. C’est ainsi que la loi du 18 novembre 2016 crée, au sein du CJA, deux chapitres entiers consacrés à l’action de groupe devant le juge administratif. Cette action est envisagée « lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles ». Elle doit permettre soit la cessation du manquement constaté, soit l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage, soit encore ces deux objectifs à la fois. Eu égard à ses conséquences potentiellement massives, cette action est strictement encadrée par la loi et, pour l’heure, ne peut être exercée que dans quatre domaines précis : la lutte contre les discriminations, la défense de l’environnement, la protection des personnes en matière de santé et le traitement des données à caractère personnel. De même, le texte introduit dans le CJA l’action en reconnaissance de droits. Celle-ci entend permettre « à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt ». Cette action peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée, mais, contrairement à l’action de groupe, elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. Compte tenu, là encore, des effets en chaîne susceptibles d’être générés par cette procédure, le législateur est heureusement venu prévoir, en détail, les modalités précises de mise en œuvre de cette voie de droit et déterminer l’office du juge qui viendrait à en être saisi. Mais c’est surtout une troisième série de dispositions qui attire particulièrement l’attention, tant ces dernières avaient été annoncées, notamment par différents travaux produits par le Conseil d’État. Contrairement aux deux précédentes, cette troisième série de dispositions ne crée pas de nouveaux recours devant le juge, mais s’inscrit dans la volonté, exprimée depuis longtemps, de développer les modes alternatifs de règlement des litiges. En effet, la loi du 18 novembre 2016 dote le CJA d’un régime complet de la médiation en matière administrative, avec cette idée d’encourager, par tous moyens, le recours à ce procédé. Ainsi, la médiation, jadis cantonnée aux litiges transfrontaliers, devient possible pour tous les types de différends administratifs. Surtout, son champ d’application se voit étendu par le fait que le législateur met fin à la distinction entre conciliation et médiation, au profit de cette dernière notion : désormais, la médiation « s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Le recours à cet outil peut être initié par les parties, bien sûr, mais aussi par le juge ou, le cas échéant, un expert25. Conscient de ce que les modes alternatifs de règlement des litiges ont été, jusqu’à présent, relativement délaissés par les justiciables, le législateur a tenté de forcer quelque peu le destin, en prévoyant, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans, un dispositif de médiation préalable obligatoire avant toute saisine du juge dans deux domaines : les contentieux relatifs à la situation personnelle des agents publics et les contentieux sociaux. Saisi des dispositions instituant ce mécanisme de médiation obligatoire, le Conseil constitutionnel a jugé qu’elles n’étaient « pas inintelligibles et qu’elles ne méconnaissaient ni l’article 37-1 de la Constitution ni aucune autre exigence constitutionnelle »26. L’entrée en vigueur de ce dernier mécanisme demeure néanmoins soumise à l’intervention d’un décret en Conseil d’État ; or, les difficultés rencontrées, par le passé, pour rendre effective la procédure de recours administratif préalable obligatoire initialement prévue par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 en faveur des différends intéressant la situation personnelle des agents publics, rappellent à quel point l’édiction d’un tel texte d’application peut se faire attendre.
FP
Notes de bas de pages
-
1.
CE, sect., 18 déc. 2002, n° 233618 : Lebon, p. 463.
-
2.
V. CE, 29 oct. 2008, n° 304426 : Lebon T., p. 797.
-
3.
V., en ce sens, CE, 3 oct. 2003, n° 240270 : Lebon T., p. 625.
-
4.
V. not. CE, 20 mars 1987, n° 70993 : Lebon, p. 100.
-
5.
CRPA, art. L. 112-8. Relevons que la formule « toute personne » demeure quelque peu relative, dès lors que, en vertu de l’article L. 112-7 du même code, les agents de l’Administration ne sont pas compris dans le champ de cette disposition.
-
6.
CRPA, art. L. 112-9.
-
7.
V. D. n° 2015-1404, 5 nov. 2015, relatif au droit des usagers de saisir l’Administration par voie électronique : JO n° 258, 6 nov. 2015.
-
8.
D. n° 2016-1411, 20 oct. 2016, relatif aux modalités de saisine de l’Administration par voie électronique : JO n° 247, 22 oct. 2016.
-
9.
CRPA, art. L. 100-3, 1°.
-
10.
Rappelant l’exigence de précision qui pèse sur l’auteur d’une QPC, v. Cons. const., 26 juill. 2013, n° 2013-334/335 QPC.
-
11.
V. CE, 13 janv. 2014, n° 360145.
-
12.
En ce sens, v. CE, 22 juill. 2015, n° 389902 et CE, 18 mars 2016, n° 376792.
-
13.
V. JRCE, 24 févr. 2006, n° 289394 : Lebon T., p. 909 et CE, 13 janv. 2014, n° 360145.
-
14.
V. Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 99-15696 : Bull. civ. I, n° 136, p. 91 et Cass. crim., 4 mars 2014, n° 13-90038.
-
15.
V. CEDH, 8 juill. 2003, n° 46096/99 et CEDH, 26 sept. 2006, n° 25456/02.
-
16.
V. Aut. conc., avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation : JO n° 255, 1er nov. 2016.
-
17.
V. arrêté du 5 décembre 2016 portant création d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation : JO n° 283, 6 déc. 2016.
-
18.
CE, 11 mai 2015, n° 379356 : Lebon, p. 168.
-
19.
JO n° 257, 4 nov. 2016.
-
20.
V. CE, 6 oct. 2014, 380778 : Lebon T., p. 799.
-
21.
D. n° 2016-1480, 2 nov. 2016, portant modification de la partie réglementaire du CJA : JO n° 257, 4 nov. 2016.
-
22.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO n° 269, 19 nov. 2016.
-
23.
CE, sect., 20 févr. 1953, n° 9772 : Lebon, p. 88.
-
24.
Sur cette possibilité, v. CE, 11 avr. 2008, n° 281374 : Lebon, p. 168.
-
25.
La possibilité, pour l’expert, d’initier une procédure de médiation résulte du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016.
-
26.
Cons. const., 17 nov. 2016, n° 2016-739 DC.