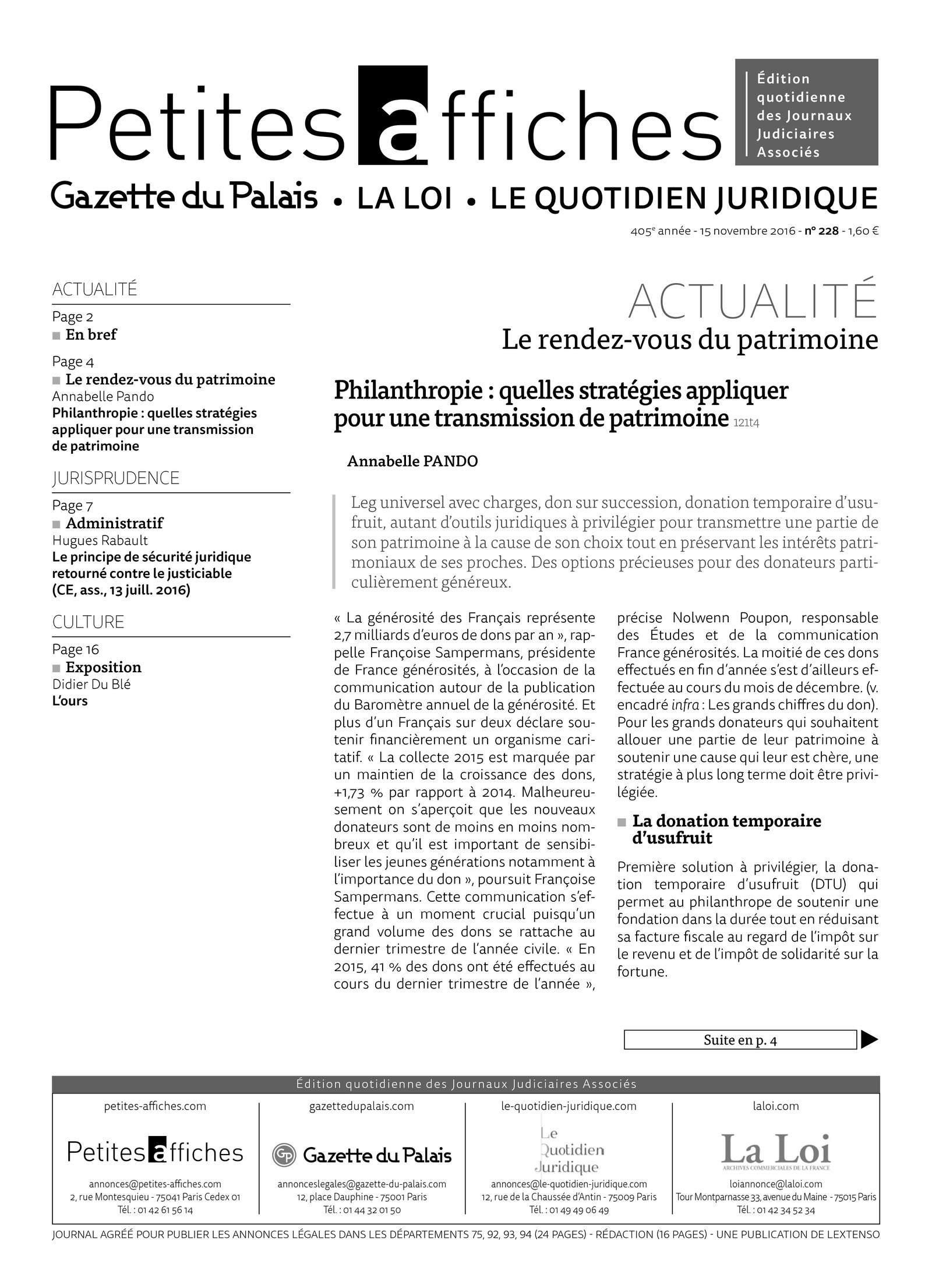Le principe de sécurité juridique retourné contre le justiciable
Lorsque les délais de recours prévus par les textes sont inopposables au justiciable, le recours contentieux n’en doit pas moins être exercé, selon le Conseil d’État, dans un « délai raisonnable », établi dans la décision commentée à une durée de principe d’un an, en vertu du principe de « sécurité juridique ».
CE, ass., 13 juill. 2016, no 387763, M. B. c/ Ministre des Finances et des Comptes publics
En matière juridique, ce sont parfois les affaires d’apparence anecdotique qui témoignent des enjeux les plus profonds. Tel est le cas d’une décision du Conseil d’État rendue cet été, à la veille de la fête nationale. Le Conseil d’État avait, d’ailleurs, pour trancher, jugé bon de se réunir en assemblée.
Un fonctionnaire contestait le mode de calcul de sa pension de retraite, qui lui avait été signifié par la notification d’un arrêté remontant à 1991. L’acte contesté semblait ancien, mais les délais de recours opposables au justiciable dépendent en principe des textes applicables. Or la notification, ne précisant pas la juridiction compétente, était entachée d’une irrégularité. Selon les principes habituellement appliqués, l’irrégularité en cause rendait donc le délai inopposable au justiciable. Ce dernier aurait dû pouvoir faire valoir ses droits sans aucune limitation de durée.
Pourtant le Conseil d’État conclut à l’irrecevabilité de la requête. Pour aboutir à cette solution, la haute juridiction administrative avance le principe selon lequel, indépendamment des délais prévus par les textes, tout recours devrait être intenté dans un « délai raisonnable ». La question se pose donc du fondement de l’opposition au justiciable d’un délai qui ne se trouve prévu par aucun texte en vigueur. Le Conseil d’État légitime la solution par le principe de « sécurité juridique ». C’est donc le principe de « sécurité juridique » qui, supposant une stabilisation des rapports de droit, exigerait que les justiciables ne puissent indéfiniment recourir contre la puissance publique, même en l’absence d’un délai légalement opposable.
Nous ne prétendons pas à un commentaire technique de la décision. Celle-ci fera l’objet d’une glose abondante en termes de contentieux administratif1. Il s’agit plutôt d’esquisser une réflexion sur les fondements de la décision. La solution adoptée suscite en effet nombre d’interrogations. On peut soutenir que la question du délai de recours contentieux relève de la compétence du législateur, ou, sur la base d’une éventuelle habilitation législative, de celle du pouvoir réglementaire. Dans l’espèce commentée, la décision substitue à l’absence de délai légalement opposable le principe prétorien d’un délai, toujours opposable, appelé « délai raisonnable ».
On pourrait soutenir que seul le législateur devrait être compétent pour créer un tel « délai raisonnable ». En l’absence d’un fondement législatif ou réglementaire valide, les recours des justiciables ne seraient en ce sens pas susceptibles de se trouver assujettis à une quelconque condition de délai. Le Conseil d’État aurait pu se contenter de s’appuyer sur la notion de « délai raisonnable ». Toutefois, il juge opportun de compléter cette argumentation par l’idée que ledit délai s’impose en vertu du principe de « sécurité juridique ». C’est la pertinence de l’application en l’espèce de la notion de « sécurité juridique » qui semble le point le plus singulier de l’argumentation.
Après avoir présenté l’affaire et le choix d’une solution prétorienne (I), il conviendra de discuter l’usage des notions de « délai raisonnable » et de « sécurité juridique » (II).
I – Le remède jurisprudentiel aux insuffisances de la pratique administrative
Les conditions imposées à l’autorité par les textes en matière de notification des décisions administratives ne sont pas toujours respectées. Dans l’affaire commentée (A) il en résultait une neutralisation du délai légal de recours contentieux (B).
A – Rappel de l’affaire
Le justiciable contestait, selon les termes de la décision, l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances « lui concédant une pension de retraite », du fait que cet arrêté « ne [prenait] pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l’article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ». Il demandait par conséquent à la juridiction « d’enjoindre au ministre de l’Économie et des Finances de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en compte cette bonification ».
Le tribunal administratif de Lille avait rejeté la demande. Pourtant, d’après l’interprétation proposée par le Conseil d’État, la demande du justiciable était fondée. En effet, selon les termes de la décision, « l’article R. 104 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en vigueur à la date de la décision contestée devant le juge du fond et dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 421-5 du Code de justice administrative [disposait] : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ce texte, selon le Conseil d’État, « que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ».
En l’espèce, il ressortait du dossier que la notification adressée au justiciable « mentionnait le délai de recours contentieux dont l’intéressé disposait à l’encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur la juridiction compétente ». Le Conseil d’État relève donc l’erreur commise par le tribunal administratif, qui avait jugé « que cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours conformément aux dispositions » précitées, et que, par conséquent, le justiciable était « fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, qui [avait] rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ».
Le Conseil d’État, examinant l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, confirme cependant le rejet du recours du contribuable. Pour justifier ce rejet, la haute juridiction administrative invoque le caractère tardif de la requête. S’agissant des délais de recours, la décision rappelle que les dispositions applicables, à l’heure actuelle l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, prévoient que : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Le Conseil d’État souligne qu’il en résulte que « lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable ».
Il était donc patent qu’au regard du strict raisonnement juridique le recours du justiciable n’était plus enserré dans aucun délai légal. Il fallait dès lors conclure que la requête était recevable. Le cinquième considérant de la décision relève en effet que « le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le Code de justice administrative ». Le juge précise toutefois, ce qui constitue l’apport de la décision, que dans ce type de circonstances, « le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ».
Très explicitement, la jurisprudence du Conseil d’État vient ici combler une lacune du Code de justice administrative. Le comblement de la lacune législative est extrêmement complet puisque la décision précise « qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ».
Ne disposant d’aucun fondement législatif pour appuyer sa décision, le Conseil d’État se réfère au principe général du droit dit de « sécurité juridique », issu de la fameuse décision Sté KPMG de 20062. Selon le Conseil d’État : « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ». La haute juridiction administrative précise dans le sixième considérant que la règle qu’il institue « ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ».
B – Le souverain juge, tout à la fois législateur et administrateur
L’argumentation du Conseil d’État apparaît d’une grande limpidité. Comme on a vu, après avoir rappelé les règles prévues par la législation en vigueur en matière de délai de recours contentieux, la haute juridiction administrative relève leur violation dans l’espèce commentée. La disposition appliquée est assez elliptique, puisque l’article R. 421-5 du Code de justice administrative se contente de disposer, répétons-le, que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». La question porte donc sur les effets de l’injonction en vertu de laquelle la notification de la décision doit préciser « les voies de recours ».
La disposition appliquée constitue une garantie majeure au bénéfice du justiciable. Cependant, comme le remarquent de bons auteurs : « L’Administration doit donc – et dans certains services elle n’a pris conscience de cette obligation qu’avec une extrême lenteur – préciser les modes de calcul du délai et les voies de recours, en indiquant le juge administratif compétent. Cette exigence retire, parfois, toute portée à l’enfermement de l’action contentieuse dans le bref délai de deux mois »3.
Ici, deux positions étaient envisageables. Une interprétation restrictive des garanties au bénéfice du justiciable pouvait tendre à considérer que les conditions étaient respectées aussitôt que le justiciable était informé de l’existence de voies de recours. Telle paraissait être l’orientation de la première juridiction saisie. Mais les obligations imposées à l’autorité administrative devenaient alors exagérément flexibles et l’intention du législateur apparaissait manifestement méconnue. C’est sans doute pourquoi le Conseil d’État interprète, au contraire, la disposition de façon stricte, en posant, comme il a été vu, que « cette notification doit (…) mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle »4.
La solution apparaît en ce sens d’abord favorable au justiciable. Néanmoins, la rigueur dans l’application de la loi se trouve contrebalancée par la formulation d’un principe jurisprudentiel qui la neutralise. Nous venons de le voir, en l’absence d’un délai légalement opposable, le Conseil d’État fait surgir, tel le lapin blanc sorti du chapeau d’un prestidigitateur, une règle en vertu de laquelle, en dehors de tout délai législatif applicable, un délai de principe d’un an se trouve opposable au justiciable.
Si l’on se contente de l’aspect pratique de la question, il suffit désormais de savoir qu’en l’absence d’un délai opposable prévu par les textes, tout recours contentieux se trouve enserré par un délai de principe d’un an à compter de la notification de la décision administrative. Sous cet angle, il apparaît simplement que le Conseil d’État complète la disposition du Code de justice administrative et, le cas échéant, d’autres dispositions analogues. La haute juridiction administrative apparaît alors comme exerçant une fonction législative de fait. Cet exercice d’un pouvoir législatif est d’autant plus explicite que, comme l’ont remarqué les commentateurs5, la durée d’un an est arbitraire.
Il s’ouvre alors un vaste champ d’initiative au bénéfice du juge. Il suffit de songer au domaine de la procédure fiscale, pour lequel le Livre des procédures fiscales, à l’article R. 196-1, dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’Administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation [etc.] ».
Dans certains cas, en matière fiscale, le délai peut se trouver réduit à un an, mais on voit que, dans le domaine de la fiscalité, on se trouve d’ores et déjà au-delà du délai prétendument raisonnable d’un an prévu par le Conseil d’État. On pourrait de la sorte multiplier les exemples de recours de nature administrative enserrés dans des délais. Cela signifie que le Conseil d’État devrait avoir à déterminer pour chaque type de recours le « délai raisonnable » applicable en cas de méconnaissance par l’autorité administrative de ses obligations.
La motivation ne peut certes pas révéler les enjeux de politique jurisprudentielle en cause. Comme le montre le commentaire des auteurs évoqués plus haut, le législateur a cru bon de protéger le justiciable par une information précise relative aux voies de recours. Malheureusement, les administrations n’ont pas toujours tiré les conséquences de cette protection. L’arrière-plan de la décision laisse alors apparaître un Conseil d’État non seulement juge et législateur, mais encore administrateur. Plutôt que de rappeler l’Administration à l’ordre et au droit, ce qui serait le rôle d’une juridiction, il lui tend une main secourable, contre les justiciables qui tentent de faire valoir leur droit des années après la notification d’une décision.
II – Les fondements discutables de la décision
En l’absence d’un fondement législatif solide, le Conseil d’État s’appuie sur des concepts abstraits, d’une part, la notion de « délai raisonnable » (A) et, d’autre part, le principe général du droit de « sécurité juridique » (B).
A – L’instrumentalisation de la notion de « délai raisonnable »
Plutôt que d’avouer la vérité, juridiquement douteuse, à savoir qu’il complète la législation qu’il applique au profit d’une partie au litige, le Conseil d’État se réfugie derrière des artifices rhétoriques. Le premier argument consiste en l’invocation du caractère « raisonnable » du délai de recours laissé au justiciable. Nul ne peut naturellement se déclarer hostile à ce qui se trouve proclamé comme conforme à la raison. La notion de « délai raisonnable » est une expression courante dans le droit contemporain. Cependant, il convient de relever qu’il n’y a pas de délai « raisonnable » en soi. Cette notion est, au départ, plutôt utilisée pour défendre le justiciable contre l’autorité. La France a été ainsi, comme on sait, condamnée en raison de retards déraisonnables mis par la juridiction administrative à statuer6.
Nous avons défendu ailleurs l’idée, en matière fiscale, que le délai de deux jours francs, considéré comme « raisonnable » par le Conseil d’État, consacré en ce qui concerne la durée exigée entre la réception par le contribuable d’un avis de vérification et la procédure de vérification de comptabilité ne constitue pas un délai objectivement raisonnable au regard du droit fiscal comparé. Là où les entreprises françaises disposent d’un peu plus de deux jours pour se préparer au contrôle fiscal, leurs homologues allemandes bénéficient de deux à quatre semaines en fonction de leur taille7. La notion de « délai raisonnable » apparaît donc, en soi, dénuée de contenu objectif. Elle doit être analysée en fonction du contexte, des rapports de force, des parties en présence, etc.
La notion de « délai raisonnable » remplit des fonctions diverses, et comporte donc un sens inverse dans le cas où elle protège le justiciable et dans celui où elle sert l’autorité. La spécificité de l’espèce commentée tient au fait que la notion en cause bénéficie non au justiciable, à la partie faible, celle qui mérite la protection de l’autorité juridictionnelle, mais au contraire à l’autorité, qui se trouve de jure protégée contre sa propre incurie, puisque le délai ne s’applique alors qu’en cas d’illégalité commise par l’Administration. En vérité, pour nombre d’administrations, une durée de deux mois ou d’un an ne change pas grand-chose. Elles peuvent ainsi se sentir délivrées des sujétions légales, désormais privées de sanction.
L’exemple issu du droit fiscal évoqué à l’instant montre de surcroît que la notion de « délai raisonnable », du fait de son équivocité, implique le danger d’un recours à deux poids et deux mesures. Le « délai raisonnable » établi par la jurisprudence est très réduit lorsqu’il s’agit de garantir la promptitude du contrôle fiscal, comme pour produire un effet de surprise au détriment du contribuable. Il peut en revanche s’allonger en ce qui concerne les poursuites. Ainsi en matière de redressement le délai de reprise légalement ouvert à l’administration fiscale est-il généralement de trois ans8. Un délai de droit commun de six ans est prévu par défaut9. En cas de non-respect des obligations déclaratives, le délai peut s’étendre à dix années10. Si l’on établit un parallèle entre le redressement fiscal, qui constitue une sorte de recours contre le contribuable, et le recours contentieux en matière administrative, on constate qu’un délai de principe d’un an demeure assez court, même si on le rencontre dans des législations étrangères, à cet égard plus avisées que le législateur français11.
La notion de « délai raisonnable » n’a donc, répétons-le, aucun contenu objectif. Elle peut n’être destinée qu’à dissimuler des choix arbitraires. On voit par là qu’il faut distinguer deux aspects de la notion de « délai raisonnable »12. D’une part, il s’agit de ce qu’on peut appeler un concept indéterminé, d’une notion à géométrie variable13. D’autre part, on dispose d’une expression connotée positivement, destinée à emporter l’adhésion du destinataire. Elle relève du slogan plus que de la précision exigée en droit. Utilisées par le législateur, les notions indéterminées visent à permettre l’adaptation de la jurisprudence aux circonstances, à introduire une souplesse dans l’application. Insérées par le juge dans l’interprétation de la loi, elles permettent d’occulter l’arbitraire jurisprudentiel. D’un point de vue juridique, ce genre de notion doit en tout cas être analysée avec la plus grande suspicion.
B – L’ambiguïté du principe de « sécurité juridique »
L’appel à la raison ne semblant pas suffisant, le Conseil d’État invoque encore le principe de « sécurité juridique ». La notion de « sécurité juridique » constitue une importation récente en droit public français. Rappelons qu’elle fait partie de ce qu’on peut désigner comme le lexique de l’État de droit post-totalitaire. C’est la Cour constitutionnelle fédérale allemande qui a l’a mise au cœur de son interprétation de la notion d’État de droit. De ce point de vue, la notion de « sécurité juridique » apparaît donc d’abord comme une protection du justiciable contre l’autorité publique, comme une garantie contre l’arbitraire étatique. Dans une fameuse décision de 1961 la Cour constitutionnelle fédérale l’a exprimée de la façon suivante : « Le citoyen doit pouvoir prévoir les immixtions étatiques possibles à son encontre et pouvoir s’adapter en conséquence ; il doit pouvoir placer sa confiance dans le fait que son action exprimant le droit en vigueur demeure reconnue par l’ordre juridique avec toutes les conséquences juridiques qui lui sont originellement liées. La confiance du citoyen est violée lorsque le législateur associe à une situation de fait accomplie des conséquences plus défavorables que celles que le citoyen avait droit, dans ses prises de dispositions, d’escompter. La sécurité juridique signifie pour le citoyen en première ligne la protection de la confiance »14 (BVerfGE, 13, 261 [271]).
La notion de « sécurité juridique » s’exprime ainsi dans la confiance que le citoyen peut placer dans la conformité des comportements de l’autorité au droit, c’est-à-dire à la loi ou à la réglementation publique. Dans l’histoire du droit public allemand, la notion de « sécurité juridique » remonte, tout comme celle d’État de droit, au XIXe siècle, où ce type de notions a pu cristalliser la revendication libérale d’une protection contre l’arbitraire étatique issu de l’absolutisme15. Il n’est pas surprenant que ce soit après la tragédie du national-socialisme que la Cour constitutionnelle fédérale a opéré la résurrection de cette idée. La notion de « sécurité juridique » apparaît ainsi comme une modernisation et une extension de la fameuse règle nullum crimen nulla poena sine lege : l’autorité se trouve étroitement liée par la loi. Les lacunes de la loi doivent être interprétées au profit du justiciable. Le mépris d’une telle règle ne serait pas compatible avec le projet d’une confiance du citoyen envers la loi et le droit.
La notion de « sécurité juridique » implique nombre de conséquences dans la jurisprudence constitutionnelle allemande, qu’on ne peut ici détailler16. Contrairement au droit français, qui ne reconnaît pas la valeur constitutionnelle du principe de « sécurité juridique », ces conséquences s’imposent au législateur comme à l’Administration17. Dans le cas de la France, on peut parler d’une réception partielle du principe de « sécurité juridique » depuis la décision Sté KPMG de 200618. Dans la décision Sté KPMG et dans la jurisprudence subséquente19, le Conseil d’État applique une conséquence particulière du principe de sécurité juridique, reconnue par la jurisprudence constitutionnelle allemande à travers la notion de « nécessité d’un régime transitoire » (Notwendigkeit einer Übergangsregelung).
Pour le juge allemand : « (…) le législateur doit en cas d’abrogation ou de modification d’une situation juridique protégée – même si l’atteinte est en soi constitutionnellement admissible – sur le fondement du principe fondamental de l’État de droit, de proportionnalité, adopter un régime transitoire approprié »20 (BVerfGE, 43, 242 [288]). Le juge administratif français applique cette idée dans la décision Sté KPMG. Cependant, contrairement au droit allemand, le champ d’application du principe est limité au pouvoir réglementaire. Il ne s’agit là de surcroît, répétons-le, que d’un effet du principe de sécurité juridique. Ce dernier est donc, en Allemagne, de nature constitutionnelle et englobant. Il demeure, en revanche, en France, de nature « infralégislative » (c’est-à-dire administrative) et implique un sens restrictif. La jurisprudence du Conseil d’État a appliqué le principe de « nécessité d’un régime transitoire » à divers types de situations21.
Moins exigeante que la doctrine allemande de la sécurité juridique, la théorie du Conseil d’État témoignait pourtant d’une avancée de la pratique de l’État de droit en France. Dans la décision commentée du 13 juillet 2016, la notion de « sécurité juridique » prend un sens tout à fait différent, et même inverse de celui formulé dans la décision Sté KPMG. Ce n’est plus le justiciable qu’il s’agit de défendre contre l’instabilité de l’État du droit, mais, comme on a vu, l’Administration, dont il s’agit de couvrir les illégalités par le comblement jurisprudentiel d’une lacune législative, c’est-à-dire par la modification du cadre législatif en vigueur. C’est pourquoi, la décision commentée semble exploiter l’idée de « sécurité juridique » en contradiction vis-à-vis de sa signification originelle.
Conclusion : « Sécurité juridique » et limitation du droit au recours. Pour critiquable qu’elle soit, la décision commentée n’en apparaît pas moins riche de signification. Son premier défaut tient à sa dimension d’arrêt de règlement, selon un procédé qui caractérisait les hautes juridictions d’Ancien Régime. Nous avons voulu montrer que loin d’appliquer la loi avec rigueur, le Conseil d’État en tempère les exigences. Une telle initiative serait louable si elle s’opérait au profit du justiciable, c’est-à-dire dans le sens des droits fondamentaux, à savoir, en l’espèce, au bénéfice du droit au recours juridictionnel. Cependant, c’est dans un sens contraire que s’oriente la jurisprudence du Conseil d’État. Loin de défendre le justiciable, loin de protéger la partie faible, le Conseil d’État prend le parti de l’autorité, il préfère garantir l’illégalité, à condition qu’elle provienne du sommet.
Pour aboutir à ce résultat, le Conseil d’État exploite de façon paradoxale le lexique de l’État de droit, en se référant, comme il a été vu, à la notion de « sécurité juridique ». Il est vrai que l’on trouve souvent sous la plume des commentateurs l’idée que le caractère réduit des délais de recours en matière administrative servirait la « sécurité » ou la « stabilité » juridique. Mais il ne faut pas confondre la sécurité bénéficiant au justiciable et la sécurité de l’État. Il a souvent été relevé que la notion de « sûreté » de l’article 2 de la Déclaration de 1789 vise non seulement la sûreté vis-à-vis des troubles à l’ordre public mais encore la sûreté vis-à-vis de l’État. Cette idée de sûreté correspond étroitement à la revendication des libéraux allemands du XIXe siècle d’une « sécurité juridique ».
C’est donc un surprenant renversement de la notion de « sécurité juridique » que la relecture consistant à la transformer en une sécurité garantie à l’État, ou à d’autres autorités publiques, contre les justiciables. Il suffit de pousser le raisonnement ad absurdum. Dans une telle conception, plus les délais de recours sont étroits mieux la sécurité juridique serait garantie. Selon cet axiome, la « sécurité juridique » serait maximale dans l’hypothèse d’une impossibilité de tout recours. Du point de vue de l’histoire de la pensée juridique, cette conception n’est pas inexistante. Elle correspond simplement à l’idée de souveraineté. L’État édicte les lois mais se trouve au-dessus du droit. Selon la formule issue du droit romain : princeps legibus solutus est.
Une telle conception a pu se justifier par l’idée d’un intérêt général prépondérant, toujours supérieur aux libertés et aux droits des particuliers. Elle caractérise l’État qu’on qualifie rétrospectivement d’absolutiste22, un État qui est apparu comme remède aux guerres de religion23. S’il y a bien ici l’idée d’une sécurité, il s’agit non de la sécurité juridique de l’État de droit, mais du principe politique de sûreté de l’État, ou de celui de raison d’État, qui veut que l’État puisse s’affranchir du droit. L’idée authentique de « sécurité juridique » a émergé en fait, avec celle d’État de droit, pour contrebalancer la toute-puissance étatique issue de la théorie de la souveraineté.
La sécurité juridique de l’État, la sécurité juridique retournée contre le justiciable, représente une interprétation discutable de la théorie de l’État de droit24. Il faut en effet considérer l’encadrement des recours contentieux jusques au fond de ses conséquences. L’expiration des délais de recours permet de consacrer les illégalités commises. La sécurité juridique dans le sens de la décision commentée est aussi, par conséquent, la garantie des pratiques administratives illégales. Or, concrètement, ces illégalités ne sont pas rares, même si elles ne trouvent pas toujours les requérants pour les faire sanctionner.
Nous avons donc voulu attirer l’attention sur le sens paradoxal de la notion de « sécurité juridique » dans sa nouvelle formulation par le Conseil d’État. Quelle « sécurité juridique » se trouve-t-elle engendrée par une solution en vertu de laquelle les recours juridiques ne sont plus seulement encadrés par un délai légal, mais aussi par un « délai raisonnable », dont la durée reste largement indéterminée ? Quelle est la « sécurité juridique » garantie par une décision qui applique brutalement un principe jusqu’alors inexistant en matière de recours contentieux ? En termes d’État de droit, le Conseil d’État eût été mieux inspiré de s’en remettre à l’initiative du législateur.
Dévoyant le concept de sécurité juridique, le Conseil d’État développe donc une singulière conception de l’État de droit. Il montre ainsi qu’organe de statut intermédiaire, législateur, administrateur et juge tout à la fois, il demeure empreint de cette nature hybride, qui en fera toujours plus un relais de la puissance de l’État qu’un contre-pouvoir juridictionnel. Ce vice n’est pas nouveau25 mais on pouvait espérer qu’il fût destiné à s’atténuer. L’affaire commentée est peut-être le signe que le mal demeure incurable.
Notes de bas de pages
-
1.
Voir le commentaire, que prolonge l’analyse ici proposée, de Pascal Caille, « Le recours déraisonnable à la notion de délai raisonnable de recours : ô sécurité juridique, que de libertés prises en ton nom ! », note sous CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, M. A. c/ Ministre de l’Économie et des Finances : www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24113 [consulté le 14 août 2016].
-
2.
CE, ass., 24 mars 2006, n° 288460, Sté KPMG et a. : Lebon, p. 154. Pour références et commentaire : Long M., Weil P., Braibant G. et a., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 2015, Paris, Dalloz, p. 819 et s., n° 108.
-
3.
Frier P.-L., Petit J., Droit administratif, 2015, Paris, LGDJ, p. 522.
-
4.
Le Conseil d’État se conforme à sa propre jurisprudence : CE, sect., 13 mars 1998, n° 120079, Mme Mauline : Lebon, p. 80 ; AJDA 1998, p. 613, concl. Combrexelle J.-D. ; RDP 1999, p. 759, étude Fraissex P.
-
5.
V. supra note 1.
-
6.
Dans l’arrêt de la Convention EDH, la procédure en vue de la communication d’un fichier des renseignements généraux devant la juridiction administrative avait exigé près de neuf années : CEDH, 20 nov. 2008, n° 32157/06, Gunes c/ France.
-
7.
CAA Nancy, 13 déc. 2007, n° 06NC00618, Société Hans-Ulrich Hege : Rabault H., « Le délai entre la réception de l’avis de vérification et le contrôle fiscal : durée et computation », LPA 11 nov. 2008, p. 7 – CAA Nancy, 30 juin 2005, n° 01NC1123, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ SARL Tapas de la Cité : Rabault H., « Le délai raisonnable avant une vérification de comptabilité », LPA 31 juill. 2006, p. 22.
-
8.
LPF, art. L. 169 et LPF, art. L. 176.
-
9.
LPF, art. L. 186.
-
10.
Par ex., LPF, art. L. 169, al. 2.
-
11.
En Allemagne, le délai légal de recours contentieux en droit administratif peut effectivement être étendu d’un mois à un an en cas de méconnaissance des obligations d’information sur les voies de recours (v. Ord. Verwaltungsgerichtsordnung, § 58, sur les tribunaux administratifs). Le même mécanisme existe en droit fiscal (v. Ord. Finanzgerichtsordnung, § 55, sur les tribunaux financiers). Lire notamment Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, 2011, Munich, Verlag C. H. Beck, p. 269 ; Tipke K., Lang J. (dir.), Steuerrecht, 2010, Cologne, Verlag Dr Otto Schmidt, p. 1100-1101.
-
12.
Rabault H., L’interprétation des normes : l’objectivité de la méthode herméneutique, 1997, Paris, L’Harmattan, p. 229 et s., spéc. p. 242.
-
13.
Sur l’utilisation de ce type de notions en droit administratif : Rials S., Le juge administratif et la technique du standard, 1980, Paris, LGDJ.
-
14.
« Der Staatsbürger soll die ihm gegenüber möglichen staatlichen Eingriffe voraussehen und sich dementsprechend einrichten können ; er muß darauf vertrauen können, daß sein dem geltenden Recht entsprechendes Handeln von der Rechtsordnung mit allen ursprünglich damit verbundenen Rechtsfolgen anerkannt bleibt. In diesem Vertrauen wird der Bürger aber verletzt, wenn der Gesetzgeber an abgeschlossene Tatbestände ungünstigere Folgen knüpft als an diejenigen, von denen der Bürger bei seinen Dispositionen ausgehen durfte. Für den Bürger bedeutet Rechtssicherheit in erster Linie Vertrauensschutz. »
-
15.
V. par ex. : Soulas de Russel D., Raimbault P., « Nature et racines du principe de sécurité juridique : une mise au point », Rev.int. dr.comp. vol. 55, janv. 2003, p. 85-103.
-
16.
Rabault H., « Tarification de l’électricité, concurrence et sécurité juridique », note sous CE, 15 juin 2016, n° 383722 et CE, 15 juin 2016, n° 386078, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) : LPA 7 sept. 2016, n° 119w1, p. 14.
-
17.
V. ibid.
-
18.
V. supra, note 2.
-
19.
Ici encore, pour un bilan jurisprudentiel, nous renvoyons à Hugues Rabault, « Tarification de l’électricité, concurrence et sécurité juridique », art. préc.
-
20.
« Das Bundesverfassungsgericht hat indessen wiederholt ausgesprochen, daß der Gesetzgeber bei der Aufhebung oder Modifizierung geschützter Rechtspositionen -- auch dann, wenn der Eingriff an sich verfassungsrechtlich zulässig ist -- aufgrund des rechtsstaatlichen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eine angemessene Übergangsregelung treffen muß ».
-
21.
Réduit à cette acception, le principe de « sécurité juridique » est appliqué par le Conseil d’État non seulement à la réglementation, mais aussi à sa propre jurisprudence ou encore à la mise en vigueur de dispositions législatives. Voir l’article précité : Rabault H., « Tarification de l’électricité, concurrence et sécurité juridique ».
-
22.
Rabault H., L’État entre théologie et technologie. Origine, sens et fonction du concept d’État, 2007, Paris, L’Harmattan, p. 100-106.
-
23.
Rabault H., « La confiance comme mécanisme social et l’approche fonctionnaliste du droit », Dr. et société n° 67, 2007, p. 741-758 ; Luhmann N., La confiance. Un mécanisme de réduction de la complexité sociale (1968), 2006, Paris, Economica.
-
24.
Au contraire de notre conclusion dans l’article précité : Rabault H., « Tarification de l’électricité, concurrence et sécurité juridique ».
-
25.
de Tocqueville A., De la démocratie en Amérique (1835-1840), 1992, Paris, Gallimard, Bibl. de la pléiade, tome I, chap. VI, p. 116, consacré au pouvoir judiciaire.