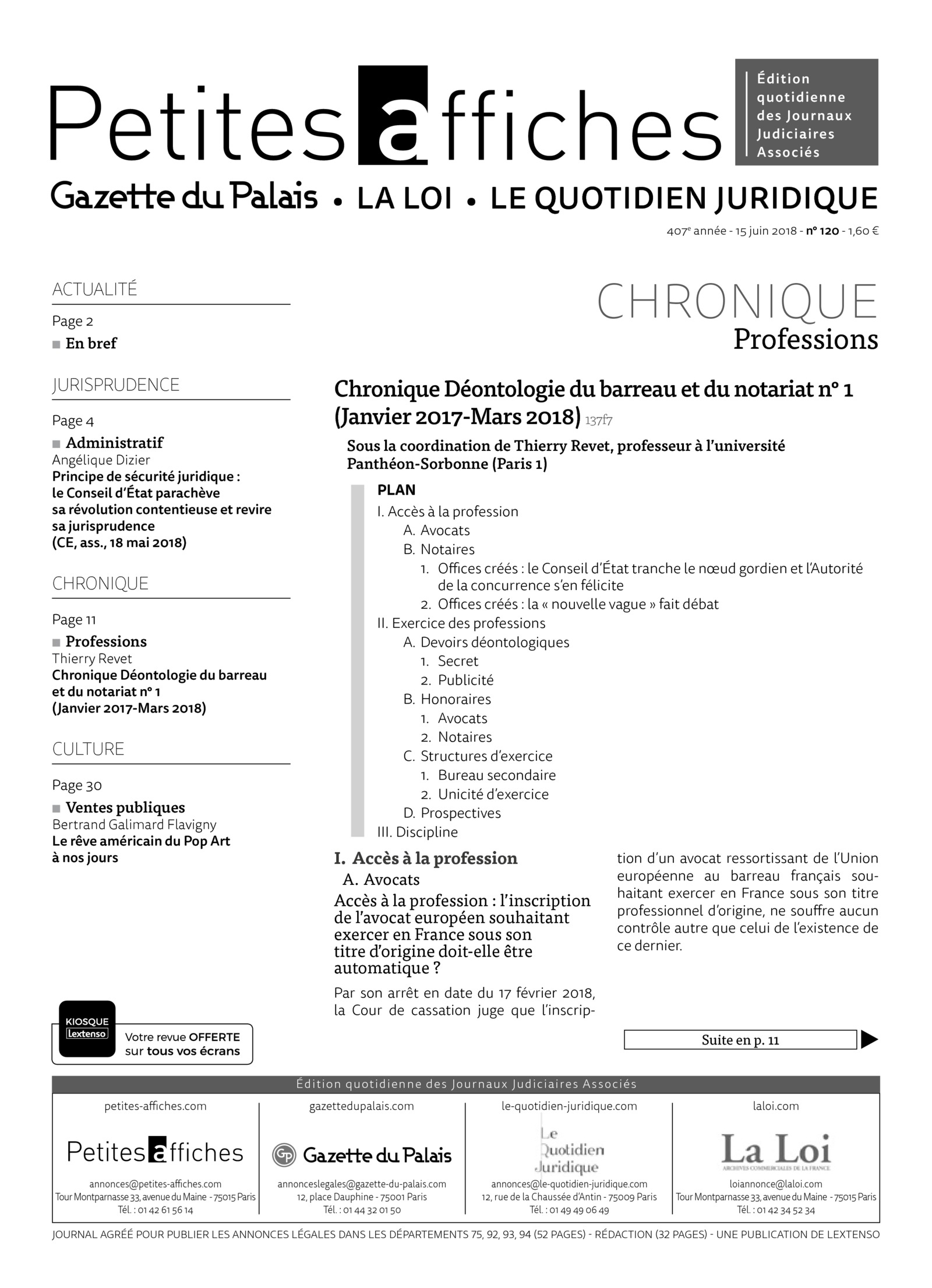Principe de sécurité juridique : le Conseil d’État parachève sa révolution contentieuse et revire sa jurisprudence
Dans une décision du 18 mai 2018, l’assemblée du contentieux du Conseil d’État a limité, au nom du principe de sécurité juridique, les moyens recevables à l’appui de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception ou à l’occasion d’un recours exercé contre le refus de l’abroger. La volonté d’assurer la permanence de l’acte administratif se concrétise alors par une hiérarchisation des moyens de légalité mais également par une redéfinition des moyens d’ordre public.
CE, ass., 18 mai 2018, no 414583, CFDT Finances
Le Conseil d’État, dans sa formation la plus solennelle, a redéfini les contours du contentieux de la légalité des actes réglementaires lorsque le juge en est saisi par voie d’exception ou à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision portant refus de les abroger. À l’occasion du recours pour excès de pouvoir exercé par la Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT (CFDT Finances), le Conseil d’État a, par un considérant de principe, affirmé que dans de telles hypothèses, les vices de forme et de procédure entachant l’acte réglementaire ne peuvent plus « utilement » être invoqués par les requérants. Ces moyens de légalité ne peuvent l’être « que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux ».
La solution retenue par les juges du Palais-Royal vient ainsi nuancer le principe classique selon lequel l’exception d’illégalité des actes réglementaires revêt un caractère perpétuel1 et limiter l’intérêt, qu’avait pourtant encore récemment consacré le Conseil d’État, de rouvrir un délai de recours contentieux à l’encontre de ces actes par une demande d’abrogation2 fondée sur les principes dégagés par la décision Alitalia3 et figurant désormais à l’article L. 243-2 du Code des relations entre le public et l’Administration.
Par voie d’exception, ou à l’encontre d’un refus d’abrogation, se trouvent donc désormais irrecevables les moyens tirés de l’existence de « vices de forme et de procédure », tandis que demeurent recevables les moyens tirés de « la légalité des règles » fixées par l’acte contesté (comprendre, selon la classification classique des moyens, ceux relatifs à sa légalité interne), « l’existence d’un détournement de pouvoir » et « la compétence de son auteur ».
S’agissant d’une décision d’assemblée, sa portée ne peut évidemment passer inaperçue, non plus que ses conséquences immédiates sur les contentieux en cours, puisque le Conseil n’a formulé aucune précision quant à une application différée dans le temps de sa solution. Mais à bien y regarder, le changement opéré par le Conseil d’État dans sa formation la plus solennelle n’est pas surprenant, eu égard à l’intérêt croissant de ses juges pour le principe de sécurité juridique, compris comme un outil bénéficiant à l’action administrative en vue d’assurer la permanence de situations consolidées par l’effet du temps au détriment d’irrégularités considérées comme secondaires (I). En réalité, c’est la nouvelle classification des moyens à laquelle semble conduire cette décision, s’agissant notamment des moyens d’ordre public et particulièrement celui de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui peut retenir l’attention et conduire à souhaiter une clarification, jurisprudentielle ou réglementaire, de ces nouvelles règles contentieuses (II).
I – Sécurité juridique et hiérarchisation de la légalité au soutien de la permanence de l’acte administratif
L’arrêt commenté n’est pas un « Grand soir » du contentieux administratif. Tout laissait présager l’intervention d’une telle solution, familiers que sont désormais les spécialistes des décisions du Conseil d’État limitant la recevabilité des recours afin de préserver l’action de l’Administration de contestations tardives. Cette préoccupation a été traduite en ces termes par Jean-Marc Sauvé le 4 novembre 2016 à l’occasion des Entretiens du Contentieux : « L’évolution du contentieux administratif traduit aujourd’hui la volonté du juge de protéger encore plus efficacement les droits fondamentaux, sans porter atteinte à l’efficacité de l’action administrative ».
La décision du 18 mai 2018 concrétise cette volonté en restreignant, sur le fondement du principe de sécurité juridique, les chances de succès d’une contestation tardive élevée à l’encontre d’un acte réglementaire (A), par une limitation des moyens recevables à son soutien, les vices de forme et de procédure se trouvant relégués au second plan d’une légalité de plus en plus subjective (B).
A – Permanence de l’acte administratif et sécurité juridique
L’impératif de sécurité juridique, que le Conseil d’État a tardé à s’approprier – contrairement à ses homologues européens – pour le circonscrire tout d’abord à l’obligation faite à l’Administration, dans certaines hypothèses, d’édicter des mesures transitoires4, justifie désormais une évolution du contentieux administratif, au bénéfice de l’action administrative, tendant à réduire les possibilités d’exercer, puis désormais les chances de remporter, des recours exercés au-delà du délai de recours de droit commun de 2 mois.
Cette évolution s’est récemment traduite dans le contentieux des décisions individuelles par la décision d’assemblée du 13 juillet 2016 par laquelle, sur le fondement du « principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps », le Conseil a jugé que la règle d’inopposabilité des voies et délais de recours non mentionnés (ou mal mentionnés), consacrée à l’article R. 421-5 du Code de justice administrative, cédait à l’issue d’une période d’un an « à compter de la date à laquelle une décision expresse (…) a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu[e l’intéressé] en a eu connaissance »5. Cette décision a été récemment confirmée s’agissant du contentieux des titres exécutoires6.
Suivant cette tendance, la décision commentée bat en brèche une règle procédurale pourtant acquise de longue date, selon laquelle l’exception d’illégalité des actes réglementaires est perpétuelle. Elle ne l’est plus désormais qu’en considération de certains moyens, à l’exclusion de ceux relatifs aux « vices de forme et de procédure » que le requérant se trouve forclos à soulever au-delà du délai de deux mois courant à compter de la publication de l’acte attaqué.
La solution vaut, comme c’était d’ailleurs le cas en l’espèce, lorsque le requérant sollicite l’annulation du refus d’abroger opposé à sa demande ; après avoir ouvert la porte encore récemment à cette démarche7, en forme de rattrapage d’un délai de recours par voie d’action qu’on aurait laissé expirer par négligence ou par ignorance de l’intervention des formalités de publicité de la décision contestée, le Conseil d’État vient la refermer en limitant les moyens invocables à l’occasion de ce recours. Une demande d’abrogation, qui peut naturellement intervenir bien longtemps après l’entrée en vigueur de l’acte attaqué, ne peut désormais donner lieu à contentieux que pour des motifs limités.
Si la décision ne fait pas expressément mention du « principe de sécurité juridique », ni même de l’impératif de bonne administration de la justice, l’on ne peut la comprendre que comme fondée sur cet ensemble de notions qui, d’abord entendues comme protectrices des justiciables contre un « fait du Prince » administratif, sont devenues les outils du renforcement de l’action administrative au détriment d’une certaine conception de la garantie des droits.
En effet, comme la règle prétorienne issue de la décision du 13 juillet 2016 concernant la mention de voies et délais de recours8, celle que l’on pourrait définir comme une cristallisation des moyens tirés de l’existence de vices de forme ou de procédure à l’issue du délai de recours par voie d’action, est applicable, à défaut d’indication contraire, aux contentieux en cours. L’on ne peut que regretter que le Conseil d’État n’ait pas fait usage du pouvoir qu’il s’est reconnu de moduler l’effet dans le temps de ses décisions9, pour limiter aux actions introduites à compter de la lecture de l’arrêt commenté l’application de cette nouvelle règle contentieuse, à défaut de quoi la sécurité juridique des justiciables semble se heurter à celle de l’action administrative.
Le renforcement de l’action administrative que concrétise la décision commentée se fait également au détriment d’une certaine conception de la légalité, dont on abandonne peu à peu le caractère objectif pour la hiérarchiser.
B – Permanence de l’acte administratif et hiérarchisation des moyens de légalité
Il ne doit rien au hasard que les moyens qualifiés d’irrecevables, par le Conseil d’État, au soutien d’une contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception ou à l’occasion d’un recours contre un refus d’abrogation, soient ceux relatifs aux « vices de forme et de procédure ».
En effet, la neutralisation de ces moyens, passé un certain délai, existe déjà en matière d’urbanisme, matière où l’on sait que le contentieux foisonne. La règle figure à l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction, qui dispose que « l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la prise d’effet du document en cause ». Ne sont toutefois pas concernés « la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales » non plus que « l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques » (même disposition).
À l’évidence, la solution consacrée par le Conseil d’État dans la décision commentée s’inspire de cette disposition législative adoptée en vue d’assurer la stabilité des règles d’urbanisme. Elle s’inspire également de la règle consacrée par l’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, et traduite par l’assemblée du Conseil d’État dans sa décision Danthony, selon laquelle « ces dispositions énoncent, s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte »10.
L’on a assisté, après le prononcé de cette décision, au phénomène de « Danthonysation » de nombre de vices de procédure, par exemple dans le contentieux des actes soumis à enquête publique préalable au titre du Code de l’expropriation ou du Code de l’environnement. La « Danthonysation » des vices de procédure a largement limité l’intérêt de soulever, au soutien de requêtes en annulation, des griefs tirés de l’irrégularité de certains processus ou consultations préalables, au bénéfice d’une certaine subjectivisation des moyens de légalité.
De manière assez évidente, les vices de forme et de procédure sont depuis lors considérés comme des moyens « secondaires », dont le bien-fondé ne peut finalement conduire à l’annulation de l’acte qu’au bénéfice d’une interprétation in concreto, empreinte de subjectivité.
En effet, le bien-fondé de tels griefs ne se trouve notamment acquis que lorsque la méconnaissance alléguée a « privé les intéressés d’une garantie ». Autrement dit, les règles relatives à l’édiction de l’acte administratif se trouvent interprétées dans une perspective téléologique : toute procédure qui, bien que prévue par les textes, n’a en réalité aucune conséquence sur le droit, subjectif, des administratifs à être informés des décisions de l’Administration ou à pouvoir utilement formuler des observations11, ne trouvera pas son irrespect sanctionné par le juge.
La finalité de la procédure administrative préalable l’emporte donc sur le respect strict de la lettre des textes, ce qui manifeste un certain réalisme pour qui convient, comme l’y invite au demeurant la particularité du droit administratif dans lequel la technique de la « régularisation » tient une place importante, que les formes et procédures n’ont qu’un rôle subalterne dans la hiérarchie des moyens de légalité.
Les vices de forme et de procédure retrouvent toutefois toute leur importance lorsque leur existence touche à un moyen d’ordre public, au premier rang desquels figure la compétence de l’auteur de l’acte querellé.
La décision Danthony, tout comme semble le faire la décision ici commentée, réservent en effet l’hypothèse dans laquelle le vice de procédure soulevé mettrait en cause la compétence même de l’auteur de l’acte. À la lecture de la décision, il n’est pour autant même pas certain qu’en pareille hypothèse, le vice de procédure puisse être utilement invoqué, ce qui conduit à s’interroger de manière générale sur le sort réservé aux moyens d’ordre public dans le contentieux par voie d’exception et celui des refus d’abrogation.
II – Les moyens d’ordre public à l’épreuve de la permanence de l’acte administratif
Traditionnellement, certains vices de procédure ont été considérés comme touchant à la compétence de l’auteur de l’acte, ce qui conduisait le juge à les soulever d’office et les parties à pouvoir les soulever « en tout état de cause », quel que soit le stade de la procédure ou le mode de contestation de l’acte : par voie d’action, d’exception ou à l’occasion d’un recours dirigé contre un refus d’abrogation.
Si elle demeure muette sur le traitement général des « moyens d’ordre public » en matière d’exception d’illégalité ou de refus d’abroger, la décision réserve toutefois expressément celui de l’incompétence, qui demeure recevable. À cet égard, la décision commentée induit deux séries d’interrogation. Il n’est d’une part pas certain que les « moyens d’ordre public » échappent, sans condition, à la limitation des moyens consacrée par le Conseil d’État (A), ni même que celui relatif à la compétence soit finalement recevable, sauf à considérer que les juges du Palais-Royal en ont redéfini les contours par ce qui constituerait un considérable revirement de jurisprudence (B).
A – Limitation des moyens invocables et moyens d’ordre public
Dans la décision commentée, le Conseil énumère les moyens pouvant être utilement invoqués dans le cadre d’une exception d’illégalité ou d’une contestation d’un refus d’abrogation : légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, compétence de son auteur, détournement de pouvoir.
Il n’est pas précisément fait référence aux moyens d’ordre public ; mais l’incompétence en est évidemment un12 et la « légalité des règles fixées par l’acte » peut quant à elle couvrir nombre d’entre eux, au premier rang desquels la méconnaissance du champ d’application de la loi13.
L’on pourrait donc légitimement penser que la décision du Conseil d’État du 18 mai dernier ne fait pas obstacle à l’invocation des moyens d’ordre public, selon la règle contentieuse classique, non plus qu’à l’obligation faite au juge de les soulever d’office. En réalité, les choses semblent devoir être plus nuancées, certains moyens, malgré leur caractère d’ordre public, tombant sous le coup de l’irrecevabilité dans le cadre particulier des contentieux tardifs, au bénéfice une fois encore de la permanence de l’acte administratif.
Par exemple, et bien qu’en principe, la méconnaissance par un règlement du principe de non-rétroactivité des actes administratifs soit un moyen d’ordre public14, il n’est plus invocable dans le cadre d’un refus d’abrogation s’il ne présente plus, au moment de la demande, « un effet utile ». Le Conseil d’État a ainsi déjà jugé « qu’à l’appui d’une requête formée à l’encontre d’une décision rejetant une demande d’abrogation ou de réformation d’un acte réglementaire, un requérant ne peut utilement se prévaloir d’une illégalité affectant les conditions de son entrée en vigueur, qu’elle résulte de la méconnaissance du principe selon lequel un tel acte ne dispose que pour l’avenir (…) que pour autant qu’à la date à laquelle cette décision est intervenue, le pouvoir réglementaire pouvait encore prendre utilement des mesures propres à modifier les conditions de cette entrée en vigueur »15. Ce qui n’est pas le cas lorsque la demande intervient un an après l’entrée en vigueur de l’acte dont l’abrogation est demandée (même décision).
Par conséquent, les moyens d’ordre public ne semblent pas échapper à la hiérarchisation et à la subjectivisation de la légalité auxquelles se livre le Conseil d’État. Il est donc fort probable que dans la droite ligne de cette décision, l’arrêt commenté ne conduise pas les juges à leur réserver un sort particulier.
Il en résulte que les « vices de forme et de procédure » ne sont potentiellement pas les seuls moyens de légalité frappés par la limitation des moyens invocables à l’appui d’un recours contre un refus d’abrogation ou par la voie de l’exception d’illégalité, sauf à considérer soit que la décision du 18 mai 2018 abroge la solution retenue précédemment par les 1re et 6e chambres réunies s’agissant de l’invocabilité du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, en fixant une liste précise des moyens recevables en pareille hypothèse ; soit qu’elle ne règle que partiellement la question des moyens pouvant être utilement soulevés dans ces cas de figure, laissant de côté la question des moyens d’ordre public ; soit encore qu’elle comporte un revirement de jurisprudence, peut-être involontaire, au moins aussi important que l’est la nouvelle règle qu’elle édicte.
Cette troisième hypothèse peut emporter la conviction s’agissant du moyen d’ordre public touchant à la compétence de l’auteur de l’acte.
B – Permanence de l’acte administratif, compétence et vice de procédure
Comme exposé, la décision commentée réserve le cas du moyen tiré de l’incompétence de l’acte lequel peut, selon le Conseil d’État, être utilement invoqué dans le cadre d’une exception d’illégalité ou d’un refus d’abroger. L’on pourrait donc en déduire, par exception à la règle dégagée par l’arrêt, qu’un vice de forme ou de procédure touchant à la compétence même de l’auteur de l’acte est recevable.
De jurisprudence bien établie, certains vices de forme ou de procédure deviennent des moyens d’incompétence, donc d’ordre public, que le juge doit soulever d’office. Il en va ainsi lorsqu’une décision doit être adoptée après avis conforme d’un organisme et que celui-ci n’a pas été consulté16 et également lorsqu’une décision qui ne peut être prise qu’après avis du Conseil d’État n’a pas été précédée de sa consultation ou que les dispositions finalement adoptées diffèrent de celles soumises à son examen17.
En toute logique, dans la décision commentée, le Conseil d’État aurait donc dû examiner le moyen, soulevé devant lui, selon lequel les dispositions du décret dont l’abrogation était demandée différaient de celles soumises à son examen, ce grief ne constituant pas un simple vice de procédure mais un moyen d’incompétence.
Il n’en a pourtant pas été ainsi. En effet, saisi de ce moyen, et tirant les conséquences du considérant de principe qu’il vient d’énoncer, le Conseil d’État l’écarte en jugeant « qu’il résulte de ce qui précède que la fédération requérante ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger le décret du 29 mars 2017, les moyens tirés (…) de ce que ce décret différerait à la fois du projet qui avait été soumis par le gouvernement au Conseil d’État et de celui adopté par ce dernier ».
La lecture de la décision ne laisse a priori guère place au doute : le moyen tiré des modalités de consultation du Conseil d’État est à présent considéré comme un simple vice de procédure, et non plus comme une incompétence. Est-ce à dire qu’aucun vice de procédure ne peut désormais entacher d’incompétence l’acte attaqué ? Si tel est le cas, des décennies de jurisprudence viennent d’être bouleversées, sans mention particulière au titrage du Lebon. Et si tel est le cas, bon nombre de décrets adoptés en violation de la consultation obligatoire du Conseil d’État échapperont à l’annulation si les requérants ne soulèvent pas d’eux-mêmes ce vice de procédure, dans le délai de recours contentieux par voie d’action, le juge n’étant plus habilité à le soulever d’office puisqu’il ne touche plus à la compétence de l’auteur de l’acte et n’est ainsi plus d’ordre public. Il n’est pas certain que cette solution satisfasse les formations consultatives des Sages du Palais-Royal.
Notes de bas de pages
-
1.
CE, 29 mai 1908, Poulin : Lebon, p. 580.
-
2.
CE, sect., 13 juill. 2016, n° 388150, Sté GDF Suez.
-
3.
CE, ass., 3 févr. 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia.
-
4.
CE, ass., 24 mars 2006, n° 288460, Sté KPMG et a.
-
5.
CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763.
-
6.
CE, 9 mars 2018, n° 401386, Sté Sanicorse.
-
7.
CE, 13 juill. 2016, n° 388150, préc.
-
8.
N° 387763, préc.
-
9.
CE, ass., 11 mai 2004, n° 255886, Assoc. AC ! ; en matière procédurale v. par ex. CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Dpt de Tarn-et-Garonne.
-
10.
CE, ass., 23 déc. 2011, n° 335033, Danthony.
-
11.
V. par ex. CE, 23 oct. 2015, nos 375814, 375836, 375837, 375924, 375993, 381895 et 381897, Cne de Maisons-Laffitte et a.
-
12.
CE, 15 févr. 1961, Alfred Joseph : Lebon, p. 114.
-
13.
CE, sect., 5 avr. 1996, n° 176611, Houdmond : Lebon, p. 116.
-
14.
CE, sect., 8 nov. 1968, Menez : Lebon, p. 557.
-
15.
CE, 16 déc. 2016, n° 393501, Assoc. de défense et d’entraide des personnes handicapées et a.
-
16.
CE, 29 janv. 1969, n° 66080 : Lebon, p. 43 – CE, 5 févr. 1990, n° 70595 ; CE, 8 juin 1994, n° 127032.
-
17.
CE, sect., 28 mai 1971, n° 80819, Assoc. des directeurs d’instituts et de centres universitaires d’études économiques régionales ; CE, 26 avr. 1974, n° 85597 ; CE, 17 juill. 2013, n° 358109, Syndicat national des professionnels de santé au travail.