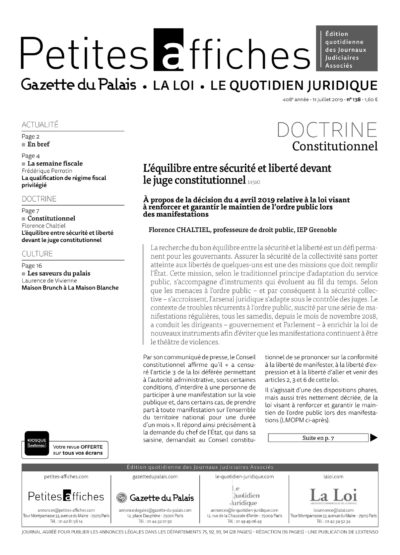L’équilibre entre sécurité et liberté devant le juge constitutionnel
La recherche du bon équilibre entre la sécurité et la liberté est un défi permanent pour les gouvernants. Assurer la sécurité de la collectivité sans porter atteinte aux libertés de quelques-uns est une des missions que doit remplir l’État. Cette mission, selon le traditionnel principe d’adaptation du service public, s’accompagne d’instruments qui évoluent au fil du temps. Selon que les menaces à l’ordre public – et par conséquent à la sécurité collective – s’accroissent, l’arsenal juridique s’adapte sous le contrôle des juges. Le contexte de troubles récurrents à l’ordre public, suscité par une série de manifestations régulières, tous les samedis, depuis le mois de novembre 2018, a conduit les dirigeants – gouvernement et Parlement – à enrichir la loi de nouveaux instruments afin d’éviter que les manifestations continuent à être le théâtre de violences.
Par son communiqué de presse, le Conseil constitutionnel affirme qu’il « a censuré l’article 3 de la loi déférée permettant à l’autorité administrative, sous certaines conditions, d’interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique et, dans certains cas, de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois »1. Il répond ainsi précisément à la demande du chef de l’État, qui dans sa saisine, demandait au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la liberté de manifester, à la liberté d’expression et à la liberté d’aller et venir des articles 2, 3 et 6 de cette loi2.
Il s’agissait d’une des dispositions phares, mais aussi très nettement décriée, de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations (LMOPM ci-après). La raison en est que, telles que rédigées, les dispositions contestées, laissaient à « l’autorité administrative une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction »3.
Outre la saisine du Conseil constitutionnel par soixante députés et soixante sénateurs, ainsi que le prévoit la constitution, le président de la République avait, lui aussi, décidé de saisir le Conseil constitution de la loi contestée. Ce type de saisine n’est ni inédit ni surprenant. En effet, en cas de loi contestée et suspectée d’inconstitutionnalité, la polémique peut s’éteindre à la faveur d’une décision du juge constitutionnel, voix autorisée de la constitution. Un exemple ancien vient le rappeler. En 1976, l’acte relatif à l’élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct avait fait l’objet de violentes polémiques dans l’hémicycle, les députés craignant une confiscation européenne de la souveraineté nationale. Ainsi le président Valéry Giscard d’Estaing avait saisi le Conseil constitutionnel, comme suit : « Monsieur le président, lors de sa réunion tenue à Rome les 1er et 2 décembre 1975, le Conseil européen est convenu que l’Assemblée serait élue au suffrage universel direct à une date unique, située en mai ou juin 1978. Cette prise de position s’est traduite, sur le plan juridique, par une décision du Conseil des Communautés européennes en date du 20 septembre 1976, à laquelle est joint un acte qui détermine la répartition des sièges entre les États membres. Avant de demander au Parlement l’autorisation d’approuver la décision du Conseil des Communautés européennes, je veux m’assurer de sa compatibilité avec notre constitution, au respect de laquelle j’ai mission de veiller. Aussi je me propose de vous demander, en application de l’article 54 de la constitution, de bien vouloir soumettre à l’examen du Conseil constitutionnel la question de savoir si l’engagement international du 20 septembre 1976 comporte des clauses contraires à la constitution »4. Celui-ci avait alors validé le texte et, par là même, en partie du moins, calmé la polémique5.
Cette fois-ci la démarche est comparable même si le résultat est inverse, le Conseil constitutionnel ayant censuré la disposition la plus litigieuse, tout en validant une série d’autres dispositions, contestées aussi et non négligeables pour autant. Ainsi, le dispositif censuré (III) n’empêche pas l’entrée en vigueur du reste de la loi qui est validée à la fois quant à la procédure (I) que quant au fond (II).
I – La procédure législative jugée conforme à la constitution
Plusieurs aspects de la procédure législative étaient contestés : la limitation du droit d’amendement (A), ou encore l’absence de publicité d’un avis du Conseil d’État (B). Le Conseil constitutionnel rejette ces deux griefs, en rappelant qu’« aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : “La loi est l’expression de la volonté générale”. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la constitution : “La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants”. Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. »6
A – Le droit d’amendement respecté par la procédure législative
Il faut rappeler en premier lieu que la loi contestée est issue d’une proposition de loi – initiative parlementaire – et non d’un projet de loi – initiative gouvernementale. Or ainsi que le juge constitutionnel le rappelle, l’article 39 de la constitution7 et la loi organique du 15 avril 20098 n’imposent la présentation d’une étude d’impact et la consultation du Conseil d’État que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les propositions de loi.
Il faut souligner en deuxième lieu qu’il est exact que lors de l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée nationale, le gouvernement a déposé quatre amendements. L’un d’entre eux, portant sur l’article 2 de la proposition de loi, devenu article 3, a été déposé après l’expiration du délai de dépôt opposable aux amendements des députés. Cependant, le Conseil constitutionnel juge, dans son point 4 que cette circonstance n’a pas fait obstacle à l’exercice effectif par les députés de leur droit d’amendement, notamment sous forme de sous-amendements à l’amendement du gouvernement.
Le gouvernement avait en effet rappelé, dans ses observations, qu’il a exercé les prérogatives qu’il tient de l’article 44 de la constitution sans méconnaître aucune règle, en particulier de délai, fixée par cette dernière ou par les règlements des assemblées parlementaires. Les observations rappellent encore que le Conseil constitutionnel a abandonné, par ses décisions du 19 juin 2001 et du 11 juillet 20019, son ancienne jurisprudence relative aux limites inhérentes au droit d’amendement, pour retenir le seul critère, repris par le constituant à l’article 45 de la constitution, de l’existence d’un lien avec le texte du projet ou de la proposition de loi.
Dans ces décisions de 2001, le Conseil constitutionnel avait en effet jugé qu’il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la constitution que le droit d’amendement peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 45, s’exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des articles 39 et 44 de la constitution, être dépourvues de tout lien avec l’objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement10.
L’amendement relatif à l’article 3 de la loi déférée, spécifiquement visé, qui présentait un lien direct avec l’article 1er de la proposition de loi déposée au Sénat, a en outre donné lieu au dépôt et à l’examen, de plusieurs amendements et sous-amendements. Le Conseil constitutionnel juge donc que le grief tiré de la méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire doit être écarté. La loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la constitution11.
B – L’absence de principe de publicité des avis du Conseil d’État
S’agissant des griefs tirés à la fois de l’absence d’étude d’impact et d’avis publié du Conseil d’État, il faut au préalable apporter des éléments de rappels. Il n’existe traditionnellement pas de publicité des avis du Conseil d’État. Cependant, depuis 2015, à l’initiative du président de la République12 d’alors, François Hollande, il est possible – mais pas obligatoire – de rendre public, pour le gouvernement, des avis rendus par le Conseil d’État sur un texte législatif en tout ou partie. Il faut encore rappeler que l’article 39 de la constitution prévoit désormais la possibilité pour le Parlement de saisir le Conseil d’État de propositions de lois pour avis, procédure non obligatoire – de même que l’étude d’impact – mais régulièrement utilisée13.
Le gouvernement souligne, dans ses observations, que les sénateurs auteurs de la proposition n’ont fait qu’exercer le droit d’initiative que le premier alinéa de l’article 39 de la constitution confère concurremment, en matière législative, au Premier ministre et aux membres du Parlement, et que les deuxième et troisième alinéas du même article ne soumettent à l’avis du Conseil d’État et aux conditions de présentation définies par une loi organique que les projets de loi.
C’est sur ces bases de réflexions que le Conseil constitutionnel juge qu’aucune disposition constitutionnelle n’impose au gouvernement de rendre public l’avis qu’il sollicite du Conseil d’État sur l’un de ses projets d’amendement. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire doit être écarté. La loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la constitution.
La procédure jugée régulière, le Conseil constitutionnel juge le fond des dispositions législatives nouvelles. Il valide l’ensemble des dispositions relatives au déroulé de la manifestation.
II – Un arsenal législatif validé quant au déroulé de la manifestation
La jurisprudence constitutionnelle des années 1970 avait déjà eu à se prononcer sur des questions de fouille des véhicules. Le caractère trop général des fouilles envisagées avait alors été censuré de la manière suivante. Rappelant que l’article 66 de la constitution, en réaffirmant ce principe, en confie la garde à l’autorité judiciaire, il soulignait alors que le texte soumis à son examen avait pour objet de donner aux officiers de police judiciaire ou, sur ordre de ceux-ci, aux agents de police judiciaire, le pouvoir de procéder à la visite de tout véhicule ou de son contenu aux seules conditions que ce véhicule se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique et que cette visite ait lieu en la présence du propriétaire ou du conducteur.
Il avait alors estimé que les pouvoirs attribués par cette disposition, dans les conditions prévues par la loi, aux officiers de police judiciaire et aux agents agissant sur l’ordre de ceux-ci auraient pu s’exercer, sans restriction, dans tous les cas, en dehors de la mise en vigueur d’un régime légal de pouvoirs exceptionnels, alors même qu’aucune infraction n’aurait été commise et sans que la loi subordonne ces contrôles à l’existence d’une menace d’atteinte à l’ordre public. Il en était résulté une censure, en raison de l’étendue des pouvoirs – dont la nature n’était, selon le juge constitutionnel, par ailleurs, pas définie – conférés aux officiers de police judiciaire et à leurs agents, du caractère très général des cas dans lesquels ces pouvoirs auraient pu s’exercer et de l’imprécision de la portée des contrôles auxquels ils étaient susceptibles de donner lieu. Le haut conseil avait alors jugé que ce texte portait atteinte aux principes essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté individuelle. Il l’avait donc déclaré contraire à la constitution14.
Aujourd’hui, et sur ce domaine, le législateur lie ces pouvoirs aux menaces pesant sur l’ordre public. L’article 2 de la loi déférée insère dans le Code de procédure pénale un article 78-2-5 qui permet, sous certaines conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des agents de police judiciaire, de procéder, sur les lieux d’une manifestation et à ses abords immédiats, à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les députés requérants reprochaient à ces dispositions de porter atteinte aux libertés d’aller et venir et de réunion ainsi qu’au droit à l’expression collective des idées et des opinions et au principe de proportionnalité des peines. Ils estimaient en plus que ces dispositions n’étaient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi dès lors qu’il existe déjà d’autres dispositions permettant de procéder à de telles opérations et que le périmètre sur lequel elles peuvent être conduites est très large.
Dans son argumentation, le gouvernement précisait que si le II de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale autorise, dans des conditions analogues, les visites, inspections visuelles et fouilles prévues par la disposition critiquée, c’est aux fins de recherche et de poursuite d’infractions limitativement énumérées. Parmi celles-ci figurent certes, par le renvoi au 3° du I, les infractions en matière d’armes des articles 222-54 du Code pénal et L. 317-8 du Code de la sécurité intérieure ; mais ceux-ci ne visent pas les armes par destination, qui sont au contraire dans le champ de l’article 431-10 du Code pénal. D’autre part, l’article 78-2-4 du Code de procédure pénale, également invoqué par les députés requérants, n’a pas le même objet puisqu’il poursuit des finalités administratives de prévention d’une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, alors que les mesures mises en œuvre au titre de l’article 78-2-5 nouveau poursuivront une finalité exclusivement judiciaire de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction pénale à laquelle il fait référence.
Selon le gouvernement, dans ses observations adressées au juge constitutionnel, les dispositions critiquées assurent une conciliation équilibrée entre les exigences inhérentes à la recherche des auteurs d’infractions, qui est nécessaire à la sauvegarde de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle, et la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle garantie par l’article 2 de la Déclaration de 1789, ainsi d’ailleurs qu’avec le droit au respect de la vie privée que celle-ci implique également.
L’introduction d’armes, et en particulier d’armes par destination telles que des barres de fer, boules de pétanque ou bouteilles d’acide, dans des manifestations sur la voie publique a été identifiée de longue date comme un facteur de trouble grave à l’ordre public justifiant une répression pénale. Les événements des derniers mois ont mis en évidence l’intérêt public qui s’attache à une recherche plus efficace des auteurs de cette infraction, au regard duquel la possibilité de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à des visites de véhicules et fouilles de bagages ne saurait être regardée comme excessive, selon le critère défini par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 200315.
Dans cette dernière décision, le Conseil constitutionnel avait en effet jugé que s’agissant de visites de véhicules réalisées sur réquisitions du procureur de la République, que la conciliation assurée par ces dispositions entre les principes constitutionnels rappelés ci-dessus n’est entachée d’aucune erreur manifeste ; que la liste des infractions figurant au premier alinéa du nouvel article 78-2-2 du Code de procédure pénale n’est pas manifestement excessive au regard de l’intérêt public qui s’attache à la recherche des auteurs de ces infractions ; que ces dispositions ne méconnaissent pas l’article 66 de la constitution ; que leurs termes sont assez clairs et précis pour répondre aux exigences de l’article 34 de celle-ci ; qu’il en est notamment ainsi, contrairement aux affirmations des requérants, de l’expression « lieux accessibles au public » et de celle de « véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence » ; qu’ainsi qu’il ressort des termes mêmes du premier alinéa du nouvel article 78-2-2 du Code de procédure pénale, chaque renouvellement de l’autorisation du procureur de la République vaudra pour une durée de vingt-quatre heures16.
Le juge constitutionnel fait droit à cette argumentation en estimant que les opérations d’inspection visuelle et de fouille de bagages ainsi que de visite de véhicules ne peuvent être réalisées que pour la recherche et la poursuite de l’infraction, prévue à l’article 431-10 du Code pénal, de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme. Elles poursuivent donc un objectif de recherche des auteurs d’une infraction de nature à troubler gravement le déroulement d’une manifestation. Il estime d’autre part, que les dispositions contestées prévoient que ces opérations se déroulent sur les lieux d’une manifestation et à ses abords immédiats et qu’elles sont autorisées par une réquisition écrite du procureur de la République. Il en résulte que ces opérations sont placées sous le contrôle d’un magistrat de l’ordre judiciaire qui en précise, dans sa réquisition, le lieu et la durée en fonction de ceux de la manifestation attendue.
Ainsi, ces opérations ne peuvent viser que des lieux déterminés et des périodes de temps limitées. Enfin, il ressort des paragraphes II et III de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale, auxquels renvoient les dispositions contestées, que tant les opérations d’inspection et de fouille des bagages que celles de visite de véhicules ne peuvent conduire à une immobilisation de l’intéressé que le temps strictement nécessaire à leur réalisation. Elles n’ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de restreindre l’accès à une manifestation ni d’en empêcher le déroulement. Il en résulte, selon le Conseil constitutionnel qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a procédé à une conciliation qui n’est pas déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et n’a pas porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée17.
L’équilibre est une recherche permanente dans ce domaine. On citera ici, a contrario, une décision QPC par laquelle le juge constitutionnel a censuré des dispositions relatives à des fouilles dans le cadre de l’état d’urgence. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge constitutionnel avait indiqué qu’en application du premier alinéa de l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955, pour les zones dans lesquelles l’état d’urgence a été déclaré, le préfet peut autoriser, par décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints à procéder à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Selon lui, il résulte des autres alinéas de l’article 8-1, d’une part, que le préfet doit désigner précisément les lieux concernés par ces opérations, ainsi que la durée pendant laquelle elles sont autorisées, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, et, d’autre part, que certaines des garanties applicables aux inspections, fouilles et visites réalisées dans un cadre judiciaire sont rendues applicables aux opérations conduites sur le fondement de l’article 8-1. Il juge alors cependant qu’il peut être procédé à ces opérations, dans les lieux désignés par la décision du préfet, à l’encontre de toute personne, quel que soit son comportement et sans son consentement. S’il est loisible au législateur de prévoir que les opérations mises en œuvre dans ce cadre peuvent ne pas être liées au comportement de la personne, la pratique de ces opérations de manière généralisée et discrétionnaire serait incompatible avec la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Or, en prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu dans les zones où s’applique l’état d’urgence, le législateur a permis leur mise en œuvre sans que celles-ci soient nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public dans les lieux en cause. Dès lors, le juge accueille la QPC et juge que la loi n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée18.
« Nécessaire, adaptée et proportionnée » est une expression désormais cardinale dans la recherche du meilleur équilibre entre sécurité et liberté. Ces adjectifs doivent caractériser les restrictions de liberté pour que celles-ci soient constitutionnelles. C’est sur cette base que le juge constitutionnel décide de censurer l’interdiction préventive de manifester.
III – Un dispositif censuré quant à l’interdiction préventive de manifester
C’est la norme de référence relative à la conciliation entre sécurité et liberté qui sert de fil conducteur à l’analyse juridique menée par le juge constitutionnel : Aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d’expression et de communication, dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Rappelant qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d’aller et venir, le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ainsi que le droit d’expression collective des idées et des opinions19, le juge constitutionnel censure la disposition décriée.
En effet, si législateur tient de l’article 34 de la constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Cette exigence s’impose non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions.
En outre, lorsqu’une manifestation sur la voie publique n’a pas fait l’objet d’une déclaration ou que cette déclaration a été tardive, l’arrêté d’interdiction de manifester est exécutoire d’office et peut être notifié à tout moment à la personne, y compris au cours de la manifestation à laquelle il s’applique.
Les requérants contestaient ces dispositions en estimant qu’eu égard à l’imprécision des conditions de mise en œuvre de ces dispositions, le législateur doit être regardé comme n’ayant pas exercé pleinement la compétence que lui confie la constitution et, en particulier, son article 34, et comme ayant méconnu le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789.
Ils se fondent ainsi sur la décision du 21 avril 200520, selon laquelle il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la constitution et, en particulier, son article 34 ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la constitution qu’à la loi.21
Il aurait en outre, selon eux, porté atteinte au droit d’expression collective des idées et des opinions garanti par l’article 11 de la Déclaration de 1789, dont procède la liberté de manifestation. Ils se fondent alors sur la décision du 18 janvier 199522. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel soulignait que les mesures ainsi édictées par la loi touchent aux conditions dans lesquelles s’exercent la liberté individuelle, la liberté d’aller et venir et le droit d’expression collective des idées et des opinions ; qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, l’exercice de ces libertés constitutionnellement garanties et d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et notamment des atteintes à la sécurité des personnes et des biens qui répond à des objectifs de valeur constitutionnelle23.
Ils mettaient en évidence, selon eux, des atteintes qui ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi, en se fondant la décision du 10 juin 200924. Enfin les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la loi ne garantit pas un droit au recours effectif.
Au contraire, selon le gouvernement, dans ses observations devant le Conseil constitutionnel, les comportements définis par les dispositions critiquées comme de nature à justifier le prononcé de la mesure d’interdiction sont-ils, contrairement à ce qui est soutenu, définis par des dispositions suffisamment précises, qui n’exposent pas les personnes concernées à un risque d’arbitraire ou d’interprétation contraire à la constitution. Le gouvernement soutenait que l’article L. 211-4-1 nouveau du Code de la sécurité intérieure que, dans tous les cas, une personne ne pourra être visée par une mesure d’interdiction que pour autant que sa participation à une manifestation puisse être regardée comme constituant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; ce critère de la menace pour l’ordre public, qualifiée ou non, se retrouve dans de nombreuses autres législations de police administrative et tant l’Administration que le juge ont l’habitude de le mettre en œuvre.
Le Conseil constitutionnel ne retient pas cette défense du gouvernement et juge ainsi que, compte tenu de la portée de l’interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, le législateur a porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée25. Il retient donc l’argumentation des requérants. Selon eux, en effet, comme leur saisine en atteste, les critères de constitutionnalité de la restriction de liberté n’étaient pas réunis.
Le curseur n’est certes pas évident à placer. Le gouvernement avait pris soin, dans ses observations, de placer la loi mise en cause dans un contexte de tension sociale.
Alors que les événements des derniers mois ont attesté, par la persistance de troubles majeurs en dépit de l’importance des moyens de maintien de l’ordre qui ont été mobilisés, le besoin d’outils juridiques nouveaux, l’article L. 242-1 nouveau, qui concerne un nombre très limité de personnes, offre une réponse appropriée. Ce contexte ne suffit pas à convaincre le juge constitutionnel.
C’est la décision du 10 juin 2009 qui met le mieux en évidence le triptyque qui conduit ici à la censure de la loi. Le juge précise alors qu’aux termes de l’article 34 de la constitution : « La loi fixe les règles concernant… les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d’édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l’objectif de lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ; que, toutefois, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi26. « Nécessaires, adaptées et proportionnées » sont les trois termes clés.
Par comparaison, à propos de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, le juge constitutionnel avait validé les dispositions contestées.
La loi insérait dans le Code pénal un article 222-14-2 ainsi rédigé : « Le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
L’exposé des motifs de la proposition de loi indiquait qu’il s’agissait d’instaurer « une nouvelle incrimination réprimant de façon spécifique la participation à une bande ayant l’intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens concertées, dont la définition est directement inspirée de celle de l’association de malfaiteurs. Il s’agissait alors, selon l’exposé des motifs, de combler les lacunes de l’article 450-1 du Code pénal qui est limité « à l’intention de commettre un délit puni d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement, ce qui n’est notamment pas le cas de violences volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours, même commises en réunion » (la peine encourue est alors de trois ans d’emprisonnement).
Les requérants estimaient que la loi méconnaissait les exigences constitutionnelles en matière pénale, à savoir le principe de légalité des délits et des peines, le principe de responsabilité du fait personnel, la présomption d’innocence et le respect des droits de la défense et, enfin, le principe de proportionnalité et de nécessité des peines. Ils estimaient également que cette nouvelle infraction portait atteinte au droit d’expression collective des idées et des opinions. Le Conseil constitutionnel avait ainsi pu juger en 2010, à propos de cette loi relative, elle aussi, à la préservation de l’ordre public, « qu’en instituant l’infraction critiquée, le législateur a entendu réprimer certaines actions préparatoires à des violences volontaires contre les personnes, à des destructions ou à des dégradations de biens que des personnes réunies en groupe projettent de commettre ; qu’à cette fin, la nouvelle incrimination emprunte à la définition de la circonstance aggravante de crime organisé prévue par l’article 132-71 du Code pénal les termes de “groupement” et de “préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels” ; que ces termes sont repris dans les éléments constitutifs du délit d’association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du Code pénal ; qu’il est ajouté que, pour encourir la condamnation, l’auteur doit avoir participé “sciemment” au groupement ; qu’il est précisé, d’une part, que ce groupement peut être formé “même… de façon temporaire”, d’autre part, que la participation constatée est “en vue de la préparation” d’infractions spécifiées ; que le délit est ainsi défini en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ; que ses éléments constitutifs, formulés en des termes qui ne sont ni obscurs ni ambigus, ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à mettre en cause le droit d’expression collective des idées et des opinions »27.
Le Conseil constitutionnel a en effet dégagé une exigence générale qui s’impose au législateur « d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques »28. En matière pénale, une telle exigence fondée sur les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 est à la fois plus ancienne dans la jurisprudence du Conseil et plus exigeante : le principe de légalité des délits et des peines fonde ainsi une exigence particulière à la matière pénale, de la précision de la loi pénale destinée à exclure les formules obscures ou imprécises, sources d’arbitraire.
En l’espèce, le législateur avait repris des éléments constitutifs, d’une part, de la circonstance aggravante de crime organisée, prévue par l’article 132-71 du Code pénal et, d’autre part, de la définition de l’association de malfaiteurs définie par son article 450-1. Par rapport à ce dernier délit, la nouvelle incrimination présentait trois différences, l’exigence d’un dol spécial (« sciemment »), la possibilité d’une constitution occasionnelle de bandes et sa finalité (la commission de violences volontaires, de destructions ou de dégradations).
S’agissant des éléments matériels de l’infraction, le Conseil constitutionnel a confirmé l’analyse qu’il avait faite dans sa décision du 2 mars 2004 : le Conseil avait en effet jugé « qu’en particulier, n’est ni obscure, ni ambiguë l’expression “bande organisée”, qui est définie par l’article 132-71 du Code pénal comme “tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions” et qui se distingue ainsi de la notion de réunion ou de coaction ».
Les notions employées par le législateur pour définir la nouvelle infraction ne revêtent pas un caractère obscur ou ambigu. Au regard de l’exigence constitutionnelle de précision de la loi pénale, elles ne posent pas de difficulté.
Le constat du caractère précis et non équivoque de la définition des éléments constitutifs de la nouvelle incrimination a également fondé la motivation de la décision du Conseil constitutionnel rejetant le grief tiré de l’atteinte à l’expression collective des idées et des opinions. En elle-même, cette incrimination n’était pas de nature à mettre en cause le droit d’expression collective des idées et des opinions29.
Par comparaison encore, cette fois dans le cadre d’une loi relative à la vidéosurveillance30, le Conseil constitutionnel était déjà sollicité sur les questions de prévention d’atteintes à l’ordre public ; D’ailleurs, dans ses observations, à propos de la loi dite Anti-casseurs, le gouvernement avait tenté de s’appuyer sur la décision de 1995 sur la vidéosurveillance pour gagner la conviction du juge constitutionnel. Ce dernier avait en effet validé l’essentiel de la loi en la matière selon le raisonnement suivant. Il avait estimé en premier lieu que le législateur a imposé que le public soit informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance ou de l’autorité et de la personne responsable ; qu’il a interdit que soient visualisées les images de l’intérieur des immeubles ainsi que de façon spécifique leurs entrées. Il relève alors ensuite que le législateur a assorti, sauf en matière de défense nationale, les autorisations préfectorales de l’avis d’une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. Il précise encore qu’eu égard au rôle assigné à cette commission, sa composition doit comporter des garanties d’indépendance.
Le juge constitutionnel se fonde alors aussi sur ce que le législateur a exigé que l’autorisation préfectorale prescrive toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et quant aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Il retient encore que la loi a ouvert à toute personne intéressée le droit de s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans un délai maximum d’un mois, qu’il a précisé que cet accès est de droit sous réserve que soient opposés des motifs « tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers », que la référence au « droit des tiers » doit être regardée comme ne visant que le cas où une telle communication serait de nature à porter atteinte au secret de leur vie privée. Il se fonde encore sur la circonstance que le législateur a en outre garanti à toute personne intéressée la possibilité de saisir la commission départementale de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéosurveillance, qu’eu égard au caractère général de sa formulation, ce droit doit s’entendre comme ménageant la possibilité de saisir la commission de toute difficulté d’accès à des enregistrements concernant les intéressés ou tenant à la vérification de la destruction de ces enregistrements ; que le législateur a, au surplus, rappelé que cette procédure administrative ne saurait faire obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.
Enfin, dans cette même décision de 1995, le juge constitutionnel considère qu’en prévoyant que les enregistrements doivent être détruits dans un délai maximum d’un mois hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, le législateur doit être regardé comme ayant d’une part prévu qu’il soit justifié de leur destruction et d’autre part interdit toute reproduction ou manipulation de ces derniers hors le cas prévu par le I de l’article en cause où les enregistrements de vidéosurveillance seraient utilisés pour la constitution de fichiers nominatifs conformément aux garanties prévues par la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il ressort de ces décisions et de celle du 4 avril 2019, l’importance de la précision, la proportionnalité, l’adaptation et la nécessité des dispositions visant à encadrer le droit de manifester et la lutte contre les risques d’atteintes à l’ordre public. C’est en effet faute de remplir ces impératifs pour la loi que le Conseil constitutionnel la censure en jugeant que compte tenu de la portée de l’interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, le législateur a porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Ces dispositions jugées non conformes étant séparables du reste de la loi, celle-ci a pu entrer être promulguée le 11 avril 201931.
Ainsi les dispositions relatives à la fouille des personnes et effets, dans le contexte de manifestations sont déjà entrées en vigueur. Après l’article 78-2-4 du Code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-5 ainsi rédigé. Selon l’article 78-2-5, de ce code, aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 431-10 du Code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à : « 1° L’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l’article 78-2-2 ;
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2.
Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».
Il en va de même des cas d’interdiction de manifestations, encadrés par la loi. Le Code pénal est ainsi modifié : après l’article 131-32, il est inséré un article 131-32-1 ainsi rédigé : « Art. 131-32-1.-La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction. Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ». Après le premier alinéa de l’article 222-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13 et 222-14-2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1 ». Le I de l’article 322-15 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l’article 322-1 et les articles 322-2, 322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique » ;
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431-8-1 ainsi rédigé : « Selon l’article 431-8-1, les articles 393 à 397-7 et 495-7 à 495-15-1 du Code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus par cette section ».
En somme, cette loi, adoptée dans un contexte de crise sociale et de risques de troubles exacerbés pour l’ordre public a été dans son ensemble, validée. Même sans les dispositions censurées, elle donne un cadre supplémentaire aux autorités en charge du respect de l’ordre public. La recherche de l’équilibre entre sécurité et liberté demeure, non seulement un objectif constitutionnel, mais plus généralement un objectif social. Si des troubles à l’ordre public devaient se perpétuer, la décision du Conseil constitutionnel apparaît quelque peu laconique, même si éclairée par l’ensemble des précédents existant en la matière. Ce laconisme ne permet pas de savoir dans quelles conditions une interdiction préventive de manifestation serait conforme à la constitution. En effet, la grille d’analyse, de la nécessité, de l’adaptation et de la proportion se caractérise par une certaine plasticité, non dénuée de marge d’appréciation.
Notes de bas de pages
-
1.
Déc. Cons. const., 4 avr. 2019, n° 2019-780 DC : https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2019-780-dc-du-4-avril-2019-communique-de-presse.
-
2.
Rappelé au point 1 de la décision précitée du 4 avril 2019 : Cons. const., 4 avr. 2019, n° 2019-780 DC.
-
3.
Idem.
-
4.
On trouve cette lettre de saisine sur le site internet du Conseil constitutionnel.
-
5.
Déc. Cons. const., 30 déc. 1976, n° 76-71 DC.
-
6.
Point 3 de la décision ici commentée.
-
7.
Selon l’article 39 de la constitution, l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
-
8.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la conférence des présidents et le gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
-
9.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
-
10.
L. org. n° 2009-403, 15 avr. 2009, loi relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la constitution : JORF, 16 avr. 2009.
-
11.
Déc. Cons. const., 19 juin 2001, n° 2001-445 DC ; Déc. Cons. const., 11 juill. 2001, n° 2001-450 DC.
-
12.
Déc. Cons. const., 19 juin 2001, n° 2001-445 DC, cons. n° 48, Cons. const., 11 juill. 2001, n° 2001-450 DC, cons. n° 28.
-
13.
Point 7 de la décision du 4 avril 2019, précitée.
-
14.
Lors de ses vœux aux corps constitués le 20 janvier 2015, le président de la République a annoncé sa volonté de diffuser ces avis : « Mieux légiférer, c’est aussi mieux préparer les projets de loi. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de rompre avec une tradition séculaire des secrets qui entourent les avis du Conseil d’État. Le Conseil d’État est le conseil juridique du gouvernement. Son avis est d’intérêt public et son expertise sera donc rendue publique. Le Conseil d’État, par ses avis, informera donc les citoyens, mais il éclairera aussi les débats parlementaires ». Depuis le 19 mars 2015, les avis du Conseil d’État sont publiés sur le site Legifrance. Pour la première fois le 19 mars 2015, à l’occasion de la présentation du projet loi relatif au renseignement, les avis du Conseil d’État sur les projets de loi sont rendus publics à l’issue du Conseil des ministres qui en a délibéré et ils sont joints au projet déposé au Parlement. La diffusion de ces avis a pour objet d’éclairer les débats parlementaires et d’informer les citoyens.
-
15.
V. notamment sur ce point, notre ouvrage, Le Conseil d’État, acteur et censeur de l’action publique, 2017, LGDJ.
-
16.
Déc. Cons. const., 12 janv. 1977, n° 76-75 DC.
-
17.
Déc. Cons. const., 13 mars 2003, n° 2003-467 DC.
-
18.
Déc. Cons. const., 13 mars 2003, n° 2003-467 DC.
-
19.
Points 13 à 16 de la décision ici commentée.
-
20.
Déc. Cons. const., 1er déc. 2017, n° 2017-677 QPC, Ligue des droits de l’Homme [Contrôles d’identité, fouilles de bagages et visites de véhicules dans le cadre de l’état d’urgence].
-
21.
Point 9 de la décision ici commentée.
-
22.
Déc. Cons. const., 21 avr. 2005, n° 2005-512 DC.
-
23.
Déc. Cons. const., 21 avr. 2005, n° 2005-512 DC, cons. 9.
-
24.
Déc. Cons. const., 18 janv. 1995, n° 94-352 DC.
-
25.
Déc. Cons. const., 18 janv. 1995, n° 94-352 DC, cons. 16.
-
26.
Déc. Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC.
-
27.
Communiqué de presse précité : https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2019-780-dc-du-4-avril-2019-communique-de-presse.
-
28.
Déc. Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, cons. 15.
-
29.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/2010604DC.htm, point 9.
-
30.
Déc. Cons. const., 24 juill. 2003, n° 2003-475 DC, loi portant réforme de l’élection des sénateurs, cons. 20 ; Cons. const., 29 juill. 2004, n° 2004-500 DC, loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales, cons. 13.
-
31.
Commentaires sur la décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2010604dc/ccc_604dc.pdf.
-
32.
Déc. Cons. const., 18 janv. 1995, n° 94-352 DC, loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
-
33.
L. n° 2019-290, 10 avr. 2019, visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations : JORF, 11 avr. 2019.