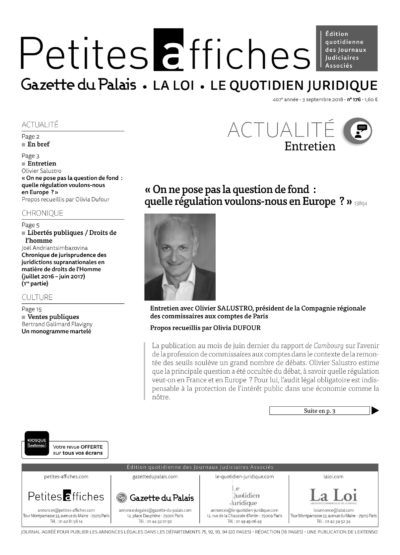Chronique de jurisprudence des juridictions supranationales en matière de droits de l’Homme (juillet 2016 – juin 2017) (1re partie)
PAS DE CHAPEAU
Avant-Propos
Les préoccupations nées de la complexité de la société contemporaine sont de plus en plus appréhendées sous l’angle des droits de l’Homme. Cette tendance transparaît dans la jurisprudence des cours supranationales comme le montre la présente livraison qui couvre le second semestre 2016 et le premier semestre 2017. En premier lieu, on peut y voir l’ancrage des valeurs véhiculées par les droits de l’Homme dans la société démocratique contemporaine. En second lieu, au-delà même de la juridictionnalisation de cette société démocratique à tous les niveaux, y compris au niveau supranational, cette omniprésence des droits de l’Homme témoigne de la confiance faite par les justiciables à la fois aux cours supranationales et aux instruments supranationaux relatifs aux droits de l’Homme pour résoudre des difficultés non résolues au niveau national. À cet égard, nous sommes frappés par la multiplication du nombre de questions de société portées jusque devant les cours supranationales : celles-ci vont des questions d’orientation sexuelle jusqu’au port du voile islamique dans les entreprises en passant par la gestation pour autrui et la protection des personnes handicapées.
La place centrale ainsi reconnue par les justiciables aux cours supranationales pour réguler la société démocratique met également en lumière un autre rôle des instruments supranationaux relatif aux droits de l’Homme dans la construction et le développement de valeurs communes dans des entités supranationales qui dépassent le cadre étatique. L’intégration progressive de ces valeurs communes dans les systèmes juridiques nationaux ne se fait pas sans difficultés car elle peut se heurter à des principes nationaux comme elle peut nécessiter une adaptation du droit national aux exigences du droit supranational. Ainsi, l’européanisation croissante du droit pénal implique une prise en compte de l’interprétation des grands principes du droit pénal par les cours supranationales comme elle incite les autorités nationales à s’aligner sur les standards européens en matière pénale. La construction d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union européenne implique la prise en compte par les juridictions pénales nationales de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le mandat d’arrêt européen. De même, la vie de la société démocratique est rythmée par le respect de quelques libertés essentielles comme le droit à des élections libres, le droit au respect de la vie privée ou la liberté d’expression. Les cours supranationales veillent à cette animation de la société démocratique dans le respect de ces droits civils et politiques.
Au fond, les cours supranationales démontrent ici l’importance des droits de l’Homme dans l’édification de sociétés politiques au-delà des États. Ainsi, elle fixe des standards supranationaux dans l’élaboration d’un espace pénal supranational (I), dans la résolution des questions de société (II) et dans l’animation et la protection de la société démocratique (III).
I – La recherche de standards supranationaux dans l’élaboration d’un espace pénal supranational
A – Nouvelles précisions sur le principe non bis in idem de l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention EDH
Dans son arrêt de grande chambre A. et B. c/ Norvège rendu le 15 novembre 20161, la Cour européenne des droits de l’Homme a apporté d’importantes précisions sur le contenu du principe non bis in idem. Dans cette affaire, deux contribuables avaient été condamnés par les autorités norvégiennes à des sanctions administratives et pénales en raison de l’infraction fiscale qu’ils avaient commise. Or selon eux, le fait d’être poursuivis et sanctionnés deux fois pour les mêmes faits était contraire au principe non bis in idem contenu dans l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention EDH. Dans son arrêt, la Cour a d’une part confirmé qu’afin de déterminer si une procédure revêt un caractère pénal, au sens de l’article 4 du protocole 7, devaient être appliqués les critères de l’arrêt Engel2 et elle a d’autre part maintenu la conception de l’idem qu’elle avait adoptée dans l’affaire Zolotoukhine3. Mais surtout, et c’est là ce qui a retenu l’attention de la doctrine, elle a jugé que la conduite de procédures mixtes aboutissant à un cumul de sanctions administratives et pénales pouvait être compatible avec le principe non bis in idem (I) dès lors qu’un lien matériel et temporel suffisamment étroit unissait les procédures (II).
I. La compatibilité du cumul de sanctions administratives et pénales avec le principe non bis in idem
En octroyant un brevet de conventionnalité à la conduite de procédures mixtes, la Cour a infléchi sa jurisprudence relative au principe non bis in idem (A) exprimant ainsi sa volonté de faire preuve de plus de bienveillance à l’égard des États parties (B).
A. Un infléchissement jurisprudentiel à la faveur d’une conception plus souple du principe non bis in idem
Alors que dans ses arrêts Zolotoukhine et Grande Stevens4 avait été retenue une interprétation stricte du principe non bis in idem, la Cour avec son arrêt A. et B. c/ Norvège a consacré la conventionnalité de la conduite de procédures administratives et pénales fondées sur les mêmes faits. Ainsi, si la Cour a souligné que « la manière la plus sûre de veiller au respect de l’article 4 du protocole n° 7 consiste à prévoir, à un stade opportun, une procédure à un seul niveau permettant la réunion des branches parallèles du régime légal régissant l’activité en cause » (§ 130), elle a néanmoins considéré que « les États devraient pouvoir légitimement opter pour des réponses juridiques complémentaires face à certains comportements socialement inacceptables (…) au moyen de différentes procédures formant un tout cohérent de manière à traiter sous ses différents aspects le problème social en question » (§ 121). Plutôt que de privilégier une interprétation stricte du principe non bis in idem, la Cour a donc exprimé une forme de bienveillance à l’égard des procédures mixtes en matière de fraude fiscale, choisissant ainsi d’étendre l’approche qu’elle avait adoptée en matière d’infractions routières5.
B. Une solution commandée par la volonté de respecter la diversité des systèmes répressifs nationaux en matière fiscale
L’intervention en qualité de tiers de six États parties dans la procédure n’est sûrement point étrangère au fait que la Cour dans cet arrêt ait valorisé la liberté dont disposent les États pour « décider de l’organisation de leur système juridique, y compris de leurs procédures pénales » (§ 120). Se référant aux conclusions de l’avocat général près la Cour de justice dans l’affaire Fransson6, la Cour a ainsi souligné que « l’imposition de sanctions sur la base tant du droit administratif que du droit pénal pour la même infraction est une pratique très répandue dans les États membres de l’Union européenne, surtout dans des domaines tels que la fiscalité, les politiques environnementales ou la sécurité publique » (§ 118). Pour autant, comme le soulignaient Luca D’Ambrozio et Donato Vozza, cet arrêt ne doit pas être interprété « comme une manifestation de faiblesse face aux revendications souverainistes des États » mais comme l’« expression de la volonté d’assurer la cohérence du système multi-niveaux de protection des droits fondamentaux dans l’espace juridique européen »7. D’ailleurs, la conventionnalité des procédures mixtes en matière de fraude fiscale ne saurait être absolue dès lors que doit être démontré que la combinaison de celles-ci « est le fruit d’un système intégré permettant de réprimer un méfait sous ses différents aspects de manière prévisible et proportionnée et formant un tout cohérent, en sorte de ne causer aucune injustice à l’intéressé » (§ 122). Ainsi, tout en faisant preuve de bienveillance à l’égard des États parties, la Cour a pris le soin de délivrer « un véritable mode d’emploi »8 de la conciliation des procédures mixtes avec le principe non bis in idem.
II. La détermination des critères de conventionnalité des procédures mixtes en matière de fraude fiscale
Afin de déterminer si la conduite parallèle de procédures administratives et pénales est compatible avec le principe non bis in idem, la Cour a précisé que les procédures devaient disposer d’un lien matériel et temporel suffisamment étroit (A). Malgré les éclairages apportés, des incertitudes subsistent quant à la substance du critère du lien temporel (B).
A. Une conventionnalité conditionnée par l’existence d’un lien matériel et temporel suffisamment étroit
Afin que puisse être ménagé un équilibre entre la préservation des intérêts de l’individu et le respect de la diversité des systèmes répressifs nationaux en matière fiscale, la Cour a conditionné la conventionnalité des procédures mixtes à l’existence « d’un lien temporel et matériel suffisamment étroit » (§ 125). Pour que soit établie l’existence d’un lien suffisamment étroit d’un point de vue matériel, la Cour a souligné que les différentes procédures devaient viser des buts complémentaires et concerner des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société, que la mixité des procédures devait être prévisible, que les autorités compétentes étaient tenues d’interagir afin que l’établissement des faits dans l’une des procédures soit repris dans l’autre et enfin, que les sanctions infligées à l’issue de ces procédures soient proportionnées (§ 132). La Cour a par la suite ajouté que l’existence d’un lien temporel devait être établi même lorsque « le lien matériel est suffisamment solide » afin que soit pleinement protégé l’intérêt des justiciables (§ 134).
B. Les incertitudes relatives à la substance du critère du lien temporel suffisamment étroit
Deux incertitudes relatives au critère du lien temporel interrogent la portée de la jurisprudence A et B c/ Norvège. D’une part, alors même que la Cour a estimé qu’en présence d’un lien matériel et temporel suffisamment étroit ne se posait plus la question de savoir si une décision définitive avait été rendue à l’issue de l’une des procédures « dès lors qu’il y a non pas une répétition des poursuites à proprement parler mais plutôt une combinaison de procédures dont on peut considérer qu’elles forment un tout intégré » (§ 126), a été réintroduite, au stade de l’application du critère du lien temporel au cas d’espèce, la référence au caractère définitif de la décision (§ 151)9. D’autre part, elle a estimé qu’un délai de 9 mois séparant la fin de la première procédure et la fin de la seconde procédure n’était pas de nature « à rompre le lien temporel unissant la procédure fiscale et la procédure pénale » (§ 151), sans que ne soient établis les éléments de nature à détériorer un tel lien. Si la Cour a défini les conditions qui devaient être remplies pour que soit satisfait au critère du lien matériel, elle n’a pas défini la substance du critère du lien temporel alors même que des considérations de sécurité juridique nécessiteraient que soient apportées de plus amples précisions sur ce point. Si la portée de cet arrêt doit encore être précisée, la Cour avec cette jurisprudence a entendu poser les jalons d’une redéfinition des contours du principe non bis in idem au niveau européen.
Julie TEYSSEDRE
B – Le principe ne bis in idem dans l’arrêt Orsi et Baldetti : entre autonomie formelle et harmonisation matérielle
CJUE, 4e ch., 5 avr. 2017, nos C-217/15, Massimo Orsi et C-350/15, Luciano Baldetti10. Deux sociétés italiennes ont omis de payer la TVA dans leur État et ce pour un montant de plus d’un million d’euros. L’administration fiscale a sévi contre ces sociétés par une mise en recouvrement donnant notamment lieu à une sanction fiscale. Ces sanctions sont devenues définitives à la suite d’un accord entre les requérants et l’administration. À la suite de cela, l’administration fiscale a déposé plainte contre chacun des requérants, engageant alors une procédure pénale contre les représentants légaux des deux sociétés.
Dans les deux cas, le Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de savoir si les mêmes faits peuvent faire l’objet de sanctions fiscale et pénale.
La CJUE apporte à cette question une réponse légèrement différente de celle proposée par l’avocat général dans ses conclusions, de telle sorte que « L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet de diligenter des poursuites pénales pour omission de verser la taxe sur la valeur ajoutée, après l’infliction d’une sanction fiscale définitive pour les mêmes faits, lorsque cette sanction a été infligée à une société ayant la personnalité morale tandis que lesdites poursuites pénales sont engagées contre une personne physique »11.
Ainsi, cette décision est l’occasion pour la Cour d’interpréter la Charte de manière autonome dans une affaire concernant le principe ne bis in idem (I). La portée de l’arrêt se rapportant à la définition européenne de ce principe est toutefois à relativiser (II).
I. La consécration de la Charte comme norme de référence du droit de l’Union
Alors que le juge national le lui demandait, le juge de l’Union choisit d’écarter la CEDH du champ de sa compétence (A), lui permettant de réaffirmer que, dans l’Union, la Charte est le principal texte de protection des droits fondamentaux (B).
A. Le refus apparent d’interpréter la Charte à la lumière de la Convention européenne des droits de l’Homme
Contrairement aux conclusions de l’avocat général qui intègre dans son raisonnement la Convention européenne des droits de l’Homme et qui conclut par une interprétation de la Charte à la lumière du protocole n° 7 à la CEDH, la Cour de justice de l’Union européenne choisit d’écarter de ses normes de référence la CEDH et ses protocoles en considérant que la CEDH « ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union »12.
Cette exclusion expresse de la CEDH comme norme de référence est la conséquence logique de l’absence d’adhésion de l’UE à la CEDH mais ne constitue pas un obstacle à la jurisprudence constante13 de la Cour considérant que « les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux »14.
Le refus d’interpréter la Charte à la lumière de la CEDH est d’autant plus relatif qu’en vertu de « l’article 52, paragraphe 3, [de] la Charte dispose que les droits contenus dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention »15. Par conséquent, même si la CJUE ne le concède pas, l’interprétation qu’elle fera du principe ne bis in idem s’inscrira nécessairement dans une protection harmonisée avec celle de la Cour EDH. Formellement, toutefois, c’est la Charte qui trouve à s’appliquer.
B. L’applicabilité réaffirmée de la Charte en matière de TVA
La Charte des droits fondamentaux de l’Union, adoptée à Nice par le Conseil européen, le 7 décembre 2000, et ayant acquis une valeur juridique par le traité de Lisbonne de 2007, « a donc vocation à s’appliquer dans toutes les situations où le droit de l’Union lui-même a vocation à s’appliquer »16.
En l’espèce, les procédures et sanctions en matière de TVA « constituent une mise en œuvre des articles 2 et 273 de la directive n° 2006/112 ainsi que de l’article 325 TFUE et, donc, du droit de l’Union »17. De manière générale, le contentieux de la TVA, qui implique une application du droit de l’Union conduit à une superposition des textes internationaux applicables. En effet, la Charte, comme la Convention européenne, pourrait être applicable au cas sur lequel le tribunal national doit statuer. En ce sens, même si la CJUE réaffirme que la Charte est le seul texte sur lequel elle peut statuer, il est important que cette application se fasse de manière harmonieuse avec les droits garantis par la Convention EDH que le juge national aura aussi à appliquer.
L’interprétation de la Charte s’insère donc dans un dialogue des juges entre la CJUE et la CEDH, conduisant à une harmonisation européenne matérielle du principe ne bis in idem malgré l’hétérogénéité de ses sources.
II. La poursuite sans difficulté du dialogue européen relatif au principe ne bis in idem
Cette décision, si elle permet de préciser la définition du principe ne bis in idem n’est pas une pierre angulaire de sa construction (A). Il pose toutefois les jalons d’une coopération entre la CJUE et la CEDH en la matière (B).
A. Le relatif apport de l’arrêt quant à la définition du principe de ne bis in idem
Le principe ne bis in idem a été construit, à l’échelle européenne, par un dialogue jurisprudentiel entre la CJUE18 et la Cour EDH19. L’arrêt A et B c/ Norvège a notamment fait office de revirement de jurisprudence en « assoupli[ssant] la rigueur de la jurisprudence de la CEDH »20. À la suite de cette affaire, la CJUE devait se positionner et adopter une protection claire du principe ne bis in idem. « Néanmoins, la présente affaire n’est pas la meilleure occasion à cette fin car en réalité, la réponse aux deux renvois préjudiciels concernés dépend de l’élément de principe non bis in idem le moins problématique, à savoir celui de l’identité personnelle des contrevenants sanctionnés »21.
C’est pour cette raison que l’arrêt de la CJUE n’a qu’un apport relatif dans la construction du principe ne bis in idem. En effet, ce n’est ni l’identité des faits ni le caractère pénal de la sanction fiscale qui sont abordés par la CJUE mais le fait que la sanction concerne la même personne. Toutefois, cette décision qui considère qu’il ne peut y avoir d’assimilation d’identité entre le représentant légal de la société et la société elle-même, est avare de détail et laisse en suspens « le cas de sociétés ayant la personnalité juridique mais fiscalement transparente ou mieux translucide »22.
Cet arrêt ne répond donc pas entièrement aux attentes produites suites à l’arrêt A et B c/ Norvège et il faudra attendre la solution de l’affaire Menci23, toujours pendante devant la CJUE pour préciser l’interprétation du principe ne bis in idem. Pourtant, l’arrêt commenté, semble poser les premières pierres d’une interprétation harmonieuse avec la jurisprudence de la Cour EDH.
B. La construction d’une protection harmonisée au niveau européen
Si la Cour écarte une interprétation de la Charte à la lumière de la CEDH contrairement à l’avocat général, elle considère qu’« il convient de s’assurer que l’interprétation susvisée de l’article 50 [de la Charte] ne méconnaît pas le niveau de protection garanti par la CEDH »24. Cette volonté d’interpréter la Charte en établissant une protection équivalente avec la CEDH, comme le prévoit l’article 52, paragraphe 3, de la Charte amène la Cour à utiliser l’interprétation du principe ne bis in idem tel qu’il pouvait découler de l’arrêt Pirttimäki c/ Finlande de la Cour EDH25, que l’avocat général26 avait considéré comme étant l’un des seuls arrêts dans lequel cette Cour avait pu traiter du sujet de l’identité de la personne27.
Selon l’article 52, paragraphe 3, « l’interprétation de la Charte doit (…) se couler dans celle de la Convention »28. Par conséquent, la CJUE semble vouloir amorcer sa future réponse relative à l’affaire Menci en annonçant sa volonté de se rapprocher de la jurisprudence de la Cour EDH. L’arrêt Massimo Orsi et Luciano Baldetti est donc « plutôt à considérer comme un arrêt de transition »29 dont l’avenir nous dira s’il aura contribué à mettre fin aux tensions entre la jurisprudence la Cour EDH et celle de la CJUE en ce qui concerne le principe ne bis in idem.
Thomas MANRIQUE
C – L’arrêt Atanas Ognyanov ou la dialectique des principes
CJUE, gde ch., 8 nov. 2016, Atanas Ognyanov, n° C-554/1430.
Entre principes avoués et principes inavoués, l’arrêt Atanas Ognyanov31, dans lequel la Cour de justice de l’Union européenne (la Cour) interprète pour la première fois la décision-cadre relative au transfèrement des personnes condamnées32, brille autant par son éloquence que par son silence.
En l’espèce, un ressortissant bulgare fut condamné au Danemark à une peine privative de liberté de 15 ans. Il travailla au cours de sa détention, laquelle dura presque 2 ans. Transféré en Bulgarie, le tribunal de Sofia dut statuer sur la question de la durée de la peine restant à exécuter. À cet égard, les autorités danoises indiquèrent expressément que la loi de leur État ne permettait pas l’octroi d’une réduction de peine en raison du travail accompli en détention. Cependant, la Cour de cassation bulgare, interprétant les articles 41, § 3 du Code pénal et 457 du Code de procédure pénale, considéra que le travail effectué au Danemark devait être pris en compte dans la détermination du quantum restant à exécuter. Le tribunal de Sofia, sceptique quant à la conformité d’une telle interprétation au regard de la décision-cadre, saisit la Cour à titre préjudiciel. Les questions sont simples : les dispositions de l’article 17, § 1 et 2, s’opposent-elles à l’application d’une règle nationale visant à permettre à l’État d’exécution d’accorder une réduction de peine en raison du travail effectué durant la détention dans l’État d’émission ? Dans la négative, le juge national peut-il tout de même appliquer sa loi au motif qu’elle serait plus douce que les dispositions de la décision-cadre ? Sans surprise, la Cour répond par la négative aux deux questions. La première solution est explicitement dictée par les principes de reconnaissance mutuelle et de confiance réciproque et, implicitement, par celui de la territorialité de la loi pénale (I). La seconde repose sur le jeu classique des principes de l’interprétation conforme et de primauté évinçant, cette fois-ci, les principes protecteurs du droit pénal (II).
I. Les principes de la coopération judiciaire au service des principes du droit pénal
L’interprétation de la Cour s’imposait au regard du principe de reconnaissance mutuelle (A). De surcroît, par le truchement du principe de confiance réciproque, la Cour protège celui de la territorialité de la loi pénale (B).
A. L’utilisation classique du principe de reconnaissance mutuelle
La lettre de l’article 17 ne permettant pas d’en saisir le sens, la Cour analyse l’ensemble des dispositions de la décision-cadre. Au terme d’un travail exégétique rigoureux, elle révèle un ordre chronologique présidant à l’articulation des lois de l’État d’émission et de l’État d’exécution. Ainsi, avant le transfèrement de la personne condamnée, la loi de l’État d’émission est seule applicable. En revanche, dès lors que le transfèrement s’est opéré, la loi du pays d’exécution s’impose. Conséquemment, ce dernier est incompétent quant à l’octroi d’une réduction de peine subie sur le sol de l’État d’émission. Si la logique est implacable, elle est surtout conforme au principe de reconnaissance mutuelle, objectif poursuivi par la décision-cadre. En effet, autoriser l’application de la loi de l’État d’exécution à la détention subie au sein de l’État d’émission reviendrait à permettre « un réexamen de la période de détention accomplie sur le territoire dudit État »33, incompatible avec l’esprit du principe de reconnaissance mutuelle commandant une réception pure et simple de la décision et l’exécution de la sentence y étant attachée. Le principe de confiance réciproque commande la même conclusion.
B. L’instrumentalisation du principe de confiance réciproque
Selon la Cour, retenir la solution inverse alors que, d’une part, l’État d’émission avait notifié son refus d’octroyer une réduction de peine et, d’autre part, que le transfèrement avait déjà eu lieu « compromettrait la confiance réciproque particulière des États membres envers leurs systèmes judiciaires répressifs »34. Si la notion de confiance réciproque n’est pas inédite, la dimension qu’elle acquiert dans cet arrêt est surprenante. En effet, classiquement, la confiance mutuelle réciproque est utilisée par la Cour afin d’asseoir le postulat d’une protection équivalente des droits fondamentaux au sein des États membres et, in fine, d’assurer la réussite de la coopération judiciaire35. Cependant, en l’espèce, il semble que la confiance risquant d’être altérée n’est pas celle, générale et abstraite, liant l’ensemble des États mais celle, spéciale et concrète, existant entre le Danemark et la Bulgarie36. Ainsi, en refusant l’application de la loi de l’État d’exécution à la portion de peine subie sur le territoire de l’État d’émission, la Cour protège, implicitement, le principe de la territorialité de la loi pénale. Or, cela protège indirectement le principe de la légalité, l’auteur d’une infraction étant en mesure de connaître la loi pénale applicable. Le silence des juges de Luxembourg sur ce point37 ne surprend guère tant le principe de territorialité, manifestation première de la souveraineté pénale, s’accommode mal avec un espace commun de liberté, de sécurité et de justice.
La solution de la Cour est donc logique au regard du principe de reconnaissance mutuelle et permet, in fine, de protéger la souveraineté pénale des États. Néanmoins, elle présente un certain danger au regard des principes du droit pénal.
II. Les principes de l’Union européenne au détriment des principes du droit pénal
La Cour évince rapidement l’argument de la rétroactivité in mitius (A), et concentre son argumentation sur le principe d’interprétation conforme afin de faire échec à l’application de la loi nationale, pourtant favorable à la personne transférée (B).
A. L’éviction hâtive du principe de rétroactivité in mitius
L’argument de l’application de la loi nationale, plus douce, est immédiatement balayé. En effet, selon la Cour, une telle affirmation repose sur la prémisse erronée selon laquelle le droit bulgare a vocation à s’appliquer à la détention subie au Danemark. Le caractère sans appel de la réponse traduit cependant une incompréhension, sans doute volontaire, de la question. Assurément, le principe de rétroactivité in mitius est hors de propos en l’espèce, ayant vocation à jouer en matière de conflit de lois dans le temps et non dans l’espace38. En outre, la juridiction de renvoi ne semblait pas se référer au rapport entre sa loi et celle du Danemark mais plutôt à celui existant entre sa loi et le droit de l’Union. En réalité, la question est donc simple : le droit de l’Union européenne est-il applicable lorsqu’il est moins protecteur que le droit national ? Dans la lignée de sa jurisprudence relative au mandat d’arrêt européen, la réponse de la Cour est sans appel : un État membre ne saurait faire prévaloir son droit national, et notamment sa conception plus stricte des droits fondamentaux, et ce, en vertu de son obligation d’interprétation conforme et du principe de primauté39.
B. L’utilisation classique du principe de l’interprétation conforme au détriment de la sécurité juridique
De jurisprudence constante, les juges des États membres sont tenus d’interpréter le droit national conformément au droit de l’Union. Une telle obligation, couplée avec le principe de primauté, impose donc d’écarter une disposition nationale lui étant contraire. En l’espèce, la disposition nationale en contradiction avec la décision-cadre étant une interprétation jurisprudentielle, la Cour relève que « l’exigence d’interprétation conforme inclut l’obligation, pour les juridictions nationales, y compris celles statuant en dernier ressort, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une décision-cadre »40. Ainsi, l’interprétation ne saurait être contra legem du seul fait qu’elle suppose un revirement de jurisprudence. Sauf à retenir une conception formelle de la loi, l’affirmation est difficilement contestable et le principe de non-rétroactivité ne saurait être violé. Cependant, il n’en demeure pas moins que l’obligation d’interprétation conforme conduit la juridiction bulgare à opérer un revirement jurisprudentiel in pejus, l’individu bénéficiant d’une réduction de peine supérieure en vertu de l’interprétation retenue par la Cour de cassation bulgare. Ainsi, la sécurité juridique semble, quoiqu’en disent les juges de Luxembourg, bel et bien fragilisée. Ce faisant, il y a fort à craindre que le dialogue des juges ne se transforme progressivement en un dialogue de sourds.
Alice MORNET
D – La libre circulation, le mandat d’arrêt européen et l’extradition
CJUE, gde ch., 6 sept. 2016, n° C-182/15, Aleksei Petruhhin. En l’espèce, un citoyen estonien faisait l’objet, depuis le 9 février 2009, de poursuites pénales par le procureur général de Russie pour tentative de trafic de stupéfiants en bande organisée. Le 22 juillet 2010, un avis de recherche était publié via le site internet Interpol. Aleksei Petruhhin est alors arrêté en Lettonie le 30 septembre 2014 et quelques mois plus tard, la Russie fait une demande d’extradition à son égard. Le parquet letton y fait droit mais M. Petruhhin demande alors l’annulation de la décision au moyen qu’étant citoyen européen, il bénéficie des mêmes droits qu’un citoyen letton dès lors qu’il se situe en Lettonie. Plus précisément, le contentieux porte sur le fait de savoir si M. Petruhhin, de nationalité estonienne, peut se prévaloir de l’article 98 de la constitution lettonne qui prévoit qu’un citoyen letton ne peut être extradé vers un État étranger, « sauf dans les cas prévus par les traités internationaux (…), à la condition que l’extradition ne viole pas les droits fondamentaux de la personne garantis par la constitution ». La Cour suprême de Lettonie sursoit alors à statuer et pose à la CJUE trois questions préjudicielles, par lesquelles il s’agit de déterminer si la libre circulation des citoyens de l’Union peut être limitée par une discrimination sur la nationalité, dès lors qu’est en jeu une extradition vers un pays tiers dans lequel il semblerait que les droits fondamentaux tels que protégés par la Charte de l’Union ne soient pas respectés. Par un arrêt du 6 septembre 201641, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) considère que si l’extradition justifie une discrimination sur la nationalité, elle est toutefois insuffisante pour expliquer une restriction à la liberté de circulation (I), ce qui ne sera pas sans conséquences futures pour les États membres (II).
I. L’extradition, motif justifiant une discrimination sur la nationalité mais insuffisant pour justifier une restriction à la liberté de circulation
Si la discrimination fondée sur la nationalité peut justifier une extradition pour la CJUE en raison de la crainte d’un risque d’impunité (A), il n’en est pas de même vis-à-vis de la liberté de circulation, où la CJUE recherche le moyen qui sera le moins attentatoire à cette liberté, quitte à privilégier le mandat d’arrêt européen à la procédure d’extradition (B).
A. L’acceptation d’une discrimination sur la nationalité en raison d’une extradition
La question de la discrimination soulevée par la Lettonie peut en effet se poser. Le texte interne prévoit l’impossibilité d’extrader un letton mais exclut cette possibilité dès lors que le citoyen n’est pas letton. En vertu de l’article 18 du TFUE, le texte pose bien une discrimination fondée sur la nationalité puisque selon la nationalité, le régime applicable varie et l’extradition est, ou non, possible. Si la Cour admet dans un premier temps une discrimination fondée sur la nationalité, elle la justifie cependant au regard de la nécessité de ne pas laisser d’impunité42. En conséquence, la nationalité étant un critère objectif et le but à atteindre étant légitime et proportionné, la discrimination est acceptée pour la Cour en raison de l’objectif à poursuivre, à savoir l’extradition.
B. L’extradition, motif insuffisant pour justifier une restriction à la liberté de circulation
Si l’extradition justifie la discrimination, elle n’est toutefois pas suffisante, selon la Cour de justice, pour permettre de restreindre la liberté de circulation. En ce sens, l’article 21 du TFUE a été, pour la Cour, affecté par cette procédure d’extradition. En effet, la Cour juge que la procédure du mandat d’arrêt européen aurait été moins attentatoire à la liberté de circulation. Il eût ainsi fallu pour la Lettonie transmettre toutes les informations nécessaires à l’Estonie pour vérifier si celle-ci était compétente pour juger la personne recherchée puis dans un second temps, émettre un mandat d’arrêt européen afin que l’Estonie soit compétente pour arrêter et juger la personne recherchée. La Cour de justice souhaite ainsi que ce soit d’abord l’État membre d’origine qui donne son feu vert à l’arrestation d’un de ses ressortissants pour qu’ensuite un État membre d’accueil puisse éventuellement mettre en œuvre l’arrestation souhaitée. Cette solution est, sur le plan théorique, tout à l’honneur de la Cour de justice. Elle soulève toutefois quelques interrogations sur la portée de cet arrêt pour les États membres.
II. Les conséquences futures pour les États membres
Reconnaître que la liberté de circulation doit primer sur l’extradition, et qu’ainsi le mandat d’arrêt européen doit être privilégié, y compris lorsque la procédure implique un État tiers laisse penser que la Cour souhaiterait une protection totalement équivalente entre chaque citoyen européen indépendamment de leur État membre d’origine (A), et ce au détriment des accords de coopération internationale passés (B).
A. Vers une équivalence entre citoyens européens indépendamment de leur État membre d’origine
Cet arrêt s’inscrit dans la perspective assumée par la Cour de justice de renforcer concrètement la notion de citoyenneté européenne. Cet objectif est louable mais, si cette logique est davantage poussée, cela signifie-t-il alors qu’il faudrait instaurer dans l’Union européenne des conditions équivalentes à celles de l’arrêt précité ? Si la liberté de circulation, droit fondamental pour un citoyen européen selon la Cour, prime aussi sur l’extradition via le mandat d’arrêt européen, cela n’aurait-il pas dans ce cas pour conséquence de suggérer l’abandon de toute extradition par les États membres de leurs nationaux afin de passer par le mandat d’arrêt européen, moins attentatoire ? Dans ce cas, un nouveau droit pour le citoyen européen a été confirmé par la jurisprudence Petruhhin, celui de bénéficier d’une protection équivalente entre les citoyens nationaux et les citoyens européens n’ayant pas la nationalité de l’État membre d’accueil. À moins de considérer que l’État membre d’origine n’est jamais compétent, ce qui permet de conserver le principe de l’extradition, et partant de respecter l’adage « aut dedere aut judicare » mais il ne semble pas que ce soit la voie choisie par la Cour de justice, au regard des jurisprudences ultérieures à celle-ci43.
B. La supériorité suggérée de la coopération pénale européenne sur les accords de coopération internationale
Enfin, en souhaitant privilégier le mandat d’arrêt européen sur la procédure internationale d’extradition, la Cour oriente les États membres vers une violation des accords internationaux passés aux fins de protéger le citoyen européen, notamment quand ses droits fondamentaux sont en péril. C’est ainsi qu‘en demandant à la Lettonie de vérifier si les droits fondamentaux tels qu’entendus par l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux sont respectés par l’État tiers qui demande l’extradition, la Cour de justice sous-entend, comme elle l’a fait quelques mois plus tôt44 et à l’instar de la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt Avotins, que certains mécanismes procéduraux peuvent être évincés dès lors qu’il existe une insuffisance manifeste de protection d’un droit garanti, en l’occurrence la libre circulation, laquelle est un droit pour tout citoyen européen. À termes, cela pourrait remettre en cause les nombreuses demandes d’extradition formulées par la Russie vis-à-vis des États membres de l’Union européenne.
Aude BERNARD
E – La notion de « détention » mentionnée dans le mandat d’arrêt européen doit s’interpréter comme une notion autonome
F – Les droits de la défense à l’épreuve de la terreur
II – La recherche de standards supranationaux dans la résolution des questions de société
A – La Cour interaméricaine des droits de l’Homme et l’affaire du village de Chichupac au Guatemala : la qualification de la disparition forcée par la constatation de violations multiples des droits de l’Homme
B – Surpopulation carcérale et lutte contre le traitement dégradant des détenus : l’audace est vaine !
C – La répression du terrorisme face aux droits à la vie et au recours effectif garantis par la CEDH
D – Exclusion de certains délinquants de la réclusion à perpétuité : une mesure non discriminatoire
E – Les rapports entre accident du travail, handicap et discriminations
III – La recherche de standards supranationaux dans l’animation et la protection de la société démocratique
A – L’absence de violation de la vie privée et familiale dans une affaire de gestation pour autrui, une solution curieuse de la CEDH ?
B – Le changement d’état civil : fruit d’une réalité sociale
C – Non à la surveillance électronique de masse
D – « It’s okay to be gay » : la législation russe « anti-propagande homosexuelle » déclarée incompatible avec la Convention
E – Licenciées pour avoir refusé de retirer leur voile : la frontière entre différence de traitement justifiée et discrimination tient à peu de choses
F – Liberté de religion et intégration par l’instruction : la primauté de l’intérêt public sur l’intérêt privé
G – « L’article 10, § 1 de la Convention peut être interprété comme incluant un droit d’accès à l’information »
H – La Cour européenne des droits de l’Homme face au discours de haine
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
CEDH, gde ch., 15 nov. 2016, nos 24130/11 et 29758/11, A. et B. c/ Norvège ; v. Andriantsimbazovina J., « La poursuite de procédures administrative et pénale conduisant à un cumul de sanctions administrative et pénale est compatible avec le principe ne bis in idem », Gaz. Pal. 7 mars 2017, n° 289w2, p. 31 ; Berlaud C., « Non bis in idem : précision des critères », Gaz. Pal. 22 nov. 2016, n° 280j2, p. 50 ; Milano L., « Non bis in idem : clarification ou inflexion ? », JCP G 2016, n° 48, 1290 ; Pelletier M., « Nouveau requiem pour le principe non bis in idem ? », Dr. fisc. 2016, n° 47, comm. 603 ; Roets D., « La question du cumul des sanctions administratives et des sanctions pénales : tango jurisprudentiel à Strasbourg », RSC 2017, p. 134 ; Sauron J.-L., « La jurisprudence de la CEDH : vers une responsabilité partagée avec les États parties ? », Gaz. Pal. 6 déc. 2016, n° 281v7, p. 18.
-
2.
CEDH, 8 juin 1976, nos 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 et 5370/72, Engel e.a c/ Pays-Bas.
-
3.
CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, n° 14939/03, Zolotoukhine c/ Russie.
-
4.
CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, Zolotoukhine c/ Russie, n° 14939/03 ; CEDH, 4 mars 2014, nos 18647/10, 18663/10, 18698/10 et 18640/10, Grande Stevens e.a c/ Italie.
-
5.
CEDH, 13 déc. 2005, n° 73661/01, Nilsson c/ Suède ; CEDH, 4 oct. 2016, n° 21563/12, Rivard c/ Suisse.
-
6.
Cruz Villalón P., conclusions sous CJUE, gde ch., 26 févr. 2013, n° C-617/10, Åkerberg Fransson.
-
7.
D’Ambrosio L. et Vozza D., « Retour sur le dialogue des juges en matière de ne bis in idem : après le silence de la Cour constitutionnelle italienne, la parole revient à la Cour de justice de l’Union », RTD Eur. 2017, p. 93, spéc. p. 99.
-
8.
Sudre F., « Droit de la Convention européenne des droits de l’Homme », JCP G 2017, n° 1-2, doctr. 32, § 21.
-
9.
V. Pelletier M., « Nouveau requiem pour le principe non bis in idem ? », Dr. fisc. 2016, n° 47, comm. 603.
-
10.
JCP G 2017, 506, obs. Berlin D. ; Dr. fisc. 2017, comm. 14, obs. Guilland N. ; Europe 2017, comm. 218, Daniel E. ; Dr. pén. 2017, comm. 101, Peltier V.
-
11.
CJUE, 4e ch., 5 avr. 2017, nos C-217/15, Massimo Orsi et C-350/15, Luciano Baldetti, § 27.
-
12.
CJUE, arrêt commenté, § 15
-
13.
CJCE, 28 oct. 1975, n° C-36/75, Rutili.
-
14.
CJUE, arrêt commenté, § 15.
-
15.
Ibid.
-
16.
Bluman C. et Dubouis L., Droit institutionnel de l’Union européenne, 6e éd., 2016, LexisNexis, p. 153, § 187.
-
17.
CJUE, arrêt commenté, § 16.
-
18.
CJUE, 26 févr. 2013, n° C-617/10, Akerberg Fransson.
-
19.
CEDH, gde ch., 15 nov. 2016, nos 24130/11 et 29758/11, A et B c/ Norvège ; CEDH, 4e sect., 20 mai 2014, n° 35232/11, Pirttimäki c/ Finlande ; CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, n° 14939/03, Sergueï Zolotoukhine c/ Russie.
-
20.
Gaz. Pal. 7 mars 2017, n° 289w2, p. 31, obs. Andriantsimbazovina J.
-
21.
Conclusions de l’avocat général, M. Campos Sánchez-Borbona, nos C-217/15, Massimo Orsi et 12 janv. 2017, C-350/15, Luciano Baldetti, § 3.
-
22.
JCP G 2017, 506, obs. Berlin D.
-
23.
CJUE, gde ch., ord., 25 janv. 2017, n° C-524/15, Luca Menci.
-
24.
CJUE, arrêt commenté, § 24.
-
25.
Cour EDH, 4e sect., 20 mai 2014, n° 35232/11, Pirttimäki c/ Finlande,
-
26.
Conclusions de l’avocat général, M. Campos Sánchez-Borbona, arrêt commenté, § 34.
-
27.
Les propos de l’avocat général peuvent toutefois être soumis à critique, car le sujet de l’identité de la personne soumis aux sanctions n’est pas la question principale de l’arrêt Pirttimäki c/ Finlande ; à ce sujet : Dr. fisc. 2017, comm. 14, obs. Guillan N.
-
28.
Bluman C. et Dubouis L., op. cit., p. 156, § 191.
-
29.
Europe 2017, comm. 218, Daniel E.
-
30.
Gazin F., « Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale », Europe, janv. 2017, n° 1, comm. 9 ; Dero-Bugny D. et Nourissat C., « Cour de justice et tribunal de l’Union européenne (1re partie) », JDI 2017, n° 2, chron. 4 ; Guiresse M., « L’arrêt Ognyanov de la Cour de justice : quand la confiance réciproque se fait le révélateur des déficiences de l’espace de liberté », ELSJ, 20 nov. 2016, [En ligne], www.gdr-elsj.eu/2016/11/20/cooperation-judiciaire-penale/larret-ognyanov-de-cour-de-justice-confiance-reciproque-se-revelateur-deficiences-de-lespace-de-liberte/.
-
31.
CJUE, gde ch., 8 nov. 2016, n° C-554/14, Atanas Ognyanov.
-
32.
Décision-cadre n° 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, JO L 327, 5 déc. 2008, p. 27.
-
33.
CJUE, Atanas ognyanov, préc., pt 49.
-
34.
Pt 48.
-
35.
V. en ce sens, CJCE, 11 févr. 2003, nos C-187/01 et C-385/01, Hüseyin Gözütok et Klaus Brügge.
-
36.
V. en ce sens, Gazin F., « Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale », Europe 2017, n° 1, comm. 9.
-
37.
Contrairement à l’avocat général, v. en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Yves Bot, présentées le 3 mai 2016, n° C-554/14, Procédure pénale c/ Atanas Ognyanov, spéc. pt 79.
-
38.
V. en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Yves Bot, préc., pt 82.
-
39.
V. en ce sens, CJUE, gde ch., 29 janv. 2013, n° C-396/11, Ciprian Vasile Radu ; CJUE, gde ch., 26 févr. 2013, n° C-399/11, Stefano Melloni c/ Ministerio Fiscal.
-
40.
CJUE, Atanas Ognyanov, préc., pt 667 ; v. également, CJUE, gde ch., 19 avr. 2016, n° C-441/14, Dansk Industri (DI) c/ Succession Karsten Eigil Rasmussen, pt 33 ; CJUE, gde ch., 5 juill. 2016, n° C-614/14, Procédure pénale c/ Atanas Ognyanov, pt 35.
-
41.
CJUE, gde ch., 6 sept. 2016, n° C182-15, Aleksei Petruhin ; v. à propos de cet arrêt les conclusions de l’avocat général Yves Bot, présentées le 10 mai 2016, ainsi que le communiqué de presse n° 84/16 de la CJUE du 6 septembre 2016, tous deux disponibles sur le site curia.europa.eu ; v. aussi Di Martina M. et Vasconcelos B., « The Court’s decision in the Petruhhin case : EU citizenship has not been extradited yet », Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, 31 mai 2017, disponible sur www.federalismi.it ; Gazin F., « Extradition d’un citoyen européen vers un État tiers », Europe 2016, n° 11, comm. 382 ; Rizcallah C., « European and International criminal cooperation : a matter of trust ? », European Legal Studies, College of Europe, janv. 2017 ; Warin C., « Liberté de circulation des personnes : citoyenneté de mouvement, citoyenneté en mouvement », Droit du marché intérieur févr. 2017, 1/2017, LCP, disponible sur blogeuropeen.com ; chron. Broussy E., Cassagnabère H. et Gänser C., AJDA 2016, p. 2209 ; Dalloz actualité, 23 sept. 2016, V.B. ; Rev. DH avr.-sept 2016, chron. Dumortier T., Guiomard F., Langlais C. et a., « Repères étrangers. (1er juillet – 30 septembre 2016) », Pouvoirs 2017/1 (n) 160), p. 137-156 ; Julien-Laferrière F., « Extradition vers un État tiers à l’Union : la CJUE préfère que les États membres mettent en œuvre le MAE », Éditions législatives, 22 sept. 2016 ; Marcus L., « Citoyenneté européenne et libre circulation : une union à toute épreuve ? », Actualité 9 sept. 2016, disponible sur www.ceje.ch.
-
42.
En application de l’adage aut dedere aut judicare (extrader ou poursuivre).
-
43.
V. nota. CJUE, 8 déc. 2016, nos C-532/15 et C/538/15, Eurosaneamientos e.a. c/ Arcelor Mittal Zaragossa.
-
44.
À l’instar de sa jurisprudence antérieure : CJUE, gde ch., 5 avr. 2016, nos C-404/15 et C-659/15 PPU, Aranyosi et Robert Caldararu : RTD Eur. 2016, p. 793, obs. Carabot B. ; RTD Eur. 2017, p. 363, chron. Benoît-Rohmer F. ; Dalloz Actu étudiant, 28 avr. 2016 ; AJ pénal 2016, p. 395, note Boursier M.-E. ; AJDA 2016, p. 1059, chron. Broussy E. ; Cassagnabere H. et Gänser C., AJDA 2016, p. 1059 ; Dalloz Actualité, 9 mai 2016, note Devouèze N.