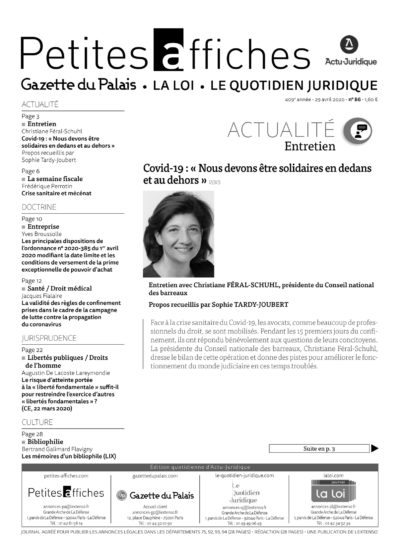Le risque d’atteinte portée à la « liberté fondamentale » suffit-il pour restreindre l’exercice d’autres « libertés fondamentales » ?
Dans son ordonnance de référé rendue le 22 mars 2020, le Conseil d’État juge que le risque d’atteinte portée au droit à la vie par la propagation du virus Covid-19 ne justifie pas un confinement total de la population et que l’État n’a pas commis de carence fautive dans les mesures prises pour prévenir ou limiter les effets de cette épidémie. Néanmoins, un durcissement et une précision de la portée de certaines des mesures déjà prises sont enjoints au gouvernement.
CE, 22 mars 2020, no 439674

Si en période normale, « la liberté est la règle et la mesure de police l’exception », ainsi que le rappelait le commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions rendues sur l’affaire Baldy, en période de crise, au nombre desquelles figure ce que l’on appelle désormais « l’état d’urgence sanitaire » – nouvelle catégorie législative issue de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 –, c’est l’inverse qui est vrai : la mesure de police est la règle et la liberté l’exception ! La récente ordonnance de référé rendue par le Conseil d’État le dimanche 22 mars 2020 nous semble confirmer abondamment cette assertion.
Saisi notamment à la demande du syndicat des jeunes médecins d’une requête et d’un mémoire en référé-liberté déposés les 19 et 22 mars 2020, le Conseil d’État a eu à se prononcer sur des circonstances et une demande inhabituelles voire exceptionnelles, y compris dans le cadre de son office de juge des référés. Dans ce contexte, la décision rendue ne pouvait être que d’une facture également exceptionnelle.
I – Des circonstances exceptionnelles tout d’abord
Les premières mesures prises pour endiguer la propagation de l’épidémie de Covid-19 à l’échelle nationale et, notamment, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, auraient pu faire craindre un ralentissement du cours de la justice. Il n’en a rien été ! Force est donc revenue au droit et ce sont, en la matière, les circonstances et les difficultés rencontrées sur le terrain qui ont sans doute dicté au syndicat des jeunes médecins et aux autres intervenants parties à l’instance le caractère urgent des mesures à prendre au regard – selon les requérants – de l’insuffisance de celles déjà prises et des moyens dont disposent les personnels de soin pour faire face à l’épidémie. Dans ses écritures, la partie demanderesse soutenait, notamment, qu’un confinement total de la population était justifié, d’une part, du fait des risques auxquels les personnels de santé se voyaient exposés en raison du caractère insuffisant des mesures prononcées par le décret du 16 mars 2020 ; d’autre part, au motif que cette « stratégie thérapeutique » avait fonctionné dans d’autres pays et plus précisément en Chine, foyer de l’épidémie. De même inspiration, on sait que plusieurs plaintes ont été également déposées devant la Cour de justice de la République.
À ce contexte inédit pour un État de droit, on ajoutera que les circonstances dans lesquelles le Conseil d’État a été amené à se prononcer au cours de cette instance ont été également assez exceptionnelles pour un référé-liberté : 2 h 30 d’audience publique à laquelle un public restreint était invité à assister, le recours à une formation collégiale, une visioconférence, une décision longue (pas moins de 18 considérants) et didactique : ces données factuelles méritaient d’être rappelées car elles sont assez inhabituelles.
II – Une demande exceptionnelle ensuite
En substance, la question posée par les requérants était assez simple mais redoutable et même exceptionnelle également par ses implications : le droit à la vie justifiait-il une restriction à certaines de nos libertés les plus élémentaires – au nombre desquelles figurent la liberté d’aller et venir, de se réunir et celle d’exercer une activité professionnelle – au point que le confinement total de la population fût la seule manière efficace d’y répondre ? À notre sens, c’est la première fois que, dans le cadre d’un référé-liberté, le juge administratif a eu à ordonner au gouvernement des mesures visant à restreindre des libertés au nom d’autres libertés. Mais il faut aller un peu plus loin, nous semble-t-il, et poser une question : peut-on considérer qu’il existe, parmi les libertés fondamentales « déclarées » par le Conseil d’État depuis l’institution de cette procédure, une hiérarchie en leur sein et que l’une d’entre d’elles (ici le droit à la vie) s’imposerait face à d’autres qui possèdent pourtant une portée identique (la liberté d’aller et venir, de réunion, du commerce et de l’industrie notamment) ?
Pour les parties à l’instance (en demande comme en intervention), la réponse à cette question ne faisait aucun doute : le droit à la vie doit l’emporter sur les autres libertés fondamentales dont l’exercice se voit restreint. Par suite, en raison des interprétations contradictoires et du caractère inégal sur l’ensemble du territoire national de l’application des mesures déjà prises, il convient, en imposant un confinement total de la population, en premier lieu, de protéger prioritairement les professionnels de santé, à commencer par les médecins, qui sont les premiers exposés à la propagation du virus. Il s’en déduit que les autorisations de sortie pour motif médical doivent être revues, que doivent être interrompues les activités de transport en commun, les activités professionnelles non vitales et que doit être mis en place un service de ravitaillement à domicile de la population dans des conditions sanitaires visant à assurer la sécurité des personnels chargés de ce ravitaillement.
Cette demande pouvait-elle être valablement accueillie ?
III – Une décision exceptionnelle enfin
À titre liminaire, on relèvera que les conditions de recevabilité du référé-liberté n’ont pas été véritablement discutées. Cette démarche est assez rare et manifeste, selon nous, une volonté de la formation de jugement de se concentrer sur l’essentiel en une période où le temps est compté. Exit donc, la discussion relative à l’urgence – bien évidemment remplie compte tenu des circonstances –, même si elle survient là où on ne l’attendait pas1. Exit également, ce qui est moins fréquent, la discussion relative à l’atteinte portée à une liberté fondamentale. En guise de justification, le Conseil d’État se borne à rappeler que le droit au respect de la vie, sans plus de précision, est bien au nombre des libertés fondamentales susceptibles d’être invoquées devant le juge des référés, réitérant ainsi une jurisprudence bien établie en la matière2, sans cependant se prononcer sur la question d’une éventuelle hiérarchie entre les libertés fondamentales en jeu, ni même réserver la question (cette démarche est plus rare).
Sur le fond, deux problèmes (ou deux questions) étaient, en l’espèce, posés au Conseil d’État :
-
l’invocation d’une liberté fondamentale telle que le droit au respect de la vie justifie-t-il que soit portée une atteinte « excessive » à l’exercice d’autres libertés fondamentales au nombre desquelles figurent notamment la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion et la liberté d’exercer une activité professionnelle ?
-
les autorités nationales et locales titulaires du pouvoir de police ont-elles pris les mesures appropriées en la circonstance pour prévenir ou limiter au mieux les risques de propagation de l’épidémie dite de Covid-19 ? Les modalités d’application de ces mesures avaient-elles été correctement interprétées et respectées et justifiaient-elles un renforcement du dispositif existant ?
La réponse à ces questions redoutables dans le contexte actuel supposait, ainsi que nous y invite Descartes dans son Discours de la méthode, de « diviser les difficultés en autant de parcelles qu’il se peut » et de procéder par ordre « en allant par degrés du simple au composé » et du plus connu au moins connu. À lire la décision du Conseil d’État, cette invitation méthodologique a été presque scrupuleusement respectée en l’espèce. Le contexte dans lequel cette ordonnance a été rendue appelait d’ailleurs de toute évidence ce didactisme et cette leçon de pédagogie.
S’agissant de la compétence, en premier lieu, cette dernière ne faisait en l’espèce pas de doute. Ainsi que le rappelle la haute juridiction dans son deuxième considérant, tant le Premier ministre – au titre de son pouvoir de police nationale en sa qualité de chef du gouvernement3, ainsi que des possibilités de dérogations que lui offre le législateur en période dite de « circonstances exceptionnelles »4 – que le ministre de la Santé – sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique – étaient fondés à prendre les mesures appropriées pour limiter, à l’échelle du territoire national, la propagation de l’épidémie de coronavirus. Il en allait bien évidemment de même s’agissant des préfets et des maires – les mesures prises pouvant, le cas échéant, être aggravées si les circonstances locales de temps et de lieu le justifient5.
En guise de réflexion terminale sur ce point, on se contentera de relever qu’au moment où la décision a été rendue, la loi créant un dispositif dit « d’état d’urgence sanitaire » n’avait pas encore été promulguée, et ce même si le Conseil d’État en avait été saisi quelques jours auparavant. C’est donc dans un cadre législatif ne reconnaissant pas l’urgence sanitaire que ce dernier a été amené à se prononcer.
Ces préliminaires étant rappelés, restaient à répondre aux deux questions posées.
Sur la première question, le Conseil d’État a une position arrêtée : si l’atteinte au droit au respect de la vie peut justifier, en principe, des restrictions à l’exercice d’autres libertés fondamentales équivalentes, en revanche, en l’espèce, l’invocation de cette dernière ne saurait justifier, pour sa mise en œuvre, qu’il soit procédé à un confinement total de la population. En effet, dans cette hypothèse précise, l’analyse du bénéfice-risque montre que les désavantages qui résulteraient de l’application d’une telle mesure sont sans proportion au regard des nécessités de la vie économique de la Nation et, plus précisément, du maintien d’un noyau dur d’activités jugées vitales et indispensables pour la continuité de la vie du pays, au nombre desquelles figurent les activités de soin, de sécurité, de transport et d’alimentation soit directement, soit indirectement. De plus, un confinement total sur l’ensemble du territoire risquerait a contrario d’entraîner de véritables difficultés de ravitaillement de la population – du moins dans des conditions jugées satisfaisantes. Cette analyse in concreto de la réalité nouvelle engendrée par le coronavirus et l’utilisation d’une sorte de méthode du « bilan coûts-avantages » pour apprécier l’efficacité des mesures déjà prises dans le cadre de la procédure de référé-liberté marquent une nouveauté dans l’office habituel de ce juge. Peut-être même est-ce la première fois que le Conseil d’État y recourt. Ce point méritait d’être rappelé.
De cette réponse se déduit la réponse à la deuxième question : les autorités compétentes, tant nationales que locales, n’ont pas fait preuve d’une carence grave et manifestement illégale en ne procédant pas à un confinement total de la population.
Il convient de relever l’approche extensive qu’a retenue le Conseil de la « salubrité publique » : la sauvegarde de la santé de la population en fait clairement partie.
Sur le fond, si le Conseil d’État confirme dans son ensemble les principales mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie, plus intéressantes sont en revanche les appréciations portées par le conseil sur la mise en œuvre de ce dispositif et le contrôle de cette mise en œuvre.
Le Conseil d’État juge sévèrement les conditions d’interprétation et la sanction du non-respect de ces mesures s’agissant notamment des déplacements pour motifs de santé, des sorties pour convenance personnelle autour ou à proximité du domicile, ainsi que du fonctionnement des marchés ouverts limités à cent personnes. Les mesures prises, dans le contexte de propagation et de lutte contre l’épidémie, doivent être revues dans le sens de la sévérité.
Il est, par ailleurs, remarquable de constater – et ce point est également suffisamment rare pour que l’on s’y arrête – que, dans le cadre du référé-liberté, le Conseil d’État s’est livré à un quasi-contrôle de « proportionnalité » des mesures de police prises concernant notamment leur nécessité et leur étendue. Cet aspect, classique en excès de pouvoir6, est quasi inexistant en matière de référé-liberté. Si, comme il le fait s’agissant des mesures de dépistage prises et à prendre, le Conseil d’État tient compte des moyens mis à disposition de l’Administration en ce sens, plus novateur en revanche est cet exercice d’un contrôle, non pas exclusivement sur le texte comme il l’avait fait dans sa décision précitée Ville de Paris du 16 novembre 2011, mais sur les mesures mises en œuvre pour éviter l’atteinte grave et manifestement illégale sous leur aspect le plus pratique.
IV – Et après ?
Ainsi que l’y invitait la formation de jugement, l’Administration a réagi sans délai puisque, le lendemain, un nouveau décret de confinement n° 2020-293 du 23 mars 2020 du Premier ministre était publié tenant compte des remarques et demandes adressées par la juridiction concernant le fonctionnement des marchés ouverts, les déplacements pour motifs de santé et les déplacements pour convenance personnelle limités à une heure par jour dans un rayon d’un kilomètre. Sur ce dernier point et en conclusion, on ne peut que regretter la sévérité de cette dernière mesure car la conservation d’une bonne hygiène physique nous semble indispensable pour le profit de la santé mentale – déjà éprouvée par des mesures d’isolement et de mise à l’écart inhabituelles pour nombre de nos concitoyens –, surtout lorsqu’on se souvient que la liberté de pratiquer un sport est au nombre des libertés fondamentales7.
Notes de bas de pages
-
1.
V. Frier P.-L., L’urgence, thèse, 1987, LGDJ.
-
2.
V. CE, 25 oct. 2007, n° 310125, Mme Y et CE, sect., 16 nov. 2011, n° 353172, Ville de Paris.
-
3.
CE, 8 août 1919, n° 56377, Labonne.
-
4.
CE, 28 juin 1918, n° 63412, Heyriès.
-
5.
CE, 18 avr. 1902, n° 04749, Cne de Néris-les-bains.
-
6.
CE, 19 mai 1933, nos 17413 et 17520, Benjamin.
-
7.
CE, 22 oct. 2001, n° 238204, Caillat.