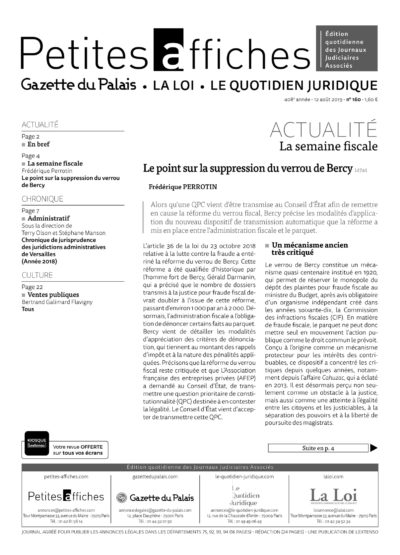Chronique de jurisprudence des juridictions administratives de Versailles (Année 2018)
Le nouvel opus de la chronique de jurisprudence des juridictions administratives de Versailles réunit une sélection des décisions les plus remarquables de l’année 2018. Magistrats administratifs de la Cité royale et jeunes chercheurs du Laboratoire VIP ont annoté douze décisions relatives à des domaines variés (responsabilité, fiscalité, droit du contentieux, plans de sauvegarde de l’emploi, urbanisme, fédérations sportives, organisation des professions). L’exercice témoigne de l’intense activité des juridictions administratives versaillaises autant que de l’heureuse pérennité des liens noués entre les deux juridictions et la jeune recherche en droit public.
Mise en cause de la responsabilité de l’État à raison de la méconnaissance alléguée du droit de l’Union européenne par une décision du Conseil d’État (CAA Versailles, 1re, 3e et 7e ch. réunies, 25 juin 2018, n° 15VE01967, Sté Fauba France). La société requérante mettait en cause la décision du 27 juillet 20051 par laquelle le Conseil d’État (CE) lui a refusé l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue par l’article 262 ter du Code général des impôts2 (CGI) pour les livraisons intracommunautaires, portant sur des biens expédiés ou transportés vers un autre État membre de l’Union. Si de telles livraisons sont utilisées dans le cadre de fraudes dites carrousel reposant sur l’implantation d’une société sans substance dans l’État de livraison en vue d’y obtenir une déduction de TVA indue, des sociétés de bonne foi peuvent toutefois être impliquées à leur insu dans ces circuits de fraude. La société Fauba France faisait valoir que la décision du CE est contraire à l’article 28 quater de la 6e directive3, transposé à l’article 262 ter du CGI, en ce qu’elle ne subordonne pas la remise en cause de l’exonération de TVA à la preuve apportée par l’administration que l’opérateur ne pouvait ignorer que la livraison litigieuse s’inscrivait dans une fraude carrousel.
L’obligation pour les États membres de réparer les dommages résultant des violations du droit de l’Union est consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’arrêt Francovitch de 19914. L’arrêt Köbler de 20035 précise que la responsabilité des États membres peut être engagée par la décision d’une juridiction statuant en dernier ressort. En application du droit commun, le contentieux relève en premier ressort de la compétence des juridictions du fond6. Enfin, la responsabilité de l’État n’est engagée qu’en cas de « violation manifeste », notion employée tant par la CJCE7 que par le CE8 et équivalant à la faute lourde. Les éléments caractérisant une telle violation, mentionnés au point 4 de l’arrêt, sont, notamment, le degré de clarté et de précision de la règle violée, le caractère délibéré de la violation, le caractère excusable ou non de l’erreur de droit, la position prise, le cas échéant, par une institution communautaire, ainsi que l’inexécution de l’obligation de renvoi préjudiciel9.
En l’espèce, la société requérante se prévalait de l’arrêt Optigen Ltd du 12 janvier 200610 et surtout de l’arrêt Teleos plc du 27 septembre 200711, par lequel la CJCE a interprété l’article 28 quater de la 6e directive comme s’opposant à ce que l’administration remette en cause l’exonération de TVA en invoquant l’existence d’une fraude carrousel, dans le cas d’un assujetti de bonne foi qui produit des justificatifs de la livraison et a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’elle ne le conduisait pas à participer à une telle fraude.
Toutefois, les arrêts ainsi invoqués sont postérieurs à la décision du CE. Or, la responsabilité de l’État doit s’apprécier au regard du droit et de la jurisprudence de l’Union en vigueur à la date à laquelle a été rendue la décision attaquée. À cette date, si la CJCE avait jugé que la notion de livraison pouvait dans des cas exceptionnels être appréciée en tenant compte de l’intention de l’assujetti12, le principe énoncé par plusieurs arrêts13 était que cette notion devait faire l’objet d’une appréciation objective, indépendante des buts et des résultats des opérations concernées.
Surtout, la cour administrative d’appel (CAA) se livre à une interprétation de la décision du CE société Fauba France. Cette décision précise que si un assujetti produisant des justifications d’expédition des biens vers un autre État membre et le numéro de TVA de l’acquéreur est présumé avoir réalisé une opération exonérée, l’administration peut toutefois établir que les opérations en cause n’ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataires présumés des personnes dépourvues d’activité réelle. Et la cour constate que cette décision n’a ni explicitement ni implicitement exclu que l’assujetti puisse s’opposer à la remise en cause de l’exonération en justifiant de ce qu’il a pris toutes les dispositions raisonnables pour s’assurer que la livraison litigieuse ne le conduisait pas à participer à une fraude carrousel. La cour en déduit que la décision Fauba France n’a méconnu ni les dispositions de la 6e directive, relatives aux livraisons intracommunautaires, ni les principes de sécurité juridique et de proportionnalité et, par voie de conséquence, que le CE n’était pas tenu de renvoyer une question préjudicielle à la CJUE. En l’absence de violation manifeste du droit de l’Union par la décision du CE, la CAA de Versailles rejette la demande indemnitaire présentée par la société Fauba France. Le Conseil d’État vient de valider, dans sa décision des huitième et troisième chambres du 16 avril 2019 n° 423643, le raisonnement qui sous-tendait la solution adoptée par la Cour.
Nicolas CHAYVIALLE
Il appartient aux parents qui demandent l’engagement de la responsabilité de l’État pour carence dans la mise en œuvre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’orientation de leur enfant atteint de syndrome autistique, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer cette carence de l’État. Il incombe à l’État de renverser cette présomption en produisant tous ceux permettant d’établir que l’absence de prise en charge ne lui est pas imputable (TA Versailles, 8 mars 2018, n° 1507496, M et Mme H). Le tribunal administratif (TA) de Versailles a été saisi de quatre requêtes, dont celle de M. et Mme H, tendant à l’indemnisation de préjudices résultant de la carence de l’État pour assurer une prise en charge pluridisciplinaire effective d’enfants souffrant de troubles autistiques.
Pour statuer sur ces requêtes, le tribunal a suivi les principes dégagés par la décision du CE du 16 mai 2011 Mme Beaufils14, selon laquelle la prise en charge pluridisciplinaire garantie par la loi à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique constituait une obligation de résultat. Il a également utilisé le cadre d’analyse proposé, afin d’identifier les conditions dans lesquelles un manquement de l’État à cette obligation de résultat pouvait être relevé, dans une série de jugements rendus le 15 juillet 2015 par le TA de Paris, éclairé par les conclusions du rapporteur public Pierre Le Garzic15.
Le TA de Paris a ainsi précisé, à la suite du principe posé par le CE, qu’en vertu de l’article L. 241-6 du Code de l’action sociale et des familles, il incombait à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d’admettre l’enfant pour un autre motif que le manque de place, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la CDAPH n’est pas adaptée aux troubles de leur enfant, l’État ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l’absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l’absence de mise en œuvre par l’État des moyens nécessaires. Il appartient dans ces deux hypothèses aux parents, soit, s’ils estiment que l’orientation préconisée par la commission n’est pas adaptée aux troubles de leur enfant, de contester la décision de la commission, qui rend ses décisions au nom de la maison départementale des personnes handicapées, groupement d’intérêt public, devant la juridiction judiciaire compétente en application de l’article L. 241-9 du Code de l’action sociale et des familles, soit, dans l’autre cas, de mettre en cause la responsabilité des établissements désignés n’ayant pas respecté cette décision en refusant l’admission ou n’assurant pas une prise en charge conforme aux dispositions de l’article L. 241-6 du Code de l’action sociale et des familles. Enfin, en l’absence de toute démarche engagée par les parents auprès de la CDAPH, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée du fait de l’absence ou du caractère insatisfaisant de la prise en charge de leur enfant.
Dans le prolongement de ce raisonnement, le jugement rendu par le TA de Versailles le 8 mars 2018 dans l’affaire M. et Mme H. est venu préciser le régime de preuve à appliquer. Compte tenu des difficultés propres à l’administration de la preuve, par les familles, d’une carence de l’État en matière de prise en charge d’enfants autistes, et partant du constat de la pluralité des approches possibles des exigences en la matière, le tribunal a décidé d’adopter un régime de preuve objective inspiré de celui déjà instauré par le CE en matière de discrimination16 et de harcèlement moral17.
Il a ainsi été jugé qu’il appartenait dans un premier temps aux parents, non d’établir l’existence d’une carence de l’État, mais de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer cette carence dans la mise en œuvre des décisions de la CDAPH. Il incombe dans un deuxième temps à l’État de renverser cette présomption en produisant tous ceux permettant d’établir que l’absence de prise en charge ne lui est pas imputable.
Concrètement, le tribunal a retenu que la carence fautive de l’État pouvait être présumée lorsque les éléments de fait apportés par les requérants témoignaient de ce qu’ils avaient sollicité tout ou partie des établissements désignés par la CDAPH et qu’au moins un refus de prise en charge résultait d’une absence de place disponible ou d’un motif assimilable à une telle absence, l’État pouvant renverser cette présomption en établissant qu’au sein des autres établissements, des places adaptées étaient disponibles.
Ce régime de preuve apparaît de nature à éviter les deux écueils que seraient, d’une part, l’exigence trop lourde pour les parents de rapporter la preuve d’une absence de toute place d’accueil pour leur enfant et, d’autre part, une reconnaissance systématique de la carence fautive de l’État à l’échelle de l’établissement, impliquant de garantir en tout temps et dans chaque structure une place disponible pour l’accueil d’enfants.
Il s’inscrit ainsi pleinement dans les nouveaux développements jurisprudentiels du mécanisme de la présomption en droit de la responsabilité administrative, dont l’avantage est de permettre, eu égard au contexte, d’assouplir sans la faire disparaître l’obligation pesant sur la victime d’établir la réalité du fait dommageable qu’elle invoque.
Anne BARTNICKI
Pour déterminer si des actions souscrites par une société dans le cadre d’une augmentation de capital constituent des titres de participation, il faut se placer à la date de cette opération, indépendamment de la comptabilisation retenue pour les titres acquis antérieurement (CAA Versailles, 6e ch., 17 mai 2018, n° 15VE04052, SA Crédit agricole). Par l’arrêt SA Crédit agricole18, rendu dans le contexte particulier des mésaventures grecques de la banque française, la CAA de Versailles a apporté des précisions inédites sur la qualification de titres de participation.
Dans le cadre de sa stratégie de développement international, le Crédit agricole avait acquis en 2006, la totalité du capital de la banque grecque Emporiki. Toutefois, les graves difficultés de cette dernière à la suite de la crise financière grecque ont conduit la banque française à engager en mai 2012 un processus de cession de sa filiale. Conformément aux prescriptions du fonds de recapitalisation du secteur bancaire grec, la société requérante a procédé, au préalable, à une augmentation du capital de sa filiale pour 2,32 milliards d’euros en juillet 2012. En octobre 2012, la banque française a conclu un accord de cession de sa filiale pour un euro symbolique.
Le litige portait sur la déductibilité fiscale de la provision pour dépréciation constituée par la banque française à raison des titres souscrits en juillet 2012. Cette déductibilité dépendait de la nature des titres. En effet, une provision pour dépréciation n’est déductible que si elle se rapporte à des titres de placement et non à des titres de participation19. Les titres de participation sont définis comme les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise20. La cour fait droit à l’argumentation de la société requérante selon laquelle les titres souscrits en 2012 ne constituent pas des titres de participation et peuvent donc faire l’objet d’une provision pour dépréciation déductible fiscalement.
Tout d’abord, la cour apporte une précision inédite concernant la date à laquelle il convient de se placer pour déterminer la nature des titres. La thèse de l’administration, conforme à sa doctrine21, consistait à faire référence à l’investissement initial au capital de la filiale au motif notamment que les nouveaux titres ne pouvaient recevoir un traitement différent des titres acquis antérieurement. Selon cette logique, les titres souscrits en 2012 étaient des titres de participation, dès lors que les titres acquis antérieurement, eu égard aux conditions de leur acquisition, étaient comptabilisés ainsi. La cour estime, au contraire, que c’est à la date de la recapitalisation qu’il faut se placer pour examiner si l’intention initiale existant en 2006 a été modifiée. Elle fait ici application du principe selon lequel la nature de titre de participation doit être déterminée au moment de l’acquisition du titre22. Dans ses conclusions, Antoine Errerra invoque deux autres éléments. D’une part, selon la doctrine autorisée, les règles comptables ne s’opposent pas à ce qu’une société applique un traitement comptable différent à des titres acquis à des moments différents, eu égard aux circonstances propres à chaque acquisition23. D’autre part, la loi fiscale elle-même24 prévoit que des titres inscrits en compte de participation doivent faire l’objet d’un déclassement s’ils ne remplissent plus les conditions de cette qualification.
La cour examine ensuite si les titres litigieux répondent à la définition de titres de participation, eu égard aux conditions de leur souscription. Cette définition se fonde sur deux critères cumulatifs portant sur l’intention lors de l’acquisition des titres : d’une part, les titres doivent être acquis en vue d’une possession durable ; d’autre part, cette possession doit être perçue comme utile à la société pour le développement de son activité, et non comme un placement financier. En l’espèce, selon la cour, le critère de possession durable n’est pas rempli dès lors qu’à la date de souscription des titres, la société avait engagé un processus de cession d’Emporiki. La cour relève les différentes preuves de la réalité de ce processus, notamment le courrier d’information adressé par la société requérante aux autorités françaises ou encore les procès-verbaux de conseil d’administration validant les étapes de la procédure. La cour estime que les titres litigieux ne peuvent être regardés comme des titres de participation dès lors qu’ils ont été souscrits, non en vue d’une possession durable, mais dans la perspective de la cession de cette filiale.
Enfin deux aspects restaient à examiner pour tirer toutes les conséquences de la qualification donnée aux titres litigieux. D’une part, alors que les actions avaient été inscrites en titres de participation par la société elle-même, la cour admet implicitement qu’il s’agit d’une erreur comptable involontaire dont la société peut demander la rectification25. D’autre part, elle constate que l’administration ne contestait pas que les conditions prévues par l’article 39 du CGI pour la déduction d’une provision pour dépréciation des titres étaient réunies. Dans ces conditions, la cour accorde au Crédit agricole la réduction d’impôt correspondant à la déduction de la provision litigeuse.
Nicolas CHAYVIALLE
La condition de détention du capital de la société émettrice des dividendes par la société bénéficiaire à la date de mise en paiement des dividendes, à laquelle est subordonné le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales prévu par les articles 145 et 216 du CGI, doit s’apprécier au regard du principe selon lequel les obligations d’une société envers ses actionnaires sont régies par la loi de l’État selon le droit duquel elle est constituée et où elle a son siège social (CAA Versailles, 22 mai 2018, n° 16VE02463, Sté Sofiza et Sté Kidiliz Group). Pendant les exercices 2006 à 2008, la SAS Financière Zannier, devenue depuis la société Kidiliz Group, avait attribué à plusieurs filiales des quotes-parts de droits d’un contrat d’assurance qu’elle avait souscrit auprès de la société Sogecap et visant à couvrir les indemnités de fin de carrière versées à leurs salariés, sans leur facturer une prestation de redistribution entre elles des quotes-parts excédentaires. Par ailleurs, elle avait cédé en 2008 la totalité des titres qu’elle détenait dans sa filiale néerlandaise IKKS Nederland BV à la société Marques Associées. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a effectué des rectifications sur les exercices 2006 à 2008 à l’égard de la SAS Financière Zannier, estimant, sur le premier aspect, que celle-ci aurait dû facturer à ses filiales bénéficiaires la réaffectation des quotes-parts non utilisées pendant cette période et intégrer le montant correspondant à son bénéfice imposable, et, sur le second, qu’elle n’aurait pas dû percevoir les dividendes distribués par la société IKKS Nederland BV au titre de l’exercice 2008 et donc déduire au titre de l’exercice 2008 l’essentiel de ceux-ci de ce même bénéfice. La SAS Financière Zannier et la société Sofiza, société mère d’un groupe d’intégration fiscale à laquelle la première appartient, ont alors introduit un recours devant le TA de Montreuil26 en vue d’obtenir la décharge des impositions litigieuses et des pénalités afférentes. Saisie en appel, la CAA de Versailles a toutefois rejeté la requête sur ces deux points, au terme d’un raisonnement révélant le double intérêt de l’arrêt. D’une part, celui-ci procède à un utile rappel des exceptions à l’acte anormal de gestion justifiant un abandon de créances, dans le cadre de l’application de l’article 223 B du CGI (I). D’autre part, il précise la condition de participation et, par ce biais, la législation nationale applicable en cas de conflit de lois, à laquelle se trouve subordonné le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du même code (II).
I. S’agissant d’abord de la question de la non-facturation de la prestation de redistribution de la couverture excédentaire des indemnités de fin de carrière octroyées aux salariés du groupe, la cour de Versailles revient dans un premier temps sur les apports jurisprudentiels successifs en matière d’exception à l’acte anormal de gestion sus-évoqué (pt 8). Elle indique en ce sens que l’abandon d’une créance au profit d’un tiers – y compris une filiale –, comme c’est le cas ici, « ne relève pas en règle générale d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt »27. Puis, précisant cette exception, elle ajoute, s’inspirant en cela de la jurisprudence du CE28, que la charge de la preuve incombe alors à l’entreprise, qui doit « justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties », à moins que l’administration ne démontre ensuite « que cette contrepartie est dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que sa rémunération est excessive ». Ces rappels effectués, la cour a justement pu qualifier les prestations non facturées de subventions indirectes entre sociétés du groupe, après avoir relevé non seulement que la contrepartie requise ne saurait résider dans l’« intérêt général » que le groupe tirerait d’une meilleure allocation de la couverture assurantielle en son sein, mais également qu’il n’existait pas en l’espèce de « contrepartie [propre] équivalente » (pt 11). En adoptant une telle démarche, la juridiction versaillaise confirme son souci de pédagogie dans l’énonciation des conditions de mise en œuvre de l’exception concernée29, là où la cour d’appel de Paris est, pour les mêmes parties et les mêmes faits sur les exercices 2006 à 2008, apparue beaucoup plus laconique30.
II. Concernant ensuite la question de la cession des titres de sa filiale néerlandaise et celle attenante de la déduction de 95 % des dividendes reçus à raison de la détention des actions de cette entreprise, la cour de Versailles se distingue de nouveau par la clarté de sa démonstration, bien que l’interprétation de la règle de droit se trouve cette fois-ci fondue dans l’examen des faits. Dans un premier temps, la juridiction répond aux arguments à la fois des requérants et du défendeur. Elle indique que l’invocation de la loi du contrat dans les relations entre la SAS Financière Zannier et la société Marques Associées se traduirait par l’application de l’article 1583 du Code civil français, dans la mesure où il ressort – au terme d’un travail de qualification31 – que les sociétés néerlandaises de la catégorie Besloten Vennootschap, dont fait partie IKKS Nederland BV, sont formellement assimilables à celles de la catégorie des SARL en droit français. L’exception prévue par l’article L. 228-1 du Code de commerce pour les sociétés autres que « par actions » ne leur serait donc pas applicable, impliquant de retenir la date de l’accord sur la chose et le prix comme date du transfert de propriété (pts 16 et 17). Mais, dans un second temps de son raisonnement, la cour juge que « les obligations d’une société envers ses actionnaires sont régies par la loi de l’État selon le droit duquel elles sont constituées et où elles ont leur siège social ». Ce considérant de principe, qui reprend une jurisprudence judiciaire bien établie sur les conflits de lois dans les relations entre les sociétés émettrices et les porteurs de titres32, met implicitement en évidence le véritable apport de l’arrêt. En effet, la mise à l’écart de la loi du contrat au profit de la loi de société passe par l’appréhension de la notion de « participation », au sens des articles 145 et 216 du CGI, à travers la qualité d’actionnaire, rejoignant en cela plus largement le droit de l’Union européenne33. Il en résulte ainsi l’application en l’espèce de la législation néerlandaise qui, régissant IKKS Nederland BV, subordonne le changement effectif de l’identité de l’actionnaire d’une société comme celle-ci à la constatation de la cession de ses titres par acte notarié. Or ce dernier est précisément intervenu après le versement des dividendes. En adoptant cette interprétation, la cour de Versailles s’éloigne néanmoins de celle donnée en vertu du Code de commerce par le CE, lequel a effectivement estimé « qu’il résulte (…) des dispositions [de ce code], notamment de ses articles L. 233-2 et L. 233-4, qu’à défaut d’indication expresse contraire, une participation dans une société consiste en la détention directe d’une fraction de son capital »34. Indirectement, elle semble ainsi inviter à une mise en cohérence de la loi et de la jurisprudence de la haute juridiction administrative d’une part, et du droit de l’Union européenne d’autre part.
Olivier PLUEN
La cour illustre les critères d’application du 1° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales qui permet aux contribuables de se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration fiscale sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (CAA Versailles, 27 nov. 2018, n° 16VE02976, Sté Tour Air et Sté SPE II Boréale). La SCI Tour Air et la SAS SPE II Boréale ont acquis, en 2008 et 2009 pour la première et 2006 et 2007 pour la seconde, des locaux dans la tour Aurore du centre d’affaires de La Défense. Initialement destinés à un usage de bureaux, ces locaux ont cessé d’être occupés à partir du début des années 2000 en raison de travaux de désamiantage, puis de réhabilitation. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a procédé à un redressement au titre des exercices 2009 à 2012, estimant que les deux sociétés propriétaires auraient dû s’acquitter pour cette période de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux applicable en région Île-de-France, nonobstant l’existence d’une prise de position formelle demandée par les précédents propriétaires. La SCI Tour Air et la SAS SPE II Boréale ont alors introduit un recours devant les tribunaux administratifs respectivement de Paris et de Cergy-Pontoise, en vue d’obtenir la décharge des impositions litigieuses et des pénalités afférentes. Après que la première requête ait été transmise au TA de Cergy-Pontoise35, cette dernière juridiction a fait droit aux demandes des deux sociétés, conduisant l’administration fiscale à interjeter appel du jugement devant la CAA de Versailles36. La décision rendue le 27 novembre 2018 offre une occasion de rappeler les conditions d’application de la taxe susvisée en cas d’indisponibilité temporaire des locaux à usage de bureaux (I) et d’opposabilité d’un rescrit général relativement à son bénéficiaire (II), telles qu’elles ressortent de la jurisprudence du CE et du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).
I. Concernant le premier point, la cour d’appel s’inspire d’un arrêt de la haute juridiction de 201437, dont rend compte le BOFiP38, estimant d’abord qu’il résulte de l’article 231 ter du CGI, « dont l’objectif est de permettre la correction des déséquilibres de la région Île-de-France en matière de logement social, (…) que le législateur n’a pas entendu exclure du champ de la taxe les immeubles vacants, antérieurement affectés à un usage de bureaux, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet (…) d’un changement de destination en faveur d’une affectation autre que commerciale ou de stockage » (cons. 2). Puis, elle écarte automatiquement l’argument des défendeurs tiré de l’existence d’un « changement dans les circonstances de fait », qui aurait résidé dans les travaux de désamiantage et de réhabilitation de la tour Aurore, mais aussi d’un « changement dans les circonstances de droit »39, considérant que l’intervention de la loi de modernisation du quartier de La Défense de 2007 et la signature la même année d’un protocole d’accord entre la société Tour Air et l’ÉPA de La Défense en vue du remplacement de ce bâtiment par un nouvel immeuble sont insuffisants à faire regarder celui-ci comme ayant changé de destination (pt 3).
II. S’agissant du second point, la cour rappelle au préalable la jurisprudence dégagée dès 1996 par le CE40, et également exposée ici avec clarté dans le BOFiP41, suivant laquelle « peuvent seuls se prévaloir [du 1° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales] les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d’égalité » (pt 5). Puis, tirant les conséquences de cette interprétation stricte de la garantie offerte par le législateur, elle applique à l’espèce le caractère intuitu personae de la prise de position formelle de l’administration fiscale, en excluant que l’opposabilité à cette dernière puisse se transmettre des anciens aux nouveaux propriétaires, quand bien même les situations de fait respectives au regard d’un texte fiscal seraient en tous points similaires (pt 6).
Olivier PLUEN
La cour précise la nature du contrôle de l’Agence de la biomédecine sur les demandes d’exportation de gamètes en vue d’une procréation médicale assistée et juge que les refus que l’Agence a opposés aux demandes de l’espèce ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CAA Versailles, plén., 5 mars 2018, n° 17VE00824, Agence de la biomédecine c/ M. et Mme B. et CAA Versailles, plén., 5 mars 2018, n° 17VE00826, Agence de la biomédecine c/ M. et Mme B., R.). Deux couples, hétérosexuels, ne pouvant naturellement donner naissance à des enfants, ont décidé, après s’être vus refuser une assistance médicale à la procréation en France en raison notamment de leurs âges, de faire appel aux services d’établissements spécialisés respectivement en Espagne et en Belgique. À cette fin, ils ont demandé auprès de l’Agence de la biomédecine une autorisation d’exportation des gamètes et tissus germinaux des hommes de chacun des couples, conservés par un laboratoire français sur le fondement de l’article L. 2141-11-1 du Code de la santé publique (CSP). L’agence a refusé les autorisations sollicitées au motif que chacun des hommes au sein des couples en cause, âgés respectivement de 68 et 69 ans, n’était plus en âge de procréer au sens de l’article L. 2141-2 du CSP. Par deux arrêts de sa formation plénière du 5 mars 2018, la cour a fait droit aux requêtes d’appel formées par l’Agence de la biomédecine contre deux jugements du 14 février 2017 par lesquels le TA de Montreuil avait annulé les décisions de l’Agence.
L’article L. 2141-2 du CSP fait figurer au nombre des conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une technique d’assistance médicale à la procréation celle tenant à ce que l’homme et la femme formant le couple soient, l’un comme l’autre, encore en « âge de procréer ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixant un âge au-delà duquel un homme n’est plus apte à procréer, la cour s’est référée aux travaux préparatoires de la loi n° 94-654 du 19 juillet 1994 pour retenir que le législateur avait entendu préserver à la fois l’intérêt de l’enfant à naître, afin que celui-ci ne soit pas exposé à certains risques inhérents au recours à une assistance médicale à la procréation, celui de la femme, les techniques de stimulations ovariennes étant éprouvantes et non sans risque pour sa santé, et enfin celui de la société, eu égard au coût élevé mis à la charge des caisses de Sécurité sociale lorsqu’il est fait usage de cette technique. Elle en a déduit qu’au sens de l’article L. 2141-2 du CSP, l’« âge de procréer » devait être entendu comme étant celui au cours duquel les capacités procréatives de l’homme et de la femme ne sont pas altérées par le vieillissement. Elle a ensuite défini le contrôle que doit exercer l’Agence de la biomédecine saisie d’une demande d’exportation de gamètes aux fins d’assistance médicale à la procréation, jugeant qu’il lui incombait d’apprécier, en veillant au respect des intérêts mentionnés ci-avant et sous le contrôle du juge, si la demande dont elle est saisie remplit, parmi les conditions légalement exigibles, et en fonction des connaissances scientifiques disponibles, celle selon laquelle l’homme et la femme ayant formé la demande n’ont pas atteint un âge au-delà duquel le vieillissement est susceptible d’altérer leurs capacités reproductives respectives.
Se fondant ensuite sur les travaux scientifiques les plus récents disponibles en la matière, qui relèvent qu’au-delà de 59 ans les capacités procréatives de l’homme sont généralement altérées compte tenu du risque statistiquement accru de malformations et autres complications médicales, la cour a jugé que l’âge au-delà duquel les capacités procréatives de l’homme étaient susceptibles d’être altérées par le vieillissement était d’environ 59 ans et que l’Agence de la biomédecine avait pu légalement refuser les autorisations sollicitées au motif que les hommes de chacun des couples, qui étaient âgés respectivement de 68 et 69 ans à la date de leurs demandes d’exportation, n’étaient plus en âge de procréer au sens de l’article L. 2141-2 du CSP.
La cour a par suite censuré le motif d’annulation retenu par les premiers juges et, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, a écarté les autres moyens soulevés contre ces décisions, dont celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales au motif que, compte-tenu notamment du caractère récent du projet parental de chacun des couples et eu égard aux dispositions de l’article L. 2141-11-1 du CSP qui interdisent toute exportation de gamètes en vue d’une utilisation contraire aux règles du droit français, les refus de l’Agence de la biomédecine ne pouvaient, dans les espèces examinées, être regardés comme méconnaissant ces stipulations. La cour a donc annulé les jugements du TA de Montreuil et rejeté les demandes d’annulation des décisions de l’Agence de la Biomédecine.
Le CE, saisi de pourvois contre ces deux arrêts, a relevé qu’en ce qui concerne l’homme du couple, la condition relative à l’âge de procréer au sens et pour l’application de l’article L. 2141-2 du CSP revêtait, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale, et qu’il y avait lieu de se fonder, s’agissant de sa dimension strictement biologique, sur l’âge de l’homme à la date du recueil des gamètes et, s’agissant de sa dimension sociale, sur son âge à la date du projet d’assistance médicale à la procréation. Il a censuré la cour pour ne s’être pas fondée, pour apprécier du point de vue biologique la limite d’âge de procréer des hommes concernés, sur l’âge qu’ils avaient à la date à laquelle il a été procédé au recueil de leurs gamètes. Il a ensuite, pour l’essentiel, fait sien le raisonnement de la cour et rejeté les demandes présentées par les requérants devant le tribunal42.
Catherine BRUNO-SALEL
Appréciation par le juge de l’injonction, après l’annulation de la décision du ministre de conclure un contrat de partenariat, de la nature de l’illégalité commise et du bilan entre la gravité de l’illégalité et l’atteinte à l’intérêt général pour déterminer s’il doit inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou enjoindre à la personne publique de résilier le contrat (CAA Versailles, 5e ch, 22 févr. 2018, n° 15VE00035, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer c/ Conseil national de l’ordre des architectes). Le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a, par une décision du 14 janvier 2010, conclu avec la société Eirenea un contrat de partenariat portant sur une mission globale de financement, conception, construction, entretien, maintenance de 63 centres d’entretien et d’intervention, destinés à assurer l’exploitation des 12 000 km de routes appartenant au réseau national.
Le contrat de partenariat, défini par l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, permet à une collectivité publique de confier à un tiers la construction et, avec elle, la maîtrise d’ouvrage et le financement d’un équipement moyennant un paiement différé et étalé. S’agissant d’un contrat dérogatoire au droit commun de la commande publique43, le recours à un tel contrat n’était possible, dans la rédaction initiale de l’article 2 de l’ordonnance applicable à l’espèce, qu’en cas de complexité du projet ou d’urgence.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2, relatives à la complexité du projet seules invoquées par le ministre pour justifier le recours au contrat de partenariat, la cour a considéré, en s’inspirant de la notion de complexité retenue par la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services justifiant le recours au dialogue compétitif (art. 1er, pt 11, c) et de la jurisprudence44, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que, compte tenu, d’une part, de la nature du projet et, d’autre part, des moyens humains ou d’expertise dont il disposait, l’État était dans l’impossibilité de définir, seul et à l’avance, les moyens ou solutions techniques permettant de répondre à ses besoins ou d’établir le montage juridique ou financier permettant d’y répondre. La cour a donc confirmé le tribunal qui avait jugé que le projet ne remplissait pas la condition de complexité prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 permettant de recourir à un contrat de partenariat et annulé la décision du 14 janvier 2010.
La cour devait alors examiner si le tribunal, saisi en tant que juge de l’exécution des conséquences à tirer de cette annulation, avait pu à bon droit enjoindre au ministre de résilier le contrat. Elle a appliqué la jurisprudence selon laquelle l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement que le contrat en cause doive être annulé. Il appartient au juge de l’exécution, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise, soit de régulariser le contrat, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de le résilier, le cas échéant avec un effet différé, soit de prononcer la résolution par les parties ou à défaut d’entente des parties sur cette résolution, saisir le juge du contrat afin qu’il en règle les modalités s’il estime que cette mesure peut être une solution appropriée45. Cette appréciation devant être faite par le juge au moment où il statue46.
La cour s’est donc livrée à un bilan entre la gravité de l’illégalité commise et l’atteinte à l’intérêt général afin de s’assurer que la résiliation ou la résolution du contrat ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Elle a estimé qu’en l’espèce la gravité de l’illégalité commise pouvait et devait être relativisée dès lors, d’une part, que le recours au contrat de partenariat était légalement justifié par l’urgence compte tenu de la nécessité de combler un déficit d’équipements collectifs particulièrement grave en matière d’entretien du réseau routier national, affectant l’exercice de la mission du service public routier et préjudiciable à l’intérêt général tenant à la sécurité routière, même si le ministre ne s’en était pas prévalu47 et que, de surcroît, le législateur avait décidé par la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, qui aurait pu à quelques jours près être applicable au projet, d’étendre les conditions légales du recours au contrat de partenariat. Elle a par ailleurs, après avoir constaté que les ouvrages étaient achevés et mis à disposition, considéré qu’une maintenance assurée par les personnels de l’État ou dans le cadre d’un contrat passé avec un autre opérateur serait dégradée par rapport aux prestations offertes par le contrat de partenariat et qu’une résiliation ou résolution du contrat coûterait au moins 198 millions d’euros à l’État pour indemniser le cocontractant, et qu’il en résulterait une atteinte à l’intérêt général, notamment à la continuité du service public routier. Elle a en conséquence jugé que la nature de l’illégalité entachant le contrat de partenariat en litige n’était pas telle qu’elle impliquerait que les parties soient invitées à résoudre leurs relations contractuelles ou qu’il soit enjoint à la personne publique de résilier le contrat et a annulé la décision des premiers juges sur ce point.
Catherine BRUNO-SALEL
Indulgence du juge d’appel à l’égard de la recevabilité d’une requête mal dirigée et sévérité de la solution quant à la non-obligation de motiver une décision administrative « collective ». Intensité du contrôle du juge sur l’appréciation portée par une commission d’évaluation professionnelle sur l’aptitude d’un candidat (CAA Versailles, 24 mai 2018, n° 16VE01821, M. A c/ Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise). M. A est recruté par la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise en 2007 en qualité d’agent non titulaire pour exercer les fonctions d’éducateur territorial des activités physiques et sportives dans un espace de remise en forme d’une piscine municipale. Il se porte candidat à la sélection professionnelle organisée par ladite communauté afin d’intégrer ce cadre d’emploi, étant éligible au dispositif de résorption de l’emploi précaire au titre de la loi du 12 mars 201248.
Or la commission d’évaluation professionnelle, par une délibération du 23 octobre 2013, le déclare inapte à exercer les missions de ce même cadre d’emploi. Après rejet de son recours gracieux, il saisit le TA de Cergy-Pontoise d’une demande d’annulation de cette décision de rejet et du courrier de notification de la délibération l’ayant déclaré inapte. Les premiers juges ayant soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief, il interjette appel.
I. Une solution libérale sur la recevabilité du recours
Les juges d’appel font, en l’espèce, application d’une jurisprudence constante visant à prévenir les fins de non-recevoir et à permettre ainsi d’apporter une solution au fond49. Le sieur A. avait en effet dirigé son recours contre la notification de la délibération l’ayant déclaré inapte et non contre la délibération elle-même, rendue un jour plus tôt. Les juges d’appel confirment qu’un tel courrier de notification ne constitue pas en lui-même une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, en analysant les termes de la demande du requérant ainsi que les moyens invoqués, les juges d’appel considèrent que sa volonté de contester « la décision de non-inscription sur la liste d’aptitude » était sans équivoque et font, de ce fait, preuve d’un heureux pragmatisme venant ainsi au secours du requérant. Cette attitude libérale de la juridiction est traditionnelle dès lors qu’elle s’estime suffisamment éclairée pour identifier la délibération qui aurait dû réellement être attaquée50 51.
De plus, les mêmes juges rappellent que la décision de rejet du recours gracieux du requérant en date du 21 février 2014 dirigé contre la délibération de la commission d’évaluation professionnelle et non à l’encontre de la notification du PV de la commission doit être considérée comme entrant dans la catégorie des décisions faisant grief et est donc, à ce titre, susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
À bien des égards, la sévérité de la solution des premiers juges ayant déclaré les conclusions du requérant irrecevables ne semble pas s’inscrire dans la lignée jurisprudentielle traditionnelle sur la prévention des fins de non-recevoir. Si les juges d’appel se montrent plus indulgents sur la recevabilité du recours, ils font en revanche une application extrêmement stricte de l’absence d’obligation de motivation de la délibération à l’égard du requérant.
II. Une solution sévère quant à l’interprétation littérale du champ d’application de la loi sur la motivation des actes administratifs
On sait que la loi du 11 juillet 1979 codifiée aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, prescrit l’obligation pour l’administration d’expliciter les moyens de fait et de droit constituant le fondement d’une décision administrative individuelle défavorable. Le requérant soulève donc, en toute logique, le défaut de motivation en droit de la délibération contestée par laquelle la commission d’évaluation professionnelle a dressé une liste des seuls agents aptes à intégrer ledit cadre d’emploi. Or la cour écarte ce moyen en estimant qu’une telle décision n’avait pas à être motivée parce qu’elle n’entre dans aucune des dispositions de la loi de 1979 et considère implicitement qu’il s’agit d’un acte collectif et non individuel. Or cette interprétation littérale de la loi apparaît probablement discutable. En effet, le requérant conteste le fait de ne pas apparaître sur ladite liste et on peut considérer que l’on se trouve finalement dans la situation d’un refus d’avantage à l’égard d’une personne remplissant les conditions légales, cas énuméré par la loi, puisqu’il avait été informé par courrier du 14 mars 2013 par son administration qu’il était éligible au dispositif de résorption de l’emploi précaire prévu par la loi Sauvadet de 2012. L’analyse de la jurisprudence démontre, en ce domaine, un certain manque de cohérence. Ainsi, doit être motivé le refus d’inscription dans une classe préparatoire52 qui pourrait en toute logique s’apparenter au cas de notre requérant à considérer qu’il s’agit d’un refus d’inscription sur la liste des admis en classe préparatoire. À l’inverse, la mutation d’office d’un fonctionnaire n’a pas besoin d’être motivée53. La loi de 1979 affichait un principe de transparence administrative, par l’obligation de motiver les décisions refusant un avantage, et donc regroupant les décisions faisant grief. Or, il n’est pas illogique de considérer qu’un acte, certes collectif, mais qui fait grief individuellement à l’intéressé, devrait pouvoir entrer dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979 si une interprétation plus libérale était opérée par les juridictions administratives. Toute la problématique réside, à notre sens, dans l’identification de la décision individuelle.
En revanche, la cour emprunte un chemin beaucoup mieux tracé quand il s’agit de retenir le contrôle restreint porté sur une délibération à l’égard de laquelle l’administration disposait d’une certaine marge d’appréciation.
III. Une solution traditionnelle sur l’intensité du contrôle du juge
Concernant la légalité interne de la décision, le requérant contestait l’appréciation portée par la commission d’évaluation professionnelle. Or la juridiction a dû déterminer l’intensité du contrôle portée sur la délibération eu égard à la nature de la mission qui incombe à ladite commission. On sait que l’intensité du contrôle du juge est fonction du plus ou moins grand pouvoir d’appréciation de l’administration. Autrement dit, lorsqu’un texte confère un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, « qui, eu égard à sa nature, ne s’exerce qu’en tenant compte de considération d’opportunité et n’est subordonné à aucune condition »54, le juge ne procèdera pas au contrôle de la qualification juridique des faits et s’en tiendra à un contrôle minimum portant uniquement sur l’erreur de droit, de fait ou manifeste d’appréciation. En l’espèce, la cour, après avoir rappelé la mission de la commission d’évaluation consistant à porter une appréciation sur le parcours professionnel du candidat et sur son expérience professionnelle, précise que la commission dispose, de ce fait, d’une certaine liberté d’appréciation. Elle indique alors qu’aucune erreur ni de droit ni de fait ne peut être retenue, pas plus qu’une erreur manifeste d’appréciation. Appliquant une jurisprudence constante en la matière55, elle se cantonne donc à un contrôle restreint de l’appréciation portée par ladite commission sur l’aptitude du requérant.
Tania EINAUDI
La définition des catégories professionnelles dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit prendre en compte la compétence professionnelle et la protection contre un éventuel « ciblage » de certains salariés (CAA Versailles, 27 nov. 2018, n° 18VE03119, Comité d’entreprise AT&T Global Network Services France). La définition des catégories professionnelles revêt une importance particulière dans le cadre de l’appréciation de la légalité de l’homologation d’un document unilatéral portant projet de licenciement collectif pour motif économique. Il en va ainsi surtout parce que l’administration est tenue de refuser l’homologation s’il apparaît que la constitution des catégories professionnelles n’est pas fondée sur la compétence professionnelle ou ne permet pas d’écarter l’hypothèse d’un ciblage potentiel de certains salariés en raison de considérations étrangères à cette compétence. En faisant pour la première fois application de l’un des récents fleurons jurisprudentiels du CE56, le présent arrêt illustre que le contrôle sur la définition des catégories professionnelles « est un contrôle entier »57, « approfondi »58, prenant avant tout appui sur les échanges entre les partenaires sociaux.
Une filiale du groupe international de télécommunications, la société AT&T Global Network Services France a mis en place un projet de réorganisation en 2017 impliquant la suppression de 13 postes. À cet effet, la société a ouvert une procédure de licenciement collectif. Le document unilatéral portant projet de licenciement collectif pour motif économique a été homologué le 12 février 2018 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Le comité d’entreprise a alors introduit une requête devant le TA de Cergy-Pontoise afin d’obtenir l’annulation de cette décision d’homologation. Par un jugement du 9 juillet 2018 le tribunal a rejeté la demande du comité d’entreprise. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Parmi les nombreux arguments soulevés par le demandeur, c’est surtout la contestation de la définition des catégories professionnelles qui attire l’attention. Qualifiée de « talon d’Achille »59 de plan de sauvegarde de l’emploi, une telle contestation est devenue désormais « un classique » dans la construction d’une stratégie d’annulation de décision d’homologation. Elle a fréquemment porté ses fruits60. De prime abord, l’espèce paraissait fournir une excellente matière pour qu’une telle contestation aboutisse, au regard du nombre élevé des catégories professionnelles. La société en a défini 36 en procédant à une réduction à 34, l’effectif étant de 147 salariés.
Ainsi que la présente décision en témoigne, le juge administratif veille à ce que l’employeur se fonde, dans la définition des catégories professionnelles, sur des considérations permettant de regrouper les salariés par fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune. Cette décision suscite en outre l’intérêt en ce qu’elle accorde une place importante au débat se déroulant en amont de la décision d’homologation. Ceci afin de clarifier les raisons qui sous-tendent la définition des catégories professionnelles. Comme le souligne D. Piveteau, « c’est d’abord au sein de l’entreprise, là où les métiers sont les mieux connus et où leur “permutabilité” est la mieux susceptible d’être discutée » et c’est de cette discussion « que doit se nourrir le dossier »61. La juridiction versaillaise a tenu compte de l’« effort d’explication »62, de la part de la société, des raisons qui l’ont mené à l’établissement des catégories professionnelles. C’est notamment la force de ses arguments, portant sur la différenciation entre les catégories « service manager – gestion comptes clients » et « service manager – gestion comptes clients stratégiques », s’inscrivant dans le cadre d’une distinction fondée sur la compétence professionnelle, qui a convaincu le juge administratif. Cet arrêt témoigne que dans son appréciation globale de la méthode de constitution des catégories professionnelles, le juge administratif tient compte du contenu du document unilatéral, mais se montre également très attentif à la teneur des échanges menés au cours de la procédure préalable à la décision d’homologation.
Katarzyna KMONK
En statuant sur la légalité du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines, le tribunal a dû se prononcer, d’une part, sur l’interprétation à donner aux dispositions transitoires de l’article L. 153-9 du Code de l’urbanisme et, d’autre part, sur la portée du régime des STECAL après modification par la loi ALUR du 24 mars 2014 (TA Versailles, 4 mai 2018, n° 1702800, Cne de Trappes). La commune de Trappes a demandé au tribunal d’annuler la délibération par laquelle le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) avait approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines.
I. La requérante s’est notamment saisie de ce que le territoire de l’EPCI compétent pour l’élaboration du PLUi attaqué s’était étendu en cours de procédure, pour en déduire une méconnaissance, par la délibération attaquée, des dispositions de l’article L. 153-1 du Code de l’urbanisme alors en vigueur. Cet article énonce en effet que « le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire : / 1° De l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (…) ».
Or en l’espèce, il est constant que l’EPCI compétent en matière de PLUi à la date d’approbation du PLUi attaqué, dénommé « Saint-Quentin-en-Yvelines » à l’issue d’un processus de fusion et d’extension mis en œuvre par le préfet des Yvelines sous l’impulsion du schéma régional de coopération intercommunale, regroupe 12 communes, alors qu’il est tout aussi constant que le PLUi approuvé par ce nouvel EPCI ne couvre que le territoire des 7 communes membres de la communauté d’agglomération de SQY CASQY, qui était compétente en la matière à la date des délibérations du conseil communautaire prescrivant, d’une part, l’élaboration du PLUi et arrêtant, d’autre part, le projet de PLUi à soumettre à enquête publique.
En outre, les dispositions transitoires figurant à l’article L. 153-9 du Code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de création de l’EPCI SQY, se bornent à énoncer que « l’établissement public de coopération intercommunale (…) peut décider, après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme (…) engagée avant la date de sa création (…) ». Ce texte ne semble pas traiter de l’hypothèse où l’EPCI succède à un autre EPCI, constat renforcé par la modification apportée à ce texte par l’article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté, en vue de préciser explicitement que cette règle vaut également lorsque l’EPCI succède à un autre EPCI.
Mais, en réalité, la version en vigueur le 1er janvier 2016 de l’article L. 153-9 résulte de la recodification du II bis de l’ancien article L. 123-1 du même code, par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, dont les dispositions, issues de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, énonçaient jusqu’au 31 décembre 2015 qu’un « établissement public de coopération intercommunale (…) peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme (…) engagée avant la date de sa création (…) ». Ces dispositions trouvent leur origine dans quatre amendements parlementaires (n° 9 rectifié, n° 20, n° 55 et n° 75) adoptés par le Sénat en première lecture. Il résulte du compte-rendu intégral des débats en séances publiques des 4 et 5 novembre 2014 qu’il s’est agi de « préciser explicitement que les EPCI nouvellement compétents en matière de PLUi pourront achever toutes les procédures d’élaboration ou d’évolution de PLUi déjà engagées, soit par une commune, soit par un EPCI, avant la date de la création (…) du nouvel EPCI ».
Ainsi, compte tenu de ces travaux préparatoires qui attestent sans ambiguïté de l’intention du législateur à l’origine de ces dispositions transitoires et du principe de recodification « à droit constant » affirmé par l’habilitation législative de l’article 171 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), le tribunal a jugé que l’article L. 153-9 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, permettait aux EPCI nouvellement compétents en matière de PLUi d’achever les procédures d’élaboration de PLUi déjà engagées par un EPCI. Il en a déduit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-1 de ce code à la date de la délibération attaquée ne pouvait être retenu.
II. Mais le tribunal a prononcé l’annulation partielle du PLUi, à savoir du secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) NhMB03, délimité en zone N du PLUi. Pour rappel, les dispositions de l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme énoncent que « le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; (…) / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ».
Le tribunal a donné plein effet à la modification apportée par la loi ALUR, en ce qu’elle a notamment ajouté la mention « à titre exceptionnel » à la possibilité de délimiter de tels secteurs. Il a pris acte de cette modification motivée par l’objectif de restreindre davantage le recours aux STECAL, pour y voir un dispositif expressément dérogatoire. Il en a déduit que la jurisprudence dégagée par la haute juridiction sous l’empire de l’état antérieur du droit, instituant le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation63, n’était pas transposable au texte actuel. Et il a considéré que la marge d’appréciation offerte, par le nouveau texte, aux auteurs du PLUi était limitée au point de devoir conduire le juge à opérer désormais un contrôle normal de la création d’un STECAL au regard tant du caractère limité de sa taille et de sa capacité que du maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
En l’espèce, étaient notamment autorisées en secteur NhMB03, d’une superficie non négligeable de 50 000 m² et situées à proximité immédiate d’une zone protégée à plusieurs titres (réserve naturelle nationale, site Natura 2000, ZNIEFF et lieu de convergence de corridors écologiques), des constructions destinées essentiellement aux activités de sports et de loisirs, certes compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, mais pour 7 500 m² de surface de plancher, sur des hauteurs pouvant aller jusqu’à 12 m et sur une bande de 50 m. Dans ces conditions, le tribunal a retenu que le secteur NhMB03 méconnaissait les dispositions de l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme.
Naïla BOUKHELOUA
Incompétence du juge administratif pour connaître des décisions des fédérations sportives fixant le montant des subventions à destination de leurs ligues régionales (TA Versailles, 16 nov. 2018, n° 1605467, Ligue régionale d’Île-de-France bowling c/ Fédération française de bowling et de sport de quilles). Il est de jurisprudence constante que les actes pris par des personnes privées chargées de l’exécution d’une mission de service public n’ont un caractère administratif, et donc ne peuvent relever de la compétence du juge administratif, que s’ils traduisent directement l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ils sont chargés64. D’apparence simple, ce critère est réputé des plus abscons. Cela s’illustre notamment dans le contentieux des actes des fédérations sportives65, premières bénéficiaires de cette jurisprudence66. Ainsi, le juge administratif perdra sa compétence pour connaître des actes d’une fédération qui ne tient pas sa mission de service public d’une délégation ministérielle67, seul acte susceptible de lui conférer des prérogatives de puissance publique ; ou encore si l’acte n’a pas été pris relativement à des faits s’étant déroulés en France, l’exécution de la mission de service public et donc la mise en œuvre des prérogatives qu’elle peut impliquer ne peuvent se réaliser que sur le territoire national68.
En l’espèce, le bowling, sport antique popularisé aux États-Unis durant le XVIIIe siècle, s’est constitué en France en une fédération, chargée par délégation ministérielle de l’exécution d’une mission de service public consistant en l’organisation de compétitions sportives et donnant lieu à la délivrance de titres. Pour se faire, la fédération institua notamment une ligue afin de la représenter dans son ressort régional d’Île-de-France. Cette dernière reçoit une subvention annuelle de la part de la fédération. Cependant, la ligue, au cours de l’année 2015, outre l’apparition de tensions politiques avec la fédération, a omis de participer à deux compétitions fédérales. En conséquence, le comité national de la fédération a appliqué à la ligue une pénalité financière de 313 €, en ne lui accordant qu’une subvention annuelle résiduelle de 965 €. La ligue saisit alors le président de la fédération, d’une demande en annulation de la pénalité qui fut rejetée. C’est ainsi qu’en juillet 2016 la ligue finit par saisir le TA de Versailles d’une demande en annulation de la décision de rejet du président de la fédération. La ligue, au contraire de la fédération, estime que la pénalité en cause est une sanction financière prise par une autorité incompétente et infondée dans tous les cas.
Cependant, contrairement à ce qu’estimaient les parties, la question qui se pose ne porte pas sur la légalité de la décision attaquée, mais sur la compétence même du juge administratif pour en connaître. En effet, bien que la fédération exerce une mission de service public par délégation ministérielle69, bien qu’elle soit, de ce fait, dotée de prérogatives de puissance publique, qu’en est-il de l’acte fédéral fixant le montant minoré de la subvention annuelle au profit de l’une de ses ligues régionales ? Traduit-il l’exercice direct de ces prérogatives, seul critère capable de fonder la compétence de la juridiction administrative ?
Le tribunal répond par la négative, conformément aux conclusions du rapporteur public70 et à la jurisprudence antérieure, au motif que l’acte en cause n’avait pas été pris dans l’exercice de prérogatives de puissance publique en ce qu’il ne faisait que fixer le montant de la subvention annuelle destinée à la ligue. Incompétent, le juge administratif renvoie donc l’affaire devant la juridiction judiciaire.
Ce jugement a le mérite de venir préciser le domaine des prérogatives de puissance publique et des sanctions disciplinaires en en excluant les décisions fixant le montant annuel des subventions des fédérations sportives auprès de leurs ligues régionales. Il illustre néanmoins la difficulté de lecture des règles de répartition des compétences juridictionnelles en matière de contentieux des actes des personnes privées exerçant une mission de service public. En effet, en l’espèce, aucune des parties n’a douté de la compétence du juge administratif ; les moyens invoqués ne soulèvent pas cette éventualité, chacun se fondant sur la mission de service public, assortie de prérogatives de puissance publique, déléguée par le ministre des Sports. Pire, l’acte en cause est qualifié par les parties de « pénalité » ou de « sanction financière », plaçant ainsi le litige dans le domaine des sanctions disciplinaires. Or, ces dernières, prises par des personnes privées chargées d’une mission de service public, ont été reconnues par le CE comme constituant des actes administratifs pris dans l’exercice de prérogatives de puissance publique71 et relevant de la compétence du juge administratif. Le juge se serait-il trompé ?
La science juridique impose de distinguer la finalité originelle d’un acte de celle poursuivie en pratique. En l’espèce, c’est cette distinction qui a guidé la réflexion du juge et qui a manqué aux parties. En ce sens, une subvention individuelle, même minorée, a pour but de permettre le bon fonctionnement d’un service et non de punir l’un de ses membres. La sanction, au contraire, est la finalité d’un acte disciplinaire qui met en œuvre une règle générale et impersonnelle ayant vocation à organiser le service. L’acte déviant ne manquera pas d’être sanctionné, le cas échéant, par le juge compétent, quel qu’il soit.
Ces considérations tendent à faire un rapprochement avec la jurisprudence relative aux services publics industriels et commerciaux qui fonde la compétence du juge administratif sur la nature réglementaire72 de l’acte se rapportant à l’organisation même du service73. Force est de constater qu’en l’espèce les termes utilisés se recoupent et que, quel que soit le domaine considéré, c’est toujours la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique qui est recherchée, de façon sous-jacente ou non. Ce rapprochement, s’il était officialisé, pourrait simplifier ce contentieux.
Ainsi, tout au plus, pourrait-on reprocher au juge de l’espèce de ne pas avoir assez développé la motivation de sa décision, afin de mieux éclairer le justiciable, à l’instar du rapporteur public qui évoquait bien une décision ne mettant en cause que des « rapports entre (…) deux personnes morales de droit privé ».
Anaëlle BOSSIÈRE
L’application aux personnes morales de l’exigence liée aux garanties de moralité pour l’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables (TA Versailles, 16 juill. 2018, n° 1606606, Commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables). La présente espèce contribue à nourrir le contentieux relatif aux inscriptions au tableau d’un ordre professionnel. Afin de se prononcer sur la question de savoir si une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) peut être regardée comme remplissant les garanties de moralité exigées pour l’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables, la juridiction versaillaise devait trancher si de telles exigences s’appliquent aux personnes morales.
Dans la présente affaire, un expert-comptable exerçant à titre individuel, inscrit au tableau de l’ordre, dépose une demande d’inscription d’une SASU dont il détient entièrement le capital. Par une décision du 22 janvier 2016, le conseil régional de l’ordre des experts-comptables l’autorise à s’inscrire. Cette décision est confirmée par le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables le 22 juin 2016. Par une requête du 21 juillet 2016 le commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables demande l’annulation de cette dernière décision. Enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du CE, cette requête est transmise, par ordonnance du 14 septembre 2016 du président de la section, au TA de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 312-10 du Code de justice administrative (CJA). Avant de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, le tribunal retient sa compétence pour juger de la requête au regard des dispositions de l’article R. 351-9 du CJA.
En statuant au fond, le juge administratif fait une application combinée de plusieurs dispositions. Il souligne que la demande d’inscription au tableau doit être accompagnée des pièces justifiant que les conditions posées au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, sont remplies. Parmi celles-ci figurent notamment l’absence de condamnation criminelle ou correctionnelle et la garantie de moralité. En vertu des dispositions de l’article 116 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, le commissaire du gouvernement est chargé de diligenter une enquête de moralité relative au comportement fiscal de l’intéressé. Le TA se réfère aussi aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
La décision du TA attire l’attention en raison de son interprétation des dispositions applicables en matière d’inscription au tableau de l’ordre concerné. Le juge administratif est amené à déterminer si la garantie de moralité s’impose à une personne morale au même titre qu’à une personne physique. Suivant le sens des conclusions du rapporteur public, le TA retient une « lecture combinée »74 des articles3, II et 7 de l’ordonnance précitée. L’interprétation retenue par le tribunal diffère ainsi de celle proposée par le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Selon cette dernière, lorsque le représentant de la société est inscrit au tableau, la société créée par celui-ci l’est également. Le TA rappelle dans sa décision que c’est pour toute demande d’inscription au tableau, en vertu de l’article 116 du décret précité, que le commissaire du gouvernement diligente une enquête de moralité. Même si une personne morale n’est pas concernée par la condition liée à l’absence de condamnation criminelle ou correctionnelle, elle l’est en revanche par l’exigence de moralité. Cette interprétation doit être saluée dans la mesure où, comme le fait valoir le rapporteur public75, une interprétation contraire permettrait à l’associé unique de contourner l’exigence de moralité par la constitution d’une société, dont il est le gérant et le seul associé, afin d’obtenir une inscription au tableau de l’ordre.
En l’espèce, le gérant et l’associé unique de la société a été condamné le 9 septembre 2015 à une peine correctionnelle définitive d’un an d’emprisonnement avec sursis pour soustraction frauduleuse à l’établissement et au paiement de l’impôt. Comme l’explique le juge versaillais, la société ne pouvait, dès lors, « être regardée comme remplissant la garantie de moralité exigée ». Cette constatation amène le juge à affirmer que le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables a entaché sa décision d’une erreur de droit, en considérant que les garanties de moralité ne s’appliquent pas aux personnes morales, mais aussi d’une erreur manifeste d’appréciation, en estimant que la société répondait aux conditions d’inscription au tableau de l’ordre, posées par l’ordonnance de 1945.
Katarzyna KMONK
Notes de bas de pages
-
1.
CE, 27 juill. 2005, nos 273619 et 273620, Sté Fauba France : Lebon T., p. 867 ; RJF 11/05, n° 1173, concl. Olléon L. ; BDCF 11/05, n° 129.
-
2.
Dans la rédaction antérieure à la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006.
-
3.
6e Dir. n° 77/388/CEE du Cons. CE, 17 mai 1977, mod. not. par Dir. n° 91/680/CEE, 16 déc. 1991.
-
4.
CJCE, plén., 19 nov. 1991, nos 6/90 et 9/90, Francovich c/ République Italienne.
-
5.
CJCE, plén., 30 sept. 2003, n° 224/01, Gerhard Köbler.
-
6.
CE, 4e et 5e ch. réunies, 21 sept. 2016, nos 394360 et 395548, B, Snc Lactalis Ingredients.
-
7.
CJCE, plén., 5 mars 1996, nos 46/93 et 48/93, Brasserie du pêcheur et Factortame Ltd et a. : RJF 1996, n° 529.
-
8.
CE, 4e et 5e ch., 18 juin 2008, n° 295831, Gestas : Lebon, p. 230.
-
9.
V. article 234 du traité instituant la Communauté européenne dont les dispositions sont reprises à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
-
10.
CJCE, 12 janv. 2006, nos C-354/03, C-355/03 et C-484/03, Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd et Bond House Systems Ldt : RJF 4/06, n° 488, concl. Maduro L.-M. P. ; BDCF 4/06, n° 47.
-
11.
CJCE, 27 sept. 2007, n° C-409/04, Téléos plc : RJF 2007, n° 1511.
-
12.
CJCE, 6 avr. 1995, n° C-4/94, BLP Group plc : RJF 1995, n° 804.
-
13.
CJCE, 14 févr. 1985, n° C-268/83, Rompelman ; CJCE, 26 mars 1987, n° C-235/85, Commission c/ Pays-Bas ; CJCE, 27 nov. 2003, n° C-497/01, Zita Modes et CJCE, 12 sept. 2000, n° C-260/98, Commission c/ Grèce.
-
14.
CE, 16 mai 2011, n° 318501, Mme Beaufils : Lebon.
-
15.
AJDA 2015, p. 2327.
-
16.
CE, ass., 30 oct. 2009, n° 298348, Mme Perreux : Lebon.
-
17.
CE, sect., 11 juill. 2011, n° 321225, Mme Montaut : Lebon.
-
18.
RJF 9/18, n° C 824, concl. Errerra A.
-
19.
En vertu des dispositions combinées des articles 39 et 219 du Code général des impôts.
-
20.
CE, 3e et 8e ch., 20 mai 2016, n° 392527, Min. c/ Selarl Lemaire : RJF 8-9/16, n° C 685, concl. Cortot-Boucher E.
-
21.
BOI-BIC-PVMV-30-10-2017-05-03, n° 98.
-
22.
CE, 20 oct. 2010, nos 314248 et 314247, Sté Hyper Primeurs, Alphaprim : RJF 1/11, n° 16, concl. Geffray E. ; BDCF 1/11, n° 5 – CE, 12 mars 2012, n° 342295, Eurl Alci : RJF 6/12, n° 564, concl. Escaut N. ; BDCF 6/12, n° 67.
-
23.
Deysine M.-A. et Blandin A.-L., « La fiscalité face à la définition comptable des titres de participation », Dr. fisc. 2017, n° 45, comm. 531.
-
24.
CGI, art. 219, I, a ter), 8e al.
-
25.
CAA Paris, 25 sept. 2012, n° 11PA03445, Boulanger : RJF 7/13, n° 695.
-
26.
TA Montreuil, 2 juin 2016, n° 1409969.
-
27.
CE, 16 juin 2004, n° 235647, SA Imprimerie Borel.
-
28.
CE, 26 sept. 2011, n° 328762, Min. c/ SARL holding Financière Séguy.
-
29.
V. Pluen O., note sous CAA Versailles, 20 juill. 2017, n° 16VE00638, SHCD : LPA 2 juill. 2018, n° 136r2, p. 9.
-
30.
CAA Paris, 26 mai 2016, n° 14PA05107, Sté Sofiza.
-
31.
CE, 24 nov. 2014, n° 363556, Sté Artémis SA.
-
32.
Cass. 1re civ., 17 oct. 1972, n° 70-13817.
-
33.
V. Dir. n° 90/435/CEE du Cons., 23 juill. 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, art. 4.1 et, pour son interprétation : CJCE, 4e ch., 22 déc. 2008, n° C-48/07, Les Vergers du Vieux Tauves.
-
34.
CE, 24 nov. 2014, n° 363556, Sté Artémis SA.
-
35.
TA Paris, ord., 28 mars 2014, n° 16VE02976.
-
36.
TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2016, nos 1404678 et 144678.
-
37.
CE, 5 mars 2014, n° 362283, SCI Europe Immobilière.
-
38.
BOI-IF-AUT-50-20190220.
-
39.
BOI-IF-AUT-50-20190220.
-
40.
CE, 17 juin 1996, n° 145594, SA France Sud Diffusion.
-
41.
BOI-SJ-RES-10-20-10-20180607.
-
42.
CE, 17 avr. 2019, n° 420468, M. et Mme C. : Lebon – CE, 19 avr. 2019, n° 420469, M. et Mme B.
-
43.
Cons. const., 26 juin 2003, n° 2003-473 DC.
-
44.
CE, 30 juill. 2014, n° 363007, Cne de Biarritz : Lebon T.
-
45.
CE, 21 févr. 2011, n° 337349, Sté Ophrys et Cté d’agglomération Clermont Communauté et a. : Lebon, p. 54, et CE, 29 déc. 2014, nos 372477 et 372479, Cne d’Uchaux : Lebon, p. 416.
-
46.
CE, 2e et 6e ss-sect. réunies, 4 juill. 1997, n° 156298, Épx Bourezak : Lebon, p. 278, concl. Abraham R. ; RFDA 1997, p. 815 ; CE, avis, sect., 30 nov. 1998, n° 188350, Berrad : Lebon, p. 45.
-
47.
Cons. const., 26 juin 2003, n° 2003-473 DC ; CE, 29 oct. 2004, nos 269814, 271119, 271357 et 271362 ; CE, 23 juill. 2010, nos 326544 et 326545.
-
48.
L. n° 2012-204, 12 mars 2012, relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique : JO, 13 mars, p. 4498, texte n° 4.
-
49.
V. Odent R., « Le destin des fins de non-recevoir », in Mélanges Waline, t. 2, 1874, LGDJ, p. 653 par ex. CE, ass., 2 déc. 1983, n° 43541, Charbonnel et a. : Lebon, p. 474.
-
50.
V. sur ce point, nos développements relatifs à l’obligation de désigner la décision dont l’examen de la légalité est sollicité et le pragmatisme dont fait preuve le juge, in L’obligation d’informer dans le procès administratif, t. 226, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, p. 124, § 164.
-
51.
A contrario, des conclusions dirigées contre une décision non précisée ne donnant aucun renseignement sur la nature ni même l’existence de la décision sont considérées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, v. en ce sens : CE, 29 oct. 1976, n° 99201, Assoc. des délégués et des auditeurs du CNAM : Lebon, p. 460 – CE, 2 mai 1952, n° 98202, Antona : Lebon, p. 219 – CE, 19 févr. 1965, n° 59347, Féd. des syndicats CFTC des travaux publics : Lebon, p. 123.
-
52.
CE, 23 oct. 1987, n° 66977, Cts Metrat : DA 1987, n° 575.
-
53.
CE, 21 oct. 1983, n° 39921, Garde des sceaux c/ Poicon : DA 1983, n° 431.
-
54.
V. Odent R., Le contentieux administratif, 1981, Les cours de droit, fasc. VI, p. 1982.
-
55.
V. par ex. CE, 23 juill. 2014, n° 363141, M. Stéphan Schreiber, concernant le contrôle minimum porté par un jury académique sur la manière de servir d’un stagiaire en fin de stage.
-
56.
CE, 7 févr. 2018, n° 407718, Sté AEG Power Solutions : RDT 2018, p. 213, obs. Géa F.
-
57.
Piveteau D., « Un entier contrôle de l’administration et du juge sur les catégories professionnelles, mais qui cible l’essentiel », SSL 2018, n° 1803.
-
58.
Piveteau D., « Un entier contrôle de l’administration et du juge sur les catégories professionnelles, mais qui cible l’essentiel », SSL 2018, n° 1803.
-
59.
Fabre A., « La détermination des catégories professionnelles : talon d’Achille des PSE », SSL 2017, n° 1785.
-
60.
V. par ex. CAA Versailles, 8 oct. 2015, n° 15VE02312 et CAA Versailles, 21 oct. 2015, n° 15VE02512. V. dans ce cadre : Brotons S., « L’incidence d’une définition irrégulière des catégories professionnelles dans le PSE », SSL 2015, n° 1698.
-
61.
Piveteau D., « Un entier contrôle de l’administration et du juge sur les catégories professionnelles, mais qui cible l’essentiel », SSL 2018, n° 1803.
-
62.
Brotons S., « Catégories professionnelles : contribution à la sécurité juridique », SSL 2019, n° 1845.
-
63.
CE, 31 mars 2010, n° 313762, Cne de Chateauneuf-du-Rhône : Lebon T.
-
64.
CE, 13 janv. 1961, n° 43548.
-
65.
Personnes privées organisées en association de la loi 1901.
-
66.
CE, 22 nov. 1974, n° 89828.
-
67.
CE, 19 déc. 1988, n° 79962.
-
68.
CE, 19 mars 2010, n° 318549.
-
69.
En vertu de l’article L. 131-14 du Code du sport et de l’arrêté du ministère des Sports du 31 décembre 2012.
-
70.
Nous remercions Mme Winkopp-Toch A. pour la communication de ses conclusions.
-
71.
CE, 26 nov. 1976, n° 95262.
-
72.
T. confl., 17 avr. 2000, n° 03193.
-
73.
T. confl., 15 janv. 1968, n° 01908 ; T. confl., 11 janv. 2016, n° 4038.
-
74.
Nous remercions Mme A. Winkopp-Toch, rapporteur public, pour la communication de ses conclusions auxquelles nous faisons sur ce point référence.
-
75.
Ibid.