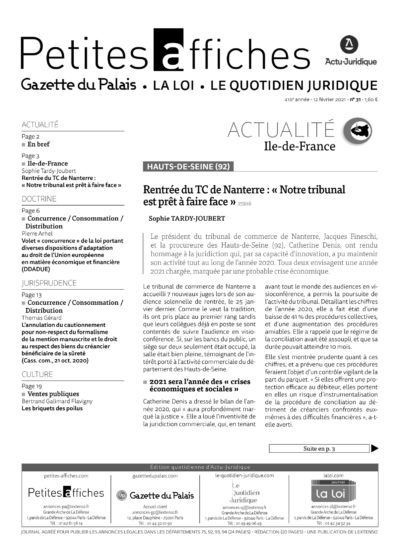L’annulation du cautionnement pour non-respect du formalisme de la mention manuscrite et le droit au respect des biens du créancier bénéficiaire de la sûreté
En se fondant sur l’objectif de protection de la caution assigné à cette exigence de solennité, la Cour de cassation décide que la nullité du cautionnement encourue pour non-respect de la mention manuscrite exigée par le législateur ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du créancier bénéficiaire de la sûreté.
Cass. com., 21 oct. 2020, no 19-11700, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00546, PB
1. Contexte. À maints égards, l’engagement de caution est un acte dangereux. Dans un souci de protection des garants, le droit positif a développé de nombreux mécanismes destinés à leur permettre de réaliser l’importance des risques encourus. C’est en particulier à cette fin que la loi Dutreil du 1er août 2003 a instauré un formalisme à titre de validité, exigeant de la caution qu’elle reproduise une mention manuscrite précise censée lui permettre de prendre conscience de la portée de son engagement1. Applicable à tous les cautionnements souscrits sous seing privé par une caution personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel, la règle revêt un degré de généralité remarquable2, au point de réduire l’empire du consensualisme en la matière à la portion congrue3. Sanctionné par la nullité de la garantie, le non-respect de cette mention manuscrite est cependant devenu la source d’un contentieux pléthorique, que la réforme du droit des sûretés en voie d’achèvement s’est donné pour ambition de résorber. La simplification espérée de cette exigence de solennité, que la doctrine appelle de ses vœux, ne dispense pas la Cour de cassation d’avoir à en éclairer les soubassements, ainsi que l’illustre l’arrêt sous commentaire, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 octobre 20204.
2. Faits et procédure. En l’espèce, un établissement de crédit avait accordé à une société un prêt d’un montant de 100 000 €, garanti par deux engagements de caution. Les difficultés rencontrées par cette société ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, la banque assigna les cautions aux fins d’exécution de leurs engagements. Par voie reconventionnelle, ces garants invoquèrent la nullité des sûretés souscrites en raison du non-respect des mentions manuscrites requises par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause (devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 dudit code depuis l’adoption de l’ordonnance du 14 mars 2016). Les juges du fond firent droit à cette demande, incitant l’établissement de crédit bénéficiaire des sûretés litigieuses à former un pourvoi devant la Cour de cassation. L’argumentation déployée par la banque épousait deux axes. Le premier, relativement classique, se fondait sur la marge d’erreur laissée aux parties dans la reproduction de la mention manuscrite exigée par le législateur. Le pourvoi arguait en effet de ce que les erreurs qui n’affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par le Code de la consommation ni n’en rendent la compréhension plus difficile pour la caution n’affectent pas la validité du cautionnement. Le second argument, plus original, consistait à présenter la nullité du cautionnement pour non-respect du formalisme comme une violation du droit au respect des biens protégé par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). Le rejet du pourvoi sur ces deux points offre à la Cour de cassation l’occasion de rappeler la finalité essentielle du formalisme de la mention manuscrite, tout entier voué à assurer la protection de la caution. C’est en effet cette ambition protectrice qui justifie l’annulation de la garantie pour non-respect du formalisme de la mention manuscrite (I) et qui légitime l’atteinte subséquente au droit au respect des biens du créancier bénéficiaire de la sûreté (II).
I – La protection de la caution, justification à l’annulation de la sûreté pour non-respect du formalisme de la mention manuscrite
3. Pour contester l’annulation des cautionnements litigieux, le pourvoi tirait argument de ce que les erreurs qui n’affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par le Code de la consommation, ni n’en rendent la compréhension plus difficile pour la caution, n’affectent pas la validité du cautionnement. L’analyse fait écho à une jurisprudence bien établie, en vertu de laquelle l’absence de fidélité absolue à la lettre de la mention exigée par le législateur ne condamne pas nécessairement la sûreté à la nullité (l’annulation). Au-delà du cas de la pure erreur matérielle, déclarée insusceptible d’entraîner l’annulation du cautionnement5, il a ainsi été jugé que l’ajout de certains mots à la formule légale n’était pas de nature à remettre en cause la validité de la sûreté6. L’utilisation de termes synonymes est également admise par la Cour de cassation7. Dans cette optique, le non-respect de la mention manuscrite n’est pas nécessairement une cause de nullité du cautionnement. En principe, l’admission d’une divergence entre la mention prévue par le législateur et celle apposée par le garant dépend du point de savoir si l’inobservation de la première n’altère ni le sens ni la portée de l’engagement souscrit par l’auteur de la seconde8. Les juges se livrent ainsi à une interprétation téléologique du formalisme imposé par le législateur, faisant prévaloir l’esprit du texte sur sa lettre9. En s’abstenant de transformer la mention légale en formule sacramentelle, l’analyse à l’œuvre fait échapper à l’anéantissement nombre de cautionnements. Surtout, elle rappelle opportunément que ce formalisme n’est « pas une fin en soi »10 mais un instrument au service de la protection des cautions. On peut en effet légitimement douter de ce que le fait de reproduire scrupuleusement les termes exigés par la loi suffise à attester de la prise de conscience par la caution des conséquences de son engagement11. Dans l’esprit des juges, la fidélité aveugle à la lettre de la mention légale importe dès lors moins que la compréhension par le garant des risques auxquels il s’expose12. Un tel mode de raisonnement ne va toutefois pas sans difficultés car il revêt une indéniable dimension subjective, ce qui ne favorise pas la prévisibilité des solutions.
4. En adoptant une approche casuistique, au prix d’interprétations parfois divinatoires, la haute juridiction favorise l’esprit de chicane : les moindres détails de la mention requise par le législateur fournissent en effet le prétexte à une contestation de la validité de la sûreté (ex. : place d’un mot, d’une virgule, de la signature). Érigé en ligne directrice, le critère de l’intégrité du sens et de la portée de l’engagement de caution est lui-même mis à mal par certains arrêts. Tel est le cas lorsque la Cour de cassation valide des mentions manuscrites irrégulières qui restreignent le gage du créancier13 ou l’étendue de l’obligation garantie14. L’imprévisibilité des solutions alimente ainsi de sévères critiques doctrinales à l’encontre du formalisme de la mention manuscrite15. Celles-ci ont manifestement été entendues par les rédacteurs de l’avant-projet de réforme du droit des sûretés, dont l’article 2298 fait œuvre de simplification en ce domaine en prévoyant une exigence de solennité plus souple, sous le contrôle du juge16. Il n’en reste pas moins qu’en certaines hypothèses, l’atteinte à la raison d’être de la mention manuscrite est si manifeste que la nullité s’impose sans conteste, ainsi que l’illustre l’arrêt étudié.
5. En l’espèce, l’irrégularité de la mention reproduite par les cautions ne laissait guère de place au doute. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir relevé que cette mention ne comprenait ni la durée du cautionnement ni l’identité du débiteur principal. Or il paraît tout à fait illusoire de prétendre à la régularité d’une mention manuscrite dépourvue d’éléments aussi essentiels à la compréhension de l’engagement de la caution17. En outre, l’acte litigieux ne précisait pas « le sens de l’engagement » souscrit. Enfin, la référence à un « engagement de caution solidaire et indivise » n’apparaît pas comme étant de nature à permettre au garant de prendre conscience de la teneur de celui-ci. D’une part, nulle indication ne lui permettait de comprendre ce que signifie le caractère « solidaire » du cautionnement. D’autre part, l’emploi de l’adjectif « indivise » s’avère être une source de confusion et d’imprécision, le terme étant jugé « impropre » et non défini. En approuvant le raisonnement des juges du fond, la Cour de cassation rappelle en filigrane que si l’on peut s’accommoder de quelque variation formelle et/ou sémantique entre la formule légale et la mention effectivement rédigée par le garant, ce n’est qu’à la condition qu’un tel décalage ne porte pas atteinte à l’objectif de protection de la caution assignée à ce formalisme. C’est également à cette aune que la haute juridiction apprécie l’atteinte alléguée au droit au respect des biens du créancier bénéficiaire.
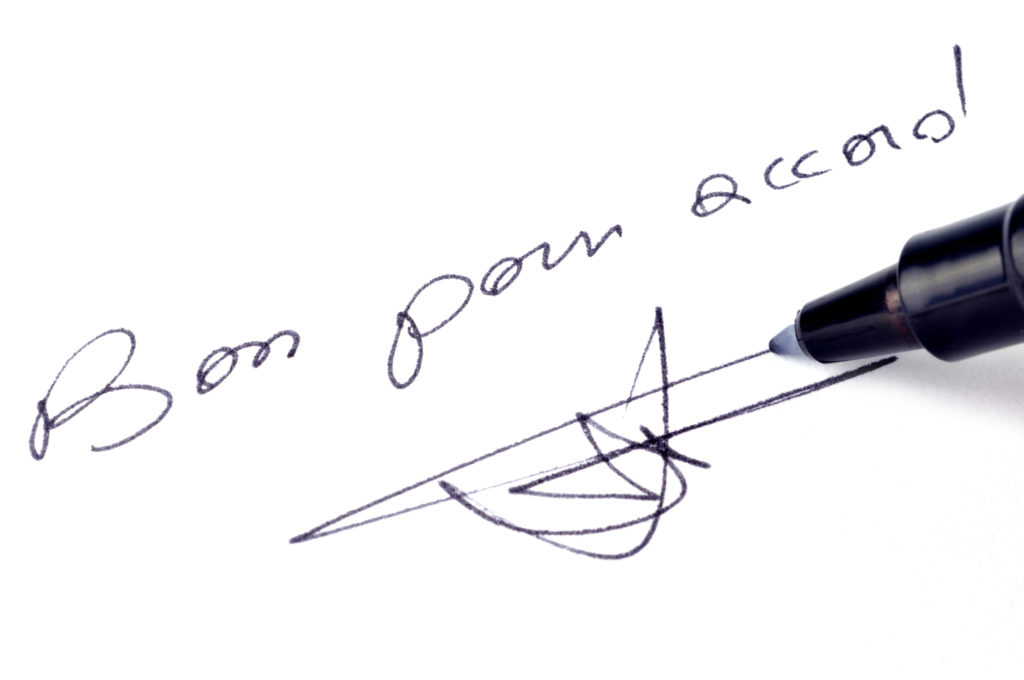
II – La protection de la caution, justification à l’atteinte au droit au respect des biens du créancier bénéficiaire de la sûreté
6. Un second argument était mobilisé par la banque afin de contester l’annulation des cautionnements souscrits à son bénéfice, qui consistait à analyser leur nullité en raison du non-respect du formalisme requis comme une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Plus précisément, l’annulation des sûretés considérées serait constitutive d’une violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention EDH. Aux termes de cette disposition, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international »18. Chargée de garantir l’effectivité de cette disposition, la Cour européenne des droits de l’Homme adopte une acception large de la notion de « bien ». Libres de s’affranchir du poids de la tradition civiliste française, qui tend à cantonner l’empire de la propriété aux choses corporelles19, les juges européens ont ainsi de longue date accepté de qualifier de « biens » des choses incorporelles, au premier rang desquels les droits de créance20. Toujours sous le patronage de cette conception accueillante, une sûreté réelle a pu être considérée comme un « bien » au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention EDH21. Selon la formule consacrée, toute espérance légitime de pouvoir exercer un droit constitue un « bien » dont le respect est protégé par la Convention EDH22. L’arrêt sous commentaire nous semble pouvoir être interprété comme s’inscrivant dans le sillage de cette analyse. En effet, en consentant à se prononcer sur le caractère proportionné de l’atteinte au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens résultant de l’annulation des sûretés litigieuses, la Cour de cassation postule implicitement mais nécessairement la qualification de « bien » de telles garanties. Ceci ne saurait surprendre, si l’on garde à l’esprit le fait que le mécanisme de la sûreté personnelle repose sur l’octroi à son bénéficiaire d’un droit de créance adjoint à une obligation principale23. En effet, si les créances sont des biens au sens du premier protocole additionnel à la Convention EDH, cette qualification s’impose fort logiquement en ce qui concerne la créance particulière dont le titulaire d’une sûreté personnelle dispose à l’encontre du garant.
7. Selon la haute juridiction, la nullité du cautionnement pourvu d’une mention manuscrite non conforme à la lettre de la loi ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du bénéficiaire de la sûreté. Le raisonnement mené pour parvenir à une telle conclusion emprunte aux méthodes spécifiques du droit européen. Dans ce cadre, si les restrictions au droit de propriété se peuvent concevoir, il est impérieux d’en contrôler les justifications, dont la réalité conditionne la légitimité de l’atteinte24. C’est dans cette perspective que la Cour de cassation met l’accent sur la finalité de la sanction encourue par la sûreté dépourvue d’une mention manuscrite régulière, « qui est fondée sur la protection de la caution ». On comprend ainsi que l’ambition de protection des garants qui sous-tend le formalisme de la mention manuscrite est considérée comme étant de nature à justifier l’atteinte au droit au respect des biens du créancier bénéficiaire. À l’heure où se dessine une significative remise à plat de ce dispositif législatif, la solution rapportée mérite l’attention. Par-delà les vicissitudes qui affectent cette exigence de solennité, elle présente en effet l’insigne intérêt de rappeler que la protection de la caution en constitue la ligne d’horizon.
Notes de bas de pages
-
1.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la règle est prévue à l’article L. 331-1 du Code de la consommation. La mention manuscrite requise est la suivante : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de XXX couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de XXX, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même ». Une mention manuscrite spécifique est exigée afin de souscrire un engagement de caution solidaire (C. consom., art. L. 331-2).
-
2.
Antérieurement à la loi du 1er août 2003, certains cautionnements étaient déjà assujettis à un formalisme ad validitatem analogue : que l’on songe aux cautionnements garantissant un crédit mobilier ou immobilier à la consommation (C. consom., art. L. 314-1 et s.). Pour une étude d’ensemble sur le formalisme en matière de cautionnement, v. Aynès L., Crocq P. et Aynès A., Droit des sûretés, 14e éd., 2020, LGDJ, nos 96 et s., p. 98 et s.
-
3.
V. Barthez A.-S. et Houtcieff D., « Les sûretés personnelles », in Ghestin J. (dir.), Traité de droit civil, 2010, LGDJ, n° 498, p. 361 : « L’affirmation classique, selon laquelle le cautionnement est un contrat consensuel avait beau faire l’un des charmes de cette sûreté, elle est aujourd’hui à peu près vide de substance ».
-
4.
Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-11700, P.
-
5.
Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-17028 : Bull. civ. I, n° 254 ; RDC 2005, p. 403, note Houtcieff D., pour qui « l’omission de la conjonction de coordination “et” entre, d’une part, la formule définissant le montant et la teneur de l’engagement, d’autre part, celle relative à la durée de celui-ci, n’affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite » – Cass. com., 5 avr. 2011, n° 09-14358 : Bull. civ. IV, n° 55 ; RD bancaire et fin. 2011, comm. 89, obs. Legeais D.
-
6.
V. par ex. Cass. com., 8 juill. 2014, n° 13-20621 : D. 2015, p. 1815, obs. Crocq P., jugeant « que l’évocation du caractère “personnel et solidaire” du cautionnement dans la formulation de l’engagement de caution n’affecte pas la portée des mentions manuscrites légalement prescrites » – Cass. com., 27 janv. 2015, n° 13-24778 : Gaz. Pal. 19 mars 2015, n° 215q2, p. 12, obs. Dumont-Lefrand M.-P., pour qui l’ajout, après la mention « au prêteur », des termes « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apports d’actifs » ne dénature pas l’engagement de la caution.
-
7.
Pour la substitution du numéro « 2021 » au numéro « 2298 » dans la mention manuscrite relative à l’engagement de caution solidaire, v. Cass. 1re civ., 27 nov. 2013, n° 12-21393 : D. 2014, p. 1615, obs. Crocq P. ; JCP E 2014, 1010, note Legeais D. Pour la substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier », v. Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 12-18544 : Bull. civ. I, n° 74 ; D. 2013, p. 1460, note Lasserre Capdeville J. et Piette G. ; D. 2013, p. 1707, obs. Crocq P. ; RDC 2014, n° 110k7, p. 230, note Barthez A.-S. ; Banque & Droit n° 149, mai-juin 2013, p. 43, obs. Netter E. ; JCP E 2013, 1268, note Legeais D.
-
8.
V. Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-17028 : Bull. civ. I, n° 254 ; RDC 2005, p. 403, note Houtcieff D., pour qui « l’omission de la conjonction de coordination “et” entre, d’une part, la formule définissant le montant et la teneur de l’engagement, d’autre part, celle relative à la durée de celui-ci, n’affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite » – Cass. 1re civ., 27 nov. 2013, n° 12-21393 : D. 2014, p. 1615, obs. Crocq P. ; JCP E 2014, 1010, note Legeais D.
-
9.
Sur ce constat, v. Legeais D., Droit des sûretés et garanties du crédit, 13e éd., 2019, LGDJ, n° 159, p. 136 : « La Cour de cassation se fait l’adepte d’une interprétation plus téléologique. Au cas par cas, elle va donc devoir opérer la liste des adjonctions acceptables et celles qui ne le sont pas. »
-
10.
Barthez A.-S. et Houtcieff D., « Les sûretés personnelles », in Ghestin J. (dir.), Traité de droit civil, 2010, LGDJ, n° 527, p. 382.
-
11.
Barthez A.-S. et Houtcieff D., « Les sûretés personnelles », in Ghestin J. (dir.), Traité de droit civil, 2010, LGDJ, n° 527, p. 382-383 : « serviteur de la protection du consentement des cautions, (le formalisme) ne doit pas être réduit à un "truc" à l'usage des plus roublardes d'entre elles. Son application ne doit donc pas être désincarnée, mais vivifiée, au contraire, par les finalités qu'il tend à accomplir. Aussi convient-il d'approuver la Cour régulatrice d'avoir préféré au critère du recopiage servile de la mention manuscrite celui de sa portée ».
-
12.
Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-23130 : D. 2015, p. 1815, obs. Crocq P., pour qui « en se déterminant ainsi, sans rechercher si cet ajout modifiait la formule légale ou en rendait la compréhension plus difficile pour la caution, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
-
13.
Cass. com., 1er oct. 2013, n° 12-20728 : Bull. civ. IV, n° 143 ; D. 2014, p. 127, note Julienne M. et Andreu L. ; D. 2014, p. 1610, obs. Crocq P. ; RTD com. 2013, p. 791, obs. Legeais D., pour qui « l’omission des termes “mes biens” n’avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affectait pas la validité du cautionnement » – Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-16989 : RD bancaire et fin. 2014, comm. 131, obs. Legeais D.
-
14.
Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-24706 : Bull. civ. IV, n° 157 ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 6, obs. Cerles A. ; JCP E 2014, 1645, note Legeais D. ; RTD civ. 2015, p. 182, obs. Crocq P., pour qui l’omission du terme « intérêts » « n’avait pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité » – Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-26397 : RD bancaire et fin. 2017, comm. 160, obs. Legeais D., pour qui « l’omission du mot « pénalités » dans la mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, n’a pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement au principal et aux intérêts de la dette, sans en affecter la validité ».
-
15.
V. Piette G., « Solutions pour mettre un terme au contentieux relatif aux mentions manuscrites dans le cautionnement », D. 2017, p. 1064 ; Dumont-Lefrand M.-P., « Le formalisme du droit du cautionnement : proposition de réforme », in Études à la mémoire de Philippe Neau-Leduc. Le juriste dans la cité, 2018, LGDJ, p. 437 et s. ; Mileville S., « La mention manuscrite : entre création et subversion », in Mélanges offerts à Geneviève Pignarre. Un droit en perpétuel mouvement, 2018, LGDJ, p. 601 et s.
-
16.
Selon l’article 2298 de l’avant-projet de réforme, « la caution personne physique appose elle-même, à peine de nullité de son engagement, la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». L’exigence ainsi formulée se veut plus souple, à charge pour le juge d’apprécier le caractère suffisant de la mention apposée. Une mention spécifique est nécessaire à la souscription d’un cautionnement solidaire.
-
17.
Pour l’identité du débiteur garanti, v. déjà Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-24400 : Bull. civ. IV, n° 58 ; Gaz. Pal. 11 sept. 2018, n° 329z6, p. 33, obs. Piedelièvre S. ; LEDC juill. 2018, n° 111r, p. 2, obs. Cattalano-Cloarec G. ; LEDB juill. 2018, n° 111n3, p. 6, obs. Mignot M. ; RD bancaire et fin. 2018, comm. 91, obs. Legeais D.
-
18.
V. Terré F. et Simler P., Droit civil. Les biens, 10e éd., 2018, Précis Dalloz, n° 87, p. 104.
-
19.
Sur cette analyse, v. Planiol M. et Ripert G., Traité pratique de droit civil français, t. III., Les biens, par Picard M., 2e éd., 1952, LGDJ, n° 215, p. 224, où « le droit de propriété stricto sensu ne peut exister qu’à l’égard des choses corporelles » ; v. égal. Mazeaud H., Mazeaud L., Mazeaud J. et Chabas F., Leçons de droit civil, t. II, 2e vol., Biens. Droit de propriété et ses démembrements, 8e éd., 1994, Montchrestien, n° 1351, p. 117 ; Larroumet C. et Mallet-Bricout B., Traité de droit civil, t. II, Les biens, droits réels principaux, 6e éd., 2019, Economica, n° 195, p. 101 ; Sériaux A., Rép. civ. Dalloz, v° Propriété, 2020, n° 36.
-
20.
CEDH, 10 juill. 1973, n° 54/79172, X c/ Autriche – CEDH, 9 déc. 1994, n° 13427/87, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c/ Grèce, § 62 – CEDH, 6 oct. 2005, n° 11810/03, Maurice c/ France – CEDH, 6 oct. 2005, n° 1513/03, Draon c/ France : RTD civ. 2005, p. 744, obs. Marguénaud J.-P. ; : RTD civ. 2005, p. 798, obs. Revêt T.
-
21.
CEDH, 23 févr. 1995, n° 15375/89, Gasus Dosier – Und Fördertechnik GmbH c/ Pays-Bas.
-
22.
CEDH, 18 nov. 2010, n° 18990/07, Richet (Cts), Le Ber c/ France : RTD civ. 2011, p. 150, obs. Revêt T.
-
23.
Legeais D., Droit des sûretés et garanties du crédit, 13e éd., 2019, LGDJ, n° 33, p. 43 : « Les garanties personnelles sont des conventions conférant à un créancier le droit de réclamer le paiement de sa créance à une ou plusieurs personnes autres que le débiteur principal. Il y a adjonction d’une créance au profit du créancier contre le garant ».
-
24.
V. Libchaber R., « La propriété, droit fondamental », in Cabrillac R. (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 26e éd., 2020, Dalloz, p. 800 et s., spéc. n° 990, p. 811-812.