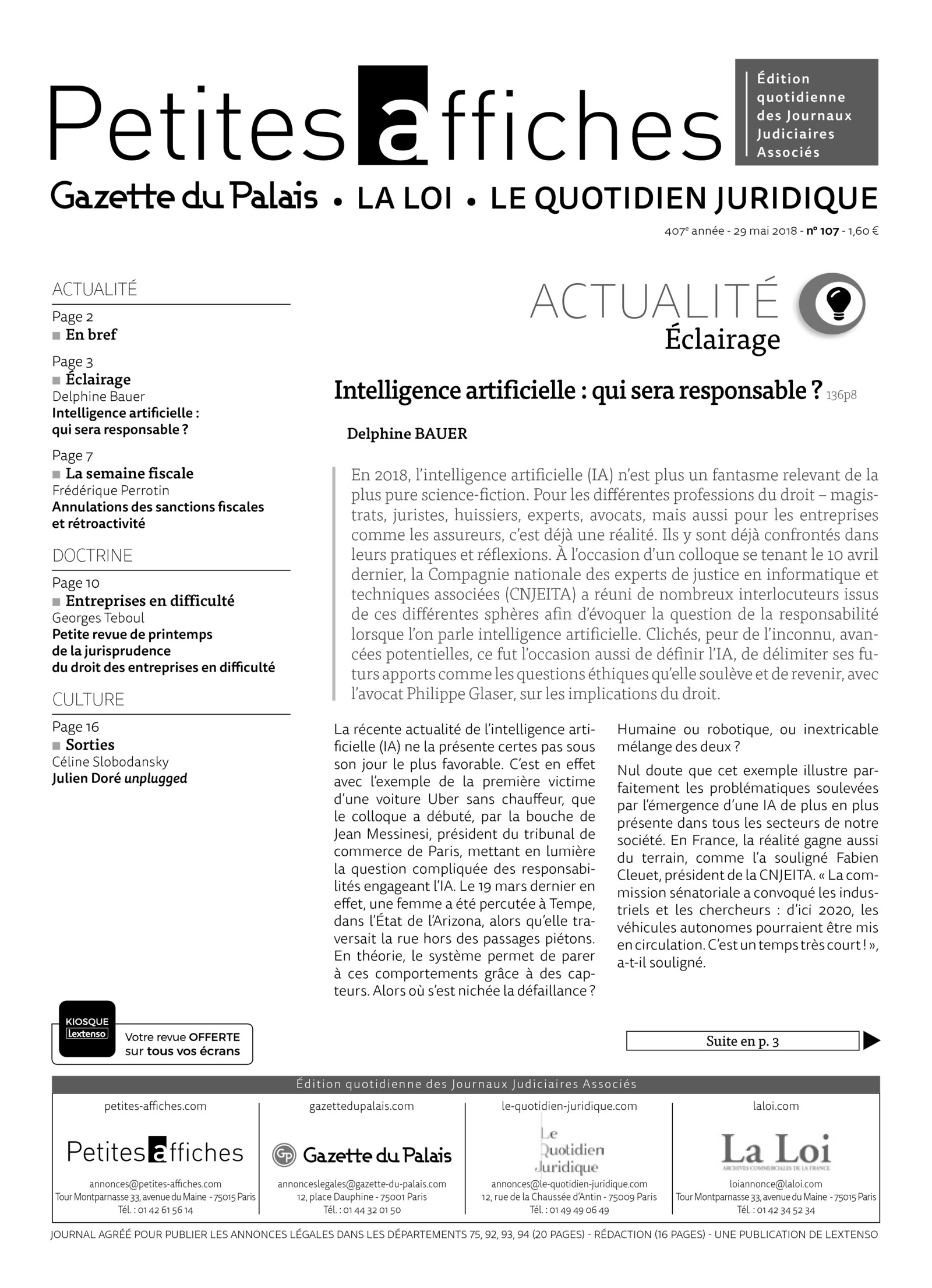Petite revue de printemps de la jurisprudence du droit des entreprises en difficulté
L’actualité récente est très soutenue, méritent d’être signalées des décisions récentes sur les sanctions et la prescription, une nouvelle illustration des droits des créanciers, notamment sur la possibilité procédurale d’intervention d’une société d’affacturage et différentes décisions sur le droit de propriété, le contentieux de la déclaration de créances, la vente d’un matériel revendiqué… En ce qui concerne les droits du débiteur, quels sont les droits propres du débiteur en sauvegarde ? A-t-il la possibilité de contester une autorisation de transiger et doit-il être entendu ou appelé ?
Sur la caution, le feuilleton copieux se poursuit avec une souplesse procédurale accordée à la caution sur ses demandes. Enfin, un point est fait sur l’activité sociale qui demeure très riche avec notamment une récente série de décisions du Conseil d’État de décembre 2017, des précisions sur la définition d’un groupe, avant de conclure sur un arrêt concernant la responsabilité d’un liquidateur au titre de ses obligations en cas de cession d’un actif.
Espérons que l’appétit de notre lecteur ne faiblira pas devant un menu aussi copieux…
Les sanctions
Une décision récente1 indique qu’un dirigeant ne peut plus être condamné au prononcé d’une faillite personnelle sur le fondement de l’article L. 654-6 du Code de commerce (cet article prévoit que le juge pénal ne peut condamner au titre d’une banqueroute à une faillite personnelle ou une interdiction si le juge civil ou commercial a déjà prononcé cette mesure par une décision définitive pour les mêmes faits).
En l’espèce, le dirigeant avait été condamné par un tribunal correctionnel notamment pour banqueroute à une interdiction d’exercer ainsi qu’à 10 ans de faillite personnelle. La cour d’appel avait confirmé ce jugement.
Le dirigeant avait contesté cette décision sur le fondement de l’article L. 654-6 du Code de commerce en indiquant que cet article avait été déclaré contraire à la constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 29 septembre 20162 et qu’il fallait donc le considérer comme abrogé. La chambre criminelle a accepté cette thèse et a censuré l’arrêt d’appel.
L’abrogation est considérée comme valable à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel au journal officiel le 1er octobre 2016 et elle concerne toutes les affaires non définitivement jugées à cette date.
En l’espèce, la décision pénale était définitive. La condamnation pour faillite personnelle ne pouvait donc être encourue une deuxième fois. Cette décision a pour mérite de prononcer une solution uniforme quelle que soit la juridiction qui a statué en premier lieu et cette décision paraît donc être bienvenue afin d’éviter une double peine pour les mêmes faits.
L’arrêt affirme donc clairement que les dispositions de l’article L. 654-6 du Code de commerce dans la rédaction résultant de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ont été déclarées contraire à la constitution, l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers ayant prononcé la faillite personnelle, étant annulé par voie de retranchement sur cette sanction.
Aucun renvoi n’a été ordonné à la suite de cette décision de principe.
En ce qui concerne la prescription sur les sanctions, rappelons une décision non publiée3.
Il a été jugé que la requête déposée par le ministère public pour demander une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer interrompt la prescription de 3 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, le dirigeant avait soutenu que seule l’assignation portée à sa connaissance pouvait interrompre la prescription et non le dépôt de la requête. La Cour de cassation a considéré cependant que le dépôt de la requête interrompt valablement la prescription, la Cour de cassation estimant que l’article 2241 du Code civil « n’exige pas que l’acte interruptif de prescription soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription ». Le respect du contradictoire pour la prise en compte du délai de prescription doit-il vraiment faire l’objet d’une « exigence » spécifique ?
Il a été en outre rappelé que le dépôt de la requête du ministère public est un mode de saisine du tribunal, de sorte qu’il s’agissait bien de la demande en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du Code civil. Le commentateur cité ci-avant a partagé cet avis en indiquant que la prescription triennale avait valablement été interrompue par le dépôt de la requête.
Nous savons cependant que dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, l’article R. 651-2 du Code de commerce prévoit que le tribunal est saisi par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévue à l’article R. 631-4 du Code de commerce.
Pour une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, l’article R. 653-2 du même code dispose que pour l’application de l’article L. 653-7, le tribunal est saisi selon le cas par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévue à l’article R. 631-44.
C’est l’article R. 631-4 qui est appliqué lorsque le ministère public décide de déposer une requête. Cet article prévoit qu’à réception de cette requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec AR à comparaître en joignant la requête du ministère public.
Lorsque la lettre recommandée avec demande d’avis de réception revient au greffe sans avoir atteint le destinataire, le greffier doit demander au ministère public de procéder par voie de signification5.
Une telle solution n’apparaît pas convaincante en regard du respect des droits de la défense. En effet, il ne semble pas normal qu’un dirigeant puisse, n’ayant reçu aucune information ni convocation pendant le délai de prescription de 3 ans, courir le risque de recevoir plus tard et après l’expiration du délai, une convocation ou une assignation le mettant en cause pour demander une sanction.
La sécurité juridique attachée en principe à la prescription n’y trouve pas son compte. La prescription est avant tout l’affaire de la personne concernée, avant d’être celle du tribunal.
Ne serait-il pas préférable que le ministère public procède par voie d’assignation lorsque le délai de 3 ans est quasiment expiré, afin que le dirigeant ait connaissance pendant le délai de prescription, des griefs qui sont formulés à son égard ?
Il peut paraître surprenant que la requête ait pour effet pratique de prolonger le délai de 3 ans. Il semble que, même si la requête est une demande en justice, cette demande doit être examinée avec un soin particulier lorsqu’elle revient à convoquer la personne concernée après l’expiration du délai de prescription et cette solution pratique aurait pour intérêt de permettre au débiteur d’être informé en temps utile.
L’autre sujet évoqué par cet arrêt concernait la présence à l’audience du ministère public qui intervient en qualité de partie principale. Sans surprise, il a été considéré que cette présence est obligatoire, ce qui est la moindre des choses lorsque le ministère public a le statut de partie au procès.
Le contrôleur peut-il engager seul l’action en insuffisance d’actif ? Une décision récente6 rappelle que si l’article L. 651-3, alinéa 2, du Code de commerce permet pour les contrôleurs de déclencher une action en insuffisance d’actif en cas de carence du liquidateur et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 2 mois7, il faut que cette action soit introduite par la majorité des créanciers contrôleurs.
Un créancier contrôleur souhaitait seul déclencher cette action et avait formulé une demande de QPC. La question posée concernait la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, le contrôleur unique ou minoritaire se plaignant de ne pouvoir exercer l’action. La Cour de cassation a refusé de renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel en considérant que la question n’avait pas un caractère sérieux.
La Cour de cassation a visé pour cela la gravité des conséquences pour un dirigeant poursuivi, ce qui justifie le régime procédural particulier de cette action.
Les droits des créanciers
Une société d’affacturage avait souhaité intervenir volontairement devant le juge commissaire en application de l’article L. 621-9 du Code de commerce sur le rôle du juge commissaire concernant la protection des intérêts en présence.
Cette société contestait une décision de l’administrateur judiciaire qui avait acquiescé à la demande de revendication. La Cour de cassation a rejeté sa prétention en indiquant que l’action en revendication qui tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant afin d’opposer ce droit à la procédure collective est strictement réglementée par l’article L. 624-17 du Code de commerce.
Seul le revendiquant, le débiteur et le mandataire de justice peuvent saisir le juge-commissaire à l’exclusion de toute autre personne même par une intervention volontaire ou une réclamation contre l’acquiescement8.
Le professeur Le Corre a rappelé les conditions posées pour l’acquiescement d’une demande en revendication en soulignant que l’acquiescement va permettre d’autoriser le propriétaire du meuble revendiqué à reprendre le bien.
Si l’acquiescement n’est pas donné, le revendiquant doit présenter une requête en revendication dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du mois imparti à l’organe compétent pour se prononcer sur la demande d’acquiescement.
Si seul le principe de l’opposabilité du droit de propriété est reconnu mais si sa portée est contestée, l’acquiescement n’est pas réputé avoir été donné et le vendeur doit donc présenter une requête en revendication au juge commissaire9.
Signalons une nouvelle avancée pour les créanciers qui peuvent présenter une action en relevé de forclusion lorsqu’ils sont créanciers d’une copropriété en difficulté10.
Il s’agit de l’application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 qui a mis en place en faveur de ces créanciers, une action en relevé de forclusion applicable aux procédures ouvertes à compter de la date d’entrée en vigueur du décret en conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 201811.
Avec quelques jours de retard, le décret du 8 janvier 2018 a prévu que l’action en relevé de forclusion peut être exercée dans le délai de 6 mois à compter de la publication de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire de la copropriété.
Le créancier demandeur doit établir la preuve que le retard dans la déclaration n’est pas dû à son fait12. Le décret prévoit que le président du tribunal statue en la forme des référés et le créancier devra ensuite déclarer sa créance dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du président le relevant de sa forclusion13.
Le créancier dispose à présent d’un recours plus large contre les ventes d’actifs ordonnés par le juge-commissaire : le créancier dont les droits sont affectés par l’autorisation de vendre un actif aux enchères peut en effet former un recours devant la cour d’appel14.
En l’espèce, un débiteur détenait du matériel dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat. Le liquidateur avait vendu aux enchères publiques ce matériel loué en exécution d’une ordonnance du juge commissaire. L’ordonnance avait été notifiée au bailleur qui a formé appel.
La cour d’appel a rejeté le recours au motif que le bailleur n’était pas partie en première instance. La Cour de cassation a censuré son arrêt en rappelant les dispositions de l’article R. 642-37-3 du Code de commerce et le fait que les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-19 sont susceptibles de recours devant la cour d’appel, notamment par les personnes dont les droits et obligations sont affectés par les décisions du juge-commissaire.
Il s’agit d’un recours devant la cour d’appel et non d’un appel, qui est réservé aux parties. Il ne s’agit pas davantage d’une tierce opposition, ce que rappelle Jean-Luc Vallens dans un commentaire particulièrement subtil.
Il est en outre souligné que le juge commissaire doit indiquer dans sa décision, les personnes dont les droits et obligations sont ou peuvent être affectés par sa décision15 puis le greffier devra préciser dans la notification les voies de recours ouvertes ainsi que les délais.
Le commentateur souligne cependant qu’en ne réclamant pas la restitution du matériel loué, le bailleur avait perdu le bénéfice de son inscription et qu’il ne pouvait dès lors pas s’opposer à la vente. Le liquidateur devait notifier au bailleur son intention de vendre le matériel, le mettre en demeure de se prononcer puis tenir à sa disposition le produit de sa vente16.
Précisons enfin qu’un arrêt récent précise les modalités de la reprise d’une saisie immobilière suspendue par un jugement d’ouverture : le juge commissaire fixe, quels que soit le stade de la procédure, la mise à prix et les modalités de vente, ce que la cour d’appel peut compléter17.
Les droits du débiteur
Signalons quelques décisions récentes :
Un débiteur en sauvegarde peut exercer seul des recours en matière de vérification et d’admission des créances. En l’espèce, une société en sauvegarde avait interjeté appel d’un jugement fixant une créance. Elle avait intimé l’administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance et le mandataire judiciaire.
Le conseiller de la mise en état avait déclaré nulle la déclaration d’appel pour défaut de qualité à agir de la société débitrice qui avait formulé son recours sans l’assistance de l’administrateur judiciaire.
Sur le fondement de l’article L. 624-3 du Code de commerce, la Cour de cassation a censuré cette décision. En effet, cet article ne vise plus l’administrateur judiciaire qui ne peut avoir une mission d’administration ou de représentation en sauvegarde.
Le débiteur peut donc exercer seul le recours contre la décision du juge-commissaire en matière de vérification et d’admission des créances18.
Le débiteur se voit en outre reconnaître pour la première fois, la possibilité de contester une autorisation de transiger. Il s’agissait d’une transaction permettant la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire. La société en liquidation cédait des droits sociaux. Le recours du dirigeant a été estimé recevable. Il s’agit de l’application des articles L. 642-24 et R. 642-41 du Code de commerce.
Rappelons que le débiteur doit être entendu ou appelé, c’est-à-dire convoqué par le greffier au moins 15 jours avant l’audience. La Cour de cassation crée donc au profit du débiteur un nouveau droit propre19.
L’arrêt a souligné que bien qu’étant dessaisi par le jugement de liquidation judiciaire, le débiteur dispose bien de ce droit propre à former un recours, dès lors qu’il s’agit de céder un actif dépendant de la liquidation judiciaire.
La caution
Un nouvel arrêt prolonge le feuilleton copieux du contentieux des cautions. En l’espèce, une caution demandait à être déchargée de son obligation de paiement en raison d’une faute commise par le créancier. Devait-elle procéder par voie de défense au fond ou en formulant une demande reconventionnelle ?20.
Depuis 1993, la chambre commerciale semblait considérer qu’il fallait procéder par voie de demande reconventionnelle et non comme un moyen de défense21.
La caution dispose donc des deux possibilités en demandant, soit le rejet de la prétention de l’adversaire, soit à être déchargée en demandant des dommages et intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui des dommages-intérêts.
L’arrêt de revirement de 1999 reste donc bien actuel22.
Un arrêt tout récent indique que la caution peut invoquer la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus, en application de l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation.
La banque avait invoqué la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Il lui a été répondu par la Cour de cassation que la position de la caution était une défense au fond et qui, comme telle, échappait à la prescription.
Cette position est donc favorable à la caution.
Le droit social
L’application du droit social en matière de procédures collectives est délicate et donne lieu à un contentieux qui reste fourni.
Signalons en premier lieu une série de décisions du conseil d’État23.
Même dans le cadre d’un plan de cession, l’employeur doit procéder à un examen spécifique des possibilités de reclassement des salariés protégés non transférés. Dans cette affaire la décision de l’inspecteur du travail autorisant les licenciements avait été annulée par un jugement du tribunal administratif confirmé par la cour d’appel administrative.
Il est rappelé que l’autorité administrative doit s’assurer que l’employeur a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié au sein de l’entreprise puis dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Or, l’administrateur judiciaire avait demandé par lettre circulaire à l’ensemble des entreprises du groupe de communiquer les emplois disponibles dans les autres sociétés du groupe en leur demandant de se fonder sur les informations disponibles sur le personnel.
Puis, l’administrateur avait diffusé aux salariés dont le licenciement était envisagé une liste de postes disponibles dans une entreprise du groupe ainsi qu’au sein de l’entreprise cessionnaire.
Il a été reproché de ne pas avoir procédé à un examen spécifique des possibilités de reclassement. Alors même que le requérant avait refusé de se voir proposer des reclassements hors de France, l’employeur ne pouvait être regardé comme ayant satisfait son obligation de reclassement.
S’il est compréhensible que le reclassement soit examiné avec soin dans les entreprises d’un groupe, l’administrateur a-t-il vraiment la possibilité d’aller au-delà de ce qui a été fait ? La complexité et les délais imposés par le droit social sont-ils compatibles avec les délais de traitement d’une procédure collective ?
Ce vieux débat mériterait d’être approfondi car le droit social, dans sa complexité, les délais imposés, peut constituer une véritable difficulté pour le traitement des difficultés d’une entreprise. Il faudra bien engager une réflexion de fond sur les possibilités de retarder un plan social qui peuvent parfois affecter la pérennité même d’une entreprise…
Rappelons, en ce qui concerne la diffusion collective des offres de reclassement, les dispositions du nouveau décret24.
À la suite de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoyant que l’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés dans les conditions fixées par décret25 sont prévues les conditions dans lesquelles les offres doivent être adressées d’une manière personnalisée.
Les postes disponibles sont situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe. Les délais sont ici indiqués et il convient de s’y reporter26.
Signalons une décision intéressante sur les conditions de couverture par l’AGS qui se montre particulièrement vigilante. Il a été en effet jugé que seules les créances résultant de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’administrateur ou du mandataire judiciaire peuvent être garanties par l’AGS, ce qui peut paraître évident.
Or, en l’espèce, le salarié avait pris acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur et il a donc été jugé que la garantie de l’AGS n’était pas due dans ce cadre. Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle avait considéré que l’indemnité pour travail dissimulé n’avait pas à être garantie par l’AGS27.
La Cour de cassation s’en est donc tenue à une interprétation stricte des articles L. 3253-8 et L. 3253-6 du Code du travail. Procédant par substitution de motifs, la Cour de cassation a considéré que la décision déférée était légalement justifiée.
En ce qui concerne la définition d’un groupe dans le cadre d’un PSE, il convient de se référer à une décision récente du conseil d’État du 7 février 2018 n° 397.900.
Il s’agit des moyens, notamment financiers, dont disposent l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante dans les conditions définies aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce, ce qui paraît transposable pour l’appréciation du caractère suffisant ou proportionnel des mesures du PSE établies par voies de documents unilatérales.
La responsabilité du liquidateur
Un arrêt intéressant a été rendu dans le cadre d’une vente faite par un liquidateur d’appartements en copropriété et de quatre terrains. Il avait été reproché au liquidateur de ne pas avoir appelé l’attention de l’acquéreur sur le risque de valider son offre avant la fin du délai de recours contre le permis de construire.
Les juges du fond avaient condamné le liquidateur à payer des dommages et intérêts et leur décision a été cassée au visa de l’article 1147 du Code civil28. Dans le cadre de la vente de gré à gré, le liquidateur n’est en effet pas tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur29.
Il convient de relever ici le caractère très laconique de la motivation de principe adoptée par la Cour de cassation qui, en trois lignes, fixe cette règle, alors que les arguments des parties étaient particulièrement détaillés et copieux.
Il était pourtant invoqué une violation d’un devoir de bonne foi du liquidateur et il lui était reproché de ne pas avoir ignoré que le projet de construction en état futur d’achèvement et en défiscalisation envisagée par l’acquéreur, était une condition préalable sur les modalités de son offre.
Or, la vente n’avait pas été conclue sous condition que le permis de construire ait acquis un caractère définitif.
Il semble en outre que la société requérante demandait l’annulation de la vente pour vice du consentement et la restitution de l’indemnité d’immobilisation et des dommages et intérêts. Or, le liquidateur avait été condamné sur le fondement de la perte d’une chance, ce qui n’aurait pas été demandé …
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. crim., 22 nov. 2017, n° 16-83549, PB.
-
2.
Cons. const., 29 sept. 2016, n° 2016-573 QPC.
-
3.
Cass. com., 13 sept. 2016, n° 14-10927, D : JCP E 2016, 1536, spéc. n° 41 avec un commentaire par Delattre C. : « Le ministère public : partie principale dont seul le dépôt de la requête est interruptif de prescription doit être présent à l’audience pour soutenir sa demande ».
-
4.
CA Angers, ch. com. A, 2 déc. 2014, n° 13/010253.
-
5.
Cass., avis, 4 avr. 2016, n° 16-70001, n° 16003 : Act. proc. coll. 2016, alerte 138 et repère 129, note Rolland B.
-
6.
Cass. com., 30 janv. 2018, n° 17-20763 : Gaz. Pal. 17 avr. 2018, n° 321j1, p. 72.
-
7.
C. com., art. R. 651-4.
-
8.
Cass. com., 24 janv. 2018, nos 16-20589 et 16-22128, FS-PBI, voir le commentaire de Le Corre P.-M., Lexbase Hebdo n° 731, 15 févr. 2018.
-
9.
Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24586, F-PB : Gaz. Pal. 18 oct. 2016, n° 277e5, p. 63, note Le Corre Broly E. ; Act. proc. coll. oct. 2016, comm. 135, note Petit initiale ; JCP E 2016, 1465, spéc. n° 9, note Petel P. ; RTD com. 2017, p. 190, spéc. n° 8, note Martin Serf A.
-
10.
D. n° 2018-11, 8 janv. 2018 : JO, 10 janv. 2018.
-
11.
Loi précitée, article 122, II.
-
12.
L. 10 juill. 1965, art. 29-4, III.
-
13.
D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 62-18-1, al. 2 et 4.
-
14.
Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-18795, n° 40, PB : voir « Organes de la procédure 13 février 2018 », note Vallens J.-L.
-
15.
C. com., art. R. 621-21.
-
16.
C. com., art. R. 641-32.
-
17.
Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-23607, F-PBI : Lexbase Hebdo, n° A 6989 XK3.
-
18.
Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-21701, n° 55, PBI.
-
19.
Note Rémery J.-P. sous Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-50033, n° 118, F-PBI : « liquidation judiciaire », 6 févr. 2018 ; Gaz. Pal. 17 avr. 2018, n° 321n0, p. 71.
-
20.
Cass. com., 13 déc. 2017, n° 13-24057, n° 1488, PB.
-
21.
C. civ., art. 2037 devenu C. civ., art. 2314, modifié par Ord. n° 2016-346, 23 mars 2006.
-
22.
Cass. com., 26 oct. 1999, n° 96-16837, PB.
-
23.
CE, 22 déc. 2017, nos 391692, 391694, 391697 et 391708.
-
24.
D. n° 2017-1725, 21 déc. 2017 : JO, 22 déc. 2017.
-
25.
D. n° 2017-1725, 21 sept. 2017.
-
26.
Note Morand M., 16 janv. 2018.
-
27.
Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-19517, n° 2694, F-PB.
-
28.
C. civ., art. 1217.
-
29.
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-20675, n° 1356, FS-PBI : Gaz. Pal. 17 avr. 2018, n° 321j0, p. 68.