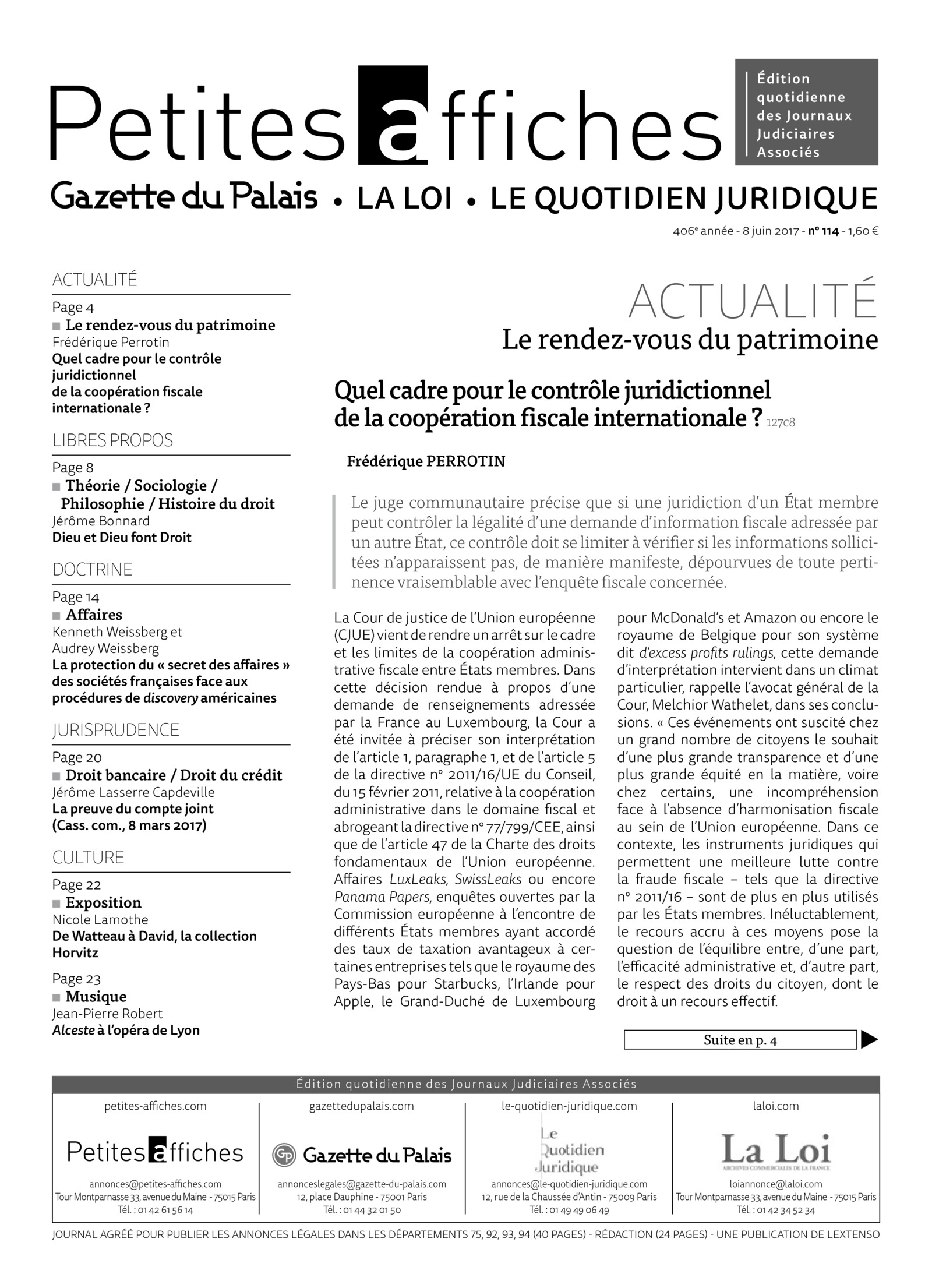La protection du « secret des affaires » des sociétés françaises face aux procédures de discovery américaines
Où en est l’application du « French blocking statute » (dite « loi de blocage ») ? Retour sur la loi de 1968, toujours en vigueur en France, promulguée pour permettre aux sociétés françaises de protéger leurs secrets d’affaires lors des procédures de discovery américaines conduites en dehors des conventions internationales. Bilan et perspectives.
La procédure de common law dite de « pre-trial discovery of documents » constitue la pierre angulaire de la procédure civile et commerciale aux États-Unis. Elle permet en effet au demandeur, dans le cadre d’une action en justice, d’avoir accès à un certain nombre de documents et d’informations détenus par le défendeur, et ce, afin de prouver et démontrer le bien-fondé de ses prétentions. Fortement utilisée en matière économique et financière, cette pratique résulte du caractère accusatoire de la procédure de Common law, dans laquelle chaque partie se doit de constituer ses propres preuves.
Cette procédure de discovery a beaucoup fait parler d’elle dans l’Hexagone, en particulier car elle a donné lieu, dans la pratique, à de nombreux abus menaçant les secrets de production de sociétés françaises confrontées à des procédures outre-Atlantique. En effet, dans le cadre de procédures engagées sur le sol américain à l’encontre de filiales ou d’établissements d’entreprises françaises, des sociétés américaines ont ainsi demandé à avoir accès à des informations stratégiques, leur permettant par la suite de fragiliser, voire de contrefaire leurs concurrentes, alors même que ces informations n’étaient pas indispensables à la bonne résolution de la procédure judiciaire en cours.
De tels abus menaçant de conduire à l’affaiblissement de grandes entreprises françaises puis, plus largement, de la puissance économique et de la souveraineté nationale, le législateur a souhaité réagir en instaurant, dès 1968, une législation à la fois préventive et répressive, dénommée outre-Atlantique le « French blocking statute » (I). Cependant, malgré l’élargissement de cette loi dès 1980, l’échec de ce dispositif est patent : en dépit de plusieurs tentatives, le texte est toujours inchangé et reste inefficace en l’état (II).
I – Le « French blocking statute »
La loi du 26 juillet 1968, étendue en 1980, a instauré un cadre législatif se voulant protecteur des intérêts économiques et des secrets industriels français (A). Pourtant, près de cinquante ans après sa création, le texte n’a reçu qu’une seule application (B).
A – Le contenu des lois du 26 juillet 1968 et du 16 juillet 1980
Promulguée en 1968 et destinée initialement à protéger les entreprises maritimes françaises contre des demandes des autorités administratives américaines, la loi du 26 juillet 1968 disposait, en son article 1er :
« Art. 1 – II est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d’une personne morale de droit privé y ayant son siège ou un établissement, de communiquer, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements relatifs aux transports par mer définis par arrêté du ministre chargé de la Marine marchande. Ces renseignements et documents sont ceux dont la communication à une autorité étrangère serait contraire aux règles du droit international ou de nature à porter atteinte à la souveraineté de l’État français. »
Ainsi, le champ d’application du texte, déjà très large, était limité par son domaine d’activité (maritime), la partie à laquelle il pouvait être opposé (autorité publique étrangère) et la nature du renseignement (contraire au droit international ou de nature à porter atteinte à la souveraineté de l’État français).
En 1970, afin d’améliorer la coopération judiciaire civile et commerciale entre les États, et pour faciliter, en particulier, les échanges entre les systèmes de tradition romano-germanique et les systèmes de common law, la Convention de La Haye du 18 mars 1970 fut adoptée. Selon cette convention toujours en vigueur, toute commission rogatoire émanant d’une juridiction étrangère doit être communiquée à une autorité centrale (en France, il s’agit du ministère de la Justice), qui s’assure de la bonne exécution de celle-ci. En théorie, aucun contrôle judiciaire ni politique ne peut intervenir. Cependant, l’article 23 de la Convention prévoit qu’il est possible, pour les États signataires, de formuler une réserve concernant la procédure de « pre-trial discovery of documents », afin d’éviter les abus. La France avait prévu une telle réserve, imposant, dans ce type de procédure, qu’un contrôle du juge soit opéré pour s’assurer que la requête en question n’était pas abusive au regard de l’objet du litige. Afin de contourner un tel contrôle, les États-Unis ont persisté à transmettre certaines de leurs demandes en dehors des procédures prévues par ladite convention.
Dix ans plus tard, en 1980, le champ d’application de la loi de blocage de 1968 a été remanié, afin d’élargir encore davantage son action et de s’assurer du respect de la Convention de La Haye de 1970. Depuis cette date, l’article 1er est rédigé ainsi :
« Sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d’une personne morale y ayant son siège ou un établissement de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public, précisés par l’autorité administrative en tant que de besoin ».
Sont désormais visés tous les domaines d’activité et non plus seulement le domaine maritime. Quant à la nature des renseignements et documents concernés par le dispositif, celle-ci concerne désormais toute information portant atteinte non seulement à la souveraineté, mais aussi à la sécurité, à l’ordre public et « aux intérêts économiques essentiels de la France ». Une précision est cependant apportée quant aux caractéristiques des renseignements : ceux-ci doivent être d’ordre économique, financier, industriel, technique ou commercial.
Enfin, le texte prévoit désormais que le dispositif n’est applicable que « sous réserve des traités ou accords internationaux ». L’objectif est donc de s’assurer que la transmission de ces informations respecte les exigences du droit international, en particulier de la Convention de La Haye de 1970.
La réforme, en 1980, de la loi de 1968 va même plus loin puisqu’elle conduit à ajouter un nouvel article 1er bis qui dispose :
« Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci ».
Le texte désigne désormais « toute personne » – indépendamment de sa nationalité ou de son lieu de résidence – et le simple fait de « demander, rechercher ou communiquer » des informations. La limitation de ce texte aux cas de « constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères » vise implicitement mais de manière on ne peut plus claire les procédures de discovery.
Enfin, obligation est faite aux personnes concernées par les deux articles précités d’informer sans délai le ministre compétent de toute situation dans lesquelles elles pourraient se trouver contraintes de livrer de telles informations (art. 2 de loi). Pour assurer une effectivité de ces dispositions, le législateur a prévu de punir la violation de celles-ci par une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 18 000 €1 (art. 3).
B – L’unique application de la loi du 16 juillet 1968, conséquence logique des objectifs poursuivis par le dispositif
Rédigé de manière à toucher un panel de situations aussi vaste que possible, ce texte poursuit un double objectif : d’abord, protéger les intérêts économiques et industriels français en empêchant leurs détenteurs de les transmettre à des puissances étrangères ; ensuite, s’assurer que les demandes découlant de procédures judiciaires ou administratives étrangères respectent bien les exigences posées par la Convention de La Haye de 1970.
La teneur des débats parlementaires de 19802 révèle clairement que l’esprit de la loi visait non pas à conduire à la condamnation d’entreprises françaises déjà confrontées à des procédures à l’étranger, mais bien à leur permettre de résister aux demandes de documents et d’informations économiques requises par la partie adverse étrangère et « d’exciper une excuse légale pour refuser de communiquer aux autorités investigatrices les documents dont le contenu aurait pu servir de fondement à d’éventuelles discriminations » (rapport de l’Assemblée nationale). Dès lors, il n’est pas étonnant que le dispositif n’ait donné lieu qu’à une seule application, dans l’affaire Executive Life, près de quarante ans après sa création3.
Dans cette affaire, une banque française avait racheté une compagnie d’assurance américaine aux États-Unis. Dans le cadre d’une procédure engagée par les autorités américaines – en l’occurrence, par le gendarme des assurances – mettant en doute la légalité de ce rachat, un avocat français avait été chargé de solliciter des informations de la part de la société française afin de constituer des preuves de l’illégalité de l’opération. Poursuivi en France pour violation de la loi du 26 juillet 1968, l’avocat s’était vu condamné en première instance comme en appel, ces décisions étant confirmées par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 12 décembre 2007.
II – L’inefficacité du dispositif
L’impuissance des dispositions législatives s’explique à deux niveaux : au niveau international, d’abord, en raison du manque de crédibilité du dispositif et du refus de certains États d’appliquer exclusivement la Convention de La Haye (A) ; au niveau national, ensuite, en raison de lacunes législatives et administratives que différents projets et propositions de loi ne sont pas parvenus à combler (B).
A – Le manque de crédibilité des dispositions françaises à l’international
Les autorités d’investigation étrangères, au premier rang desquelles les juges américains n’ont eu aucun scrupule à refuser toute défense aux entreprises françaises se prévalant du « French blocking statute » pour s’opposer à la communication des documents requis : tel fut notamment le cas dans l’affaire Aérospatiale, dans laquelle la juridiction américaine a refusé d’excuser l’entreprise française au motif que la loi du 26 juillet 1968 « inspirée par la préoccupation d’empêcher l’application de la législation antitrust des États-Unis (…) ne semblait pas avoir été strictement appliquée en France »4. L’absence d’application de cette loi en France anéantissant tout risque pour la société française de se voir condamnée pour avoir divulgué des informations dans le cadre d’une procédure étrangère, la société ne pouvait donc pas valablement opposer cette loi pour refuser la transmission des informations demandées.
La jurisprudence de 2007 constituant la première application pénale de cette loi répressive datant de 1968, la doctrine américaine n’a pas manqué de voir dans cette affaire un durcissement de la position française à l’égard des procédures de discovery : comme l’écrivait un auteur américain le 29 avril 2008, la France renforce sa loi de blocage (« France puts some muscle behind its blocking statute », dans le New York law journal). Certains ont pu voir également un éclaircissement des exigences françaises en matière de procédure de discovery. Comme le remarquait le Texas international law journal5, la Cour de cassation semblait ici exiger que toute recherche, demande, ou communication d’informations visées par la loi de 1968 passe désormais nécessairement par la procédure prévue dans la Convention de La Haye, un manquement à cette procédure exposant le contrevenant à une condamnation pénale en vertu de l’article 3 de la loi précitée.
Ce dernier point est l’un des fondements du problème : la France considère que les procédures de coopération prévues par la Convention de La Haye sont exclusives, les demandes de transmission d’informations devant impérativement les respecter. Or, comme on l’a vu, la France a émis une réserve à la Convention de La Haye, en se réservant le droit de contrôler la commission rogatoire émanant d’une procédure de discovery pour s’assurer que celle-ci n’est pas abusive. Si la France a accepté, dès 1986, de réduire l’étendue de ce contrôle qui ne s’applique désormais plus « lorsque les documents demandés sont limitativement énumérés dans la commission rogatoire et ont un lien direct et précis avec l’objet du litige », les États-Unis ont continué à voir dans cette réserve, un frein à la coopération judiciaire. Ils n’acceptent donc pas toujours de passer par ces procédures, empêchant alors le contrôle juridictionnel prévu par la France.
B – Les lacunes nationales, l’échec des tentatives de réforme de 2012 et 2015 et le recours à la directive européenne n° 2016/943
Les limites de la loi de blocage française s’expliquent d’une part, par des lacunes juridictionnelles, et d’autre part, par des faiblesses législatives. Ces imperfections n’ont toujours pas été corrigées, malgré plusieurs tentatives de réformes.
Du point de vue juridictionnel, il arrive fréquemment que le parquet refuse de poursuivre la violation de la loi de 1968. Outre le cas où la poursuite serait contre-productive en ce qu’elle conduirait à la condamnation d’une entreprise française déjà engagée dans une procédure à l’étranger, l’absence de poursuite s’explique par la crainte de voir lesdites poursuites sans effet, l’infraction étant très difficilement caractérisable en raison de ses éléments constitutifs trop peu précis.
En effet, malgré un champ d’application particulièrement large, les dispositions législatives contenues dans la loi de blocage manquent de clarté : le contenu des informations protégées et la notion de secret des affaires ne sont pas définis dans la législation française. Or pour assurer l’effectivité d’une incrimination pénale, il est nécessaire de circonscrire précisément les éléments constitutifs d’une telle infraction.
D’autres infractions, telles que le vol, l’abus de confiance, la divulgation du secret de fabrique, la violation du secret des correspondances, ou encore la violation du secret professionnel constituent des infractions potentiellement applicables à la violation du secret des affaires. Elles sont cependant trop spécifiques ou insuffisamment répressives pour assurer une protection générale et efficace.
Ces faiblesses ont fait l’objet d’une première tentative de correction en 2012, via la proposition de loi de Bernard Carayon visant à « sanctionner la violation du secret des affaires ». Le texte proposait de créer une définition du secret des affaires et un délit de violation du secret des affaires précisément défini, et de réformer l’article 1er bis de la loi de 1968 (créé en 1980). Votée en première lecture par l’Assemblée nationale le 23 janvier 2012, la loi n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour du Sénat, en raison d’une période électorale peu propice à ce type de débat.
En 2015, à l’occasion de l’étude, par l’Assemblée nationale, de la loi Macron, une nouvelle tentative a eu lieu via un amendement parlementaire qui reprenait une proposition de loi déposée quelques mois plus tôt par le président de la Commission des lois. Sous la pression des médias, inquiets de voir leur liberté d’information potentiellement restreinte, l’amendement est finalement retiré.
Aucune évolution législative nationale n’a donc eu lieu depuis la décision de 2007.
Toutefois, la directive européenne n° 2016/943 du 8 juin 2016, adoptée à une large majorité par le Parlement européen, instaure, quant à elle, un dispositif complet de secret des affaires au niveau européen. Concernant plus spécifiquement la procédure de blocage, elle prévoit, en son article 9 alinéa 1er, que les États membres devront, au minimum, veiller « à ce que les parties, leurs avocats ou autres représentants, le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure judiciaire relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires (…) ne soient pas autorisés à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d’une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont ils ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès (…).
L’obligation visée au premier alinéa perdure après la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, elle cesse d’exister dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il est constaté, dans une décision définitive, que le secret d’affaires allégué ne remplit pas les conditions prévues à l’article 2, point 1) ; ou
b) les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement de ce genre d’informations, ou sont devenues aisément accessibles à ces personnes ».
Il est également prévu par la directive, au deuxième alinéa de l’article 9, que « les États membres veillent également à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande dûment motivée d’une partie, prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d’une procédure judiciaire relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires. Les États membres peuvent aussi permettre aux autorités judiciaires compétentes de prendre de telles mesures d’office. Les mesures visées au premier alinéa incluent au moins la possibilité :
a) de restreindre à un nombre limité de personnes l’accès à tout ou partie d’un document contenant des secrets d’affaires ou des secrets d’affaires allégués, produit par les parties ou par des tiers ;
b) de restreindre à un nombre limité de personnes l’accès aux audiences, lorsque des secrets d’affaires ou des secrets d’affaires allégués sont susceptibles d’y être divulgués, ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience ;
c) de mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant partie du nombre limité de personnes visées aux points a) et b) une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés ».
Ainsi, la directive européenne se contente de fixer des objectifs minimum à respecter. Rien n’empêchera donc le législateur français de renforcer les dispositifs prévus par la directive lors de sa transposition en droit interne. Celle-ci devra intervenir au plus tard le 9 juin 2018.
ANNEXES
Article 37 (f) des règles fédérales de procédure civile :
« Failure to Participate in Framing a Discovery Plan. If a party or its attorney fails to participate in good faith in developing and submitting a proposed discovery plan as required by Rule 26(f), the court may, after giving an opportunity to be heard, require that party or attorney to pay to any other party the reasonable expenses, including attorney’s fees, caused by the failure ».
Titre 28, section 1782, du US Code :
« (a) The district court of the district in which a person resides or is found may order him to give his testimony or statement or to produce a document or other thing for use in a proceeding in a foreign or international tribunal, including criminal investigations conducted before formal accusation. The order may be made pursuant to a letter rogatory issued, or request made, by a foreign or international tribunal or upon the application of any interested person and may direct that the testimony or statement be given, or the document or other thing be produced, before a person appointed by the court. By virtue of his appointment, the person appointed has power to administer any necessary oath and take the testimony or statement. The order may prescribe the practice and procedure, which may be in whole or part the practice and procedure of the foreign country or the international tribunal, for taking the testimony or statement or producing the document or other thing. To the extent that the order does not prescribe otherwise, the testimony or statement shall be taken, and the document or other thing produced, in accordance with the Federal Rules of Civil Procedure.
A person may not be compelled to give his testimony or statement or to produce a document or other thing in violation of any legally applicable privilege.
(b) This chapter does not preclude a person within the United States from voluntarily giving his testimony or statement, or producing a document or other thing, for use in a proceeding in a foreign or international tribunal before any person and in any manner acceptable to him ».
Article 9 de la directive européenne n° 2016/943 du 8 juin 2016
« 1. Les États membres veillent à ce que les parties, leurs avocats ou autres représentants, le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure judiciaire relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires, ou ayant accès à des documents faisant partie d’une telle procédure, ne soient pas autorisés à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d’une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont ils ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès. À cet égard, les États membres peuvent aussi permettre aux autorités judiciaires compétentes d’agir d’office.
L’obligation visée au premier alinéa perdure après la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, elle cesse d’exister dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il est constaté, dans une décision définitive, que le secret d’affaires allégué ne remplit pas les conditions prévues à l’article 2, point 1) ;
b) les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement de ce genre d’informations, ou sont devenues aisément accessibles à ces personnes.
2. Les États membres veillent également à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande dûment motivée d’une partie, prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d’une procédure judiciaire relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires. Les États membres peuvent aussi permettre aux autorités judiciaires compétentes de prendre de telles mesures d’office.
Les mesures visées au premier alinéa incluent au moins la possibilité :
a) de restreindre à un nombre limité de personnes l’accès à tout ou partie d’un document contenant des secrets d’affaires ou des secrets d’affaires allégués produit par les parties ou par des tiers ;
b) de restreindre à un nombre limité de personnes l’accès aux audiences, lorsque des secrets d’affaires ou des secrets d’affaires allégués sont susceptibles d’y être divulgués, ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience ;
c) de mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant partie du nombre limité de personnes visées aux points a) et b) une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés.
Le nombre de personnes visées au deuxième alinéa, points a) et b), n’est pas supérieur à ce qui est nécessaire pour garantir aux parties à la procédure judiciaire le respect de leur droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et il comprend, au moins, une personne physique pour chaque partie et l’avocat de chaque partie ou d’autres représentants de ces parties à la procédure judiciaire.
3. Lorsqu’elles se prononcent sur les mesures visées au paragraphe 2 et évaluent leur caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que l’octroi ou le refus de ces mesures pourrait causer à l’une ou l’autre des parties et, le cas échéant, à des tiers.
4. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3 est effectué conformément à la directive n° 95/46/CE ».
Notes de bas de pages
-
1.
Ou de 90 000 € pour les personnes morales en vertu de l’article 131-38, alinéa 1er du Code pénal.
-
2.
On pourra se référer aux débats parlementaires devant l’Assemblée nationale du 24 juin 1980.
-
3.
Cass. crim., 12 déc. 2007, n° 07-83228.
-
4.
Revue critique de droit international privé, 1988, p. 559, note Dyer A.
-
5.
« The French blocking statute », Texas international law journal, vol. 50, 2014.