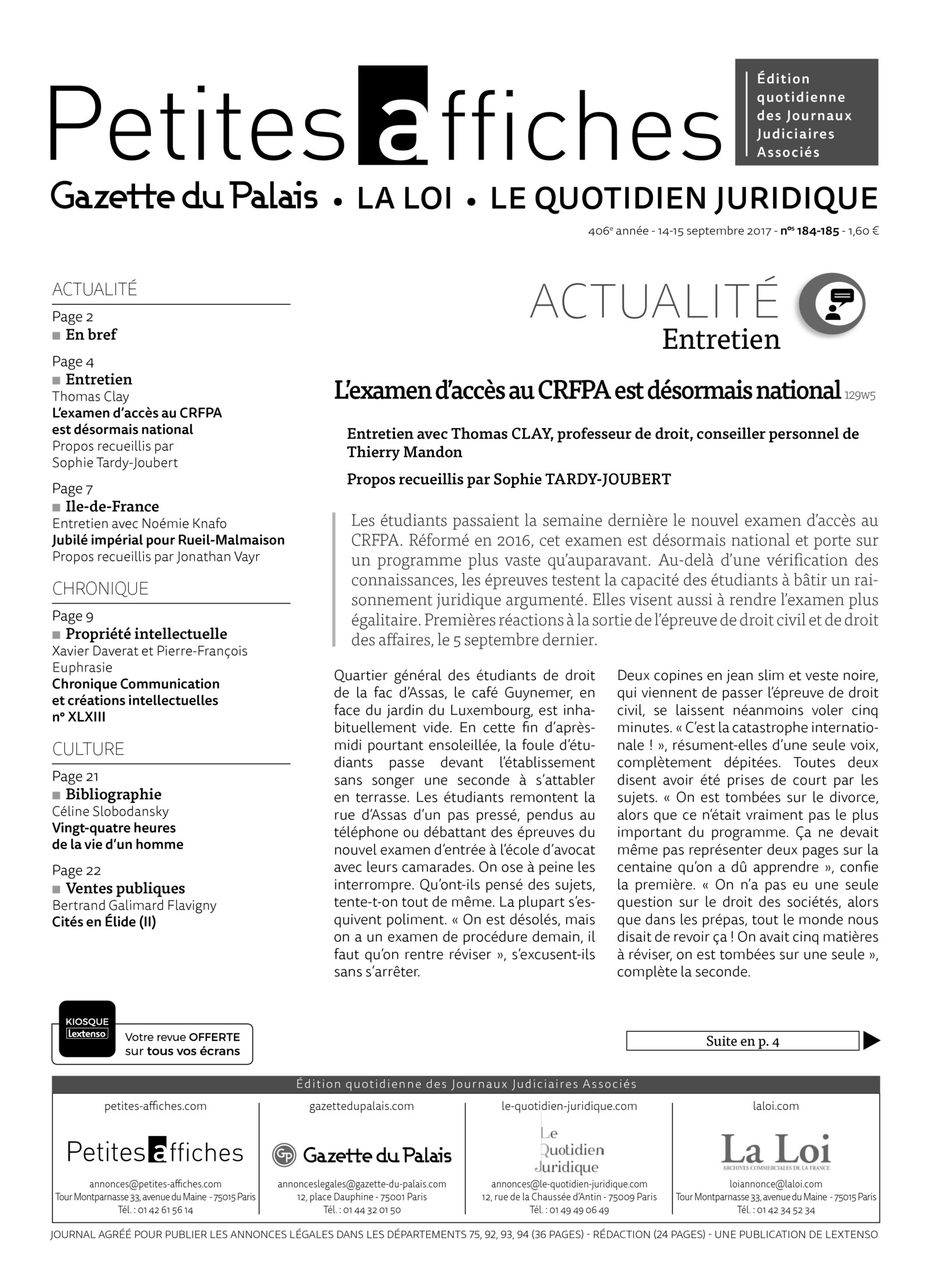Chronique Communication et créations intellectuelles n° XLXIII
I – Propriété littéraire et artistique et droit du patrimoine
L’échec aux prétentions des inventeurs de la « grotte Chauvet »
Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-17301, Chauvet & a. c/ Metropolitan Filmexport & a. La découverte, le 18 décembre 1994, de la grotte Chauvet, comme on a pris l’habitude de la désigner par référence au nom de l’un de ses inventeurs, a constitué un événement majeur. Après la déclaration de découverte, et l’inscription de la grotte par l’État à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques1, de nombreux contentieux ont vu le jour.
Il y eut d’abord une condamnation de deux fonctionnaires du ministère de la Culture par le tribunal correctionnel de Lyon, le 18 juin 1999, pour faux en écriture publique. Les spéléologues ayant agi sous la direction de Jean-Marie Chauvet, agent non titulaire au service régional d’archéologie de la direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes, sur le fondement des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques, loin d’avoir été réalisées pour le compte d’un employeur public, la découverte était le fait de personnes extérieures au service et de l’agent non titulaire durant un week-end, hors de toute mission et de tout cadre professionnel2.
Les différends les plus vifs ont été relatifs au droit des propriétaires des terrains. Outre que la revendication de la propriété des terrains au-dessous desquels se trouve la grotte a donné lieu à un développement judiciaire3, ce sont les contentieux sur l’expropriation pour cause d’utilité publique qui ont retenu l’attention4. Ceux-ci ont même été couronnés par un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme considérant que l’État n’avait pas outrepassé sa marge d’appréciation et que, s’écartant de la stricte valeur marchande des biens, les expropriés avaient obtenu une somme raisonnablement en rapport avec la valeur des biens dont ils avaient été dépossédés5.
Le droit de propriété de l’État avait également été contesté, par une revendication de la propriété réelle de la grotte et des droits de propriété intellectuelle sur la découverte ; mais l’assignation « de l’État, représenté par le ministre de la Culture », a abouti à une décision d’irrecevabilité dans la mesure où l’administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant le droit de propriété et les droits réels de l’État6.
Naturellement, des litiges autour de l’exploitation du site sont intervenus. Ce fut le cas, d’abord, dans une affaire visant l’utilisation des images de la grotte par une agence de communication7, puis autour d’un film documentaire, objet de la décision qui est ici commentée. Le réalisateur allemand Werner Herzog a, en effet, obtenu de la part du ministère de la Culture et de la Communication, l’autorisation de tourner dans la grotte Chauvet pour réaliser La Grotte des rêves perdus8. Les inventeurs ont alors agi en justice, n’obtenant gain de cause ni devant les juges du fond9 ni devant la première chambre civile qui, dans l’arrêt rapporté10, rejette le pourvoi interjeté tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui de l’inventeur.
I. Invocation du droit d’auteur
La revendication sur le fondement du droit d’auteur était double. D’un côté, était invoqué le droit exclusif que l’article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît à ceux qui publient ou font publier les œuvres posthumes, dont se prévalaient les demandeurs en l’appliquant aux œuvres pariétales. D’un autre côté, plus classiquement, ces derniers agissaient en vertu du droit d’auteur sur les photographies qu’ils avaient réalisées.
A. La divulgation de l’œuvre
Les textes reconnaissent un droit exclusif à celui qui effectue la publication posthume d’une œuvre. La directive n° 93/98 CEE11 désigne comme bénéficiaire du monopole « toute personne qui, après l’extinction de la protection du droit d’auteur, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une œuvre non publiée auparavant »12. L’article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle, pour sa part, investit du droit de procéder à cette publication les « propriétaires, par succession ou par d’autres titres, de l’œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication ».
Apparaît immédiatement un hiatus, le texte européen liant le bénéfice du monopole au seul acte de publication, tandis que le droit national requiert que l’acte de publication soit effectué par le propriétaire de l’œuvre. Ajoutons que la jurisprudence avait surenchéri, précisant, dans un litige entre une bibliothèque et l’éditeur de l’ouvrage d’un chercheur auquel avaient été remises des copies de textes inédits de Jules Verne, que l’article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle visait le propriétaire de l’original et non de simples copies « établies et remises sans intention de transmettre le droit d’exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux »13. Curieux processus dans lequel la loi ajoute à la directive et la jurisprudence à la loi…
Il était donc tentant de se référer à la directive pour dire que la loi française n’était pas conforme au texte européen, argument que la cour de Paris avait balayé, au motif que « le législateur français avait la faculté de poser, comme il l’a fait, une condition supplémentaire à l’octroi de la protection particulière qu’il accordait à ce bénéficiaire du droit d’exploitation », rejoignant ce qu’avait dit la cour de Nîmes14. On peut d’ailleurs ajouter que la loi s’écarte également du texte de la directive lorsqu’elle prévoit un double régime de publication posthume, par les ayants-droit de l’auteur tant que l’œuvre n’est pas tombée dans le domaine public, puis par les propriétaires de l’œuvre après l’expiration de la durée des droits patrimoniaux, ainsi qu’il est dit plus haut ; or, la directive ne vise que la situation « après l’extinction de la protection du droit d’auteur ». On regrette très vivement que la Cour de cassation ait purement et simplement esquivé le débat sur ce point. L’État étant propriétaire de la grotte du fait de la procédure d’expropriation, les inventeurs ne pouvaient tirer parti de l’article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle.
La Cour raisonne, en revanche, de façon assez précise, sur le régime de l’œuvre posthume, généralement considérée comme celle qui n’a pas été divulguée du vivant de l’auteur. Ainsi qu’on peut le lire en détail dans la décision, la première chambre civile donne raison à la cour d’appel qui a considéré que, les peintures s’étant échelonnées sur une période de 5 000 ans, et la grotte portant des traces d’occupations successives, notamment à des fins rituelles, corroborées par les datations au carbone 14, une divulgation des œuvres était bien intervenue avant l’obstruction de la grotte. La découverte de celle-ci ne constituait donc pas une première divulgation, et comme le droit de divulgation s’épuise dès la première utilisation que l’on en fait15, les intéressés ne pouvaient s’en prévaloir. Dit autrement, la mise au jour de vestiges (qui seraient des œuvres de l’esprit) n’est pas une divulgation posthume dès lors que ceux-ci ont fait manifestement, jadis, l’objet d’une communication au public… Peu importe, ainsi que le soutenaient les demandeurs, qu’un acte clairement identifiable soit venu corroborer la volonté de divulguer de la part des auteurs. En l’espèce, la preuve d’une occupation humaine suffit pour admettre la divulgation.
B. Le droit sur les photographies
Les demandeurs n’ont pas plus obtenu gain de cause s’agissant des droits revendiqués sur les photographies qu’ils avaient prises : l’originalité de leurs clichés n’est pas retenue du fait d’une « approche générale » et à défaut d’« identifier les caractéristiques des œuvres qui les rendraient éligibles à la protection par le droit d’auteur ». Si « les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie »16 sont citées parmi les œuvres protégeables, il n’en demeure pas moins qu’elles doivent souscrire à la condition générale d’originalité17. La directive du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation et à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins évoque « les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur » (art. 6), en ajoutant cette précision selon laquelle « aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection ». La Cour de justice de l’Union européenne a fait application de cette disposition18 avant de préciser que l’originalité s’entendait de « choix libres et créatifs » en détaillant quelques critères, dont certains sont habituels – choix de mise en scène, de pose, d’éclairage, de cadrage – tandis que l’allusion aux techniques de développement ou de logiciel est plus singulière19.
On voit bien ici quelle est la relativité de la présomption d’originalité pour des œuvres qui seraient au nombre de celles citées par la loi, l’auteur des photographies suspectées d’être utilisées sans autorisation devant justifier de l’originalité de ses clichés. Il aurait donc fallu entrer dans le détail de ce qui paraissait fonder l’originalité des images, au-delà d’une simple reproduction servile des détails de la grotte, soit, pour prendre quelques exemples jurisprudentiels : le choix de la pose du sujet, l’angle de prise de vue, l’éclairage20, l’objectif et le temps d’exposition21, la mise en valeur des objets, l’environnement ou la tonalité des fonds22, la qualité des contrastes de couleurs, le choix de l’objectif ou celui du tirage le plus adapté23, etc.
II. Invocation du droit de l’inventeur
La décision évoque à la fois l’application de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et les termes d’un accord passé avec l’État.
A. Les dispositions légales relatives à la propriété du dessous
Les inventeurs revendiquaient l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive24. En effet, selon l’article 13 de ladite loi, qui ajoutait un article 18-1 à la loi du 27 septembre 1941 (l’historique loi Carcopino), est écartée la présomption de l’article 522 du Code civil selon laquelle « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » et sur laquelle veillait la jurisprudence25, permettant au propriétaire de « faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir ». Au contraire, comme il est fait exception aux dispositions précitées du Code civil en matière de vestiges archéologiques immobiliers26, c’est l’État qui est considéré comme propriétaire des vestiges découverts. C’est là, ni plus ni moins, une expropriation à peine déguisée, la loi attribuant à l’État la propriété des vestiges sans avoir à utiliser la procédure d’expropriation : inutile de dire combien les péripéties judiciaires engendrées par la découverte de la grotte Chauvet ont conditionné l’intervention du législateur…
À compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de 2001, les propriétaires du sol ne peuvent donc se prévaloir de la présomption de propriété du sous-sol que l’article 552 du Code civil édicte au profit du propriétaire du sol ; cependant, on ne prévoit pas pour autant de présomption de propriété des vestiges immobiliers au bénéfice d’une personne publique puisque le législateur a prévu que le propriétaire du fonds puisse apporter la preuve de cette qualité2728… Soit, en fin de compte, un retournement de la présomption de « propriété du dessous » qui permet d’éviter le grief de privation d’un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que, sans doute, le risque d’une inconstitutionnalité29. Le mécanisme est subtil puisqu’il n’est pas dit péremptoirement que les vestiges appartiennent à l’État, mais il y a fort peu de chances que la revendication d’un droit de propriété sur le dessous puisse intervenir. La question n’a même pas été débattue lors du contrôle de constitutionnalité de la loi de 2001, faute d’avoir invoqué ce grief et dans la mesure où le Conseil constitutionnel a indiqué qu’il n’y a pas lieu à soulever d’office une question de conformité à la Constitution30. Il a même été décidé par la suite que, avec le dispositif issu de la loi de 2001, l’objectif d’intérêt général de préservation du patrimoine archéologique était concilié avec divers principes constitutionnels, parmi lesquels le droit de propriété31.
Les textes hérités de la loi de 2001 disposaient également : « Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du vestige. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État »32. En 2001, les dispositions nouvelles introduisaient ainsi une indemnité ou un intéressement de l’inventeur d’un bien immobilier qui, jusqu’alors, n’existait pas, à la différence du régime applicable aux inventeurs de biens mobiliers.
La cour d’appel avait considéré que la loi de 2001 n’était pas rétroactive et ne devait pas s’appliquer à une découverte intervenue en 1994, ce qu’entérine purement et simplement la Cour de cassation. Une application limpide des principes hérités de la loi de 2001 peut être relevée à propos de la grotte de Vilhonneur, dans une décision rappelant qu’est inapplicable aux vestiges archéologiques la présomption de propriété du sous-sol que l’article 522 du Code civil établit au profit du propriétaire du sol et que ceux qui deviennent, à compter de sa promulgation, propriétaires du sol ne peuvent revendiquer la propriété de tels vestiges ; au contraire, ces dispositions ne sauraient s’appliquer aux personnes qui étaient propriétaires du sol antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 200133. En revanche, il convient de respecter le principe d’application immédiate de la loi nouvelle, comme le dit une décision rendue à propos de la grotte Cosquer : « En dehors des situations nées d’un contrat, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets des situations juridiques qui ne sont pas encore définitives ; (…) M. Cosquer, qui a découvert la grotte préhistorique qui porte son nom le 3 septembre 1991, ne demande pas que les dispositions législatives et réglementaires précitées, en vigueur à compter du 1er février 2002, lui soient appliquées rétroactivement ; (…) il demande, en revanche, qu’elles lui soient appliquées à compter de leur entrée en vigueur, pour l’avenir ; (…) le ministre de la Culture ne soutient pas que la grotte découverte par M. Cosquer n’ait pas donné lieu à exploitation ; (…) celle-ci peut se prolonger dans le temps au-delà de cette date ; (…) le ministre de la Culture, saisi sur le fondement de l’article 51 susmentionné, était, le 9 septembre 2003, légalement tenu d’évaluer, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, l’importance de la découverte archéologique de M. Cosquer34 ».
B. Les dispositions conventionnelles relatives à la valorisation du site
Un accord entre l’État et les inventeurs avait été passé le 15 février 2000, aux termes duquel il était stipulé : « L’État, dans l’exercice de ses responsabilités, notamment avec le département de l’Ardèche, veillera à ce que les inventeurs soient convenablement associés à la valorisation du site, et en particulier au futur espace de restitution ». Les inventeurs considéraient que la réalisation du documentaire avait été entreprise sans leur autorisation et sans que les conditions financières de celle-ci aient été arrêtées et que l’autorisation de tournage donnée par l’État devait être subordonnée à la conclusion d’un accord entre le producteur et les inventeurs en fixant les modalités de rémunération de ce dernier. La Cour de cassation ne leur a pas donné gain de cause et entérine encore l’arrêt d’appel sur ce point. Il est considéré, d’une part, que la stipulation n’exigeait pas une autorisation de tournage de la part des inventeurs, assortie de rémunération et, d’autre part, que la proposition financière faite par le producteur aux intéressés, qui n’avaient pas donné suite, suffisait à remplir l’association de ceux-ci à la valorisation du site.
Le présent arrêt permet de mettre l’accent sur les dispositions qui, dans les conventions établies par les personnes publiques et notamment visant des activités culturelles ou artistiques, ont plus tendance à relever de déclarations d’intention qu’elles ne se veulent très précises pour évoquer des situations susceptibles de voir le jour. S’engager à être « convenablement associés à la valorisation » est très vague, cependant que, en citant le « futur espace de restitution » du site, on visait la réplique de la grotte sans envisager tout ce qui découle de l’exploitation de la réplique elle-même et des autres formes d’exploitation. Certes, l’allusion à cet espace étant évoquée « en particulier », on conçoit que les signataires de l’accord entendaient ouvrir l’association des inventeurs aux autres formes d’exploitation. Mais la précision dans les stipulations contractuelles n’aurait pas été inutile. Point n’est pourtant besoin d’être devin pour inventorier à l’avance les vecteurs de valorisation du site : réalisation de documentaires (comme en l’espèce), mais aussi de supports (ouvrages, produits multimédias, jeux…) et plates-formes de communication (sites), outils et programmes de médiation culturelle, produits dérivés et merchandising, voire utilisation des modèles numériques de la grotte d’origine nécessairement réalisés pour l’exécution de la réplique et qui peuvent servir à d’autres fins (restitutions virtuelles hors site, fabrication de produits dérivés…), etc. Cela dit, très cyniquement, on constate que le fait d’être demeuré dans le vague a bien servi les intérêts de l’État, la décision commentée venant entériner une lecture très libérale par la cour d’appel de l’énoncé des droits des inventeurs, participant à sa manière de l’appropriation générale des droits sur un site archéologique par la puissance publique.
Xavier Daverat
II – Propriété littéraire et artistique
A – Droit moral
Rappel de l’inaliénabilité du droit au nom
Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-22723. Voici une décision35 qui renseigne sur l’imagination parfois déployée pour s’approprier les droits d’un auteur… Une agence de publicité, VIe jour, aux droits de laquelle se trouvait la société Maetva, avait confié à la société Gris Line studio la réalisation de photographies destinées à illustrer le catalogue édité par la société Pierre X. Considérant que les photographies avaient été reproduites sans autorisation sur d’autres supports, la société Gris Line studio a assigné en contrefaçon la société Pierre X, laquelle a appelé en garantie la société Maetva. Les juges du fond, tant en première instance qu’en appel, avaient donné gain de cause à Gris Line studio en retenant l’existence d’actes de contrefaçon. L’un des moyens, visant les droits de Gris Line studio retient principalement l’attention.
D’un côté, l’arrêt d’appel considérait que la société était propriétaire des photographies litigieuses, pour être l’employeur du photographe les ayant réalisées. Or, il est acquis, selon l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, que le droit de propriété incorporelle reconnu à l’auteur (al. 1er), qui « comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial » (al. 2), ne sont pas affectés par l’existence d’un contrat de travail : « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code » (al. 3). L’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose, quant à lui, que « la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel » (al. 1er) et que l’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4 » (al. 2). Ainsi, Gris Line studio ne pouvait, contrairement à ce que la cour d’appel avait jugé, se prévaloir du préjudice qui résulte de l’absence de mention du nom du photographe sur les reproductions. D’un autre côté, l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom » (al. 1), droit se trouvant « attaché à sa personne » (al. 2) et inaliénable (al. 3), « de sorte que ni l’existence d’un contrat de travail ni la propriété du support matériel de l’œuvre ne sont susceptibles de conférer à la personne morale qui l’emploie la jouissance de ce droit », l’arrêt encourait la cassation.
La lecture du moyen est particulièrement instructive dans la tentative de la société de s’octroyer les prérogatives du photographe, voire de se substituer quasiment à l’auteur. Elle considérait, en effet, que « la mention du nom du photographe sert, en la matière, comme moyen de communication et publicité pour cette profession » et « que des annonceurs ou toute autre personne ayant besoin de faire de la publicité auraient pu être intéressés par la qualité des clichés pris par la SARL Gris Line studio dans le cadre de la campagne publicitaire orchestrée par la SARL Maetva au profit de la SARL Pierre X (…) ; dans cette mesure, il peut effectivement être considéré que la SARL Gris Line studio a été privée de la reconnaissance de son travail et donc, de possibles retombées commerciales ». Plus encore, il était avancé que « l’appelante, contrairement à ce qu’elle soutient, n’établit nullement qu’elle aurait fourni des maquettes et aurait dirigé les séances photos ; qu’à l’opposé, la SARL Gris Line studio justifie, par la production du témoignage d’un des mannequins, que les prises de vues ont été réalisées à l’entière initiative du photographe de la société, la seule intervention technique du client résidant dans la sélection du modèle de montre devant être porté ; qu’ainsi il en résulte, même s’agissant d’une œuvre publicitaire, un travail de conceptualisation et de mises en scène provenant exclusivement de la SARL Gris Line studio et traduisant nécessairement la créativité et le savoir-faire de cette entreprise ». Au visa des trois articles cités plus haut, la première chambre civile casse (sans renvoi).
Xavier Daverat
B – Droit patrimonial
La notion de communication au public selon la CJUE
CJUE, gr. ch., 31 mai 2016, n° C-117/15, Reha Training Gesellschaft für Sport & a. c/ GEMA. L’arrêt rendu par la CJUE le 31 mai 2016 opère une synthèse importante à propos de la notion de communication au public36. En effet, la communication au public est évoquée dans les directives n° 2001/29/CE37 et n° 2006/115/CE38. Or, on se souvient que, par deux décisions du même jour, la CJUE avait traité différemment la diffusion de phonogrammes dans des chambres d’hôtel et la diffusion par un dentiste de musique à ses clients, excluant dans le second cas la qualification de communication au public du fait du petit nombre de patients concernés et de l’absence d’exploitation commerciale39.
De l’arrêt rapporté ici, qui découle d’une question préjudicielle, dépendait donc le fait de savoir si l’on appliquait la jurisprudence de la CJUE visant le dentiste à un centre de rééducation qui avait installé des téléviseurs pour ses patients. Dans la foulée de l’arrêt Premier League, qui affirmait (point 28) l’obligation de donner une même signification à une notion présente dans différentes directives au nom de l’unité et de la cohérence de l’ordre juridique de l’Union40, la CJUE considère que la notion de communication au public doit être interprétée de manière uniforme s’agissant du droit d’auteur et des droits voisins, indépendamment de la nature de ces droits et semble donc opérer un revirement par rapport à la solution dégagée dans le cas du cabinet dentaire.
Ce faisant, la Cour revient sur les critères de la communication au public, dans une perspective héritée de son arrêt dans l’affaire SGAE41, en particulier pour cerner la notion de « public » ; il s’agit de se référer à la fois à un « nombre indéterminé de destinataires potentiels » et à un « nombre de personnes assez important ». On voit bien la subtilité de la synthèse : le nombre indéterminé de destinataires peut faire allégeance à la jurisprudence sur le cabinet dentaire qui vise un nombre déterminé de personnes, lesquelles constituent une clientèle privée et échappant peut-être, du même coup à l’importance quantitative de celles-ci…
Xavier Daverat
Régime des hyperliens pointant sur des contenus illicites
CJUE, 2e ch., 8 sept. 2016, n° C-160/15, GS Media BV c/ Sanoma Media Netherlands BV & a. Saisie d’une question préjudicielle posée à l’occasion d’un contentieux aux Pays-Bas, la CJUE revient sur la question de savoir dans quelle mesure l’insertion d’un hyperlien constitue une communication au public42. Deux décisions importantes, rapportées dans cette chronique, avaient considéré que la fourniture, sur un site, de liens pointant vers des œuvres librement disponibles sur un autre site internet ne constituait pas un acte de communication au public, notamment du fait de l’absence de mise à disposition auprès d’un nouveau public43. Dans l’affaire qui donne lieu à l’arrêt du 8 septembre 2016, il s’agissait de la mise à disposition de photographies grâce à un hyperlien qui renvoyait à un site proposant l’utilisation de celles-ci, mais sans autorisation des auteurs. La question portait de nouveau sur l’interprétation de l’article 3, § 1, de la directive n° 2001/29/CE et de la notion de communication au public. Selon la Cour, le régime n’est pas le même selon que celui qui appose le lien a connaissance ou non du fait que le contenu du site visé est illicite. Dans la foulée de l’arrêt Reha Training, évoqué plus haut, la décision rappelle qu’il y a communication au public en présence d’un « nombre indéterminé de destinataires potentiels » et d’un « nombre de personnes assez important ». Mais, visant l’acte de communication lui-même, l’arrêt en appelle à une « appréciation individualisée », au moyen de « critères complémentaires » dont celui tiré du rôle de l’utilisateur, et notamment du fait que celui-ci aurait agi « en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée ».
Une fois que la licéité ou l’illicéité des contenus est avérée, on raisonne de la manière suivante. Si les contenus sont licites, on applique la jurisprudence Svensson et BestWater (en raisonnant sur la notion de public nouveau pour déterminer s’il y a acte de communication au public). Si les contenus sont illicites, tout dépend de la connaissance de cette illicéité par celui qui appose le lien. La preuve de la connaissance par l’opérateur du caractère illicite des contenus (ou la démonstration que celui-ci ne pouvait ignorer ce caractère) fait exiger l’autorisation du titulaire des droits pour établir le lien ; si, au contraire, la preuve n’est pas rapportée que l’opérateur connaissait le caractère illicite (ou la démonstration de ce qu’il ne pouvait l’ignorer pas faite), l’autorisation du titulaire des droits pour établir le lien n’est pas nécessaire. On imagine la difficulté en matière de preuve ; la Cour introduit alors une présomption : si l’apposition du lien hypertexte est effectuée dans un but lucratif, celui qui établit le lien est présumé avoir connaissance du caractère illicite des contenus sur lesquels il pointe, laquelle présomption peut évidemment être combattue par la preuve contraire.
On comprend bien que la capacité à créer des liens hypertextes doit être ménagée puisqu’elle est consubstantielle du Web (pas de « toile » sans liens !). Mais l’arrêt de la CJUE s’engage dans une confusion des domaines. S’il est indéniable que la connaissance de l’illicéité de contenus vers lesquels on renverrait par liens hypertextes doit être stigmatisée et sanctionnée, elle n’est nullement un critère pertinent de l’existence d’une communication au public dans la logique du droit d’auteur, et devient même la pierre angulaire de l’exercice des monopoles puisque la preuve de l’existence de cette connaissance conditionne le droit d’agir sur la base de l’autorisation des auteurs… Dans la mesure où la référence à un « public nouveau » constitue elle-même l’adjonction d’un critère par la CJUE, on mesure combien l’Union européenne élabore sensiblement un droit nouveau. L’impact de cette décision ne s’est pas fait attendre, la CJUE ayant très vite poursuivi dans la même voie à propos de boîtiers multimédias, dans l’arrêt du 26 avril 2017 rapporté ci-après.
Xavier Daverat
Régime des hyperliens pointant sur des contenus illicites
CJUE, 26 avr. 2017, n° C-527/15, Stichthing Brein c/ Jack Frederik Wullems. M. Wullems vend des boîtiers multimédias permettant à leur propriétaire de visionner gratuitement, sur leur télévision, des œuvres figurant sur internet en flux continu (streaming). Ce visionnage est possible grâce à des logiciels complémentaires tiers intégrés dans ces boîtiers, et qui utilisent des hyperliens vers des sites internet contenant les œuvres en streaming. Une partie de ces sites internet donne accès aux œuvres sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur. Stichthing Brein, une fondation néerlandaise œuvrant pour la défense des droits d’auteur, cite M. Wullems devant le tribunal néerlandais Midden-Nederland, afin de faire cesser la vente des boîtiers multimédias. Au fondement de sa demande, Stichthing Brein invoque la loi néerlandaise sur le droit d’auteur, transposant la directive n° 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. En effet selon la fondation, la communication au public des œuvres par M. Wullems viole les dispositions relatives au droit d’auteur. Pour sa part, M. Wullems invoque les exceptions au droit d’auteur, notamment l’exception de l’article 5, § 1, de la directive n° 2001/29/CE. Bien qu’ayant eu connaissance de la définition de la « communication au public », telle que précisée par l’importante décision GS Média44, le tribunal néerlandais sursoit à statuer et pose une double question aux juges du Luxembourg : d’une part, il s’agit de savoir si M. Wullems effectue bien une communication au public lorsqu’il vend son boîtier, comprenant les logiciels tiers, ayant eux-mêmes recours à des hyperliens pour accéder à des œuvres sur des sites internet ; d’autre part, il s’agit de savoir si les actes de reproduction temporaire sur le boîtier, nécessaires pour la lecture à flux constant d’œuvres figurant sur les pages internet, font partie des exceptions au droit de reproduction45.
En ce qui concerne la question de savoir s’il y a bien communication au public, la CJUE répond in fine de manière positive. Elle développe une introduction ayant valeur de majeure générale, détaillant d’abord sa méthodologie et rappelant ensuite les critères de caractérisation de la communication au public. Ainsi en premier lieu, au regard de cette méthodologie, elle rappelle que la notion de communication au public doit être entendue dans un sens large (n° 27), et qu’il faut aussi apprécier cette communication au public par des critères individualisés (n° 28). En second lieu, concernant la caractérisation de la communication au public, elle énonce les critères principaux qui sont : un « acte de communication », et « un public » (n° 29). À ces deux critères principaux, elle ajoute quatre critères qu’elle qualifie communément de « complémentaires », « interdépendants » et « d’intensité très variable » (nos 30 à 34), et qui pourront être utilisés pour apprécier les deux critères principaux : la connaissance de son acte de communication par le vendeur du boîtier, le nombre de personnes constituant le « public », le mode technique spécifique ou à défaut la « nouveauté » du public et le caractère lucratif de la communication. Tous ces critères sont la confirmation de la décision GS Média qui les avait déjà énoncés, quand certains d’entre eux semblaient avoir perdu de l’importance (notamment le caractère lucratif, tel qu’exposé dans l’arrêt Reha Training46).
Après cette introduction, la CJUE reprend alors chacun des deux critères principaux. D’une part, il s’agit de « l’acte de communication » (nos 35 à 42). La CJUE rappelle qu’en vertu de la jurisprudence Svensson47, l’acte de communication correspond à une mise à disposition du public, cette qualification pouvant être retenue pour les hyperliens48. En l’espèce, bien que la CJUE admette que la simple fourniture d’installations physiques ne constitue pas un « acte de communication »49, elle n’applique pas cette exception pour le boîtier multimédia, au motif que M. Wullems avait pleine connaissance des conséquences de son comportement en vendant un boîtier qui permet spécifiquement à ses acquéreurs d’accéder à des œuvres protégées. Il n’y a donc pas une « simple » fourniture. Ce faisant, la CJUE étend le statut des hyperliens de sites web à la fourniture d’un boîtier qui donne lui-même accès à ces hyperliens, par l’intermédiaire de logiciels complémentaires. Elle suit ainsi les conclusions de son avocat général même si celui-ci admettait qu’il y avait là une différence « notable ». D’autre part, il s’agit aussi de définir le « public » (nos 43 à 51). Après avoir estimé le critère du « nombre » rempli (nos 43 à 46), la CJUE valide aussi le critère du public « nouveau ». Pour que le public soit nouveau, il fallait que les liens renvoient à des œuvres illégalement publiées, et que la vente du boîtier soit effectuée en pleine connaissance de ces circonstances. Cette pleine connaissance est alors présumée (de façon simple), dès lors que le placement des liens a été effectué « dans un but lucratif » (n° 49). En conclusion, M. Wullems commet un acte de communication au public lorsqu’il vend les boîtiers multimédias concernés.
En ce qui concerne la question de savoir si les actes de reproduction temporaire font partie des exceptions au droit de reproduction, la CJUE répond par la négative. Elle pose là aussi une majeure générale sur l’exemption du droit de reproduction, en énonçant les conditions cumulatives de cette exemption (nos 60 à 61) : il doit s’agir d’un acte provisoire, cet acte doit être transitoire ou accessoire, cet acte doit être une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, l’unique finalité de ce procédé doit être la transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé, enfin ledit acte ne doit pas avoir de signification économique indépendante. Ces conditions font l’objet d’une interprétation stricte, et doivent respecter aussi le test des trois étapes (nos 62 et 63)50. Ces conditions étant cumulatives, il suffit alors à la CJUE de relever qu’une seule d’entre elles n’est pas remplie pour rejeter l’application de l’exception. Elle fonde justement ce rejet au regard du critère selon lequel « l’unique finalité de ce procédé doit être la transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé ». Pour ce faire, elle définit la licéité, en rappelant que l’utilisation est réputée licite si elle est autorisée par le titulaire ou si elle n’est pas limitée par cette réglementation applicable51. En l’espèce, l’autorisation des auteurs n’ayant pas été donnée pour les œuvres concernées, la CJUE se reporte à la réglementation applicable (appréciée au regard du test des trois étapes). À ce stade, après avoir rappelé des jurisprudences proches (nos 67 et 68) la CJUE estime que, au vu de la publicité faite pour le boîtier, le principal attrait pour l’acheteur est l’installation des logiciels complémentaires. Ainsi, « il y a lieu de considérer que c’est, en principe, (…) en connaissance de cause que l’acquéreur d’un tel lecteur accède à une offre gratuite ». À cet argument, dont le fondement n’apparaît pas clairement, elle ajoute le test des trois étapes pour rejeter la caractérisation d’une exception au droit de reproduction (nos 71 et s.).
Pierre-François Euphrasie
C – Contrefaçon
Sanction de la contrefaçon d’un film cinématographique
CA Paris, pôle 5, 2e ch., 10 juin 2016, n° 15/10188, EuropaCorp & a. c/ J. Carpenter & a. Ce n’est pas la première fois que les films de Luc Besson sont impliqués dans des contentieux en contrefaçon. Dans une première espèce, le réalisateur avait été assigné par les auteurs de la bande dessinée L’Incal, qui considéraient que celui-ci avait repris des traits caractéristiques de leurs personnages dans Le cinquième élément ; ils n’ont pas eu gain de cause52. À l’occasion d’une seconde affaire, Luc Besson a, au contraire, fait sanctionner l’utilisation du personnage de Leloo, joué par Mila Jovovich dans le même film, et rejoué par son interprète à l’occasion d’une publicité de l’opérateur de téléphone SFR53. Si le cinéaste avait, jusqu’ici, eu gain de cause, il n’en va pas de même à l’occasion du film Lock Out, réalisé par James Mather et Stephen St. Leger sur un scénario coécrit par ces derniers avec Luc Besson, et produit par EuropaCorp, dont le français est un des cofondateurs. La cour de Paris54 a, en effet, confirmé la décision des premiers juges55 qui retenait l’existence d’une contrefaçon du film de John Carpenter, New York 1997.
La décision rappelle que le droit d’auteur protège la forme des œuvres, et que la contrefaçon s’apprécie eu égard aux ressemblances entre l’œuvre suspectée d’être contrefaisante et celle dont l’auteur prétend qu’elle a été contrefaite. Deux éléments participent traditionnellement de la forme que revêt l’œuvre : l’expression et la composition. Ainsi que l’a dit la Cour de cassation, dans une affaire célèbre mettant en cause Régine Deforges pour un roman, La bicyclette bleue, démarqué de l’œuvre de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent, les juges du fond « doivent rechercher si, par leur composition ou leur expression, les scènes et les dialogues des romans, qui mettent en œuvre des rapports comparables entre les personnages en présence, ne comportent pas des ressemblances telles que, dans le second roman, ceux-ci constituent des reproductions ou des adaptations du premier56 ». Cet arrêt avait été suivi, quelques mois après, d’une décision allant dans le même sens dans une espèce visant le film d’Yves Boisset, Le prix du danger et celui de Paul Michael Glaser, The running man57. Fonder la contrefaçon sur les ressemblances et non les différences est certes, parfois, bien artificiel58, mais il faut en passer par la comparaison des similitudes, ce qu’opère l’arrêt évoqué ici avec une précision assez grande pour être remarquée.
Il était ainsi fait valoir, à propos de l’évolution du récit, des « contextes respectifs (…) radicalement différents » à partir d’une même trame, qu’on attribuait dans le second film « une épaisseur au héros en montrant qu’il s’agit d’un agent de la CIA qui a été victime d’une machination tandis que le héros du film New York 1997, criminel endurci (…) en est volontairement dépourvu afin de ne pas troubler l’allégorie qui est proposée au spectateur », que « la façon dont chacun des otages tombe aux mains des prisonniers n’a, selon eux, absolument aucune ressemblance », etc. Or la cour relève, pour sa part, « le même dilemme initial [qui] se retrouve dans les deux récits », le choix de la même option et d’armements semblables, des rebondissements similaires. Bref, l’argumentation des appelants évoquant les différences ne tient pas devant « l’argumentation adverse stigmatisant incidemment l’ajout de “leurres” ressortant de l’art de tout plagiaire ».
Trop riche pour pouvoir être détaillée ici, la décision raisonne également sur le traitement cinématographique, les personnages principaux (aspects physiques et profils psychologiques) et secondaires, les scènes présentées comme caractéristiques du film accusé de contrefaçon, le message véhiculé par les deux œuvres, etc., pour confirmer la décision des premiers juges et conclure à la contrefaçon. Il est intéressant, aussi, de noter que la cour entérine la démarche du tribunal qui avait cité des critiques cinématographiques et ajoute, à l’appui de son propre arrêt, que des articles relevaient la proximité avec New York 1997 en considérant « qu’on évolue plus dans le domaine du plagiat que dans celui de l’hommage » et que « le scénario est complètement pompé » !
Xavier Daverat
Absence de mandat d’une agence photographique pour agir au nom des auteurs
TGI Paris, 18 nov. 2016, Magnum Photos c/ Sté. Yann Le Mouel & a. Des sociétés de vente aux enchères ont procédé à la vente de photographies dont les auteurs étaient liés à la célèbre agence Magnum. Cette dernière a assigné les sociétés du fait de la présence des photographies sur des catalogues papier et sur internet et a conclu à la contrefaçon, mais sa demande est jugée irrecevable par le tribunal de grande instance de Paris59 à défaut d’être cessionnaire des droits des photographes ou de pouvoir se prévaloir d’un mandat pour agir en justice.
En effet, le demandeur à l’action civile, en matière de contrefaçon, est l’auteur ou un ayant-droit de celui-ci, mais également le cessionnaire des droits. La directive n° 2004/48/CE60 le dit de manière générale en évoquant, outre les titulaires de droits de propriété intellectuelle, « toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci » (art. 4, b). La situation en droit interne n’est pas tout à fait la même. Outre que, à la différence de la solution retenue en propriété industrielle61, dans le cadre de la propriété littéraire et artistique, le licencié ne peut pas agir, l’ouverture de l’action au cessionnaire des droits est d’origine jurisprudentielle : la première chambre civile a d’ailleurs fait bénéficier le cessionnaire d’une présomption lui permettant d’agir : « En l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé les clichés, ces actes de possession étaient de nature à faire présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que SMD était titulaire sur ces œuvres quelle que fût leur qualification du droit de propriété incorporelle de l’auteur62 ».
Hors de la qualité de cessionnaire des droits, il fallait donc justifier d’un mandat. L’agence Magnum prétendait être « représentante des photographes » et « mandataire de ses photographes », et rappelait qu’elle établissait des factures « pour le compte » de ces derniers, de même qu’elle concluait des conventions de cession de droits de représentation et de reproduction « pour le compte des photographes ». Se fondant sur l’article 416 du Code de procédure civile selon lequel « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission », le tribunal considère que l’agence « ne justifie d’aucun mandat d’ester en justice pour le compte de chacun des photographes qu’elle prétend représenter, et ne peut déduire sa qualité pour agir de ce que son action en référé a été déclarée recevable en 2010 dans un litige de ventes aux enchères de photographies sans aucun lien avec la présente action ». Par voie de conséquence, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir et la demande n’est pas examinée au fond.
Xavier Daverat
L’instigateur d’une contrefaçon est un contrefacteur
Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-80678, Géraldine X. C’était une singulière entreprise familiale ! Le père, puis, à son décès, sa fille faisaient reproduire des biens contrefaisants, notamment par un sculpteur. Pour la chambre criminelle63, qui confirme l’arrêt d’appel, « se rend coupable de contrefaçon celui qui concourt sciemment à la reproduction, sans autorisation, d’une œuvre de l’esprit en la faisant réaliser par un exécutant de son choix ». La solution n’était pas évidente : l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur ». Or, Mme X ne fait pas elle-même acte de reproduction, les éléments constitutifs de l’infraction ne pouvant être relevés qu’à l’encontre de ceux qui réalisent les biens contrefaisants ; le principe d’interprétation stricte de la loi pénale ne devait-il pas, alors, conduire à tenir l’intéressée comme complice ? Ce n’est pas l’avis de la chambre criminelle qui le dit dans un attendu de principe. La décision est donc emblématique, mais rejoint une solution déjà admise s’agissant des complices et fournisseurs de moyens64.
Xavier Daverat
D – Cumul des protections
Conditions d’un cumul de protection par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles.
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10885, Impex. La société Impex commercialise des sacs destinés à contenir des chaînes pour pneus de véhicules, et sur lesquels elle est titulaire d’un modèle communautaire. Estimant que la société Hervé et Philippe Schneider Distribution distribuait des sacs qui reproduisaient les caractéristiques de son modèle sans son autorisation, elle l’assigne le 20 février 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de modèle et de droit d’auteur, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme. Si le tribunal reconnaît l’existence d’un modèle communautaire, il rejette les demandes d’Impex, qui interjette appel devant la cour d’appel de Paris, laquelle rejette elle aussi les actions en contrefaçon de modèle et de droit d’auteur, ainsi que l’action en concurrence déloyale et parasitisme. Impex forme alors un pourvoi qui aboutit à l’arrêt de rejet évoqué ici65.
Tout d’abord, Impex estime que le caractère individuel d’un modèle protégé implique nécessairement une empreinte de la personnalité de l’auteur, donc une originalité au sens du droit d’auteur. La Cour de cassation rejette ce moyen, en indiquant que « les articles L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle et 96–2 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires n’imposent pas un cumul total ou de plein droit des protections qu’ils instituent, mais autorisent seulement un tel cumul lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites, de sorte que la cour d’appel n’a méconnu ni les termes du litige ni la portée de ces textes en examinant si les conditions de la protection spécifique, par le droit d’auteur, du modèle communautaire enregistré étaient réunies ». Ainsi, pour bénéficier du cumul de la protection des dessins et modèles et du droit d’auteur, la Cour de cassation juge que le demandeur doit démontrer que les critères de chacune de ces protections sont remplis. En ce sens, l’arrêt est conforme à la jurisprudence contemporaine66. La première protection n’implique donc pas automatiquement la seconde. Le moyen est rejeté.
Puis, en se fondant sur le règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et l’article L. 515-1 du Code de la propriété intellectuelle, Impex estime qu’il y a contrefaçon de modèle car les deux sacs ne produisent pas une impression globale différente pour un public averti. Selon la première branche du moyen soulevé, Impex considère que la cour d’appel n’a pas expliqué en quoi les différences relevées entre les deux sacs procuraient une impression globale différente pour un public averti. Sur cette question, la chambre commerciale reprend les éléments de fait énoncés par la cour et estime qu’ils sont suffisants, et que celle-ci « a pu en déduire que le sac incriminé ne produisait pas sur le “public” averti une même impression visuelle globale67 ». Selon la seconde branche, Impex invoque un moyen de procédure en expliquant que, la cour d’appel (ayant admis que les caractéristiques techniques n’étaient pas invocables en l’espèce pour rejeter la contrefaçon), devait aussi réfuter le motif contraire adopté par les premiers juges, pour ne pas se contredire. La Cour de cassation considère cependant que la Cour n’avait pas à se prononcer formellement contre le motif invoqué. Le moyen est lui aussi rejeté.
Enfin, Impex fait valoir que, puisque son argument sur la contrefaçon doit être accueilli, les deux sacs produisent une impression globale identique. Il y a, par voie de conséquence, un risque de confusion qui engendrerait aussi une concurrence déloyale68. Par suite, toute concurrence déloyale serait génératrice d’un trouble commercial impliquant nécessairement un préjudice. La Cour de cassation rappelle d’abord qu’elle a préalablement rejeté l’argument fondé sur l’impression globale identique et la contrefaçon, et que celui-ci ne peut donc plus être invoqué. Néanmoins, elle étudie subsidiairement l’action en concurrence déloyale69, en corrigeant l’analyse menée par Impex. En effet, cette dernière n’a pas justifié « d’investissements caractérisant l’effort commercial et financier dont elle soutenait que la partie adverse bénéficiait indûment », et ne peut donc prétendre avoir caractérisé le préjudice. De cette façon, elle rappelle que l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur l’appréciation d’un préjudice dûment caractérisé. Le pourvoi est donc rejeté.
Pierre-François Euphrasie
Notes de bas de pages
-
1.
D., 13 oct. 1995, portant classement parmi les monuments historiques : JO n° 0241, 15 oct. 1995, p. 15051.
-
2.
T. corr. Lyon, 18 juin 1999 : Carius M., « Les découvertes faites par un agent public. Le cas de la Grotte Chauvet », Droit adm. 2000, chron. 2.
-
3.
Cass. 3e civ., 15 juin 2010, n° 09-67358 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022370884&fastReqId=287931299&fastPos=1.
-
4.
Cass. 3e civ., 14 avr. 1999, n° 98-70038, Helly & a. c/ État français & a. (cassant CA Nîmes, ch. des expr., 19 janv. 1998, et renvoyant à CA Toulouse) : AJDI 1999, p. 1148, obs. Lévy A. ; JCP G 1999, II 10091, note Weber J.-F. – Cass. 3e civ., 20 déc. 2000, n° 99-70263, Lafuma c/ État français ; Sur renvoi, fixant une indemnité principale de dépossession de 70 000 000 F et une indemnité de remploi de 17 500 000 F : CA Toulouse, 27 mars 2001 : Cabrol P., « Grotte Chauvet, un coup d'arrêt aux expropriations abusives de monuments historiques », LPA 13 août 2001, p. 10 ; Hostiou R., « La valeur de la grotte Chauvet multipliée par 3 000 », Études foncières mars-avr. 2001, n° 90, p. 6 ; sur la disproportion entre le montant fixé par les juges de première instance et celui révisé par la cour d’appel de Toulouse, v. JOAN n° 1370, 21 mai 2001 – La Cour de cassation a annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, mais du fait que la cour de Toulouse avait « constaté qu'une instance judiciaire était en cours devant le juge de droit commun portant sur la propriété de la grotte », tout en faisant valoir qu'« il n'existe aucun doute sérieux sur l'identité des propriétaires dépossédés », et avait renvoyé à la cour d'appel de Lyon, Cass. 3e civ., 15 févr. 2006, n° 01-70106, État français c/ Helly & a. : Hostiou R., « La grotte Chauvet, retour à la case départ », Études foncières mars-avr. 2006, n° 120, p. 5 – CA Lyon, 10 mai 2007, accordant plus de 770 000 € aux propriétaires ; Rejetant le pourvoi contre CA Lyon, Cass. 3e civ., 18 nov. 2008, n° 07-17240 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019781958&fastReqId=1249987597&fastPos=5 ; Adde. : Brige M. et Cabrol P., « L'État s'approprie le patrimoine archéologique », Journ. arts 2004, n° 186, p. 29 ; Cortembert S., « La grotte Chauvet (ou la protection des intérêts de l'État sous le couvert de celle d'un site paléolithique) », LPA 7 avr. 1997, p. 11.
-
5.
CEDH, 24 oct. 2011, n° 28216/09, Helly & a. c/ France : JCP A 2011, act. 722 ; « Expropriation pour cause d'utilité publique », JCP G 2012, doctr. 1000, chron. Huyghe M., § 33.
-
6.
Cass. 3e civ., 24 sept. 2014, n° 12-21978 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029509910&fastReqId=1506224809&fastPos=1 ; AJDA 2015, p. 59, avis Petit S. ; D. 2014, p. 2115.
-
7.
CA Nîmes, 1re ch., sect. A, 30 oct. 2001, Sarl Ardèche Images productions c/ Chauvet & a. : Comm. com. électr. 2002, comm. 132, note Caron C. ; RIDA 2003, p. 267, obs. Kéréver A.
-
8.
Herzog W., « Cave of Forgotten Dreams », 2010, 90’, Metropolitan Video.
-
9.
TGI Paris, 3-4, 30 janv. 2014 ; CA Paris, 2-5, 6 févr. 2015, n° 14/05418 : Propr. intell. 2015, p. 201, obs. Lucas A. ; LMDI 2015, n° 117, obs. Mourron P.
-
10.
Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-17301 ; Comm. com. électr. 2017, comm. 11, note Caron C. ; Dalloz IP/IT 2017, p. 112, obs. Daleau J.
-
11.
Consolidée par la dir. n° 2006/116/CE, 12 déc. 2006, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins.
-
12.
Dir. n° 2006/116/CE, 12 déc. 2006, art. 4.
-
13.
Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 91-16286 ; sur renvoi CA Amiens, 2e & 4e ch. civ. réunies, 1er avr. 1996 : RIDA 1997, n° 173, p. 298.
-
14.
CA Nîmes, 1re ch., sect. A, 30 oct. 2001, préc.
-
15.
Cass. 1re civ., 11 déc. 2013, nos 11-22031 et 11-22522 : Comm. com. électr. 2014, comm. 15, note Caron C. ; Propr. intell. 2014, n° 50, p. 65, note Lucas A.
-
16.
CPI, art. L. 112-2, 9.
-
17.
CE, 26 avril 1963 : D. 1964, p. 124, concl. Chardeau J., note Desbois H.– Cass. 1re civ., 24 mars 1993, Areo c/ Syndicat de Villeneuve Loubet : RIDA 1993, n° 156, p. 200.
-
18.
CJCE, 16 juill. 2009, n° C-5/08, Infopaq : Comm. com. électr. 2009, comm. 97, note Caron C. ; Propr. intell. 2009, p. 185, obs. Benabou V.-L. ; JCP G 2009, 272, note Marino L.
-
19.
CJUE, 4 oct. 2011, nos C-403/08 et C-429/08, Football association Premier League : JCP G 2011, 1296, note Buy F. & Roda J.-C. ; Comm. com. électr. 2011, comm. 110, note Caron C. ; Europe 2011, comm. 468, note Idot L. – CJUE, 1er déc. 2011, n° C-145/10, Painer : Comm. com. électr. 2012, comm. 26, note Caron C.
-
20.
CA Paris, 14 mai 1987, Jonvelle : CDA 1988, n° 1, p. 20.
-
21.
CA Paris, 17 juin 1988 : D. 1989, Somm., p. 44, obs. Colombet C.
-
22.
CA Versailles, 28 avr. 1988 : D. 1988, IR, p. 165.
-
23.
CA Paris, 11 juin 1990 : D. 1990, IR, p. 192.
-
24.
L. n° 2001-44, 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive : JO 18 janv. 2001, p. 928 ; v. Frier P.-L., « Commentaire de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive », AJDA 2001, p. 182 ; Saujot C., « La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive », JCP G 2001, doctr. 351.
-
25.
Cass. 3e civ., 12 juill. 2000, n° 97-13107, Florini c/ Terreno : Bull. civ. III, n° 144 ; Defrénois 15 avr. 2001, n° 37341, p. 451, obs. Atias C. ; RD imm. 2000, comm. 525, obs. Bruschi M. ; JCP G 2001, I 305, obs. Périnet-Marquet H. ; RTD civ. 2002, p. 539, obs. Revet T.
-
26.
Dorénavant, C. patr., art. L. 541-1, al. 1.
-
27.
D. n° 2004-490, 3 juin 2004, art. 63, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : JO, 5 juin 2004, p. 9983.
-
28.
CE, 8e-3e ss-sect. réunies, 24 avr. 2012, n° 346952 : Rec. Lebon 2012.
-
29.
En ce sens : Saujot C., art. préc., § 37.
-
30.
Cons. const., 16 janv. 2001, n° 2000-439 DC : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2001/2000-439-dc/decision-n-2000-439-dc-du-16-janvier-2001.458.html ; JO, 18 janv. 2001, p. 931 ; RFD const. 2001, p. 360, note Bernaud V. et p. 365, Fatome E. ; D. 2002, Somm. 1944, obs. Ogier-Bernaud V. ; RD publ. 2001, p. 947, obs. Rueda F. ; LPA 12 févr. 2001, p. 18, obs. Schoettl J.-E.
-
31.
Cons. const., 31 juill. 2003, n° 2003-480 DC : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2003/2003-480-dc/decision-n-2003-480-dc-du-31-juillet-2003.866.html ; D. 2004, p. 1281.
-
32.
C. patr., art. L. 541-1, al. 3, depuis l’intervention de la L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, art. 70, V, cet alinéa 3 a été reporté sous le numéro d’article C. patr., art. L. 541-3-C avec quelques modifications, On parle de « biens » et non plus de « vestiges » ; l’allusion finale aux limites et modalités a disparu, C. patr., art. L. 541-5-C, fixant le régime applicable à l’intéressement de l’inventeur.
-
33.
CE, 24 avr. 2012, n° 346952 : AJDA 2012, p. 1345.
-
34.
TA Marseille, 12 avr. 2007, n° 0307735 : AJDA 2007, p. 833.
-
35.
Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-22723 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033430687 ; Dalloz IP/IT 2017, p. 172, note Daleau J.
-
36.
CJUE, gr. ch., 31 mai 2016, n° C-117/15 : Dalloz IP/IT 2016, p. 420, note Benabou V.-L.
-
37.
Dir. n° 2001/29/CE du PE et du Cons., 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32001L0029.
-
38.
Dir. n° 2006/115/CE du PE et du Cons., 12 déc. 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0115.
-
39.
CJUE, 15 mars 2012, n° C-162/10, Phonographic Performance (Irlande) Ldt. c/ Irlande ; CJUE, 15 mars 2012, n° C-135/10, Società Consortile Fonografici c/ Del Corso : Légipresse 2012, n° 300, synth. p. 720, n° 8, obs. Alleaume C. ; Comm. com. électr. 2012, comm. 48, note Caron C. ; LPA 2013, n° 21, p. 18, obs. Daverat X. ; Comm. com. électr. 2013, chron. 4, § 13, obs. Daverat X. ; Europe 2012, comm. 217, note Idot L. ; RTD com. 2012, p. 322, obs. Pollaud-Dulian F. ; Comm. com. électr. 2012, chron. 9, § 8, obs. Tafforeau P. ; RTD eur. 2012, p. 964, obs. Treppoz E. ; Légipresse 2012, n° 293, p. 210.
-
40.
CJUE, 4 oct. 2011, n° C-403/08, Football Association Premier League c/ QC Leisure : D. 2012, p. 704, chron. « Droit du sport », obs. Alaphilippe N. ; AJDA 2011, p. 2339, chron. Aubert M., Broussy E. et Donnat F. ; RTD eur. 2012, p. 446, obs. Blaise J.-B. ; RSC 2012, p. 315, chron. Idot L. ; RTD com. 2011, p. 744, obs. Pollaud-Dulian F. ; RTD eur. 2012, p. 229, obs. Sibony A.-L. ; D. 2012, p. 2836, obs. Sirinelli P. ; RTD eur. 2011, p. 855, obs. Treppoz E. Dans cette affaire, la Cour avait jugé que la notion de communication au public, au sens de l'article 3, § 1, de la directive n° 2001/29, devait être interprétée en ce sens qu'elle couvre la transmission des œuvres radiodiffusées, au moyen d'un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients d’un bar-restaurant.
-
41.
CJCE, 7 déc. 2006, n° C-306/05, SGAE : D. 2007, p. 1236, obs. Daleau J., note Edelman B. ; RTD com. 2007, p. 85, obs. Pollaud-Dulian F.
-
42.
CJUE, 2e ch., 8 sept. 2016, n° C-160/15 : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=183124 ; Dalloz IP/IT 2016, p. 543, note Sirinelli P.
-
43.
CJUE, 4e ch., 13 févr. 2014, n° C-466/12, Nils Svensson a. c/ Retriever Sverige : Comm. com. électr. 2014, comm. 34, note Caron C. ; D. 2014, p. 2317, obs. Larrieu J., Le Stanc C. et Tréfigny P. ; RTD com. 2014, p. 600, obs. Pollaud-Dulian F. ; D. 2014, p. 2078, obs. Sirinelli P. ; RTD eur. 2014, p. 965, obs. Treppoz E. – CJUE, ord., 9e ch., 21 oct. 2014, n° C-348/13, Best Water International GmbH c/ Michael Mebes & a. : D. 2015, p. 2214, obs. Larrieu J., Le Stanc C. et Tréfigny P. ; RTD com. 2014, p. 808, obs. Pollaud-Dulian F. ; Sur les deux décisions, v. LPA 19 janv.2016, p. 6, obs. Daverat X.
-
44.
CJUE, 2e ch., 8 sept. 2016, n° C-160/15 : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=183124 ; Dalloz IP/IT 2016, p. 543, note Sirinelli P.
-
45.
CJUE, 26 avr. 2017, n° C-527/15 : http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-527/15.
-
46.
CJUE, gr. ch., 31 mai 2016, n° C-117/15 : Dalloz IP/IT 2016, p. 420, note Benabou V.-L.
-
47.
CJUE, 4e ch., 13 févr. 2014, n° C-466/12, Nils Svensson a. c/ Retriever Sverige : Comm. com. électr. 2014, comm. 34, note Caron C. ; D. 2014, p. 2317, obs. Larrieu J., Le Stanc C. et Tréfigny P. ; RTD com. 2014, p. 600, obs. Pollaud-Dulian F. ; D. 2014, p. 2078, obs. Sirinelli P. ; RTD eur. 2014, p. 965, obs. Treppoz E.
-
48.
Not. : CJUE, 2e ch., 8 sept. 2016, n° C-160/15 : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=183124 ; Dalloz IP/IT 2016, p. 543, note Sirinelli P.
-
49.
CJCE, 7 déc. 2006, n° C-306/05, SGAE : D. 2007, p. 1236, obs. Daleau J., note Edelman B. ; RTD com. 2007, p. 85, obs. Pollaud-Dulian F.
-
50.
CJUE, 4 oct. 2011, n° C-403/08, Football Association Premier League c/ QC Leisure : D. 2012, p. 704, chron. « Droit du sport », obs. Alaphilippe N. ; AJDA 2011, p. 2339, chron. Aubert M., Broussy E. et Donnat F. ; RTD eur. 2012, p. 446, obs. Blaise J.-B. ; RSC 2012, p. 315, chron. Idot L. ; RTD com. 2011, p. 744, obs. Pollaud-Dulian F. ; RTD eur. 2012, p. 229, obs. Sibony A.-L. ; D. 2012, p. 2836, obs. Sirinelli P. ; RTD eur. 2011, p. 855, obs. Treppoz E. Dans cette affaire, la Cour avait jugé que la notion de communication au public, au sens de l'article 3, § 1, de la directive n° 2001/29, devait être interprétée en ce sens qu'elle couvre la transmission des œuvres radiodiffusées, au moyen d'un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients d’un bar-restaurant.
-
51.
Terme issu du 33e considérant de la directive n° 2001/29/CE, qui fait référence à la limitation « par la loi ».
-
52.
TGI Paris, 28 mai 2004, Sté. Les Humanoïdes Associés, Jodorowski & Moebius c/ Luc Besson et Sté. Gaumont) ; TGI Paris, 8 sept. 2004 : Comm. com. électr. 2004, comm. 11, p. 23, note Caron C.
-
53.
CA Paris, 8 sept. 2004, Stés. SFR & Publicis Conseil c/ Luc Besson et Sté. Gaumont : D. 2004, p. 2574, obs. Daleau J. ; LPA 23 mai 2005, p. 3, note Daverat X. ; RTD com. 2004, p. 732, obs. Pollaud-Dulian F.
-
54.
CA Paris, 5-2, 10 juin 2016, n° 15/10188 : Dalloz IP/IT 2016, p. 550, note Disdier-Mikus K. et Debiesse G.
-
55.
TGI Paris, 7 mai 2015, n° 14/01637 : Légipresse 2015, n° 329, I, p. 391 ; Comm. com. électr. 2016, chron. 8, obs. Montels B.
-
56.
Cass. 1re civ., 4 févr. 1992, n° 90-21630 : JCP G 1992, I 21930, note Daverat X. ; D. 1992, p. 182, note Gautier P.-Y.
-
57.
Cass. 1re civ., 25 mai 1992, n° 90-19460, Yves Boisset : D. 1993, p. 184, note Daverat X. – Sur renvoi, se pliant à la décision de la Cour de cassation et concluant à la contrefaçon : CA Douai, 20 mai 1996 : LPA 28 juill. 1997, p. 11, obs. Caron C.
-
58.
Daverat X., « Libres propos sur les critères de la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques », JCP G 1995, I 3827.
-
59.
TGI Paris, 18 nov. 2016, https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3eme-ch-2eme-section-jugement-du-18-novembre-2016/.
-
60.
Dir. n° 2004/48/CE, 29 avr. 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:fr:PDF.
-
61.
Cass. 1re civ., 22 janv. 2009, n° 07-21498 : Comm. com. électr. 2009, comm. 32, note Caron C. ; JCP E 2009, I 30, n° 13, obs. Caron C. ; Propr. intell. 2009, comm. 31, p. 169, note Lucas A. ; RTD com. 2009, p. 307, obs. Pollaud-Dulian F.
-
62.
Cass. 1re civ., 24 mars 1993 : JCP G 1993, II 22085, note Greffe F. ; RIDA 1993, n° 158, p. 200.
-
63.
Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-80678 : Dalloz IP/IT 2016, p. 481, note Enser N.
-
64.
Par ex. : CA Aix-en-Provence, 10 mars 2004, n° 2004-240851 : Comm. com. électr. 2004, comm. 103, note Caron C.
-
65.
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10885 : http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000034345512.html.
-
66.
V. not. : Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-20589, Giovani SAS c/ Sam SAS : PIBD 2015, n° 1020, III, p. 94. – Cass. crim., 26 nov. 2013, n° 12-81700, CIPA Distribution : Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, 2e éd., 2015, Dalloz, n° 29, comm. Kamina P. ; PIBD 2014, n° 999, III, p. 122 – Cass. crim., 13 déc. 2011, n° 10-80623, Asimpex France : Les grands arrêts de la propriété intellectuelle ; PIBD 2012, n° 957, III, p. 180. – CA Paris, 5-1., 21 juin 2016, n° 15/00425 : PIBD 2016, n° 1059, III, p. 863. – CA Paris, 5-1., 29 nov. 2016, n° 15/08734 : PIBD 2017, n° 1065, III, p. 109. – Contra : Cass. com., 13 févr. 1996, n° 94-12102 : D. 1998, p. 290, note Greffe P.
-
67.
Rapp. : Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 13-28116, Sté Jean Cassegrain, Sté Longchamp c/ Sté Vivadia : Comm. com. électr. 2015, chron. 8, obs. Kahn A.-E. – Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-22798, Sté Cupidon et M. X c/ Prada Retail : PIBD 2015, n° 1023, III, p. 217 ; Propr. intell. 2015, n° 57, p. 454, obs. de Candé P. – Cass. com., 25 nov. 2014, n° 13-15166, Sté Smoby Toys c/ Sté Splash-Toys : D. 2015, p. 1662, obs. Galloux J.-C. et Lapousterle J. ; Propr. industr. 2015, comm. 16, obs. Gasnier J.-P. – CA Paris, 5-1, 26 janv. 2016, n° 15/00320 : PIBD 2016, n° 1045, III, p. 214.
-
68.
Sur la distinction entre préjudices fondant la contrefaçon et la concurrence déloyale : Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-20589, Giovani SAS c/ Sam SAS, préc. ; V. aussi, sur les liens entre appréciation de la contrefaçon et risque de confusion, Malaurie-Vignal M. : « Contrefaçon et concurrence déloyale : pour en finir avec les incertitudes sur la notion de fait distinct », Propr. industr. 2017, étude 14.
-
69.
Ceci en application de la différence de fondements entre contrefaçon et concurrence déloyale, V. not. Cass. com., 6 nov. 2007, n° 06-15227 : D. 2008, p. 252, note Auguet Y.