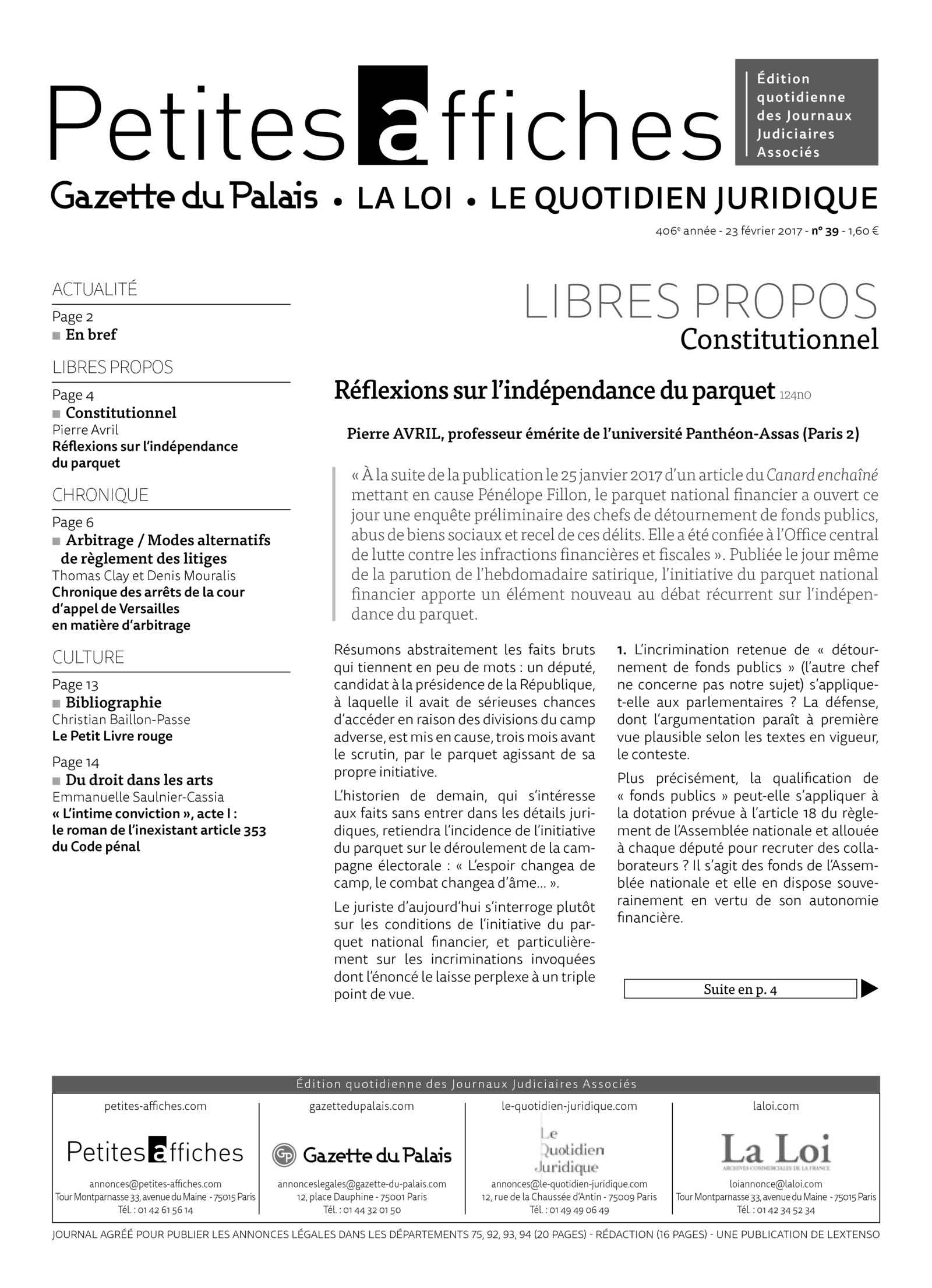Chronique des arrêts de la cour d’appel de Versailles en matière d’arbitrage
Si, en matière de droit de l’arbitrage, la cour d’appel de Paris joue, depuis toujours, un rôle prépondérant, celle de Versailles apporte régulièrement sa pierre à l’édifice. Comme cour de renvoi, ou non, elle joue de plus en plus un rôle clé sur l’affinement du droit positif de l’arbitrage. Les quatre arrêts commentés ici en attestent, s’il en était besoin. Il était donc naturel que le pôle de recherche en droit de l’arbitrage de l’université de Versailles, soit mis à contribution pour commenter les décisions de la cour d’appel du ressort et, dans une version locale du croisement des sources du droit, mettent de la manière la plus profitable en synergie jurisprudence et doctrine versaillaises.
I – La preuve de la clause compromissoire par référence conclue par oral
1. CA Versailles, 1re ch., 14 janv. 2016, n° 14/06802, GAEC de la Berhaudière c/ SAS Hautbois. Il n’est pas toujours besoin de grands enjeux pour poser de grandes questions. L’arrêt commenté en fait une fois de plus la démonstration. Le montant du litige ? 8 750 €. Et pourtant cet arrêt intervient après une sentence arbitrale rendue par cinq arbitres sous l’égide de la chambre internationale d’arbitrage de Paris, d’ailleurs précédée d’un projet de sentence, suivi d’un arrêt de la cour d’appel de Paris et même d’un arrêt de la Cour de cassation qui l’a cassé. Trois décisions de justice, donc, déjà rendues au sujet d’une commande de colza, d’orge et de blé, passée en 2010 par la société Hautbois au GAEC de la Berhaudière. Cette commande, formulée verbalement, renvoyait aux conditions générales d’achat de l’acheteuse qui contenaient une clause compromissoire.
2. Une demande d’arbitrage fut donc formée devant le centre d’arbitrage choisi, qui appliquait un ancien dispositif prévoyant qu’un projet de sentence serait d’abord rendu, lequel se convertirait en sentence si les parties l’acceptaient1. Ce ne fut pas le cas. Un deuxième tribunal arbitral fut donc constitué qui fit droit à la demande d’arbitrage par une sentence rendue le 25 août 2011. Celle-ci fut annulée par la cour d’appel de Paris au motif que la preuve de l’existence de la clause compromissoire n’était pas rapportée2. Pourtant, cette décision aboutit à une cassation brutale par la haute cour le 14 mai 2014, sur la base de l’article 1447, avec visa et chapeau, pour rappeler que l’autonomie de la clause compromissoire n’est pas affectée par l’absence de preuve de l’existence du contrat principal : « La convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci »3.
3. Les parties s’opposaient donc, de manière assez classique, sur la question dite de la clause compromissoire par référence, c’est-à-dire celle qui figure dans un acte différent de celui qui est signé et auquel il renvoie. La demanderesse estimait qu’elle n’avait jamais accepté une telle clause, contenue dans des conditions générales d’achat dont l’application n’était mentionnée qu’en petits caractères au pied du verso du contrat, sans que le recto ne s’y réfère, qu’il n’y avait aucun courant d’affaires entre les parties pouvant s’appuyer sur une pratique arbitrale quelconque et que, enfin, s’agissant d’une entreprise agricole, elle était peu familière de l’arbitrage.
4. Pour la défenderesse, au contraire, l’acceptation de la clause compromissoire n’était pas douteuse, en ce qu’elle ressortait à la fois des usages professionnels et des pratiques contractuelles, en ce que les conditions générales d’achat avaient été visées au recto du contrat et en ce que l’arbitrage est une pratique courante en matière agricole. Elle ajoutait que, entre les parties, les conditions générales d’achat litigieuses ont toujours été acceptées par l’acheteuse qui faisait soudainement mine de découvrir la clause compromissoire au moment du litige.
5. La question portait donc sur l’opposabilité de la clause compromissoire contenue dans les conditions générales d’achat. Formulée ainsi, cette interrogation ne poserait pas de difficulté car voilà bien longtemps que le Code de procédure civile reconnaît la validité des clauses compromissoires par référence4. Le particularisme de l’espèce tenait au fait que le contrat principal avait été conclu, non par écrit, mais par oral. Certes, chacun sait que, en droit commun l’écrit n’est pas une condition de validité des contrats. Mais chacun sait aussi que l’écrit est une condition de validité de la clause compromissoire interne. En l’espèce, elle figurait dans les conditions générales d’achat. Mais l’acte qui y renvoyait, lui, ne reposait pas sur un contrat signé par les deux parties, puisqu’il s’agissait d’un bon de commande émis par la seule acheteuse, renvoyant à ses propres conditions générales d’achat. Est-ce que cela pouvait suffire ?
6. La cour d’appel de Versailles répond ici par l’affirmative arguant du fait que deux autres commandes passées le même jour, dans les mêmes conditions, avaient été exécutées par la société vendeuse. Elle ajoute que cette relation d’affaires était également constituée de douze contrats écrits conclus en 2008 et 2009, créant un véritable « courant d’affaire », et elle précise enfin que ces contrats comportaient un recto avec des conditions particulières qui renvoyaient bien au verso contenant les conditions générales dont faisait partie la clause compromissoire. La cour de Versailles répond donc de la manière suivante : « Considérant qu’en consentant par écrit à de nombreuses reprises en 2008 et 2009 aux conditions particulières, lesquelles renvoient expressément et de façon très apparente aux conditions générales figurant au verso, le GAEC a accepté que ses relations contractuelles présentes et à venir avec la société Hautbois soient régies selon lesdites conditions générales et, en particulier, accepté que les différends susceptibles de naître de ces relations soient réglés par voie d’arbitrage ; qu’il n’est pas allégué qu’il aurait été mis fin à ces relations contractuelles, la conclusion de contrats verbaux en 2010, dont deux ont été exécutés, établissent au contraire leur poursuite ». En d’autres termes, inutile de signer ces contrats pour qu’ils soient valables, surtout s’ils ont été exécutés.
7. Il est permis de ne pas être convaincu par cette solution, bien qu’elle s’inscrive dans la continuité de l’arrêt de la Cour de cassation après lequel la cour de Versailles statue. Même si l’on approuve la volonté de favoriser l’arbitrage et de donner effet à l’engagement compromissoire, et même si l’on est convaincu que les arguments de la demanderesse pour échapper à l’arbitrage ont été invoqués de mauvaise foi, il manque à notre sens une étape dans le raisonnement de la cour d’appel de Versailles pour donner plein effet à la clause compromissoire de l’espèce.
8. L’arrêt considère en effet qu’un écrit, au sens où il est signé par les deux parties, n’est plus nécessaire pour la clause compromissoire. Celle-ci peut naître des relations antérieures entre les parties, leur courant d’affaires, voire les pratiques du secteur. Il est exact que cette interprétation existe, mais pas pour l’acte principal censé sceller l’accord des parties. Elle est admise uniquement pour l’acte auquel cet accord renvoie et qui contient la clause compromissoire. Il y a ici ce qui pourrait être considéré comme une inversion des actes. Autant on peut comprendre que l’acte auquel il est renvoyé peut être d’une forme souple, au point de n’être constitué que des relations antérieures des parties, autant l’acte qui renvoie, lui, doit respecter les conditions de validité fixées par le Code de procédure civile. Or celui-ci a toujours exigé que la clause compromissoire interne soit rédigée par écrit « à peine de nullité »5. L’écrit est donc une condition de validité, et, en l’espèce, la clause compromissoire n’est pas conclue par écrit car ni l’acte principal ni l’acte auquel il est renvoyé ne sont écrits. La clause compromissoire est donc nulle.
9. Le droit de l’arbitrage est suffisamment souple et compréhensif pour ne pas outrepasser les rares contraintes qu’il impose, comme justement l’écrit ad validitatem pour la clause compromissoire interne. C’est même devenu la seule exigence. On accepte bien sûr le contrat oral en droit français, on accepte aussi la clause compromissoire par référence, mais on ne peut pas accepter le cumul des deux. Le contrat oral qui renverrait à une clause compromissoire ne reposant sur aucun écrit viole, à notre sens, l’exigence d’écrit de la clause compromissoire interne.
10. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait tenté de contourner la difficulté en posant que l’absence de preuve était finalement intégrée dans les cas d’inefficacité de l’acte principal, lesquels cédaient face au sacro-saint principe d’autonomie de la clause compromissoire. L’arrêt rapporté s’inscrit aussi dans cette logique en citant l’article 1447 nouveau du Code de procédure civile qui consacre ce principe (même si l’on sera un peu surpris qu’il soit cité comme étant l’article 1442 ancien).
11. Cette approche, pour intéressante qu’elle soit, relève en réalité de la preuve de l’acte et non de sa validité. Peu importe que pour le prouver il faille le compléter par un élément extrinsèque dès lors que l’écrit est exigé ad validitatem et non ad probationem. À trop vouloir favoriser l’arbitrage, on en oublie qu’il n’est légitime que s’il a été véritablement voulu par les parties, c’est ce qui lui donne sa pleine puissance, et c’est pourquoi le législateur a prévu que, en matière interne, la cause compromissoire doit être conclue par écrit. Ce n’est pas négociable.
TC
II – L’interprétation des sentences internationales par le juge de l’exécution et ses limites
12. CA Versailles, 16e ch., 31 mars 2016, n° 15/00782, Orion Satellite Communications c/ Russian Satellite Communications Company ; CA Versailles, 16e ch., 7 juill. 2016, n° 16/03409 RG, Orion Satellite Communications c/ Russian Satellite Communications Company. Voici que la cour d’appel de Versailles intervient à son tour dans la saga Orion, par deux arrêts, le premier ayant donné lieu à une requête en omission de statuer. C’est l’occasion pour la deuxième cour d’appel du pays de rappeler les contours du pouvoir du juge de l’exécution, à propos du contentieux relatif à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale internationale. Afin de comprendre ces décisions, il faut rappeler l’historique de l’affaire.
13. Par une sentence arbitrale rendue à Moscou le 3 décembre 2004, la société Russian Satellite Communications Company (ci-après : RSCC) fut condamnée à payer à la société Orion Satellite Communications (ci-après : Orion) la somme de 42 820 000 €, outre les intérêts. Cette sentence ayant reçu l’exequatur en France, Orion fit pratiquer une saisie-vente sur les actions détenues par sa débitrice dans le capital d’Eutelsat, afin d’avoir paiement du total de sa créance, qui, intérêts compris, s’élevait selon elle à 56 330 971,66 €.
Toutefois, le juge de l’exécution cantonna la mesure au principal de la créance, estimant que la sentence n’expliquait pas clairement comment calculer les intérêts. Saisie d’un recours contre ce jugement, la cour d’appel de Paris6 s’estima au contraire en mesure d’interpréter la sentence afin de calculer les intérêts dus par RSCC.
14. En l’espèce, selon la traduction française, la sentence indiquait que la créance devait produire « des intérêts au taux LIBOR ». Or, cet acronyme de London Interbank Offer Rate, désigne non pas un mais plusieurs taux d’intérêts, publiés chaque jour par la British Banker’s Association, à partir des taux auxquels un certain nombre de banques internationales déclarent quotidiennement être disposées à prêter et à emprunter sur le marché monétaire londonien, à plusieurs échéances et dans dix devises, notamment la livre sterling, l’euro et le dollar américain. Les taux ainsi définis varient donc chaque jour, en fonction de la devise et de la maturité, qui va d’un jour à douze mois.
Dès lors, la seule mention du « taux LIBOR » ne suffisait pas à déterminer le taux d’intérêt applicable. Toutefois, la cour d’appel de Paris constata que la version originale russe précisait « intérêts annuels au taux LIBOR ». Or, selon elle, lorsque la sentence a été rédigée dans une langue étrangère, c’est la décision elle-même et non sa traduction française qui reçoit l’exequatur. Dès lors, il fallait donner effet à la précision figurant dans la version russe.
Néanmoins, même la version russe était sibylline. D’une part, on pouvait douter que l’expression « intérêts annuels au taux LIBOR » eût pour objet de désigner un taux LIBOR à un an car elle pouvait tout autant signifier que les intérêts seraient produits annuellement, quel qu’en fût le taux. D’autre part, même en admettant que le tribunal arbitral ait voulu viser un taux LIBOR à un an, il pouvait y avoir quatre manières de calculer les intérêts, en fonction, notamment, de la date de référence retenue, comme l’expliquait un rapport d’expertise produit par Orion. Et chacune de ces manières faisait varier sensiblement la solution.
Pourtant, la cour d’appel de Paris, invoquant l’aspect contractuel de l’arbitrage, décida d’appliquer la méthode d’interprétation des conventions définie par le Code civil7, en particulier la règle selon laquelle la clause susceptible de deux sens doit être comprise dans celui où elle peut avoir un effet plutôt que dans celui où elle n’en produirait aucun8. Elle en déduisit que la sentence désignait le taux LIBOR à un an et, parmi les différents calculs possibles sur cette base, retint celui qui était le plus favorable au créancier, en ce qu’il aboutissait au montant d’intérêts le plus élevé. Assez étrangement, ce dernier choix était contraire au principe selon lequel les clauses ambiguës doivent être interprétées contre le créancier et en faveur du débiteur9. Cela dit, ce principe doit-il vraiment s’appliquer à l’exégèse d’une sentence10 ? Il faut bien admettre qu’interpréter un acte juridictionnel selon la méthode utilisée en matière contractuelle est en soi discutable.
Surtout, il était permis de reprocher à la cour d’appel de Paris d’avoir outrepassé ses pouvoirs. En effet, si le juge de l’exécution peut interpréter les titres exécutoires, y compris les sentences arbitrales, il ne doit jamais modifier le dispositif d’une décision de justice11, limite que la cour prit d’ailleurs soin de rappeler ! Or, confrontée à un chef de dispositif dont le créancier lui-même admettait qu’il était susceptible de plusieurs interprétations, la cour en avait choisi une, de manière somme toute arbitraire. N’avait-elle pas ainsi ajouté à la sentence ?
15. Naturellement, la débitrice forma un pourvoi. La Cour de cassation12 approuva la cour d’appel d’avoir considéré que c’était la sentence arbitrale elle-même qui avait reçu l’exequatur et, qu’en cas de doute, la version originale devait faire foi. Toutefois, l’arrêt fut cassé en ce qu’il avait infirmé le jugement qui limitait les effets de la saisie au principal, parce que la cour d’appel avait considéré que les deux parties étaient d’accord sur le fait que la sentence désignait un taux LIBOR annuel, alors que RSCC le contestait expressément dans ses conclusions. La cour d’appel avait donc violé le principe dispositif13.
Le motif de cassation était évidemment frustrant, puisqu’il laissait sans réponse la question relative à la différence entre interprétation et modification du dispositif d’une sentence arbitrale, essentielle pour la délimitation des pouvoirs du juge de l’exécution. Il appartenait donc à la cour d’appel de Versailles, juridiction de renvoi, de résoudre le problème, ce qu’elle fait de manière très convaincante, à travers les deux arrêts rapportés.
16. Par son arrêt du 31 mars 2016, la cour d’appel de Versailles, constate d’abord que, si les parties sont d’accord pour considérer que la sentence prévoit un calcul des intérêts moratoires sur une base annuelle, elles divergent sur la maturité du taux LIBOR à retenir. Elle observe aussi que, à supposer qu’on décide d’utiliser un taux LIBOR annuel, encore faudrait-il déterminer la date de référence pour connaître le taux exact. C’est pourquoi, le rapport d’expertise produit par Orion propose quatre calculs différents des intérêts.
Dès lors, explique la cour, déterminer le taux d’intérêt applicable irait ici « bien au-delà d’une simple interprétation de la sentence » et Orion demandait en réalité au juge de l’exécution d’opter « pour tel coût de financement plutôt que tel autre ». Autrement dit, le juge de l’exécution ne pouvait ici déterminer le montant des intérêts sans ajouter à la sentence. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a cantonné la saisie-vente au montant du principal, à l’exclusion de tout intérêt.
17. Cette analyse, qui doit être approuvée, soulève néanmoins une question : que peuvent faire les parties lorsqu’elles se trouvent, comme ici, confrontées à une sentence tellement ambiguë que son exécution nécessite une précision qui dépasse la simple interprétation ? La cour d’appel de Versailles s’attache à répondre à cette question, en rappelant un certain nombre de principes théoriques et pratiques, à partir de diverses solutions qui auraient pu être envisageables.
18. Une première solution est écartée, celle consistant, pour le créancier, à demander l’application du taux d’intérêt légal. C’est ce qu’Orion avait fait ici, à titre subsidiaire, mais la cour d’appel rejette aussi cette demande, parce que l’accueillir reviendrait à modifier le dispositif de la sentence, dès lors que l’arbitre s’était prononcé sur le taux d’intérêt, fût-ce de manière ambiguë, sans choisir le taux légal français. Cela dit, si la sentence ne s’était pas du tout prononcée sur les intérêts moratoires, la Cour aurait pu condamner le débiteur à en payer, sur la base du taux légal français14.
19. Une deuxième solution aurait consisté à demander au tribunal arbitral lui-même de préciser le sens du dispositif qu’il a adopté15. Il a en effet une marge de manœuvre légèrement plus importante que celle du juge de l’exécution. Certes, dans le cadre d’un recours en interprétation, les arbitres ne peuvent modifier le sens de leur décision mais ils peuvent légitimement préciser ce sens, parce que, justement, il s’agit de leur décision. Au cas d’espèce, le tribunal arbitral aurait pu indiquer la maturité et la date de référence du taux LIBOR. C’est tout l’intérêt de saisir le tribunal arbitral, plutôt que d’attendre que le juge de l’exécution soit amené à se prononcer. Ce dernier ne peut qu’interpréter la sentence comme un observateur extérieur, ce qui l’empêche d’expliquer la signification d’une formule objectivement obscure, alors que le tribunal arbitral peut reformuler le dispositif afin d’exprimer sa véritable intention.
Cependant, cette solution n’existe pas lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni. C’était le cas ici, parce que l’arbitre unique était décédé. Dans une telle hypothèse, en matière interne, les parties peuvent demander à la juridiction qui eût été compétente à défaut de convention d’arbitrage d’interpréter la sentence16. Cela dit, il n’est pas certain que le juge étatique puisse alors aller aussi loin que le tribunal arbitral lui-même : comment préciser la pensée d’autrui, exprimée par un libellé incompréhensible ?
Toujours est-il que cette saisine du juge étatique à la place du tribunal arbitral est impossible en matière d’arbitrage international17, en raison, observe la Cour, de son autonomie : « Lorsque des parties choisissent de confier leur différend à un tribunal arbitral international, elles décident de s’en remettre à un ordre juridique autonome sans lien avec l’ordre juridique étatique, (…) [le] principe d’autonomie de la juridiction arbitrale internationale fait échec à ce que le juge étatique vienne suppléer l’absence de tribunal arbitral ».
Dès lors, si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, la partie souhaitant voir préciser un chef de dispositif très équivoque figurant dans une sentence doit provoquer la mise en œuvre d’un nouvel arbitrage. D’ailleurs, conclut la cour, c’est parce qu’il est possible de saisir un nouveau tribunal arbitral que l’interdiction faite au juge étatique d’interpréter la sentence dans ce cas de figure ne constitue pas un déni de justice.
Néanmoins, la cour d’appel de Versailles semble négliger une difficulté. La demande ainsi présentée à un nouveau tribunal arbitral risquerait d’être déclarée irrecevable, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la première sentence, celle-ci ayant déjà tranché le point litigieux. Pour admettre la demande, il faudrait assimiler l’imprécision de la première sentence à une absence de décision.
20. À la suite de l’arrêt du 31 mars, Orion a saisi la cour d’appel de Versailles d’une requête en omission de statuer18, en prétendant que ce premier arrêt avait ignoré deux de ses demandes subsidiaires, tendant à ce que la cour applique un taux LIBOR à trois mois et à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée. Cette requête a été rejetée par l’arrêt du 7 juillet, parce que le dispositif du précédent arrêt avait débouté Orion de la totalité de ses prétentions et parce que ses motifs indiquaient clairement que la cour ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, déterminer quel taux LIBOR était applicable. La cour considère cependant que cette requête n’est pas abusive et refuse de condamner Orion à payer les dommages et intérêts réclamés par RSCC.
21. Pour conclure, observons que le mode de calcul des intérêts représente un enjeu très important lorsque le principal de la créance est élevé. Ici, parce que l’exécution de la sentence a été circonscrite au principal, RSCC a économisé environ quatorze millions d’euros, soit un tiers de sa dette !
Ainsi, la moindre ambiguïté dans la rédaction du dispositif d’une sentence peut avoir de lourdes conséquences. Certes, les motifs peuvent permettre d’éclairer le sens du dispositif mais, comme la sentence Orion le montre, ce n’est pas nécessairement le cas. Aussi, en cas de rédaction gravement défectueuse, les arbitres pourraient-ils engager leur responsabilité civile.
C’est pourquoi, ils doivent veiller à rédiger leur sentence avec soin, clarté et précision. L’approximation est toujours regrettable et nuit à l’image de l’arbitrage. De ce point de vue, le recours à un centre d’arbitrage réputé, qui procède à une relecture attentive du projet de sentence19, peut être recommandé.
De leur côté les parties elles-mêmes doivent être vigilantes et demander au tribunal arbitral d’interpréter toute disposition de la sentence qui ne serait pas claire, en prenant garde à agir avant l’expiration du délai imparti par le règlement d’arbitrage20 ou, à défaut, par la loi21, délai qui commence à courir à la notification de la sentence aux parties. Toutefois, la partie qui aurait laissé passer le délai pourrait sans doute provoquer la constitution d’un nouveau tribunal arbitral. C’est du moins ce que suggère l’arrêt du 31 mars 2016.
D’ailleurs, à la lecture de cet arrêt, on peut avoir le sentiment que la cour d’appel de Versailles a voulu, en invoquant l’autonomie de l’arbitrage international, renvoyer les arbitres et les parties à leurs responsabilités. Qui veut échapper à la justice étatique en recourant à ce mode de résolution des litiges doit en suivre les règles et en assumer les conséquences. Si l’on choisit un juge non professionnel on prend le risque de l’amateurisme : il faut savoir choisir ses arbitres ! Lorsqu’une sentence est mal rédigée, on ne saurait demander au juge étatique de la réécrire. Il doit au contraire se borner à l’interpréter, si c’est possible, et à l’exécuter. Il ne peut rien faire de plus.
DM
III – Le contrôle par le juge de l’annulation du pouvoir de conclure une convention d’arbitrage
22. CA Versailles, 1re ch., 30 juin 2016, nos 15/03050 et 15/03639, M. Ziad Fakhri et société Jnah Development S.A.L. c/ société Marriott International Hotels Inc. Par son contexte, la quatrième affaire ici commentée, comme d’ailleurs la première, reflète bien la très grande diversité de l’arbitrage. Il ne s’agit plus cette fois, comme pour la première ci-dessus rapportée, d’un contentieux agricole inférieur à 10 000 € entre entreprises françaises, mais d’un litige international entre une société libanaise et une société américaine, dans un arbitrage régi par la chambre de commerce internationale, portant sur plusieurs millions de dollars. Seul point commun avec l’affaire agricole, la sentence arbitrale a été annulée par la cour d’appel de Paris, avant que l’arrêt soit lui-même cassé par la Cour de cassation, renvoyant le dossier à la cour de Versailles.
23. Le litige prit naissance à l’occasion de l’exploitation à Beyrouth, par la société Jnah, d’un hôtel de la chaîne bien connue Marriott. Une première instance arbitrale opposait les deux parties, à l’initiative de la société Marriott qui a été déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Jnah, laquelle a même vu ses demandes reconventionnelles accueillies par une sentence arbitrale rendue le 30 octobre 2003. Inversant les rôles, c’est la société Jnah qui était demanderesse dans le deuxième arbitrage initié deux ans plus tard, le 30 juin 2005. La sentence fut rendue le 4 juin 2009 et condamna à nouveau la société Marriott pour avoir manqué à son obligation de gérer l’établissement comme un hôtel de première classe. D’esprit décidemment querelleur, la société Jnah engagea le 14 juin 2010 un troisième arbitrage à l’encontre de la société Marriott pour obtenir des dommages et intérêts suite à la résiliation du contrat de gestion de l’hôtel qui était intervenue entre-temps, le 18 juillet 2007.
24. Pensant sans doute et à juste titre qu’un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès, les parties conclurent, le 6 avril 2011, une transaction mettant fin à tous leurs litiges. Mais une sentence fut tout de même rendue dans le troisième arbitrage, le 3 février 2012, par laquelle le tribunal arbitral, à la majorité, se déclara incompétent au motif que celui qui avait engagé l’arbitrage, M. Fakhri — qui avait cédé ses parts dans la société Jnah en 2009 tout en se faisant octroyer par procuration le droit d’agir dans le litige avec la société Marriott —, n’avait conservé que le droit de finir le litige en cours (le deuxième arbitrage) et non pas celui d’en engager un nouveau (le troisième arbitrage). Il n’aurait donc pas eu le pouvoir d’agir, ce qui aurait ôté toute compétence au tribunal arbitral.
25. Bien que rendue par des arbitres expérimentés, cette sentence d’incompétence fut annulée par la cour d’appel de Paris le 17 décembre 2013 qui estima au contraire que le cédant avait conservé le droit d’agir contre la société Marriott y compris pour de nouveaux différends22. On sait que, compte tenu des conditions limitées abusives, il est rare que les sentences arbitrales internationales soient annulées, surtout lorsqu’elles sont rendues sous l’égide de la chambre de commerce internationale qui les a préalablement supervisées. Le phénomène est plus rare encore lorsque ce sont non pas des sentences au fond, mais des sentences sur la compétence. Et le cas est alors franchement rarissimes lorsqu’il s’agit de sentences qui, non pas retiennent la compétence des arbitres, mais au contraire par lesquelles ils s’en dépouillent eux-mêmes23. Lorsque les arbitres se sont spontanément déclarés incompétents, il est vraiment exceptionnel que la cour d’appel les rétablisse dans leur compétence. C’est pourtant ce qui s’est produit en l’espèce, en application de la célèbre jurisprudence Abela qui donne plein pouvoir au juge de l’annulation de rechercher, en matière de compétence arbitrale, « tous les éléments de droit et de fait permettant d’apprécier l’existence et la portée de la convention d’arbitrage »24.
26. Mais, à l’inverse de l’affaire Abela dans laquelle la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi contre l’arrêt d’annulation de la sentence d’incompétence, ici la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans une décision particulièrement remarquée25. La première chambre civile estime en effet que le juge de l’annulation a confondu une question de compétence pour laquelle il peut user « de tous les éléments de fait et de droit » et une question de recevabilité de la demande, pour laquelle son contrôle est bien plus sommaire. En d’autres termes, l’examen de la procuration de M. Fakhri relevait de la recevabilité de la demande et non de la compétence du tribunal arbitral. La cour d’appel de Paris ne pouvait donc rejuger de la recevabilité, laquelle relève du pouvoir souverain du tribunal arbitral. C’est en ces termes que l’affaire fut renvoyée à la cour d’appel de Versailles, qui a statué par l’arrêt commenté.
27. Après avoir écarté un moyen relatif à une éventuelle fraude procédurale devant le tribunal arbitral du fait de la rétribution des témoins, au motif que la preuve n’était pas rapportée de ce que cette rémunération ait influencé les témoignages (sic), la cour d’appel de Versailles adopte la solution de la Cour de cassation interprétant à son tour la question de l’étendue des pouvoirs du recourant à l’arbitrage comme relevant de la recevabilité, et non pas de la compétence, contrairement à ce que les arbitres avaient eux-mêmes écrit dans leur sentence. La cour relève que le tribunal arbitral avait procédé à une analyse minutieuse de la question, non seulement en droit libanais, applicable au litige, mais aussi en fait pour mieux évaluer la portée de la procuration obtenue par M. Fakhri. Le tribunal arbitral avait également analysé la notion de « litige existant » dont la traduction était ambiguë. Bref, le tribunal arbitral avait procédé à un examen poussé de la question au terme de laquelle il avait écarté le pouvoir du demandeur d’engager un arbitrage.
28. La cour d’appel de Versailles estime donc à son tour que cette question relevait d’un problème de recevabilité, et non de compétence. Elle rejette par conséquent le recours en annulation qui postulait qu’il s’agissait d’une question de compétence. On approuvera cette décision non sans noter la situation inextricable dans laquelle se trouve le juge de l’annulation qui doit procéder à une analyse approfondie pour savoir s’il a le pouvoir de faire cette analyse approfondie. En effet, seul un examen des faits et du droit lui permet de savoir s’il s’agit d’une question de recevabilité ou de compétence. Or dans le premier cas, il n’a pas le pouvoir de procéder à une telle investigation, alors qu’il en jouit dans le second cas. En définitive, il utilise les prérogatives du contrôle de la compétence pour juger qu’il s’agit d’une question de recevabilité pour laquelle il ne dispose pas de ces prérogatives. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que révèle cette affaire définitivement close, après trois sentences et trois arrêts, par la cour d’appel de Versailles.
TC
Notes de bas de pages
-
1.
CPC, art. 1455 anc., abrogé par le décret du 13 janvier 2011.
-
2.
CA Paris, 4 déc. 2012, n° 11/17334 : LPA 29 avr. 2013, p. 12, note Akhouad S. ; Rev. arb. 2013, p. 449, note Vidal D. ; D. 2013, p. 2938, obs. Clay T. ; Gaz. Pal. 8 janv. 2013, n° 111p1, p. 19, obs. Bensaude D.
-
3.
Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-15827 : Procédures 2014, p. 207, note Weiller L. ; Rev. arb. 2014, p. 937, note Bureau D. ; JCP G 2014, 857, § 1er, obs. Seraglini C. ; D. 2014, p. 2541, obs. Clay T. ; RTD civ. 2014, p. 641, obs. Barbier H. ; RTD com. 2015, p. 63, obs. Loquin E. ; Gaz. Pal. 22 nov. 2014, n° 201c0, p. 21, obs. Bensaude D.
-
4.
Art. 1443 anc.
-
5.
Art. 1442 anc., applicable ; art. 1443 nouv.
-
6.
CA Paris, 31 janv. 2013, n° 12/10267 RG : Juris-Data n° 2013-001677 ; Rev. arb. 2013, p. 460, note Meyer-Fabre N.
-
7.
C. civ., art. 1188 à C. civ., art. 1192 – C. civ., art. 1156 à 1164 anc.
-
8.
C. civ., art. 1191 – C. civ., art. 1157 anc.
-
9.
C. civ., art. 1190 – C. civ., art. 1162 anc.
-
10.
V. Meyer-Fabre N., note préc.
-
11.
CPC exéc., art. R. 121-1.
-
12.
Cass. 1re civ., 14 janv. 2015, n° 13-20350 : Bull. civ. I, n° 1 ; D. 2015, p. 2288, obs. Clay T. ; Gaz. Pal. 19 juin 2015, n° 228f0, p. 20, obs. Bensaude D. ; RJDA 2015, p. 552.
-
13.
CPC, art. 4.
-
14.
Cass. 1re civ., 30 juin 2004, nos 01-10269 et 01-11718, ABC International Bank c/ BaII Recouvrement : Bull. civ. I, n° 189 ; Rev. arb. 2005, p. 655, note Libchaber R. ; D. 2004, p. 3185, obs. Clay T. ; JCP G 2005, I, 676, spéc. n° 6, obs. Béguin J. ; JCP E 2004, 1860, note Chabot G. ; JDI 2005, p. 785, note Raimon M. ; RTD com. 2005, p. 267, obs. Loquin E. ; Gaz. Pal. 28 mai 2005, n° 148, p. 2, Baude-Texidor C. ; v. aussi Mouralis D., « Le contentieux devant le juge de l’exécution », in L’exécution des sentences arbitrales internationales, actes du colloque organisé à Paris le 26 septembre 2016, à paraître chez Lextenso.
-
15.
CPC, art. 1485, al. 2 et CPC, art. 1506, 4°.
-
16.
CPC, art. 1586, al. 3.
-
17.
CPC, art. 1506, 4°.
-
18.
CPC, art. 463.
-
19.
V. par ex. règl. CCI, art. 33 ; règl. CMAP, art. 23.2.
-
20.
Règl. CCI, art. 35.2 : trente jours ; Règl. CMAP, art. 28.3 : trois mois.
-
21.
C. civ., art. 1586 et C. civ., art. 1506, 4° : trois mois.
-
22.
CA Paris, 17 déc. 2013, n° 12/07231 RG : Paris Journ. intern. arb. 2014, p. 579, note Mourre A. et Pedone P. ; Rev. arb. 2014, p. 942, note Cohen D.
-
23.
Racine J.-B. : « Les sentences d’incompétence », Rev. arb. 2010, p. 729.
-
24.
Cass. 1re civ., 6 oct. 2010, n° 08-20563 : Bull. civ. I, n° 185 ; JCP G 2010, 1028, note Chevalier P. ; Rev. arb. 2010, p. 813, note Train F.-X. ; RCDIP 2011, p. 85, note. Jault-Seseke F. ; D. 2010, p. 2943, obs. Clay T. ; Paris Journ. intern. arb. 2011, p. 443, note Racine J.-B. ; D. 2010, p. 2441, obs. Delpech X. ; JCP G 2010, I, 1286, § 6, obs. Orscheidt J. ; LPA 23 févr. 2011, p. 6, obs. de Keyzer A. ; Gaz. Pal. 8 févr. 2011, n° 39, p. 14, obs. Bensaude D.
-
25.
Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 14-13336 : Bull. civ. I, n° 54 ; JCP G 2015, 877, § 7, obs. Seraglini C. ; Procédures 2015, p. 194, note Weiller L. ; LPA 28 mars 2015, p. 17, obs. Canonica A. ; Paris Journ. intern. arb. 2015, p. 343, note Fadlallah I. ; D. 2015, p. 2591, obs. Clay T. ; RDC 2015, n° 112k0, p. 555, obs. Boucobza X. et Serinet Y.-M.