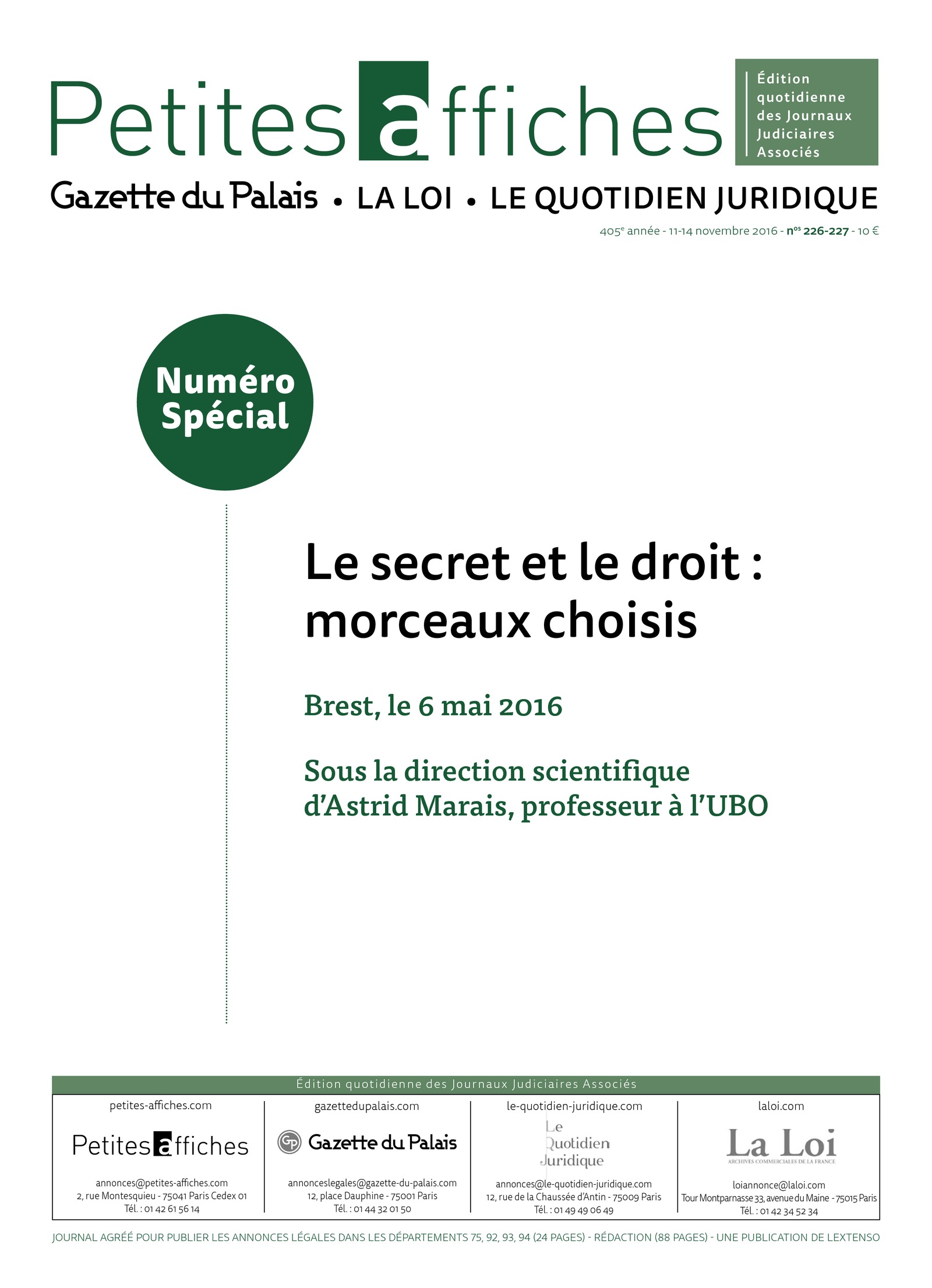Avant-propos : secret et transparence en droit des affaires
Cet avant-propos vise à mettre en perspective les différents morceaux choisis sur le secret et le droit des affaires.
Jusqu’il y a peu, le secret en droit des affaires1 n’était pas un sujet « tendance ». En effet, depuis quelques années, le dogme de la transparence2 était mis en avant. Cette politique de transparence se justifiait par deux raisons principales3 : d’une part, par un processus vertueux de transformation des pratiques des sociétés, érigé en politique législative (ainsi obligées d’informer, les sociétés allaient transformer leurs pratiques) ; d’autre part, par une volonté de renfoncer la compétitivité des entreprises sur les marchés et de doter l’Europe de la première place financière dans le monde.
Toutefois, la valeur de ces équations a été rapidement critiquée. On a ainsi évoqué le mythe de la transparence4. La transparence a pu être qualifiée d’ambiguë : elle libère mais elle induit la surveillance5. Carbonnier avait déjà évoqué les possibles dérives de la transparence en notant que la transparence cristal peut dégénérer en transparence chicane6. Par ailleurs, la transparence peut dériver vers l’apparence7.
Mais, alors que la transparence avait été prônée par des directives européennes8, le secret revient également par ce biais. En effet, une directive relative au secret des affaires a été adoptée le 13 avril dernier par le Parlement européen9. Le législateur français avait lui-même tenté d’introduire le secret des affaires lors des travaux parlementaires de la loi Macron à l’été 2015, mais sans succès. La directive affiche pour ambition de protéger les entreprises européennes contre l’espionnage économique en créant la notion juridique de « secret des affaires et protection civile »10. Divulguer des secrets d’affaires exposerait à des sanctions pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende, voire – en cas d’atteinte à la sécurité ou aux intérêts économiques de la France – à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende.
D’ores et déjà, trois critiques ont éclos. Une première critique tient à la nécessité d’un tel texte. Les défenseurs du projet ont mis en avant la constante augmentation des violations du secret des affaires : « en 2013, une entreprise de l’Union européenne sur quatre aurait fait état d’au moins un cas de vol d’informations »11. Ces chiffres ont été contestés en ce qu’ils émanent d’un bilan établi par un cabinet américain de renseignement économique12, c’est-à-dire une structure proposant des services de protection des renseignements aux entreprises et qui a donc tout intérêt à souligner ces risques, voire à les surévaluer.
Une deuxième critique tient à la difficulté d’articuler le secret des affaires avec la liberté d’information. L’affaire des Panama Papers a montré l’importance des informations que les lanceurs d’alerte peuvent révéler. Depuis quelques années, les entreprises mettent en avant leur attitude citoyenne à travers des politiques de responsabilité sociale (RSE), notamment par le biais de codes d’éthique13. Aujourd’hui, l’efficacité de ces engagements volontaires passe en partie par le risque de réputation : si une entreprise ne respecte pas les engagements éthiques qu’elle a affiché de son plein gré, elle risque de voir sa réputation ternie par la révélation des manquements à ses propres engagements. Désormais, ces manquements pourront-ils encore être révélés ? La révélation ne pourra-t-elle pas être considérée dans certains cas comme une atteinte au secret des affaires, sanctionnée pénalement ? Selon le texte justificatif, l’application de la directive ne devrait pas entraver les activités des lanceurs d’alerte. En effet, « La protection des secrets d’affaires ne devrait dès lors pas s’étendre aux cas où la divulgation d’un secret d’affaires sert l’intérêt public dans la mesure où elle permet de révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale directement pertinents »14. Dès lors, toute la question résidera dans la définition de la faute professionnelle et de la pertinence de la révélation. C’est au juge qu’il appartiendra de décider, comme c’est le cas en ce moment dans l’affaire LuxLeaks au Luxembourg qui a déjà une législation qui protège le secret des affaires. La question laisse toutefois un sentiment d’incohérence, au moment où, précisément, le Conseil d’État rend un rapport préconisant la protection des lanceurs d’alerte15.
Enfin, une troisième critique tient à l’adéquation entre le but affiché et les effets prévisibles de la directive. En effet, les défenseurs du projet au Parlement européen ont mis en avant la nécessité de protéger les PME. Certains y ont vu un leurre, considérant que ces entreprises avaient d’autres préoccupations au quotidien. À cet égard, 75 % des PME estiment que l’intervention de l’Union européenne n’est pas nécessaire16. D’autres ont souligné que cela creuserait encore plus les écarts entre les PME et les multinationales, ces dernières pouvant encore plus aisément camoufler les montages leur permettant de payer moins d’impôts17.
Ces critiques sont-elles justifiées ? Les secrets des affaires sont-ils véritablement menacés ? Les outils actuels de protection sont-ils suffisants ou insuffisants pour protéger les secrets ? Dans ce contexte agité, qu’advient-il du secret bancaire ? La nouvelle directive va-t-elle vraiment changer le paradigme en droit des affaires ? Les craintes des universitaires ont-elles du sens au regard de la pratique ? Quel équilibre peut-on trouver entre transparence et secret ? C’est à toutes ces questions que vont tenter de répondre les développements qui suivent.
Notes de bas de pages
-
1.
Sur ce sujet, v. not. Garinot J.-M., Le secret des affaires, 2013, LexisNexis, CREDIMI ; G’Sell F. et Durand-Barthez P., La protection du secret des affaires – État des lieux en droit civil français et projet européen, 2015, Lextenso-Fondation pour le droit continental ; Py E. et Garinot J.-M., La protection des secrets d’affaires – Enjeux et perspectives, 2015, LexisNexis ; Du Manoir de Juaye T., Le secret des affaires, 2016, LexisNexis, Droit Professionnels.
-
2.
V. not. Reygrobellet A., Les vertus de la transparence – L’information légale dans le droit des affaires, 2011, Presses de Sciences Po-Creda.
-
3.
Drummond F., « L’information des actionnaires et des investisseurs », in Colloque Deauville « Entreprise : information et rumeur », RJC 2005, n° spécial, p. 20 et s.
-
4.
Chaput Y., « La transparence : clair-obscur juridique d’un concept économique », in Colloque Deauville « Entreprise : information et rumeur », préc., p. 7, spéc. p. 11. V. aussi Salin P. et Maine M., « Le mythe de la transparence imposée », JCP E 2003, 1586.
-
5.
Bury B., « La transparence en droit des affaires : quelle valeur ? », in « Transparence en droit des affaires », JDS 2006, p. 23.
-
6.
Carbonnier J., « Propos introductifs », in Colloque Deauville « La transparence », RJC 1993, n° spécial, p. 9, spéc. p. 13.
-
7.
Chaput Y., art. préc., p. 12.
-
8.
Voir notamment la directive n° 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, la directive n° 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières et la directive n° 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence.
-
9.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 28 novembre 2013, sur la protection du savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, COM(2013) 813 final. V. récemment Lapousterle J., « Les secrets d’affaires, du serpent de mer au JO ? », D. 2016, p. 1072.
-
10.
Proposition de directive COM (2013) 813 final, exposé des motifs.
-
11.
V. not. Durand A.-A. et Damgé M., « Les Panama Papers auraient-ils été possibles avec la directive sur le secret des affaires ? », Le Monde, 20 avr. 2016. On trouve aussi d’autres chiffres : environ 34 % des entreprises détentrices de secrets d’affaires interrogées dans le cadre de la consultation publique menée par la Commission déclarent avoir déjà fait l’objet d’un vol d’informations confidentielles, SWD(2013) 471 final, p. 17.
-
12.
Le rapport présenté par Frantz J., La protection des secrets des affaires dans l’Union européenne, adopté par la CCI Paris, 11 sept. 2014, cite le rapport Hogan Lovells International LLP, Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes), Report on Trade Secrets for the European Commission, MARKT/2010/20/D, ainsi qu’un rapport de Baker & McKenzie, Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market, final study April 2013, MARKT/2011/128/D.
-
13.
V. not. le colloque « Les codes d’éthique : un nouveau défi pour les entreprises », Cah. dr. entr., n° 4, juill.‐août 2014, et notre participation à ce colloque, Goffaux Callebaut G., « La relation symbiotique des codes d’éthique et de la RSE », p. 33.
-
14.
Directive précitée, considérant 20 et article 5 (selon les dernières corrections du 25 mai 2016. V. sur ce point Garinot J.-M., « Secret des affaires : n’ayez pas peur », Dalloz actualité, 20 avr. 2016.
-
15.
Conseil d’État, Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger, La documentation française, Les études du Conseil d’État, 13 avr. 2016.
-
16.
V. les débats au Sénat, Commission des affaires européennes, 17 déc. 2013, http://www.senat.fr/ue/pac/E8922.html.
-
17.
Sur cette question, v. A. Coignac, « 3 questions à Eric Alt », JCP G 2016, 578, spéc. n° 19.