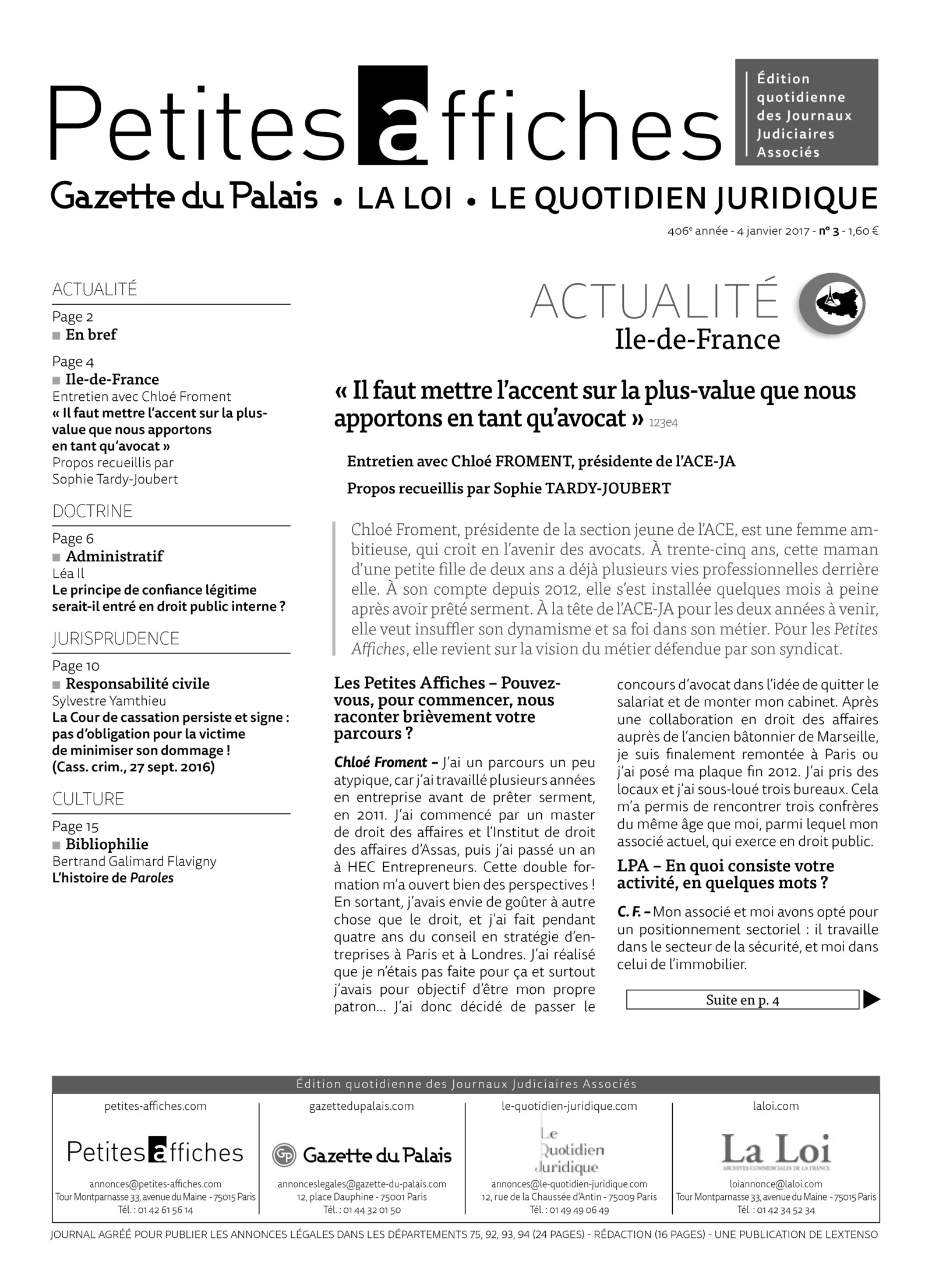La Cour de cassation persiste et signe : pas d’obligation pour la victime de minimiser son dommage !
La Cour de cassation persiste et signe : pas d’obligation pour la victime de minimiser son dommage. Selon cette cour, le refus par la victime d’un accident de la route de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infraction ; ce qui apparaît fortement contestable. La solution dégagée par la Cour de cassation pourrait, à certains égards, être interprétée comme une légitimation de l’aggravation du dommage par la victime.
Cass. crim., 27 sept. 2016, no 15-83309, PB
1. Petite « mine d’or » juridique, ainsi pourrait-on qualifier l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 2016 et publié au Bulletin1. La chambre criminelle a eu l’occasion de se prononcer sur plusieurs questions tenant à l’indemnisation de préjudices. Ainsi a-t-elle notamment rappelé sa position sur les conditions de la réparation de la perte d’une chance, sur la réparation du préjudice de mort imminente ou sur le point de départ du doublement de l’intérêt légal imposé à l’assureur qui a tardé à présenter son offre d’indemnisation.
2. Bien que cohérente au regard de la position déjà adoptée par la Cour, la motivation de cet arrêt et la position tenue sur chacune de ces questions nous paraît pouvoir être sujet à discussion. Cependant, seule la question de l’obligation de minimiser son propre dommage, dont la victime serait éventuellement débitrice, retiendra notre attention. C’est en effet sur cette question que la Cour de cassation était la plus attendue en raison des critiques formulées à sa position antérieure et de la résistance menée par les juridictions de fond. Or, alors que les derniers coups tirés contre son arrêt du 15 janvier 2015 affirmant que le refus de soins ne peut justifier une limitation de la réparation intégrale, « fument encore »2, la Cour de cassation persiste et signe : pas d’obligation pour la victime de minimiser son dommage ; ce qui apparaît fortement contestable.
3. En l’espèce, une étudiante, victime d’un accident de voiture à la suite duquel son époux est décédé, développe un « syndrome psychologique post-traumatique avec état dépressif » qui la contraint à mettre un terme à ses études. Des poursuites pénales sont engagées contre l’auteur du délit routier et, à cette occasion, la veuve réclame diverses indemnités au titre de la réparation de ses préjudices. En première instance, le juge déboute la victime de sa demande au titre de son préjudice universitaire, résultant de la perte d’une ou plusieurs années d’études, à l’origine d’un simple retard dans la formation, d’un changement d’orientation, voire d’une renonciation à toute formation.
À la suite de l’appel interjeté par la victime, la cour d’appel de Dijon confirme la décision du tribunal de grande instance, soulignant que la victime avait délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient prescrits par les experts pour suivre son propre traitement. Selon la cour d’appel, la victime a, par cet acte, participé à la dégradation de son état psychologique, remettant ainsi en cause toute possibilité de reprendre les études engagées avant l’accident. La cour conclut en conséquence que la réparation doit être limitée à la suite du comportement fautif de la victime.
4. La demanderesse a alors porté le litige devant la Cour de cassation qui a dû répondre à la question de savoir si le comportement de la victime peut avoir une incidence sur la réparation de son dommage corporel. Plus exactement, la victime a-t-elle l’obligation de minimiser son dommage ?
5. La Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le refus par la victime d’un accident de la route de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infraction (I). La solution dégagée par la Cour de cassation pourrait donc, à certains égards, être interprétée comme une caution à l’aggravation du dommage par la victime. Pourtant, la responsabilité civile suppose encore et toujours un dommage subi par une victime et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage lui-même. Or, il est fort probable que le lien de causalité soit brisé ou altéré, notamment lorsque la victime ne minimise pas son dommage alors qu’elle en a les possibilités, ou lorsqu’elle adopte un comportement de nature à l’aggraver. À tout le moins, la position de la haute cour, qui implique certaines conséquences, suggère qu’elle n’est pas prête à admettre cette obligation en matière de dommage corporel (II).
I – Le caractère non fautif du refus par une victime de suivre un traitement
6. Une victime qui voit son dommage aggravé par son propre fait, notamment à la suite de l’arrêt d’un traitement prescrit par le médecin et opte pour une automédication, peut-elle prétendre à la réparation intégrale de son préjudice ? À cette question, la Cour de cassation reste constante et nie toute obligation de la victime de minimiser son propre dommage rejetant ainsi le caractère fautif de l’arrêt d’un traitement médical3. Cette constance de la Cour de cassation s’observe également à travers les visas ou fondements par lesquels la haute juridiction rappelle sa position. Il s’agit notamment du principe de la réparation intégrale (A) et du consentement du patient aux soins (B).
A – La réaffirmation du principe de la réparation intégrale
7. La Cour de cassation fait droit à la demande de la victime en se fondant sur l’article 13824 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). Elle rappelle à cet effet que « l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences dommageables (…) et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ». La Cour de cassation souligne ainsi son attachement au principe de la réparation intégrale du dommage. Il s’agit de placer la victime dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de dommage5. Elle ne doit subir ni perte ni profit et le responsable ne saurait être tenu de réparer le dommage ni au-delà ni en-deçà du préjudice subi.
Pour soutenir sa demande en réparation, la victime met en avant le fait qu’elle a subi un préjudice universitaire et professionnel très important, notamment en ce qu’elle n’a pu reprendre le cours de ses études et viser la carrière professorale qu’elle envisageait avant l’accident. Le préjudice universitaire invoqué entre dans la catégorie des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), au sein de la nomenclature Dintilhac. La réparation de ce préjudice est gouvernée par le principe de la réparation intégrale. L’objectif est de réparer la perte d’années consécutive à la survenance du dommage6.
Si de ce point de vue la réparation intégrale est satisfaisante pour la victime, elle serait en revanche assez sévère pour l’auteur du dommage, notamment lorsqu’une action de la victime aurait pu contribuer à réduire l’étendue de son préjudice. En réalité, la mise en œuvre de la réparation intégrale n’est qu’une application de la théorie de l’équivalence des conditions. Selon cette théorie, toute cause est à l’origine de l’intégralité du dommage. Tous les faits sans lesquels le dommage ne se serait pas produit sont dès lors considérés comme en étant la cause. Ainsi, la victime qui refuse de se soigner et opte pour une automédication, serait fondée à demander la réparation liée aux conséquences des médicaments qu’elle s’est auto-prescrite. L’application stricte des règles issues de cette théorie pourrait entraîner des conséquences difficiles à maîtriser.
8. On se demande alors si la théorie de l’équivalence des conditions ne devrait pas, à certains égards être assouplie à défaut d’être écartée au profit de la théorie de la causalité adéquate. Cette théorie implique l’identification de la cause adéquate, c’est-à-dire la cause qui a provoqué le dommage.
Cette approche ne serait pas nouvelle dans la mesure où, si la jurisprudence, notamment celle de la deuxième chambre civile, privilégie l’application de la théorie de l’équivalence des conditions, elle sait s’en séparer ou l’assouplir lorsque son application devient déraisonnable. En faisant preuve de pragmatisme et de bon sens, « elle refuse de retenir l’existence du lien de causalité quand il lui paraît trop lâche ou trop incertain »7. Ainsi, dans plusieurs espèces, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a écarté la causalité, notamment lorsque s’intercale une circonstance causale qui n’a pas été provoquée ou rendue nécessaire par le fait de l’auteur du dommage initial8. Il a même été observé, qu’à certains égards, la première et la troisième chambre civile écartent le lien de causalité lorsque ce fait apparaît comme insusceptible d’entraîner rationnellement l’enchaînement causal9.
9. Sur le fondement de cette jurisprudence, la victime dont le sort a été aggravé à la suite du refus de se soigner au profit de la prise de médicaments dont elle s’est auto-prescrite, aurait pu voir sa réparation réduite. Dans l’arrêt commenté, la chambre criminelle épouse la solution dégagée par la deuxième chambre civile qui a érigé en principe le refus d’une obligation pour la victime de minimiser son dommage. D’un certain point de vue, cela pourrait s’expliquer en ceci que le juge pénal s’aligne sur ce que dit le juge de la réparation. Se pose alors la question de savoir si la solution de la chambre criminelle aurait été différente si les chambres civiles adoptaient une solution contraire. La réponse à cette question est délicate, dans la mesure où le juge de la chambre criminelle reprend les fondements avancés par la chambre civile. En l’espèce, le juge a estimé qu’il n’est pas certain que la victime ait commis une faute de nature à réduire sa réparation. Ainsi, la haute juridiction réaffirme son attachement au respect du principe du consentement à l’acte médical.
B – La réaffirmation du principe du consentement à l’acte médical
10. La victime a non seulement délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient prescrits par les spécialistes, mais en outre elle a adopté un traitement choisi sans prescription médicale. Ce choix a conduit à la dégradation de son état psychologique et a empêché la poursuite de ses études engagées avant l’accident.
Se fondant sur les articles 16-3 et L. 111-4 du Code de la santé publique, la Cour de cassation souligne conformément à sa jurisprudence antérieure10, que nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par les lois, de subir un traitement médical. La chambre criminelle renouvelle ainsi son attachement au principe du consentement du patient à l’acte médical. Elle souligne à cet effet que le refus d’une personne, victime d’une infraction pénale, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut constituer une faute de nature à entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infraction.
11. Toutefois, il convient de souligner que, la Cour de cassation n’a pas toujours reconnu ce principe et a déjà eu l’occasion de retenir que le refus de se soigner pouvait constituer une faute de la victime. Dans une affaire, la victime avait refusé de se soigner et s’était alors « privée d’une chance d’amélioration ou de survie ». La Cour de cassation avait alors reconnu « qu’une telle faute doit être retenue pour la réparation du préjudice subi lorsque ce refus a concouru à la réalisation du dommage »11.
Cette position a fait l’objet d’un revirement total initié par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 1997. Dans cette décision, la Cour a rejeté cette obligation de minimiser le dommage en relevant, sur le fondement de l’article 16-3 du Code civil, que « nul ne peut être contraint hors les cas prévus par la loi de subir une intervention chirurgicale »12.
12. On l’a dit, c’est au visa de l’ancien article 1382 que la Cour fonde, en grande partie, sa décision : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Si c’est donc à bon droit que le juge énonce sa solution, cela signifie a contrario que c’est ce droit qui n’est « pas bon ». La haute juridiction reste donc cantonnée à la lettre et à l’esprit de la loi. Or, du côté du législateur, le renouveau, en l’occurrence, la consécration de l’obligation pour la victime de minimiser son dommage en matière corporelle, n’est pas pour demain.
Cependant, en matière contractuelle, l’avant-projet portant réforme de la responsabilité civile tend à modifier partiellement le droit français sur la question. Le texte, dans sa version du 29 avril 2016, prévoit notamment que « le juge peut réduire les dommages et intérêts lorsque la victime n’a pas pris les mesures sûres et raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter l’aggravation de son préjudice »13.
En revanche, le statu quo semble de mise en matière délictuelle, notamment par la réaffirmation du principe de la réparation intégrale dans la formule consacrée par la Cour de cassation : « la réparation doit avoir pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu. Il ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit »14. Si le principe de la réparation intégrale s’explique en matière corporelle, on se demande s’il n’aurait pas été opportun, de saisir l’occasion du projet de réforme en cours, pour moraliser le droit de la responsabilité civile, notamment les conséquences sur l’indemnisation de la victime.
II – Les conséquences sur l’indemnisation de la victime
13. La victime ayant délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient prescrits par les médecins pour poursuivre son propre traitement, a non seulement participé à la dégradation de son état, ruinant toute possibilité de restaurer la poursuite de ses études engagées avant l’accident, mais pire encore, elle a contribué à son aggravation. Se pose alors la question suivante : si la victime n’a pas l’obligation de minimiser son dommage, peut-elle pour autant l’aggraver impunément ? La question se pose dans la mesure où la solution dégagée par la haute cour pourrait être interprétée comme une légitimation de l’impunité de l’aggravation du dommage par la victime (A). Au regard de la résistance observée dans les décisions des juges de fond, on se demande si la mutation du régime de l’incidence du comportement de la victime sur la réparation serait poussée par les juridictions du fond (B).
A – La légitimation de l’« aggravation » du dommage par la victime
14. Les médecins ont estimé qu’un traitement antidépresseur assorti d’un suivi psychothérapique et psychiatrique, aurait permis de faire disparaître, dans un intervalle de trois à cinq ans, les séquelles du « syndrome psychologique post-traumatique » diagnostiqué chez la victime. Pour cette raison, un traitement approprié lui a été prescrit. Or, la victime a délibérément cessé ce traitement au profit des médicaments qu’elle s’est auto-prescrits. Cela a contribué, semble-t-il, à aggraver son état, notamment par le développement de difficultés cognitives.
La solution dégagée par la Cour de cassation pourrait donc, à certains égards, être interprétée comme une caution à l’aggravation du dommage par la victime. Mais la question doit être abordée avec prudence car, au fond, il s’agit de rechercher un équilibre entre des libertés fondamentales, notamment le libre consentement du patient aux soins prévu à l’article 16-1 du Code civil, et le principe de la réparation intégrale du dommage. Cette réparation est subordonnée à trois conditions en l’occurrence une faute, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et la faute.
Or, sur le terrain de la causalité, doit-on admettre que la progression du dommage est toujours et nécessairement la suite immédiate et directe de la faute ? Si le comportement de la victime, au moment de la réalisation du dommage, peut faire l’objet d’un examen, par conséquent, il serait plus cohérent que cet examen se prolonge postérieurement à l’apparition du dommage. Cela s’explique d’autant que l’activité et la passivité de la victime peuvent avoir pour effet de rompre le lien de cause à effet. Dans cette hypothèse, le surcroît de préjudice ne serait plus rattaché au fait dommageable initial.
15. Si la victime ne peut subir ni perte ni profit, le principe de la réparation intégrale n’impliquerait-il pas corollairement que l’auteur de l’acte dommageable ne saurait être obligé à réparer plus, et par conséquent à supporter le coût d’une évolution du dommage qui aurait pu être postérieurement évitée par la victime ? À supposer que l’on admette l’idée largement admise au sein de la doctrine selon laquelle il ne serait pas souhaitable d’introduire une obligation pour la victime de minimiser son dommage dans l’intérêt de la victime en matière corporelle, ne serait-il pas opportun de poser, à tout le moins, que cette victime ne devrait pas pour autant aggraver son préjudice dans le but d’élargir l’assiette de la réparation ?
À cet effet, il a été suggéré d’introduire une distinction entre les actes médicaux graves, douloureux ou risqués que la victime pourrait refuser sans que cela lui soit reproché et ceux qui, bénins et sans danger, devraient être acceptés sous peine de se voir opposer une faute15. Cette distinction serait le gage du rééquilibrage et de l’équité de la responsabilité civile en matière de dommages corporels. L’équation à résoudre reste toutefois difficile, au regard des différents droits qui entreraient en conflit, mais la moralisation du droit de la responsabilité passerait aussi par cette distinction. Le défi est de créer un système où les règles du droit de la responsabilité civile délictuelle entraînent des réparations justes ainsi que l’envisagent déjà certaines juridictions de fond.
B – La mutation par la résistance des juridictions du fond ?
16. Par deux arrêts du 19 juin 2003, la chambre civile de la Cour de cassation avait clairement exprimé sa position, notamment son opposition à une obligation pour la victime de minimiser son dommage. Dans la première espèce16, une cour d’appel décida de réduire le montant de l’indemnisation allouée au titre de l’IPP en retenant le comportement fautif de la victime. En l’espèce, pour les troubles psychiques retenus par l’expert, la victime avait refusé de pratiquer une rééducation orthophonique et psychologique, alors qu’elle lui avait été recommandée et rappelée, à deux reprises, par son neurologue et son neuropsychologue. La cour d’appel avait donc conclu que ce refus constituait une faute ayant contribué, en partie, à la résistance de troubles psychiques. Dans la deuxième affaire17, une cour d’appel avait conclu à l’absence d’un lien de causalité entre l’accident et la perte d’un fonds de commerce, au motif que le comportement de la victime était la seule cause du dommage. En l’espèce, une femme qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie et sa fille avaient été blessées lors d’un accident de la circulation. La mère (propriétaire) a sollicité la réparation du préjudice résultant de la perte du fonds du fait de son inexploitation durant plusieurs années. En revanche, pour obtenir réparation, la fille (héritière potentielle) a invoqué la perte d’une chance d’avoir pu reprendre un fonds de commerce prospère. La cour d’appel rejeta les deux demandes au motif que la propriétaire « avait la possibilité de faire exploiter le fonds par un tiers et que si elle a choisi de le laisser péricliter, elle ne saurait en imputer la responsabilité à l’auteur de l’accident [et] que la perte de valeur du fonds n’[était] pas une conséquence de l’accident ». Au regard des faits ayant conduit aux deux arrêts de 2003, on s’aperçoit que la haute juridiction a manqué une occasion de nuancer le refus de l’obligation pour la victime de minimiser son dommage.
17. Malgré la solution discutable de la Cour de cassation, on se serait attendu à ce que les juges de fond s’alignent sur cette position. Mais, les décisions ultérieures rendues par certains tribunaux et certaines cours d’appel traduisent une « résistance », des juridictions inférieures. Par exemple, dans l’arrêt commenté, la cour d’appel de Dijon s’est fondée sur le comportement de la victime pour limiter la réparation du préjudice universitaire. Dans une autre espèce postérieure à 2003, une cour d’appel a, en 201018, limité la réparation de la victime au motif que ses besoins pouvaient être résolus par des solutions plus simples, moins contraignantes et plus économiques que celle consistant à garantir à la victime l’assistance d’une tierce personne durant toute la nuit. Mais l’arrêt de la cour d’appel a été cassé au visa du principe selon lequel l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable19. Plus récemment encore, en 2013, la cour d’appel de Douai a limité la réparation au motif que la perte de gains professionnels futurs invoquée par la victime n’expliquait pas en quoi elle n’avait pas persévéré dans la voie d’un emploi en atelier protégé, alors que l’expérience qu’elle y avait faite était concluante20. Cette décision n’a pas échappé à la censure de la Cour de cassation21.
18. Se pose alors la question de savoir combien de temps la haute juridiction continuera à censurer les décisions des juges du fond posant l’obligation pour la victime de minimiser son dommage ou des mesures tendant à limiter la réparation au regard du comportement de la victime après la réalisation du dommage. À tout le moins, la divergence observée entre la Cour de cassation et les juridictions de fond montre la nécessité d’une clarification ou du moins d’une évolution de l’incidence du comportement de la victime au moment de l’évaluation du préjudice corporel.
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. crim., 27 sept. 2016, n° 15-83309.
-
2.
Guégan-Lécuyer A. , note sous, Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-16011 : Gaz. Pal. 2 juill. 2015, n° 230x4, p. 11.
-
3.
Cass. 2e civ., 28 oct. 1954 ; Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 00-22302 ; Cass. 1re civ., 3 mai 2006, n° 05-10411 ; Cass. 1re civ., 24 nov. 2011, n° 10-25635 ; Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, n° 12-13851 ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-17599 ; Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 01-13289 ; Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 00-22302. Dans cet arrêt, la Cour de cassation nie toute obligation de la victime de minimiser son propre dommage (Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 01-13289, Dibaoui c/ Flamand et a.).
-
4.
v. C. civ., art. 1240 nouv.
-
5.
Cass. 2e civ., 28 oct. 1954 : Bull. civ. II, n° 328 ; JCP G 1955, II, note Savatier R. Cette formulation est reprise par l’article 1258 de l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile (version du 29 avril 2016 en discussion à la Chancellerie).
-
6.
Cass. 2e civ., 9 avr. 2009, n° 08-15977.
-
7.
Jourdain P., « Causalité : les limites raisonnables de l’équivalence des conditions », note sous Cass. 2e civ., 8 nov. 2007, n° 06-19655 : RTD civ. 2008, p. 307.
-
8.
Cass. 2e civ., 8 févr. 1989, nos 87-19167 et 87-19821 : RTD civ. 1989, p. 556 – Cass. 2e civ., 18 juin 1997 : Bull. civ. II, n° 198 – Cass. 2e civ., 24 févr. 2000, nos 98-17861 et 98-14185 : RCA 2000, comm. 144 – Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, nos 05-17199 et 05-16645 : RTD civ. 2007, p. 128.
-
9.
Cass. 1re civ., 30 sept. 1997, n° 95-16500 : Bull. civ. I, n° 259 ; RCA 1997, comm. 373 – Cass. 3e civ., 19 févr. 2003 : RTD civ. 2003, p. 50.
-
10.
Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 00-22302.
-
11.
Cass. crim., 30 oct. 1974, n° 73-93381.
-
12.
Cass. 2e civ., 19 mars 1997, n° 93-10914 : RTD civ. 1997, p. 675.
-
13.
v. art. 1263 issu de la réforme de la responsabilité civile, ouvert à consultation publique par le garde des Sceaux, le vendredi 29 avril 2016.
-
14.
Cass. 2e civ., 28 oct. 1954 : Bull. civ. II, n° 328 ; JCP G 1955, II, note Savatier R. Cette formule est reprise par l’article 1258 issu de la réforme de la responsabilité civile (version du 29 avril 2016 en discussion à la Chancellerie).
-
15.
Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 01-13289 : RTD civ. 2003, p. 716, note Jourdain P.
-
16.
Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 01-13289, ibid.
-
17.
Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 00-22302.
-
18.
CA Paris, 1er mars 2010, cité dans Cass. 2e civ., 25 oct. 2012, n° 11-25511.
-
19.
Cass. 2e civ., 25 oct. 2012, n° 11-25511 : D. 2013, p. 415, note Guégan-Lécuyer A.
-
20.
CA Douai, 24 nov. 2011, citée dans Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-15373 : D. 2013, p. 2658.
-
21.
Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-15373 : D. 2013, p. 2658.