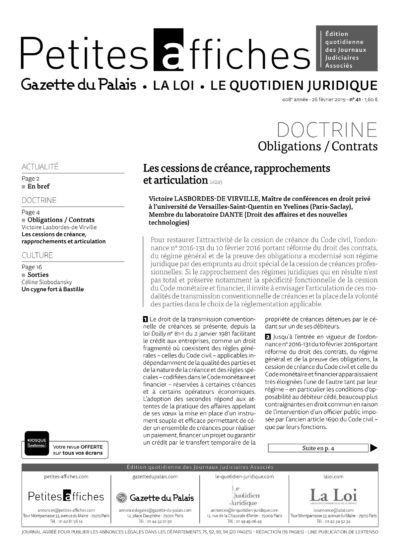Les cessions de créance, rapprochements et articulation
Pour restaurer l’attractivité de la cession de créance du Code civil, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a modernisé son régime juridique par des emprunts au droit spécial de la cession de créances professionnelles. Si le rapprochement des régimes juridiques qui en résulte n’est pas total et préserve notamment la spécificité fonctionnelle de la cession du Code monétaire et financier, il invite à envisager l’articulation de ces modalités de transmission conventionnelle de créances et la place de la volonté des parties dans le choix de la réglementation applicable.
1. Le droit de la transmission conventionnelle de créances se présente, depuis la loi Dailly n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, comme un droit fragmenté où coexistent des règles générales – celles du Code civil – applicables indépendamment de la qualité des parties et de la nature de la créance et des règles spéciales – codifiées dans le Code monétaire et financier – réservées à certaines créances1 et à certains opérateurs économiques2. L’adoption des secondes répond aux attentes de la pratique des affaires appelant de ses vœux la mise en place d’un instrument souple et efficace permettant de céder un ensemble de créances pour réaliser un paiement, financer un projet ou garantir un crédit3 par le transfert temporaire de la propriété de créances détenues par le cédant sur un de ses débiteurs.
2. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la cession de créance du Code civil et celle du Code monétaire et financier apparaissaient très éloignées l’une de l’autre tant par leur régime – en particulier les conditions d’opposabilité au débiteur cédé, beaucoup plus contraignantes en droit commun en raison de l’intervention d’un officier public imposée par l’ancien article 1690 du Code civil – que par leurs fonctions, la fonction de garantie du cessionnaire étant réservée, par la jurisprudence, à la cession de créances professionnelles régie par les dispositions du Code monétaire et financier4. Si la réforme de 2016 n’est pas allée jusqu’à reconnaître une fonction de garantie à la cession de créance du Code civil, elle s’est inspirée de la législation spéciale pour en moderniser le régime renouvelant ainsi les perspectives que pourrait offrir cet instrument de transmission de créances délaissé en raison de son inadaptation aux exigences de la vie des affaires5.
L’ordonnance du 10 février 2016 procède, par ailleurs, à un changement de localisation du mécanisme au sein du Code civil. La cession de créance quitte le titre consacré au contrat de vente pour intégrer, au sein de celui relatif au régime général des obligations, le chapitre sur les opérations sur obligations où elle précède la nouvelle cession de dette et deux opérations créatrices d’obligations plus familières, la novation et la délégation. Formellement détachée de la vente, la cession de créance se présente comme un instrument susceptible de constituer le support d’opérations translatives variées, à titre onéreux comme à titre gratuit6. Elle profite surtout de changements de fond illustrant un constat plus général à propos de la réforme de 2016, celui de l’influence des droits spéciaux sur le droit commun des contrats. Si le législateur a emprunté au droit de la consommation certaines techniques de protection du contractant pour répondre à une exigence – nouvelle en droit commun7 – de justice contractuelle8, les articles 1321 et suivants du Code civil s’inspirent quant à eux des dispositions du Code monétaire et financier spécifiques aux cessions de créances professionnelles9. Cette modernisation de la cession de créance du Code civil issue de la réforme procède ainsi à un rapprochement des régimes juridiques applicables à la transmission conventionnelle de créances, le droit commun puisant dans le droit spécial la plupart de ses innovations (I). Ce rapprochement invite alors à envisager l’articulation entre ces deux mécanismes transférant la propriété de créances (II), celui du Code civil à l’attractivité restaurée par les emprunts au droit spécial et celui du Code monétaire et financier dont l’attractivité semble à première vue menacée par l’atténuation du particularisme de son régime juridique.
I – Rapprochement des régimes juridiques des cessions de créance
3. Si les dispositions du Code civil relatives à la cession de créance s’inspirent incontestablement de la réglementation que le Code monétaire et financier réserve aux cessions de créances professionnelles, le rapprochement des régimes juridiques n’est pas total (A). Le droit applicable à la cession Dailly présente des spécificités qui contribuent à son attractivité (B).
A – Les emprunts au régime spécial de la cession de créances professionnelles
4. Pour répondre à l’objectif de modernisation des modalités de transmission des obligations, l’ordonnance du 10 février 2016 s’est inspirée des dispositions du Code monétaire et financier tant en ce qui concerne l’objet de la cession que les conditions de son opposabilité aux tiers. En revanche, le formalisme qui entoure désormais la cession de créance du Code civil s’accorde mal avec la simplification recherchée.
5. L’objet de la cession. L’objet de la cession est entendu largement par l’article 1321 du Code civil selon lequel la transmission « peut porter sur une ou plusieurs créances, présentes ou futures, déterminées ou déterminables ». La réforme réalise ainsi un premier rapprochement avec la législation spéciale en reconnaissant la possibilité de céder, par un seul et même contrat, plusieurs créances détenues sur un ou plusieurs débiteurs10. Le second rapprochement tient dans l’affirmation de la cessibilité de la créance future, déjà admise par la jurisprudence11, et désormais consacrée par le Code civil. Par créance future, il faut entendre une créance dont l’élément générateur existe déjà au jour de la cession comme une créance de loyers à venir d’un contrat de bail déjà conclu par le cédant ou celle résultant de contrats d’application à conclure en exécution d’un contrat-cadre. Elle se distingue en cela de la créance simplement éventuelle dont le fait générateur n’existe pas encore parce que, par exemple, le contrat de bail de nature à générer les créances locatives n’est pas encore conclu au jour de la cession. Bien que l’article 1321 du Code civil n’envisage que la créance future, une créance éventuelle devrait pouvoir être cédée dès lors qu’elle est déterminable. La Cour de cassation a déjà admis que des créances futures ou éventuelles puissent faire l’objet d’une cession « sous la réserve de leur suffisante identification »12 et le droit spécial n’y semble pas hostile, envisageant la cession comme le nantissement de créances « résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés »13. La validité de la cession au regard de l’exigence de déterminabilité qu’imposent les articles 1321 et 1163 du Code civil implique donc une identification suffisante de la créance. Par quels éléments ? Les juges pourraient s’inspirer des dispositions du Code monétaire et financier14 et accueillir des éléments d’identification alternatifs à l’identité du débiteur telle qu’une qualité15 – par exemple celle de locataire d’un bail à conclure par le cédant –, un lieu de paiement ou tout autre élément de nature à permettre cette identification. Pour autant, si la liberté contractuelle implique celle de céder une créance éventuelle suffisamment identifiable, l’admettre n’est pas sans risque pour le cessionnaire. Ayant acquis la créance à ses risques et périls ou en connaissance de son caractère incertain16, le cessionnaire ne devrait plus pouvoir bénéficier de la garantie d’existence de la créance que l’article 1326 du Code civil fait peser sur le cédant. En consentant à la cession d’une créance seulement éventuelle, fût-elle déterminable, le cessionnaire prend un risque dont il ne saurait ensuite invoquer la réalisation auprès du cédant. L’enjeu attaché à la reconnaissance de la cessibilité d’une créance éventuelle se trouve, par ailleurs, limité par le législateur. Le Code civil diffère en effet au jour de la naissance de la créance l’effet translatif de la cession entre les parties comme à l’égard des tiers17.
6. L’opposabilité de la cession aux tiers. La principale manifestation du rapprochement des régimes de transmission conventionnelle de créances concerne l’opposabilité de la cession aux tiers. L’objectif recherché par le législateur était de restaurer l’attractivité du mécanisme de droit commun affecté par la formalité lourde et onéreuse de la signification de la cession par exploit d’huissier18. L’ordonnance du 10 février 2016 lui substitue des modalités plus souples dissociant, sur le modèle des réglementations spéciales19, l’opposabilité aux tiers, fixée à la date de l’acte20, de l’opposabilité au débiteur cédé laquelle résulte de la notification qui lui est adressée par le cessionnaire ou de sa prise d’acte de la cession21. À l’égard des créances professionnelles, l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier précise il est vrai que « la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise ». L’opposabilité immédiate de la cession à la date du bordereau joue donc aussi à l’égard du débiteur cédé ce qui n’est pas la solution retenue par l’article 1324 du Code civil. Toutefois, une lecture a contrario de l’article L. 313-28 selon lequel à compter de la notification22 le débiteur ne se libère valablement qu’entre les mains du cessionnaire, assouplit la règle de l’opposabilité immédiate de la cession23. Jusqu’à la notification, le cédé est fondé à croire que le cédant, auprès duquel il effectuerait un paiement, agit au nom et pour le compte du cessionnaire en vertu d’un mandat de recouvrement. Son paiement est libératoire comme celui réalisé avant que la cession ne lui soit opposable.
La notification de la cession civile de créance purge, par ailleurs, certaines exceptions que le cédé entendrait opposer au cessionnaire. L’article 1324, alinéa 2, du Code civil distingue à cet égard les exceptions inhérentes à la dette (telles que, précise le texte, la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes), opposables quelle que soit leur date de survenance24 et celles « nées de ses rapports avec le cédant » (tels l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes), inopposables à compter de la notification. Sur ce point, l’emprunt au droit spécial n’est pas total puisque si la notification de la cession Dailly n’emporte pas purge des exceptions, le Code monétaire et financier réserve le cas où le débiteur cédé aura accepté la cession renonçant, par cette acceptation, à opposer au cessionnaire « les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau »25. La protection des intérêts du cessionnaire qui en résulte reste toutefois conditionnée à un engagement du cédé formalisé, pour sa validité, dans un écrit dont on sait que la jurisprudence vérifie l’exacte concordance avec la mention légale26. En droit commun, une renonciation du débiteur est prévue par l’article 1347-5 du Code civil selon lequel le débiteur qui prend acte sans réserve de la cession de créance ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eut pu opposer au cédant. Au-delà de cette inopposabilité exceptionnelle, le cédé pourrait-il renoncer à opposer au créancier les exceptions inhérentes à la créance ? L’admettre, fût-ce avec certaines réserves27, accentuerait le rapprochement des modalités de transmissions conventionnelles de créance au détriment du particularisme du régime spécial déjà affecté par les emprunts dont il est l’objet. Un dernier emprunt, à l’opportunité discutable cette fois, s’illustre à travers le formalisme qui entoure désormais la cession de créance du Code civil.
7. Le formalisme de la cession. Contrat jusque-là consensuel, la cession civile de créance est soumise par l’article 1322 du Code civil à un formalisme ad validitatem dont la contradiction avec l’objectif de modernisation et de simplification de la transmission conventionnelle de créance n’est plus à souligner. Ce formalisme est toutefois moins contraignant que celui auquel le Code monétaire et financier soumet le bordereau Dailly et dont la jurisprudence contrôle scrupuleusement le respect28. Outre les mentions imposées par l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier – celle de la qualification de l’acte afin d’éviter toute ambiguïté entre la cession ou le nantissement, de sa soumission aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier, la désignation du cessionnaire par son nom ou sa dénomination sociale ainsi que la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou des éléments de nature à y procéder – le bordereau doit être signé par le cédant29 et daté par le cessionnaire30. L’article 1322 du Code civil exige, quant à lui, un écrit sans plus de précision quant à son contenu. Ses mentions sont cependant aisément identifiables.
Outre celles issues du droit commun qui tiennent au consentement des parties et à la désignation des créances cédées – qui, si elles sont futures voire éventuelles doivent pouvoir être identifiées31 –, la mention de la date est essentielle pour l’opposabilité de la cession aux tiers et le règlement des conflits entre les cessionnaires successifs d’une même créance lequel se résout en faveur du premier en date32. En cas de contestation de la date, l’article 1323, alinéa 2, du Code civil s’inspire du régime spécial pour prévoir que la preuve incombe au cessionnaire qui peut la rapporter par tout moyen33.
D’autres mentions pourront compléter l’acte de cession. Elles tiennent au caractère gratuit ou onéreux de la cession ou à la cessibilité limitée de la créance. Ainsi, mention sera faite du prix en cas de transmission à titre onéreux tandis que le consentement du débiteur, en principe non partie à l’acte de cession, devient nécessaire lorsque la créance aura été déclarée incessible sans son accord34. Toutefois, comme en matière de cession de créances professionnelles où elle se heurte déjà à la réticence des tribunaux35, la clause limitant la cessibilité de la créance est nulle lorsqu’elle permet à un producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers « d’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui »36.
8. Le formalisme de la cession de créance du Code civil s’accorde assez mal avec l’objectif de simplification recherché. L’incertitude qui entoure la nature de la nullité de l’acte irrégulier en la forme37 nuit par ailleurs à la sécurité juridique et pourrait, dans un premier temps au moins, détourner les opérateurs économiques de cet instrument au régime pourtant modernisé. Pour autant, c’est bien la cession Dailly qui semble menacée par le rapprochement des régimes juridiques réalisé.
B – Les spécificités du régime spécial de la cession de créances professionnelles
9. Si les emprunts au droit spécial sont nombreux, la cession du Code monétaire et financier conserve des spécificités au regard de son régime comme de ses fonctions38.
10. Les spécificités du régime de la cession de créances professionnelles. Ces spécificités du régime de la cession de créances professionnelles profitent essentiellement au cessionnaire Dailly. La première a trait à l’opposabilité de la cession d’une créance future. Le régime de la cession de créances professionnelles offre, par rapport à celui de droit commun, un avantage indéniable pour le cessionnaire d’une créance non encore née au jour de sa cession. En effet, l’ordonnance du 10 février 2016 a fait le choix discutable de différer au jour de la naissance de la créance l’effet translatif de la cession39. Si donc la cessibilité d’une créance future voire éventuelle est affirmée, son intérêt se trouve immédiatement neutralisé par un texte qui cette fois s’éloigne des régimes spéciaux – cession Dailly40 comme cession fiduciaire41 – lesquels retiennent la date de l’acte. En dépit des suggestions doctrinales42, la loi du 20 avril 2018 de ratification de l’ordonnance n’a pas modifié les termes de l’article 1323, alinéa 3, du Code civil de sorte que le cessionnaire d’une créance future acquise selon les modalités du Code civil sera primé par le cessionnaire Dailly de cette même créance (même acquise postérieurement) dont le droit sur la créance est opposable à compter de la date portée sur le bordereau et cela, « quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances »43. Il y a là un avantage pour la cession spéciale particulièrement utile en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du cédant, la jurisprudence considérant désormais que « même si son exigibilité n’est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date »44.
11. La deuxième spécificité du régime spécial concerne la garantie pesant sur le cédant. L’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas modifié les règles relatives à la garantie due par le cédant45. S’il doit garantir l’existence de la créance cédée à titre onéreux et de ses accessoires, c’est sous réserve que le cessionnaire n’ait pas acquis la créance à ses risques et périls ou en connaissance de son caractère incertain46. S’il doit garantir la solvabilité du débiteur, ce n’est que de manière exceptionnelle, parce qu’il en aura accepté le principe47 et « jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession »48. La cession Dailly offre, à cet égard, davantage de sécurité au cessionnaire qui profite, sauf clause contraire, de la garantie solidaire du cédant pour le paiement des créances transmises par bordereau49. Il est vrai que la jurisprudence encadre l’appel en garantie du cédant en contraignant le cessionnaire à adresser préalablement une demande amiable au débiteur ou à justifier d’un évènement rendant impossible le paiement50. Pour autant, la contrainte doit être relativisée dans la mesure où il ne s’agit que d’une demande amiable adressée au cédé et non d’une mise en demeure de payer51, qui s’impose au seul cessionnaire ayant notifié la cession52 et qui semble pouvoir être conventionnellement écartée53.
12. Une dernière spécificité peut être relevée. Son enjeu est important puisqu’elle concerne la validité de la cession de créance dans l’hypothèse d’une procédure collective du cédant. La cession de créances professionnelles apparaît moins menacée par les nullités de droit de la période suspecte qu’une cession conclue par le débiteur suivant les modalités du Code civil. Réalisée au support d’un bordereau Dailly, la cession de créance est considérée par le législateur comme un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires lorsqu’elle porte sur une dette échue du cédant54 contrairement à la cession de droit commun, nulle de droit. Cet avantage cesse en revanche lorsque la cession Dailly réalise le paiement d’une dette non échue55. Le paiement est alors suspect quel qu’en soit le mode et l’intérêt du cessionnaire Dailly cède face à celui de l’entreprise et de ses créanciers. Outre ces spécificités de régime, c’est une spécificité fonctionnelle qui contribue à l’attractivité de la cession de créances professionnelles.
13. La spécificité fonctionnelle de la cession de créances professionnelles. « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ». L’article L. 313-24 du Code monétaire et financier reconnaît en ces termes la fonction de garantie de la cession Dailly au profit d’un cessionnaire à qui est transférée, à titre temporaire, la propriété d’une ou de plusieurs créances de son débiteur. Cette fonction de garantie n’est plus l’apanage de la cession de créances professionnelles depuis que la loi du 19 février 2007 a introduit la fiducie dans le Code civil56 permettant à un débiteur de transférer, dans l’intérêt de son créancier, le bénéficiaire, un ensemble de biens – dont des créances – dans un patrimoine distinct de son patrimoine propre et de celui du fiduciaire. L’ordonnance du 30 janvier 200957 a ensuite introduit au sein des dispositions relatives aux sûretés réelles celles relatives à la propriété fiduciaire cédée à titre de garantie faisant coexister deux modalités de transmission de créances qui diffèrent selon qu’est nécessaire ou non la constitution d’un patrimoine fiduciaire pour accueillir les biens transférés dans l’intérêt du créancier58. En dehors de ces supports, la jurisprudence s’oppose à ce qu’une fonction de garantie soit conventionnellement conférée à la cession de créance du Code civil jugeant qu’« en dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créance »59. La cession de créance du Code monétaire et financier présente en conséquence une spécificité fonctionnelle contribuant à son attractivité tant pour le débiteur, qui trouve là une sûreté supplémentaire à proposer à son créancier en garantie d’un financement, que pour le créancier soucieux de la préservation de ses intérêts. La cession Dailly en garantie offre en effet de nombreux avantages de nature à concurrencer les sûretés réelles traditionnelles par ce transfert de la propriété des créances qui quittent temporairement le patrimoine du cédant et échappent aux recours des autres créanciers60. Cette concurrence doit, il est vrai, être nuancée à l’égard du nantissement de créances dont l’ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés a modernisé le régime juridique au point que cette sûreté réelle n’aurait, de l’avis de certains61, rien à envier à la cession de créances en garantie. La jurisprudence s’y était déjà employée reconnaissant au créancier nanti, en dépit de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du constituant, un droit à recevoir le paiement d’une créance échue après le jugement d’ouverture62. Pour autant, les attraits de la cession Dailly en garantie demeurent.
14. S’agissant de la menace de la nullité de plein droit des actes réalisés par le débiteur pendant la période suspecte, la cession Dailly en garantie en est doublement préservée. D’abord, parce que cette cession ne réalise pas un paiement, nul de droit s’il porte sur une dette non échue63, mais transfère la propriété temporaire de créances dans le but de prémunir le créancier contre le risque de défaillance de son débiteur64. La transmission de créances professionnelles en garantie échappe ensuite à la nullité de droit que l’article L. 632-1, 6°, du Code de commerce réserve aux sûretés réelles – hypothèque, nantissement et gage – constituées sur les biens du débiteur pour des dettes antérieurement contractées65.
Toujours dans le contexte d’une procédure collective du cédant, le cessionnaire de créances cédées par bordereau avant l’ouverture de la procédure est avantagé puisque s’il est tenu, comme tout créancier antérieur, de déclarer sa créance contre le débiteur-cédant66, il est admis pour son intégralité sans déduction des paiements réalisés par le cédé avant l’ouverture de la procédure. Ces règlements lui restent acquis tant que la créance garantie n’a pas été payée par le cédant67. La solution tient compte de la spécificité de la cession en garantie qui réalise un transfert simplement temporaire de propriété contraignant le cessionnaire à restituer au cédant les créances cédées après l’extinction de sa créance68. En ce qui concerne le montant de la créance cédée, la Cour de cassation autorise le cessionnaire à en exiger le paiement intégral à charge de restituer à la procédure du cédant la quote-part excédentaire69. Conforme à l’indivisibilité des sûretés réelles, la solution sécurise les droits du cessionnaire en privant le cédant du droit d’agir en paiement contre le cédé pour la part excédant le montant de la créance garantie sauf renonciation du cessionnaire. Bien que non limitée à l’hypothèse d’une procédure collective, la solution présente un intérêt évident dans un contexte menaçant les intérêts des créanciers.
15. L’ouverture récente de la qualité de cessionnaire Dailly à d’autres opérateurs que les établissements de crédit et les sociétés de financement souligne par ailleurs l’attractivité du régime spécial. L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, prise en application de la loi Sapin II n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, répond ainsi à la volonté du législateur d’ouvrir à des opérateurs non bancaires des supports de financement au profit d’entreprises. L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier étend ainsi la qualité de cessionnaire Dailly à certains fonds d’investissement alternatif (FIA), ceux ouverts à des investisseurs professionnels70 et les organismes de financement lesquels regroupent les organismes de titrisation et les nouveaux organismes de financement spécialisés71. Ces fonds d’investissement alternatif peuvent se voir transmettre la propriété de créances par la remise d’un bordereau conforme au formalisme légal et profiter des spécificités du régime du Code monétaire et financier.
La coexistence de ces régimes de transmission conventionnelle de créances invite à envisager leur articulation et la place de la volonté des parties dans le choix de la réglementation applicable à la cession projetée.
II – Articulation des régimes juridiques des cessions de créance
16. S’il est des situations dans lesquelles l’articulation entre le régime du Code civil et celui du Code monétaire et financier s’opère naturellement au bénéfice du premier (A), d’autres rendent plus discutable le recours au droit commun comme alternative au droit spécial (B).
A – Le droit commun, une application naturelle
17. L’articulation des régimes des cessions de créance s’opère à la faveur des articles 1321 et suivants du Code civil dans plusieurs hypothèses. Cela tient à ce que le régime spécial soit n’a pas vocation à s’appliquer, soit est silencieux sur tel ou tel aspect du régime de la cession soit encore à ce qu’il n’a plus vocation à s’appliquer.
18. Le droit spécial n’a pas vocation à s’appliquer lorsque ses conditions rationae personae ne sont pas réunies. La cession Dailly se présente depuis sa mise en place par la loi du 2 janvier 1981 comme un mode spécial de transmission de créances réservé à certains opérateurs économiques. Elle n’est ouverte qu’à un établissement de crédit, à une société de financement et à certains fonds d’investissement alternatif72 à qui est transmise, « par une personne morale de droit privé ou de droit public » ou « par une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle », la propriété de créances sur un tiers, « personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle »73. Lorsque le régime spécial n’a pas vocation à s’appliquer, le droit commun constitue le support naturel de la transmission de créance projetée, à moins que les parties envisagent une garantie avec transfert de propriété laquelle ne relève pas des fonctionnalités prévues par les articles 1321 et suivants du Code civil74. Une cession fiduciaire de créances permettra alors à des parties non éligibles aux dispositions du Code monétaire et financier de garantir la dette du constituant par le transfert de la propriété de créances au sein d’un patrimoine fiduciaire75. Initialement limitée dans le temps et réservée à un constituant personne morale76, la fiducie est ouverte depuis la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 à tout constituant, personne morale ou personne physique, au profit de tout créancier77. Le mécanisme, qui repose sur la constitution d’un patrimoine fiduciaire indispensable pour accueillir les biens transférés en garantie du paiement du bénéficiaire78, protège les intérêts du créancier y compris en cas de procédure collective du débiteur79. Sauf convention de mise à disposition du bien80, le juge-commissaire peut autoriser le paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire lorsque ce retour est justifié par la poursuite de l’activité81. La fiducie échappe par ailleurs au régime des contrats en cours et à la menace d’une non-continuation82 comme à la nullité de droit de la période suspecte lorsqu’elle a été consentie par le débiteur en garantie d’une dette concomitante83.
19. Le droit spécial est silencieux. L’articulation s’opère naturellement à la faveur du droit commun lorsque la règle spéciale est silencieuse sur tel ou tel élément du régime juridique de la cession. Cette deuxième hypothèse est envisagée par l’article 1105, alinéa 3 du Code civil selon lequel les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières de sorte qu’en leur absence, les premières ont vocation à s’appliquer. La règle d’articulation conduit à la situation suivante où la cession de créances obéit principalement aux dispositions du Code monétaire et financier et subsidiairement, en cas de silence du régime spécial, à celles du Code civil. En pratique, cette situation ne devrait guère se rencontrer. Cela tient aux dispositions du Code monétaire et financier dont la précision laisse peu de place à une application supplétive du régime de droit commun des articles 1321 et suivants du Code civil.
20. Le droit spécial n’a plus vocation à s’appliquer. La dernière hypothèse correspond à celle où la réglementation spéciale avait vocation à s’appliquer mais ne peut plus l’être, le formalisme du bordereau de cession n’ayant pas été respecté84. L’alinéa final de l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier dispose que « le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 ». Inefficace en tant que cession de créances professionnelles, l’acte pourrait néanmoins produire des effets juridiques en application, cette fois, des dispositions du Code civil85. Cette disqualification du titre consécutive à la conversion par réduction du bordereau irrégulier86 préserve l’acte de cession dont les effets connaîtront cependant certaines limites.
L’une a disparu avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. Avant la réforme et faute de signification de l’acte en application de l’article 1690 du Code civil, la cession était inopposable au débiteur cédé. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, la cession doit être notifiée au débiteur pour lui être opposable de sorte que la notification de la cession Dailly devrait – si elle a eu lieu – profiter au cessionnaire dans ses rapports de droit commun avec le cédé. En revanche, les effets de la disqualification du bordereau Dailly en cession de droit commun se heurtent à deux autres limites. La première est inhérente à la nature de la créance. Lorsque la cession Dailly irrégulière en la forme porte sur des créances futures, la disqualification en cession de droit commun désavantagera le cessionnaire, la créance future n’étant opposable qu’à compter de sa naissance87 et non à la date de l’acte comme le prévoit le Code monétaire et financier. La seconde limite tient à la finalité du transfert de créances. Si la volonté des parties était de garantir le créancier contre la défaillance du débiteur par le transfert temporaire de la propriété de créances, le cessionnaire devra y renoncer, la jurisprudence ne reconnaissant pas cette fonction à la cession de créance du Code civil88. Tout au plus le bordereau irrégulier produira-t-il les effets d’un nantissement de créance opposable au débiteur sous réserve qu’il lui ait été notifié89. La menace de disqualification du bordereau est d’autant plus prégnante que la jurisprudence contrôle avec rigueur le respect du formalisme légal sanctionnant l’absence comme l’imprécision d’une mention obligatoire90. En revanche, la Cour de cassation a récemment jugé que la validité du bordereau n’était pas affectée par la présence de mentions qui ne sont plus exigées dispensant ainsi les opérateurs, le cessionnaire en particulier, d’une obligation d’actualiser d’éventuels modèles-types de bordereaux de cession91.
21. Si dans ces situations l’articulation entre le régime du Code civil et celui du Code monétaire et financier ne soulève guère de difficultés, il en va autrement lorsque les conditions du régime spécial se trouvent réunies. Le droit commun est-il une option de sortie envisageable ?
B – Le droit commun, une option discutée
22. Lorsque le droit spécial a vocation à s’appliquer, les parties sont-elles libres de soumettre la cession aux dispositions du Code civil par préférence à celles du Code monétaire et financier ? Au contraire, le régime spécial doit-il être compris comme un régime d’application exclusive ? La question s’est posée à propos du gage des stocks régit, depuis l’ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés, par des dispositions spéciales du Code de commerce92. La perspective d’une coexistence entre deux régimes de cession de créances en garantie que pourrait consacrer la réforme prochaine du droit des sûretés renforce l’enjeu de la réflexion.
23. Exclusivisme du droit spécial ? À propos du gage sur les stocks de marchandises, la Cour de cassation a dû trancher la question de la liberté pour les parties de préférer le droit commun du gage lequel reconnaît au créancier la possibilité de se voir automatiquement attribuer la propriété du bien gagé en cas de défaillance du débiteur93. Elle l’a fait en privilégiant le régime spécial94 privant les parties de toute option et réduisant leur liberté au choix d’une autre garantie95. En dépit de la résistance des juges du fond96, la Cour a réaffirmé l’impossible soumission au droit commun du gage lorsque sont réunies les conditions du régime spécial97. Si l’on peut y voir l’affirmation de principe de l’exclusivisme du régime spécial, la solution peut aussi être comprise comme un appel à la réforme législative dans un souci d’efficacité et de simplification d’un droit des sûretés réelles affecté par la coexistence de régimes spéciaux à l’utilité parfois discutable98. Si l’appel a été entendu, ce n’est pas une simplification qu’a réalisée l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 201699 mais un alignement du régime spécial sur les modes de réalisation du gage de droit commun100. Le législateur affirme par ailleurs, pour les gages de stocks conclus à compter du 1er avril 2016, la liberté des parties de préférer le droit commun101. Il est dès lors possible de soutenir, par analogie, la liberté des parties au transfert de créances d’opter pour le régime spécial ou pour le régime de droit commun en fonction de leurs intérêts102. Il est vrai qu’en matière de gage de stocks, l’option est expressément reconnue par le législateur faisant ainsi figure d’exception au principe de primauté de la règle spéciale affirmé par l’article 1105, alinéa 3, du Code civil. Toutefois, une lecture contemporaine de la règle d’articulation autorise une application cumulative voire alternative de la règle générale et de la règle spéciale103. Le droit commun ne serait écarté qu’en cas d’incompatibilité des règles partageant un objet commun104 et le droit commun constituerait alors une option envisageable même en présence d’une règle spéciale. Les parties à la cession de créance pourraient préférer les dispositions du Code civil à celles du Code monétaire et financier, y compris si est envisagée une cession en garantie dont la consécration est préconisée par le projet de réforme du droit des sûretés105.
24. Exclusivisme du droit spécial de la cession à titre de garantie ? Le projet de loi n° 1088 relatif à la croissance et à la transformation des entreprises du 18 juin 2018 habilite le gouvernement à réformer par ordonnance le droit des sûretés dans un objectif de clarification et de simplification. Le législateur pourrait s’inspirer des propositions présentées par l’association Henri Capitant dans l’avant-projet de réforme lequel envisage notamment de reconnaître à la cession de créance du Code civil une fonction nouvelle, de garantie. La section du livre quatrième du Code civil relative à la propriété mobilière cédée en garantie, actuellement composée des articles relatifs à la fiducie-sûreté106, pourrait accueillir ceux organisant un transfert de créance du patrimoine du cédant vers celui du cessionnaire107.
Généraliser la cession de créance en garantie est un choix discutable tant au regard de ce que propose déjà le Code civil que des difficultés d’articulation inhérentes à la coexistence de plusieurs régimes juridiques pour une même opération. Le Code civil connaît déjà deux sûretés sur créances, l’une – le nantissement – modernisée par la réforme du 23 mars 2006 et dont la jurisprudence conforte l’attractivité108, l’autre – la fiducie – particulièrement efficace pour le créancier grâce au transfert des créances au sein d’un patrimoine fiduciaire échappant au recours des créanciers du constituant comme de ceux du fiduciaire109. Est-il dès lors opportun d’y ajouter le transfert de la propriété de créances en application des articles 1321 et suivants du Code civil ? Sans doute pour des opérateurs non éligibles aux dispositions du Code monétaire et financier qui trouveront là une sûreté nouvelle à proposer à un créancier sans devoir constituer un patrimoine fiduciaire. Mais lorsque les dispositions du Code monétaire et financier auront vocation à s’appliquer se posera la question de la liberté d’option des parties. Même à considérer, au nom de la liberté contractuelle, que cette option existe, il n’est pas certain que le droit commun soit préféré. L’avant-projet ne consacre en effet que trois articles à cette garantie dont deux intéressent son régime. Il est vrai que le Code monétaire et financier n’est guère plus précis110 mais la jurisprudence en a fixé le régime dans un sens, qui plus est, favorable aux intérêts du cessionnaire en particulier en cas de procédure collective du cédant111. Compte tenu de la similitude des mécanismes, ces solutions pourraient être étendues à la cession en garantie du Code civil.
25. Les projets d’articles 2374 et 2375 du Code civil précisent certains aspects du régime de la cession de créance en garantie. Pour le reste, il est renvoyé aux articles 1321 et suivants du Code civil. Par l’effet de ce renvoi, la validité de la cession en garantie suppose un écrit dont l’avant-projet précise le contenu en exigeant la désignation des créances garanties et de celles cédées en garantie. Si elles sont futures, ce que permet l’article 1321, alinéa 2, du Code civil, le projet d’article 2374 emprunte au régime spécial112 pour prévoir que « l’acte de cession doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que la personne du débiteur, le lieu de paiement, la nature des créances, leur montant ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance ». Toujours par l’effet de ce renvoi, l’opposabilité de la cession obéit aux articles 1323 et 1324 du Code civil. La garantie est opposable aux tiers à compter de sa date et au débiteur cédé, à compter de sa notification113. En revanche, la cession d’une créance future n’étant opposable qu’à compter de sa naissance114, le cessionnaire d’une créance future se trouvera dans une position moins avantageuse que celle reconnue au cessionnaire Dailly115. Rien de spécifique non plus à propos de la garantie du cédant ce qui la limitera, conformément à l’article 1326 du Code civil, à l’existence de la créance cédée sauf volonté contraire du cédant116. Le projet d’article 2375 envisage enfin les droits du cessionnaire. Celui-ci « a sur la créance cédée un droit exclusif » et exerce « l’intégralité des droits qui lui sont attachés » dont celui de réclamer le paiement.
L’avant-projet ne traite pas du dénouement de la garantie117 pas plus qu’il n’envisage les droits du cessionnaire en cas de procédure collective du cédant118. La proximité des mécanismes – reposant sur un transfert temporaire de la propriété de créances – pourrait justifier l’application à la garantie du Code civil des solutions réservées à la cession en garantie du Code monétaire et financier. Ainsi lorsque la garantie n’a plus de raison d’être (extinction de la créance garantie, renonciation du créancier), le cédant retrouverait « la propriété des créances cédées sans formalité particulière »119 tandis qu’en cas de défaillance du débiteur à l’échéance, le cessionnaire conserverait la propriété définitive de la créance cédée à charge de restituer l’éventuelle part excédant le montant garanti. Pour la même raison, la cession en garantie du Code civil devrait échapper aux nullités de droit de la période suspecte120 et le cessionnaire devrait être admis à déclarer l’intégralité de sa créance, sans déduction des sommes déjà versées par le cédé tout en pouvant réclamer le paiement de la totalité de la créance, fût-elle d’un montant supérieur à la créance garantie121. Le caractère succinct des dispositions de l’avant-projet ne devrait pas dissuader de recourir à cette nouvelle garantie sur créances dès lors que des réponses jurisprudentielles et légales existent et peuvent être appliquées. Les parties pourront-elles se soustraire au régime spécial au profit de celui du Code civil ? Il serait sans doute opportun, dans un souci de sécurité juridique, de préciser la place laissée à la liberté contractuelle.
26. En rapprochant le régime juridique de la cession de créance du Code civil de celui plus souple réservé à la cession de créances professionnelles, l’ordonnance du 10 février 2016 a restauré l’attractivité de la cession du Code civil tout en préservant la spécificité fonctionnelle de la cession du Code monétaire et financier. C’est cette spécificité fonctionnelle que menace cette fois l’avant-projet de réforme du droit des sûretés préconisant de reconnaître à la cession du Code civil une nouvelle fonction de garantie. La menace suppose toutefois que les parties aient le choix, celui de soumettre la garantie aux dispositions du Code civil plutôt qu’à celles du Code monétaire et financier ce qui, pour l’heure, reste discuté. Même en l’admettant, la sécurité que la cession spéciale réserve aux opérateurs économiques pourrait les dissuader, dans un premier temps au moins, de se tourner vers le Code civil.
Notes de bas de pages
-
1.
Les créances professionnelles au sens de C. mon. fin., art. L. 313-23 c’est-à-dire, celles « détenues par une personne morale ou une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle, sur une personne morale ou une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle ».
-
2.
La qualité de cessionnaire Dailly, réservée aux établissements de crédit et sociétés de financement, a été étendue par ord. n° 2017-1432, 4 oct. 2017 à certains fonds de financement alternatif (FIA), v. C. mon. fin., art. L. 313-23 et infra n° 15.
-
3.
Cette fonction de garantie est expressément envisagée par C. mon. fin., art. L. 313-24 complété en ce sens par la L. n° 84-46, 24 janv. 1984.
-
4.
« En dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur ses créances, constitue un nantissement de créance », v. Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-16395 : D. 2007, p. 344, note Larroumet C. ; D. 2007, p. 319, note Dammann R. et Podeur G. ; D. 2007, p. 961, note Aynès L. ; JCP G 2007, 1131, note Legeais D. et rapp. Cohen-Branche M. ; RTD civ. 2007, p. 160, obs. Crocq P. ; RTD com. 2007, p. 217, obs. Legeais D. et p. 59, obs. Bouloc B. ; Gaz. Pal. 24 mai 2007, n° G3913, p. 11, note Piedelièvre S. Sur cette question, v. infra n° 13.
-
5.
V. Gijsbers C., « Le nouveau visage de la cession de créance », Dr. & patr. mensuel 2016, n° 260, p. 46.
-
6.
C. civ., art. 1321, al. 1er.
-
7.
Le Code civil étant traditionnellement indifférent au déséquilibre contractuel, qu’il s’agisse des clauses ou du rapport d’équivalence qu’entretient le prix avec la valeur du bien vendu ou du service rendu en contrepartie.
-
8.
C. civ., art. 1171 emprunte ainsi à C. consom., art. L. 212-1 le critère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties permettant au juge de réputer non écrite la clause abusive dans un contrat de consommation.
-
9.
C. mon. fin., art. L. 313-23 et s.
-
10.
Comp. C. mon. fin., art. L. 313-23, 4°.
-
11.
Cass. 1re civ., 20 mars 2001, n° 99-14982 : RD bancaire et fin. 2001, comm. 224, obs. Legeais D.
-
12.
Cass. 1re civ., 20 mars 2001, n° 99-14982.
-
13.
C. mon. fin., art. L. 313-23, al. 2, « Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés ».
-
14.
C. mon. fin., art. L. 313-23, 4°, exige que le bordereau prévoie la désignation ou l’individualisation des créances ou à défaut, « des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance ».
-
15.
V. en ce sens, Cass. 1re civ., 20 mars 2001, n° 99-14982 : D. 2001, p. 3112., note Aynès L. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé, à propos du formalisme du bordereau Dailly, que « la désignation du débiteur cédé n’étant pas une mention obligatoire du bordereau mais seulement l’un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d’effectuer l’identification des créances cédées » son caractère erroné était dépourvu d’incidence dès lors que cette identification résulte d’autres éléments, Cass. com., 7 juin 2006, n° 04-18211.
-
16.
V. Gijsbers C., « Le nouveau visage de la cession de créance », Dr. & patr. mensuel 2016, n° 260, p. 46.
-
17.
C. civ., art. 1323, al. 3. Il y a sur ce point une différence avec le régime spécial du Code monétaire et financier, v. infra n° 10.
-
18.
À moins que le cédé ait accepté la cession par acte authentique, C. civ., art. 1690 anc.
-
19.
Nantissement de créances, C. civ., art. 2361 ; C. civ., art. 2362 ; cession fiduciaire de créances, C. civ., art. 2018-2 ; cession de créances professionnelles, C. mon. fin., art. L. 313-27 ; C. mon. fin., art. L. 313-28.
-
20.
C. civ., art. 1323.
-
21.
C. civ., art. 1324, al. 1er, « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
-
22.
Laquelle doit être faite par un écrit conforme aux exigences de l’article R. 313-15 imposant la désignation du cédant et des créances cédées, l’interdiction de payer le cédant et l’indication de la personne à l’ordre de laquelle le paiement doit être fait. Il a été jugé que l’efficacité de la notification n’était pas affectée par le fait qu’elle n’ait pas eu lieu au domicile élu par le débiteur dans le contrat générateur de la créance dès lors que le cédé en a eu une connaissance effective, v. Cass. com., 11 oct. 2017, n° 15-18372 : RDC 2018, n° 114w2, p. 44, obs. Libchaber R. ; RDC 2018, n° 114x0, p. 58, obs. Julienne M. ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, n° 306x9, p. 65, obs. Moreil S. ; AJCA 2017, p. 527, obs. Forti V. ; RTD civ. 2017, p. 861, obs. Barbier H. ; Banque & droit nov. 2017, n° 176, p. 29, obs. Bonneau T. ; RTD civ. 2018, p. 186, obs. Crocq P.
-
23.
Bonhomme R., Instruments de crédit et de paiement, Introduction au droit bancaire, 12e éd., 2017, LGDJ, coll. Manuel, spéc. n° 276.
-
24.
V. déjà en ce sens, Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-22000.
-
25.
C. mon. fin., art. L. 313-29, al. 2, « à moins que l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ».
-
26.
Cass. com., 5 nov. 1991, n° 90-12334 : RTD com. 1992, p. 431, obs. Cabrillac M. et Teyssié B. ; Cass. com., 29 oct. 2003, n° 01-02512 : RTD com. 2004, p. 157, obs. Cabrillac M. La jurisprudence neutralise par ailleurs toute acceptation anticipée du débiteur, v. Cass. com., 3 nov. 2015, n° 14-14373 : D. 2016, p. 2311, obs. Martin D. R. ; RTD civ. 2016, p. 123, obs. Barbier H. ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 24, obs. Cerles A. ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 55, obs. Crédot F-J et Samin T.
-
27.
V. en ce sens, Gijsbers C., « Le nouveau visage de la cession de créance », Dr. & patr. mensuel 2016, n° 260, p. 46, notes 68 et 69.
-
28.
Un arrêt récent juge toutefois que la validité du bordereau Dailly n’est pas affectée par la présence de mentions qui ne sont plus exigées parce qu’abrogées, v. Cass. com., 11 oct. 2017, n° 15-18372 : RDC 2018, n° 114w2, p. 44, obs. Libchaber R. ; RDC 2018, n° 114x0, p. 58, obs. Julienne M.
-
29.
C. mon. fin., art. L. 313-25, envisageant une signature manuscrite ou non.
-
30.
C. mon. fin., art. L. 313-27.
-
31.
Sur la cessibilité des créances éventuelles, v. supra n° 5.
-
32.
C. civ., art. 1325 reconnaît au premier cessionnaire en date un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.
-
33.
C. mon. fin., art. L. 313-27, al. 4 selon lequel, en cas de contestation de la date portée sur le bordereau, le cessionnaire rapporte par tous moyens l’exactitude de celle-ci.
-
34.
C. civ., art. 1321, al. 4.
-
35.
À propos d’une clause d’agrément, v. Cass. com., 21 nov. 2000, n° 97-16874 : RTD civ. 2001, p. 933, obs. Crocq P. ; RTD com. 2001, p. 203, obs. Cabrillac M. – comp., Cass. com., 22 oct. 2002, n° 99-14793 : RTD civ. 2003, p. 129, obs. Crocq P., où il a été au contraire jugé que « le débiteur cédé qui n’a pas accepté la cession de créance, peut opposer à l’établissement de crédit cessionnaire les exceptions fondées sur les rapports personnels avec le cédant » et, notamment, la clause interdisant au cédant de céder la créance sans le consentement du cédé.
-
36.
À propos d’une clause de préavis contraignant le cédant à avertir le cédé avant toute cession au profit d’un établissement bancaire, v. Cass. com., 11 oct. 2017, n° 15-18372 : RDC 2018, n° 114w2, p. 44, obs. Libchaber R. ; RDC 2018, n° 114x0, p. 58, obs. Julienne M.
-
37.
C. com., art. L. 442-6, II, c.
-
38.
La nullité relative écarterait la menace d’une action intentée par un tiers à la cession, qu’il s’agisse du débiteur ou d’un autre créancier mais la nullité absolue pourrait être admise en raison du caractère tripartite de l’opération de cession envisagée dans sa globalité comme des intérêts des autres créanciers. V. C. civ., art. 1179.
-
39.
Dans la mesure où la reconnaissance d’une fonction de garantie à la cession de créance du Code civil n’est à ce jour qu’une proposition de l’avant-projet de réforme du droit des sûretés présenté par l’association Henri Capitant à l’automne 2017 et reprise par le projet de loi PACTE relatif à la croissance et à la transformation des entreprises du 19 juin 2018, v. infra nos 23 et s.
-
40.
C. civ., art. 1323, al. 3.
-
41.
C. mon. fin., art. L. 313-27, al. 1.
-
42.
C. civ., art. 2018-2, la cession de créances réalisée au support d’une fiducie permet au constituant de transférer temporairement, au sein d’un patrimoine fiduciaire, un ensemble de créances au profit d’un bénéficiaire qui peut être le fiduciaire.
-
43.
Danos F., « Proposition de modification de l’article 1323 du Code civil : l’opposabilité aux tiers de la cession d’une créance future », RDC 2017, n° 114c4, p. 200.
-
44.
C. mon. fin., art. L. 313-27 complété par la L. n° 2003-706, 1er août 2003.
-
45.
Cass. com., 7 déc. 2004, n° 02-20732 : D. 2005, p. 230, note Larroumet C. – Cass. com., 22 nov. 2005, n° 03-15669 : D. affaires 2005, p. 230, obs. Larroumet C. ; RTD com. 2005, p. 155, obs. Cabrillac M. ; RTD civ. 2005, p. 132, obs. Mestre J. et Fages B. ; RD bancaire et fin. 2005, p. 17, obs. Cerles A. ; RTD com. 2006, p. 169, obs. Legeais D.
-
46.
Elle n’a cependant pas repris l’ancien article 1693 du Code civil qui privait d’effet la clause limitant ou excluant la garantie d’existence de la créance.
-
47.
Ce qui devrait être le cas lorsque la cession a pour objet une créance future ou éventuelle, v. supra n° 5.
-
48.
Dans ce cas, la solvabilité s’entend de la solvabilité actuelle du débiteur et non de sa solvabilité à l’échéance, sauf volonté contraire du cédant.
-
49.
C. civ., art. 1326, al. 2.
-
50.
C. mon. fin., art. L. 313-24, al. 2 issu de L. n° 84-46, 24 janv. 1984.
-
51.
Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-12951 : RDC 2017, n° 114d3, p. 256, obs. Libchaber R. ; JCP E 2017, 1246, note Mathey N. – v. déjà Cass. com., 14 mars 2000, n° 96-14034 ; Cass. com., 18 sept. 2007, n° 06-13736 : D. 2007, p. 2532, obs. Delpech X. ; RTD com. 2007, p. 821, obs. Legeais D.
-
52.
Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-12008.
-
53.
Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-24755 : Gaz. Pal. 7 juin 2016, n° 266y1, p. 67, obs. Moreil S.
-
54.
Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-18210 : D. 2012, p. 1605, obs. Delpech Y. V. sur ce point, Bonhomme R., Instruments de paiement et de crédit, Introduction au droit bancaire, 12e éd., 2017, LGDJ, coll. Manuel, spéc. n° 273.
-
55.
C. com., art. L. 632-1, 4°. Elle pourrait tomber sous le coup de la nullité facultative que C. com., art. L. 632-2 subordonne à la connaissance de la cessation des paiements par le contractant du débiteur mais lorsqu’une convention-cadre prévoyant la cession a été conclue avant la période suspecte, la jurisprudence fait échapper la cession de créance à la sanction légale, Cass. com., 20 févr. 1996, n° 94-10156 : RTD com. 1996, p. 309, obs. Cabrillac M. ; JCP E 1997, I 635 n° 16, obs. Stoufflet J.
-
56.
C. com., art. L. 632-1, 3° ; v. nullité d’une cession destinée à éteindre une dette non échue de prêt maritime, Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-11215 : RTD com 2015, p. 588, obs. Martin-Serf A. ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 167, obs. Houin-Bressand C.
-
57.
Le bénéficiaire du contrat de fiducie pouvant être le fiduciaire, il devra alors avoir une des qualités limitativement envisagées par C. civ., art. 2015.
-
58.
C. civ., art. 2372-1 ; C. civ., art. 2372-5.
-
59.
V. Aynès A., « La fiducie-sûreté par et hors les textes », RD bancaire et fin. 2014, n° 5, dossier 41, envisageant les opérations de pension sur titres (C. mon. fin., art. L. 211-27 et s.), les prêts de titres financiers (C. mon. fin., art. L. 211-22) et les contrats de garantie financière (C. mon. fin., art. L. 211-38). S’y ajoute le gage-espèces que la jurisprudence analyse en un transfert de propriété de somme d’argent à titre de garantie, Cass. com., 3 juin 1997, n° 95-13365 : RTD com. 1997, p. 663, obs. Cabrillac M.
-
60.
Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-16395, préc. note 4.
-
61.
V. par exemple sur recours après cassation dans l’affaire Cœur Défense, CA Versailles, 13e ch., 28 févr. 2013, n° 12/06573 : D. 2013, p. 829, note Dammann R. et Podeur G. ; RTD com. 2013, p. 571, obs. Legeais D. ; D. 2013, p. 1716, note Crocq P. Contra, Cass. com., 26 avr. 2000, n° 97-10415 : D. 2000, p. 717, note Larroumet C. La cession fiduciaire de créances présente de ce point de vue le même intérêt.
-
62.
V. Gijsbers C., « Le nouveau visage de la cession de créance », Dr. & patr. mensuel 2016, n° 260, p. 46 citant Julienne M., Le nantissement de créance, thèse Paris 1, Economica, 2011, 2012. V. C. civ., art. 2363, « Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts ».
-
63.
Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-13388 : RTD civ. 2010, p. 597, obs. Crocq P. ; RDC 2010, p. 1338, obs. Aynès A. ; D. 2010, p. 2201, note Borga N. ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 14, obs. Cerles A.
-
64.
C. com., art. L. 632-1, 3°.
-
65.
Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15361 : « la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie », dès lors, elle ne constitue pas le paiement de la dette garantie, RD bancaire et fin. 2017, comm. 133, obs. Houin-Bressand C. ; RTD civ. 2017, p. 455, obs. Crocq P. ; AJCA 2017, p. 236, obs. Reygrobellet A. ; RTD com. 2017, p. 434, obs. Martin-Serf A.
-
66.
Cass. com., 28 mai 1996, n° 94-10361, jugé que la cession Dailly n’est pas une constitution d’un droit de nantissement sur un bien du débiteur : D. 1996, p. 390, note Piedelièvre S. ; RTD com. 1996, p. 508, obs. Cabrillac M. ; RTD com. 1997, p. 517, obs. Martin-Serf A. ; RTD civ. 1996, p. 671, obs. Crocq P.
-
67.
C. com., art. L. 622-24.
-
68.
Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-13784 : RTD civ. 2015, p. 666, obs. Crocq P ; RTD com. 2015, p. 731, obs. Legeais D. ; LPA 11 sept. 2015, p. 15, note Bonhomme R. ; RDC 2016, n° 113a1, p. 261, obs. Julienne M.
-
69.
En revanche, le banquier cessionnaire ne saurait déclarer à la fois une créance au titre de la dette garantie et une autre au titre de la garantie solidaire du cédant pour le paiement des créances cédées, Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-13784 : RD bancaire et fin. 2015, comm. 155, obs. Cerles A.
-
70.
Cass. com., 18 nov 2014, n° 13-13336 : RTD civ. 2015, p. 185, obs. Crocq P. ; Banque & droit 2015, n° 159, p. 41, obs. Bonneau T. ; RDC 2015, p. 516, obs. Julienne M. ; comp. Cass. com., 9 janv. 2010, n° 09-10119 : RTD civ. 2010, p. 360, obs. Crocq P. ; RTD com. 2010, p. 770, obs. Legeais D. ; RLDC 2010, p. 37, note Ansault J-J.
-
71.
C. mon. fin., art. L. 214-152 à C. mon. fin., art. L. 215-153-1 visant les fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels de capital investissement, société de libre partenariat.
-
72.
C. mon. fin., art. L. 214-166-1.
-
73.
V. supra, n° 15.
-
74.
C. mon. fin., art. L. 313-23.
-
75.
La jurisprudence s’y oppose et voit dans l’opération un nantissement de créances, v. Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-16395 : D. 2007, p. 344, note Larroumet C. ; D. 2007, p. 319, obs. Dammann R. et Podeur G. ; D. 2007, chron., p. 961, Aynès L. ; JCP G 2007, 1131, note Legeais D. et rapp. Cohen-Branche M. ; RTD civ. 2007, p. 160, obs. Crocq P. ; RTD com. 2007, p. 217, obs. Legeais D. et p. 59, obs. Bouloc B.
-
76.
Ou un nantissement de créances lequel n’est pas sans intérêts pour le créancier, v. supra n° 13.
-
77.
Par L. n° 2007-211, 19 févr. 2007 instituant la fiducie dans sa double fonction d’instrument de gestion d’un patrimoine et de sûreté.
-
78.
À moins que le bénéficiaire soit également le fiduciaire auquel cas, il doit avoir une des qualités prévues à C. civ., art. 2015 : établissements de crédit mentionnés au I de C. mon. fin., art. L. 511-1, institutions et services énumérés à C. mon. fin., art. L. 518-1, entreprises d’investissement mentionnées à C. mon. fin., art. L. 531-4, sociétés de gestion de portefeuille, entreprises d’assurance régies par C. assur., art. L. 310-1 et depuis L. n° 2008-776, 4 août 2008, avocats.
-
79.
Patrimoine fiduciaire qui ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de sa conservation ou de sa gestion sans préjudice, toutefois, des droits des créanciers du constituant titulaires d’un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude, v. C. civ., art. 2025.
-
80.
Cerles A., « La fiducie, nouvelle reine des sûretés ? », RD bancaire et fin. 2007, étude 18 ; Barrière F., « La fiducie-sûreté », JCP E 2009, I, 1808.
-
81.
Dans ce cas, C. com., art. L. 622-23-1 neutralise la réalisation de la fiducie pendant la période d’observation.
-
82.
C. com., art. L. 622-7, II, al. 2.
-
83.
C. com., art. L. 622-13, VI.
-
84.
C. com., art. L. 632-1, I, 9° modifié par ord. n° 2008-1345, 18 déc. 2008.
-
85.
Sur son contenu, v. supra n° 7.
-
86.
À moins que la ou les créances cédées ne soient pas identifiables auquel cas l’acte serait nul en application de C. civ., art. 1163. Sur la possibilité d’une disqualification de l’acte, v. Stoufflet J. et Chaput Y., « L’allégement de la forme des transmissions de créances liées à certaines opérations de crédit », JCP 1981, I, 3044, spéc. n° 12 ; Schmidt D. et Gramling P., « La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises », D. 1981, chron. p. 221 ; Stoufflet J., JCl. Banque – Crédit – Garantie, fasc. 570, spéc. nos 16 et 31.
-
87.
Sur la conversion par réduction, v. Boujeka A., « La conversion par réduction des actes juridiques irréguliers », RTD com. 2002, p. 223 et s.
-
88.
C. civ., art. 1323, al. 3, v. supra n° 10.
-
89.
V. supra n° 13.
-
90.
C. civ., art. 2362.
-
91.
Cass. com., 9 avr. 1991, n° 89-20871 : RTD com. 1001, p. 421, obs. Cabrillac M. et Teyssié B. ; Cass. com., 11 juill. 2000, n° 97-22452 : D. 2000, p. 339, note Lienhard A. ; JCP E 2001, n° 31, p. 1331, note Stoufflet J.
-
92.
Cass. com., 11 oct. 2017, n° 15-18372 approuvant la cour d’appel d’avoir décidé « à bon droit que l’ajout de ces textes réglementaires, fussent-ils abrogés, n’a pas d’incidence sur la validité de la cession », RDC 2018, n° 114w2, p. 44, obs. Libchaber R. ; RDC 2018, n° 114x0, p. 58, obs. Julienne M. ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, n° 306x9, p. 65, note Moreil S. ; RTD civ 2017, p. 861, obs. Barbier H. ; Banque & droit nov.-déc. 2017, n° 176, p. 29, obs. Bonneau T. ; RTD civ. 2018, p. 186, obs. Crocq P.
-
93.
C. com., art. L. 527-1 à C. com., art. L. 527-11.
-
94.
Jusqu’à ord. n° 2016-56, 29 janv. 2016, le Code de commerce n’autorisait pas le pacte commissoire à la différence du droit commun du gage depuis l’ordonnance du 23 mars 2006, v. C. civ., art. 2348.
-
95.
Cass. com., 19 févr. 2013, n° 11-21763, jugé que « s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à C. com., art. L. 527-3, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession » : D. 2013, p. 493, obs. Dammann R. et Podeur G. et p. 1713 obs. Crocq P. ; RTD civ. 2013, p. 418, obs. Crocq P. ; RTD com. 2013, p. 328, obs. Bouloc B. et p. 574, obs. Legeais D. ; RD bancaire et fin. 2013, comm. 59, obs. Legeais D. ; Dr. & patr. mensuel 2013, p. 96, note Aynès A. ; JCP G 2013, doctr. 585, spéc. n° 1, obs. Delebecque P. ; JCP G 2013, p. 539, note Martial-Braz N. ; Gijsbers C., « L’exclusion du droit commun du gage par le régime spécial du gage des stocks », RLDC avr. 2013, p. 26 ; d’Avout L. et Danos F., « Collisions de régimes juridiques en matière de sûretés réelles », Dr. & patr. mensuel 2013, p. 24
-
96.
La fiducie par exemple, v. nos obs., Lasbordes-de Virville V., « L’avenir incertain du gage de stocks du Code de commerce après l’arrêt du 19 février 2013 : à propos de l’interdiction d’une soumission conventionnelle au gage du Code civil », Rev. proc. coll. juill./août 2013, p. 20.
-
97.
CA Paris, 27 févr. 2014, n° 13/03840 : D. 2014, p. 924, note Gijsbers C. ; D. 2014, p. 1613, obs. Crocq P. ; RLDC juill-août 2014, p. 38, note Clavel-Thoraval J. ; JCP 2014, p. 635, note Delebecque P.
-
98.
Cass. ass. plén., 7 déc. 2015, n° 14-18435 : RTD civ. 2016, p. 416, obs. Crocq P. ; RTD com. 2016, p. 186, obs. Bouloc B. ; RDC 2016, n° 113m9, p. 470, obs. Julienne M. ; JCP G 2016, 57, note Ansault J.-J. et Gijsbers C. ; Gaz. Pal. 16 févr. 2016, n° 257q3, p. 30, note Dumont-Lefrand M-P ; Gaz. Pal. 12 janv. 2016, n° 254q4, p. 22, note Piedelièvre S.
-
99.
C’est ce que préconise l’avant-projet de réforme du droit des sûretés présenté à l’automne 2017 par l’association Henri Capitant, v. Grimaldi M., Mazeaud D. et Dupichot P., « Présentation d’un avant-projet de réforme du droit des sûretés », D. 2017, p. 1717.
-
100.
Le gage des stocks est en effet maintenu dans le Code de commerce.
-
101.
Par un renvoi express à C. civ., art. 2348, v. C. com., art. L. 527-1.
-
102.
C. com., art. L. 527-1, al. 4, « Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu à C. civ., art. 2333 et s. ».
-
103.
V. en ce sens, Gijsbers C « Le nouveau visage de la cession de créance », Dr. & patr. mensuel 2016, n° 260, p. 46 et s. ; v. aussi, Deshayes O., « Mobilisation de créance : quel instrument choisir depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit des obligations », RDC 2018, n° 115f0, p. 308, spéc. n° 17 ; Stoufflet J., JCl. Banque – Crédit – Garantie, fasc. 570, spéc. n° 8.
-
104.
Goldie-Génicon C., Contribution à l’étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des contrats, préf. Lequette Y., 2009, LGDJ, t. 509, spéc. n° 393 ; Balat N., « Réforme du droit des contrats : et les conflits entre droit commun et droit spécial ? », D. 2015, p. 699.
-
105.
Sous réserve du caractère d’ordre public de la règle spéciale.
-
106.
V. Grimaldi M., Mazeaud D. et Dupichot P., « Présentation d’un avant-projet de réforme du droit des sûretés », D. 2017, p. 1717 ; v. aussi, l’avant-projet Catala de réforme du droit des obligations et de la prescription : Synvet H., « Opérations sur créances, Exposé des motifs », in Catala P. (dir.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, 2006, La documentation française, p. 70 et s.
-
107.
C. civ., art. 2372-1 à C. civ., art. 2372-5 issus de l’ord. n° 2009-112, 30 janv. 2009.
-
108.
Projet d’articles 2373 à 2375 du Code civil.
-
109.
V. supra n° 13
-
110.
C. civ., art. 2025 ; C. civ., art. 2024 et supra n° 18.
-
111.
La cession en garantie n’est que succinctement évoquée à C. mon. fin., art. L. 313-24.
-
112.
V. supra n° 14.
-
113.
C. mon. fin., art. L. 313-23, 4°.
-
114.
V. supra n° 6.
-
115.
C. civ., art. 1323, al. 3.
-
116.
V. Julienne M., « Nantissement ou cession(s) fiduciaire(s) : que choisir ? », RDC 2018, n° 115d7, p. 318, spéc. n° 14 ; Borga N., « La concurrence des fiducies-sûretés », in Borga N. et Gout O. (dir.), L’attractivité du droit français des sûretés 10 ans après la réforme, 2016, LGDJ, p. 145, n° 9.
-
117.
La situation du cessionnaire de droit commun apparaîtra ici encore moins satisfaisante que celle réservée au cessionnaire Dailly lequel profite de la garantie solidaire du cédant, v. supra n° 11.
-
118.
L’avant-projet Catala de réforme du droit des obligations et de la prescription prévoyait, art. 1257-1, qu’« une créance peut être cédée en propriété sans stipulation de prix à titre de garantie. Elle fait retour au cédant lorsque le cessionnaire a été rempli de ses droits ou que l’obligation garantie est éteinte pour une autre cause », v. Synvet H., « Opérations sur créances (art. 1251 à 1282) », in L’avant- projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, 22 sept. 2005.
-
119.
V. Legeais D., L’avenir du Dailly, in Mélanges AEDBF, 2001, p. 219, spéc. n° 2 soulignant que « l’avenir du Dailly dépend presque exclusivement de sa résistance à l’emprise sans cesse croissante du droit des procédures collectives » ; Malecki C., « Le bordereau Dailly à l’épreuve du droit des procédures collectives », in Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, 2003, Dalloz, p. 767 et s.
-
120.
Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 04-18372 : RD bancaire et fin. 2007, comm. 209, obs. Crédot F. et Samin T. ; RDC 2008, p. 425, obs. Aynès A.
-
121.
Parce qu’elle n’est pas visée par l’article L. 632-1, 6° et qu’elle n’est pas un paiement d’une dette non échue au sens de l’article L. 632-1, 3°, v. en ce sens Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15361 : « la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie », dès lors, elle ne constitue pas le paiement de la dette garantie, RD bancaire et fin. 2017, comm. 133, obs. Houin-Bressand C. ; RTD civ. 2017, p. 455, obs. Crocq P. ; RTD com. 2017, p. 434, obs. Martin-Serf A.
-
122.
C. mon. fin., art. L. 313-23, 4°, exige que le bordereau prévoie la désignation ou l’individualisation des créances ou à défaut, « des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance ».