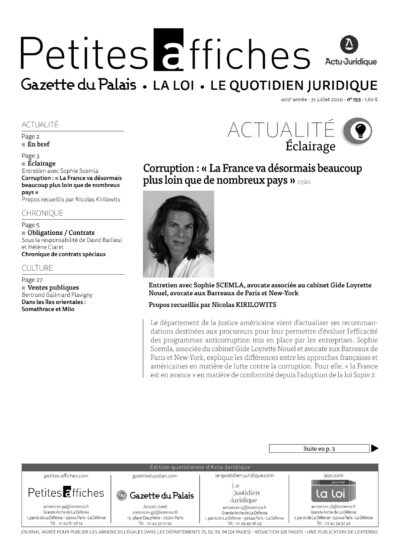Chronique de contrats spéciaux
Avec cette nouvelle chronique, les enseignants-chercheurs affiliés au centre de recherche en droit Antoine Favre, de l’université Savoie Mont Blanc, livrent leur analyse de quelques décisions de jurisprudence relatives aux contrats spéciaux. Les décisions retenues le sont pour leur intérêt du point de vue de l’état du droit et de son évolution, mais aussi pour la diversité des thématiques qu’elles présentent, et qui reflètent l’ambition collective de celles et ceux qui participent. Dans la continuité des publications précédentes, la chronique s’intéresse ainsi principalement aux contrats de droit privé, mais aussi aux contrats publics, et réserve une place particulière aux problématiques numériques.
I – Contrats relatifs au transfert de biens
A – Promesse unilatérale de vente
« Entre l’esprit et la lettre de l’ordonnance de réforme du droit des contrats, la Cour de cassation lève une (légère) incertitude en matière de promesse unilatérale » (Cass. 3e civ., QPC, 17 oct. 2019, n° 19-40028).
Si la réforme du droit des contrats du 10 février 20161, avait entendu briser la fameuse jurisprudence Cts Cruz2, les poches de résistance jurisprudentielles3 et doctrinales4 se sont multipliées çà et là. On sait en effet que la Cour de cassation retenait en substance que la rétractation du promettant dans le cadre d’une promesse unilatérale de contrat était fautive, mais efficace5. Partant, le bénéficiaire ne pouvait forcer la conclusion d’un contrat dont le promettant ne voulait plus et devait se contenter de dommages et intérêts. Globalement mal perçue par la doctrine, cette position devrait, conformément à l’apparente volonté du législateur, être progressivement abandonnée. En effet, désormais, suivant l’alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil, « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».
C’est justement cette disposition qui fait l’objet de la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, adressée par un juge de la mise en état à la Cour de cassation, à la suite de la rétractation par un promettant d’une promesse unilatérale de vente conclue après l’entrée en vigueur de l’ordonnance. La question posée était alors de savoir si l’article en question est contraire au principe de la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété garanti par l’article 17 du même texte. La réponse est apportée avec force par la troisième chambre civile. La question n’est ni nouvelle, en ce qu’elle ne porte pas sur une l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application ; ni sérieuse, « dès lors que, selon l’article 1124, alinéa 1er, du Code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ». La question n’est donc pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Ce faisant, la Cour de cassation préserve, au moins en apparence, l’esprit du texte (I), mais les lacunes persistantes de celui-ci (II) pourraient, malgré l’intention des rédacteurs de l’ordonnance, conduire à un maintien plus ou moins artificiel des conséquences de la jurisprudence antérieure.
I. La préservation apparente de l’esprit du texte
La question de la conformité aux droits fondamentaux de l’exécution forcée de la promesse, ou plutôt de la réalisation forcée du contrat, est balayée6. Cette solution semble en conformité avec l’objet même de la promesse unilatérale. Tout d’abord, le promettant ne saurait invoquer une privation de liberté contractuelle dès lors qu’il a déjà, au moment de la conclusion de la promesse, renoncé à la possibilité de retirer son consentement. Puisque la promesse renferme l’accord du promettant au contrat définitif, sa liberté contractuelle a déjà été exercée et il ne saurait dès lors être question qu’il puisse s’en prévaloir à nouveau. Si certains auteurs ont pu s’interroger sur l’absence de caractère sérieux de la question7, la solution de la Cour de cassation se justifie pleinement dès lors que l’on recentre le débat sur la nature profonde des effets de la rétractation illicite et sur l’esprit du texte.
L’article 1124, alinéa 2, du Code civil, prévoit que « la révocation (…) n’empêche pas la formation du contrat promis ». La formule peut sembler à première vue assez maladroite8, en ce qu’elle ne prévoit pas systématiquement l’inefficacité de la révocation, mais se contente de prévoir ce qu’elle ne paralyse pas9. L’on pourrait néanmoins envisager cette rédaction comme une sorte d’alternative laissée à la discrétion du bénéficiaire. S’il entend toujours, malgré la révocation, lever l’option et conclure le contrat, il pourra considérer la révocation comme inefficace. Si au contraire, échaudé par la révocation, il ne souhaite plus conclure le contrat et ne pas lever l’option, il aura la possibilité de se voir restituer le montant de l’indemnité d’immobilisation, dès lors que celle-ci a été stipulée. Dans cette dernière hypothèse, la révocation demeurerait alors en partie efficace, mais serait fautive et justifierait alors une « sanction » du promettant, en dehors même de toute action en justice exercée par le bénéficiaire tendant à obtenir des dommages et intérêts10. L’on admettra néanmoins que le seul risque de perdre le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation pour le promettant paraît bien peu dissuasif et neutre économiquement. La stipulation d’une clause pénale destinée à contraindre le promettant à respecter son engagement s’imposerait alors. Cette interprétation serait, peut-être, en adéquation avec les circonstances entourant la conclusion d’une promesse unilatérale. Le choix par les parties de cette forme d’avant-contrat, et donc l’exclusion du recours à la promesse synallagmatique, peut, en pratique, se justifier par la volonté de limiter le contentieux, essentiellement dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne souhaite plus conclure. Dans ce cas de figure le promettant est, en effet, privé de toute action en justice à l’encontre de son cocontractant, mais conserve l’indemnité d’immobilisation et retrouve la liberté de vendre le bien11. Laisser les conséquences de la révocation dans les seules mains du bénéficiaire s’inscrirait donc dans cette conception de la promesse unilatérale conçue comme un outil de désactivation du contentieux. L’on admettra toutefois qu’un tel objectif ne pourrait être rempli qu’à la condition que la rédaction de la promesse ait été entourée de précautions (indemnité d’immobilisation et clause pénale), ce qui limite considérablement les mérites du texte !
Dès lors que le bénéficiaire entend lever l’option, la révocation est donc inefficace. Partant, la conclusion du contrat définitif n’est pas à proprement parler une sanction de la révocation ; elle n’est que la conséquence de l’inefficacité de cette dernière. L’inefficacité conduit à nier l’existence de cet acte juridique, à faire comme s’il n’avait jamais existé, et donc à demeurer dans la situation juridique créée par la promesse. Il n’est pas question d’exécution forcée de la promesse voire d’une quelconque obligation12, mais bien de respecter la force obligatoire de l’avant-contrat13. Pour aller légèrement plus loin, l’on pourrait ajouter que s’il est question de liberté contractuelle une fois la promesse conclue, il ne peut s’agir que de celle du bénéficiaire de la promesse, qui seul peut décider ou non de conclure le contrat projeté. Une telle analyse de la promesse permet d’ailleurs de justifier pleinement la requalification d’un tel avant-contrat en promesse synallagmatique lorsque le montant trop important de l’indemnité d’immobilisation, versé par le bénéficiaire au promettant, rend illusoire la liberté du premier de ne pas vouloir conclure le contrat14. Nier toute portée à la révocation du promettant devrait dès lors exclure toute autre solution que la conclusion du contrat, à la condition, bien entendu, que le bénéficiaire lève l’option. Les dommages et intérêts, ayant vocation à sanctionner l’inexécution d’une obligation, n’ont guère de place en la matière.
Ne pas envisager la conclusion du contrat définitif comme une sanction, mais simplement comme l’issue naturelle du contrat de promesse unilatérale conduit également à éclairer les raisons de la mise à l’écart de la question de la privation de propriété. La question prioritaire de constitutionnalité faisait ici probablement écho à la pensée d’une auteure relative à la position de l’article 1124 du Code civil. Celle-ci se demandait en effet « comment l’exécution forcée d’un contrat non translatif de propriété – le contrat de promesse unilatérale de vente – peut-elle entraîner le transfert forcé de la propriété »15 ? Or si l’on admet qu’il n’y a pas d’exécution forcée de la promesse, mais simplement une conclusion du contrat définitif par la levée d’option, le transfert de propriété découle bien de la vente et non de l’avant-contrat. L’aliénation de propriété n’est donc pas véritablement imposée au vendeur qui y a consenti au stade de l’avant-contrat, il n’y a ici ni transfert de propriété sans consentement ni dénaturation du sens et de la portée du droit de propriété au sens du Conseil constitutionnel.
II. L’exploitation potentielle des lacunes de la lettre ?
La portée de la décision de non-renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité ne doit toutefois pas être surestimée. La Cour de cassation ne fait guère preuve ici de contrition vis-à-vis de sa jurisprudence antérieure à l’ordonnance de réforme. En effet, elle avait admis dans un arrêt du 27 mars 2008 que les parties à la promesse unilatérale « étaient libres de convenir que le défaut d’exécution par le promettant de son engagement de vendre pouvait se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente ». En outre, puisqu’une telle clause était jugée valable, la Cour de cassation reconnaissait bien implicitement l’absence de contrariété aux droits fondamentaux de l’inefficacité de la révocation. Nombreuses sont encore les incertitudes quant à la réception par la Cour de cassation du nouveau dispositif législatif de la promesse unilatérale. L’on ne saurait, pour l’heure, interpréter l’arrêt sous commentaire comme une traduction de la volonté des magistrats du quai de l’Horloge de revenir pleinement sur le régime jurisprudentiel de la promesse tel que créé depuis 1993.
Deux éléments nous paraissent pouvoir être soulevés par la Cour de cassation si d’aventure celle-ci souhaitait maintenir – au moins partiellement – les effets de la jurisprudence Cts Cruz. Le premier a déjà été souligné en doctrine et se fonde sur la mauvaise qualité rédactionnelle du second alinéa de l’article 1124 du Code civil. En effet, l’application littérale de la formule retenue pourrait permettre de considérer que deux temps doivent être distingués : le premier, celui de la réalisation des conditions suspensives, le second, celui de l’option. Or dans l’article, la révocation du promettant n’est envisagée que « dans le temps laissé au bénéficiaire pour opter ». Partant, tant que les conditions sont pendantes, une interprétation a contrario conduirait à considérer que la révocation, certes fautive, demeurerait efficace16.
Le second tient à la détermination du préjudice réparable si la conclusion forcée du contrat définitif est exclue, lorsque la violation de la promesse est liée à la conclusion du contrat avec un tiers de bonne foi, ou si le bénéficiaire préfère opter pour des dommages et intérêts plutôt que pour la réalisation forcée du contrat. La question se pose alors nécessairement de savoir s’il convient d’indemniser l’intérêt positif, et donc procurer au bénéficiaire « l’équivalent le plus fidèle possible à l’avantage en nature obtenu »17 ; ou, comme semblait le retenir la jurisprudence précédant l’ordonnance, la perte de chance d’obtenir un gain18. La solution antérieure se justifiait par l’absence de droit à la conclusion du contrat. Elle devrait donc être abandonnée puisqu’à l’inverse l’alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil postule l’existence de ce droit19. Pour autant, lorsqu’un contrat est passé en violation de la promesse avec un tiers de bonne foi, la préservation des intérêts de ce dernier conduit à exclure la conclusion forcée du contrat promis. En effet, le troisième alinéa de l’article 1124 précité prévoit la nullité du contrat conclu en violation de la promesse lorsque le tiers connaissait l’existence de l’avant-contrat, il laisse nécessairement entendre que lorsque tiers ignorait cette existence, le contrat conclu n’est pas frappé par la nullité. La sanction de la violation de la promesse ne saurait dès lors qu’être constituée par des dommages et intérêts. Or dans cette hypothèse le droit à la conclusion du contrat disparaît : la révocation demeure fautive, mais est alors efficace. La raison devrait conduire à indemniser le bénéficiaire selon des règles identiques à celles de la violation de la promesse sans conclusion du contrat avec un tiers20. Il n’est, cependant, pas totalement à exclure que les magistrats voient dans cette situation un moyen détourné de faire renaître les conséquences de la jurisprudence Cts Cruz en refusant l’indemnisation du gain manqué et en cantonnant celle-ci à la seule perte de chance de réaliser un gain. La situation serait pour le moins caricaturale, qui consisterait à retenir un préjudice différent selon que la violation de la promesse ait été accompagnée ou non de la conclusion du contrat promis avec un tiers, mais l’attachement marqué de la Cour de cassation à sa conception bien particulière de la promesse unilatérale pourrait continuer de susciter la controverse.
Johann LE BOURG
B – Vente immobilière
« L’absence d’actualisation des informations relatives aux risques lors de la conclusion de l’acte authentique fait obstacle à la perfection de la vente » (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, nos 18-16700, 18-16935 et 18-17562).
Une société civile immobilière a vendu à une autre un terrain de camping. Un acte sous seing privé fut signé entre les parties le 13 août 2008 avant qu’un acte authentique ne soit dressé le 24 mars 2009 par un notaire. Concomitamment, une société a vendu à une autre le fonds de commerce du camping. Un cabinet fut chargé d’établir le dossier de diagnostic technique. Ce dossier, annexé au contrat de vente, ne faisait pas état du fait que le terrain se trouvait en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation approuvé par arrêté préfectoral après la conclusion de l’acte sous seing privé, le 25 novembre 2008, et publié le 18 février 2009 au Recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département.
Pour cette raison, les acquéreurs se sont heurtés au rejet de leur demande d’obtention d’un permis de construire un local technique pour une piscine chauffée. Sur le fondement de l’article L. 125-5 du Code de l’environnement, ces derniers ont alors assigné les vendeurs en résolution de la vente et en indemnisation de leurs préjudices pour défaut d’information sur l’existence d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Dans un arrêt du 21 mars 2018, la cour d’appel d’Agen fait droit à la demande des acquéreurs et prononce la résolution de la vente. Le pourvoi formé par les vendeurs dont était saisie la troisième chambre civile invoquait différents arguments, et notamment le principe énoncé à l’article 1589 du Code civil selon lequel la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Selon les vendeurs, c’était donc au jour de la signature de la promesse de vente par acte sous seing privé qu’il convenait d’apprécier le respect de l’obligation d’information qui leur incombait, la vente étant parfaite dès le 13 août 2008.
Dans un arrêt du 19 septembre 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les vendeurs et approuve la cour d’appel d’avoir prononcé la résolution de la vente. Se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 125-5 du Code de l’environnement, L. 271-4 et L. 271-5 du Code de la construction et de l’habitat, elle retient que si après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un PPNRP, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l’acte authentique par un état des risques ou par une mise à jour de l’état existant.
L’absence d’actualisation des informations relatives aux risques lors de la conclusion de l’acte authentique fait ainsi obstacle à la perfection de la vente. Cette solution renforce les droits de l’acheteur qui est prémuni contre tout changement de circonstances intervenant entre la signature de la promesse de vente et celle de l’acte authentique. Elle tend également à renforcer les obligations auxquelles les notaires sont tenus. Ils devront se montrer particulièrement vigilants quant à l’évolution de la situation juridique du bien entre la signature de la promesse de vente et celle de la signature de l’acte authentique en raison de leur obligation de conseil et de renseignement, d’une part, et de celle d’assurer l’efficacité de l’acte au regard du but poursuivi par les parties, d’autre part21.
Défavorable aux vendeurs, cette solution se montre protectrice des prévisions contractuelles des parties, plus particulièrement de celles des acquéreurs. En effet, ces derniers avaient acquis le terrain de camping avec l’intention de l’améliorer. Le refus de délivrance du permis de construire sollicité faisait échec à ce projet. Il s’agit donc de protéger leur consentement. De la même façon que les parties peuvent faire de la réitération du compromis par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, faisant échec à l’application de l’article 1589 du Code civil22, la prescription par le législateur d’une obligation d’information tend à faire de cette obligation un élément essentiel de ce consentement. En son absence, la vente ne peut être parfaite.
En dépit de l’impossibilité de réaliser les travaux souhaités, le camping n’était pas impropre à sa destination normale. Ce n’est donc pas de vice caché dont il était question. En revanche, il apparaît que la chose n’était pas conforme aux spécifications convenues entre les parties. Ce qui était reproché ici aux vendeurs, c’est l’inexécution de leur obligation de délivrance énoncée à l’article 1604 du Code civil.
Le pourvoi invoquait le fait que l’arrêté du 25 novembre 2018 ne faisait pas partie des informations mises à disposition par le préfet sur le site internet de la préfecture. Les vendeurs soutenaient qu’ils avaient exécuté leur obligation d’information en tenant compte de ces informations. Ils faisaient valoir leur ignorance du PPNRP et semblaient ainsi soutenir que cette absence les avait privés de la possibilité d’exécuter diligemment leur obligation d’information, autrement dit, que la non-conformité ne leur était pas imputable. Ils espéraient que leur responsabilité soit écartée, la jurisprudence rejetant la responsabilité du vendeur dans une telle situation23. Approuvée par la Cour de cassation, la cour d’appel avait rappelé que les informations contenues sur le site internet de la préfecture n’avaient qu’une valeur indicative, de sorte qu’il convenait de consulter le recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département. Les vendeurs avaient donc l’obligation de se renseigner de sorte que leur ignorance du PPNRP n’était pas légitime.
En revanche, cette obligation ne pèse pas sur les acquéreurs, pas plus qu’une éventuelle acceptation des risques qui leur serait opposable. Dans cet arrêt, des éléments étaient pourtant de nature à susciter chez les futurs acquéreurs une certaine vigilance. En effet, le dossier de diagnostic technique annexé au compromis mentionnait que le camping était en zone inondable dans le PPNRP prescrit par arrêté préfectoral en 2002. La cour d’appel avait d’ailleurs observé que cette situation faisait « peser sur l’établissement un risque d’inconstructibilité important, compte tenu, notamment, de sa situation en bordure d’eau »24. En outre, puisque la possibilité d’entreprendre des travaux d’amélioration était déterminante du consentement des époux, on peut se demander s’ils n’auraient pas dû prévoir une condition suspensive d’obtention du permis de construire, qui, par ailleurs, n’a été sollicité qu’1 an après l’acquisition. Certes, en raison des délais d’instruction des demandes de permis de construire, la stipulation d’une telle condition aurait pu se heurter à la réticence des vendeurs. Mais en son absence, on pourrait considérer que les acquéreurs ont accepté d’assumer la charge du risque encouru. Tout cela suppose bien évidemment que les acquéreurs non professionnels aient été informés de cette possibilité par le notaire. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, ne tient pas compte de ces éventuelles réserves. Les acquéreurs n’ont aucune obligation de se renseigner puisqu’ils sont créanciers d’une obligation d’information. Leur ignorance était donc bien légitime et ils n’avaient pas à assumer la charge du risque.
En revanche, ces différentes circonstances auraient dû attirer l’attention du notaire auquel un manque de diligence pourrait être opposé, plus précisément un manquement à son obligation de renseignement et de conseil. Ces éléments auraient dû le conduire à se renseigner auprès des acquéreurs afin de connaître leurs intentions et sur l’éventuel changement de situation administrative du bien. Cette information était facilement accessible pour ce professionnel, le préfet adressant copie de ses arrêtés pris sur le fondement de l’article R. 125-24 du Code de l’environnement à la chambre départementale des notaires. Ce manque de diligence a justifié la reconnaissance par les juges du fond de sa responsabilité en raison des préjudices subis par les acquéreurs25.
Cet arrêt illustre la tendance actuelle du droit de la vente à privilégier les intérêts des acquéreurs au détriment de ceux des vendeurs. Cette tendance laisse également présager un renforcement de la responsabilité professionnelle du notaire.
Laurie FRIANT
II – Contrats de bail
« Bail commercial, pouvoirs de l’usufruitier et paiement de l’indemnité d’éviction » (Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-26162).
L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 201926 permet une rencontre entre le droit civil et le droit commercial, une confrontation entre le caractère temporaire de l’usufruit et la durée parfois très longue de certains baux. Il vient nourrir la jurisprudence déjà importante et les débats relatifs à la location d’un local commercial faisant l’objet d’un démembrement de propriété.
Une usufruitière et une nue-propriétaire d’un immeuble à usage commercial loué avaient délivré aux preneurs un refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction. Par un arrêt du 20 février 2008, confirmé sur ce point par une ancienne décision de la Cour de cassation27, ce refus de verser l’indemnité due en cas de non-renouvellement du bail commercial a été déclaré sans motif grave et légitime. La cour d’appel de Toulouse, dans une décision du 3 octobre 2018, va alors condamner in solidum l’usufruitière et la nue-propriétaire au paiement de l’indemnité d’éviction au motif que la nue-propriétaire a fait délivrer l’acte de refus de renouvellement qui excède en soi les pouvoirs du seul usufruitier28. La Cour de cassation rappelle dans un premier temps qu’en cas de démembrement de propriété, l’usufruitier, qui a la jouissance du bien, ne peut, en application de l’article 595, dernier alinéa, du Code civil, consentir un bail commercial ou le renouveler sans le concours du nu-propriétaire ou, à défaut d’accord de ce dernier, qu’avec une autorisation judiciaire, en raison du droit au renouvellement du bail dont bénéficie le preneur même après l’extinction de l’usufruit. La haute juridiction précise dans un second temps que, en revanche, l’usufruitier a le pouvoir de mettre fin au bail commercial, et, par suite, de notifier au preneur, sans le concours du nu-propriétaire, un congé avec refus de renouvellement et a, seul, la qualité de bailleur dont il assume toutes les obligations à l’égard du preneur ; dès lors l’indemnité d’éviction due en application de l’article L. 145-14 du Code de commerce, qui a pour objet de compenser le préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement du bail, est à sa charge. Elle reproche donc à la cour d’appel d’avoir condamné la nue-propriétaire in solidum avec l’usufruitière, alors que l’indemnité d’éviction n’était due que par celle-ci.
Cette décision est l’occasion de rappeler les règles relatives à la conclusion d’un bail commercial portant sur un local dont la propriété est démembrée (I) et précise les règles relatives au congé et au paiement de l’indemnité d’éviction (II).
I. Rappel des règles de conclusion d’un bail commercial portant sur un local dont la propriété est démembrée
Selon l’alinéa 4 de l’article 595 du Code civil, « l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ». Cette règle est issue de la loi du 13 juillet 196529 et ne concerne que les baux conclus après le 1er février 196630. Elle s’applique à tous les baux de biens ruraux qu’ils soient soumis ou non au statut du fermage ou à celui des baux commerciaux à l’époque de la conclusion du contrat31 et à tous les baux d’immeubles à usage commercial32. En revanche, ne sont pas concernés par cet alinéa 4 les baux d’habitation, la location-gérance33 ou la convention d’occupation précaire34. Dans le prolongement de cette règle, la Cour de cassation a considéré que devaient être également déclarés nuls les baux signés par le seul nu-propriétaire, en fraude des droits de l’usufruitier35. Si le nu-propriétaire refuse de donner son accord à la conclusion du bail, l’usufruitier peut se voir autorisé en justice à passer l’acte seul ; le juge examinant les intérêts en présence36 et devant vérifier que le bail ne porte pas atteinte à la substance de la chose37 et préjudice au nu-propriétaire38. La règle issue de l’alinéa 4 de l’article 595 du Code civil est rappelée par la Cour de cassation dans cet arrêt de 2019 qui cite une décision de la troisième chambre civile du 24 mars 199939 ; elle vise en effet à protéger le nu-propriétaire contre l’exercice du droit au renouvellement dont certains preneurs sont titulaires40 et qui permettrait à ces derniers de rester sans limitation de durée dans des locaux41, et ce même après l’extinction de l’usufruit42. Dans ces circonstances, le bail devient alors plus un acte de disposition, qu’un acte d’administration43.
Bien que le Code civil ne précise pas la sanction du défaut d’accord du nu-propriétaire ou d’autorisation de justice, les juges estiment que celui-ci peut demander la nullité du bail44, sans même attendre la fin de l’usufruit45 ou le décès de l’usufruitier et alors même qu’il en est l’héritier46. Il s’agit d’une nullité relative qui ne peut pas être soulevée par le preneur ou l’usufruitier47. La Cour de cassation a donc préféré la nullité à l’inopposabilité de l’acte alors même que le nu-propriétaire n’est pas partie au contrat de bail ; c’est bien l’usufruitier qui est qualifié de bailleur48. Quant à l’usufruitier, il semble qu’il puisse être amené à engager sa responsabilité à l’égard du preneur du fait de l’annulation du bail même si le preneur connaissait la qualité d’usufruitier du bailleur49 et il bénéficie d’une indemnité d’occupation sans titre si le preneur dont le bail a été annulé se maintient indûment dans les lieux50. L’action en nullité du bail conclu en violation de l’article 595 du Code civil doit être intentée dans un délai de 5 ans à compter du jour où le nu-propriétaire en a eu connaissance51. Il appartient au preneur qui prétend que le droit du nu-propriétaire d’agir en nullité du bail est prescrit, d’établir que ce dernier a eu connaissance de ce bail depuis plus de 5 ans à la date de l’assignation, la délivrance du congé ne pouvant suffire à établir une renonciation à la nullité52. Dès lors, si le bail a été exécuté et que plus de 5 ans se sont écoulés depuis qu’il a eu connaissance du contrat, le nu-propriétaire ne peut plus agir en nullité, même par voie d’exception53. Le preneur peut également tenter de sauver son contrat en prouvant que le nu-propriétaire a ratifié le bail ou que l’usufruitier s’est comporté soit comme propriétaire apparent54, soit comme mandataire apparent55. Toutefois, la ratification et la théorie de l’apparence sont rarement admises, les circonstances autorisant le preneur à croire en la ratification ou en la qualité de propriétaire ou de mandataire du nu-propriétaire devant être caractérisées56. Tel n’est pas le cas lorsque des recherches élémentaires auraient pu éviter l’erreur commise par les preneurs sur la qualité du bailleur57 ou alors même que l’usufruitier « s’était comporté comme le seul et unique propriétaire des lieux et avait durant des années perçu lui-même les loyers »58. Il n’y a également pas ratification du bail par la seule remise d’un loyer par le locataire au nu-propriétaire59. Ainsi, le preneur doit vérifier l’étendue des pouvoirs du signataire dès lors qu’il sait qu’il n’est pas le seul propriétaire60.
La Cour de cassation ayant rappelé ces règles relatives à la conclusion du bail commercial, il convient désormais d’étudier l’apport principal de cet arrêt.
II. Précision des règles relatives au congé et au paiement de l’indemnité d’éviction
Pendant toute la durée du bail, l’accord du nu-propriétaire lors de la conclusion du contrat garantit une jouissance paisible au preneur. Dans la mesure où le renouvellement du bail a les mêmes conséquences que la conclusion du contrat initial, c’est-à-dire entrave la jouissance du bien lorsque le nu-propriétaire aura retrouvé la pleine propriété du bien, la Cour de cassation considère que l’article 595, alinéa 4, du Code civil ne comporte aucune distinction entre renouvellement et conclusion du bail initial61. Ainsi, le preneur doit adresser sa demande de renouvellement aux deux détenteurs de droits sur la chose : l’usufruitier et le nu-propriétaire62, alors même que l’article L. 145-10 du Code de commerce lui permet normalement s’il y a plusieurs propriétaires de l’envoyer à l’un d’eux. De la même façon, les juges considèrent que l’usufruitier ne peut seul exercer le droit de repentir que lui permet l’article L. 145-58 du Code de commerce et qui équivaut à une acceptation du renouvellement63.
En cours d’exécution du contrat, et en dehors du renouvellement du bail, l’usufruitier dispose des pouvoirs et devoirs du bailleur qu’il exerce et accomplit seul64. Ainsi, les travaux et réparations sont à sa charge65, il peut autoriser la cession de bail66 ou demander la résiliation judiciaire du contrat67. Si des modifications secondaires du bail semblent pouvoir être effectuées par le seul usufruitier, la Cour de cassation a récemment considéré que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, consentir une réduction de la moitié du loyer, ni une reconnaissance de dette au preneur68. Quant à la fin du contrat, les juges décident que l’usufruitier a le pouvoir de délivrer seul un congé au preneur69, de lui refuser le renouvellement du bail70 ou d’exercer son droit de reprise71. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt commenté ici et qui cite une décision de la troisième chambre civile du 29 janvier 197472. La solution se justifie pleinement puisqu’un congé ou un refus de renouvellement met fin au bail et restitue donc au nu-propriétaire son droit de jouissance au terme de l’usufruit. La fin du bail implique toutefois le plus souvent le versement d’une indemnité au preneur destinée à compenser le préjudice causé par l’éviction, comme le rappelle la haute juridiction dans notre arrêt. La question posée ici porte précisément sur le paiement de cette indemnité d’éviction. Les juges peuvent-ils condamner solidairement l’usufruitier-bailleur et le nu-propriétaire au paiement de cette indemnité, notamment lorsque le congé a été délivré de concert par ceux-ci ?
La cour d’appel de Toulouse avait préféré condamner l’usufruitière et la nue-propriétaire au paiement in solidum de l’indemnité d’éviction au motif que les deux avaient agi ensemble pour délivrer le refus de renouvellement. La cour d’appel de Paris, dans une autre affaire, a jugé, elle, que seul l’usufruitier est redevable envers le preneur de l’indemnité d’éviction dans la mesure où l’usufruitier est tenu aux obligations du bailleur à l’égard des locataires de l’immeuble sur lequel porte son usufruit73. La Cour de cassation, dans notre arrêt du 19 décembre 2019, va utiliser le même argument que la cour d’appel de Paris, puisqu’elle estime que l’usufruitier a le pouvoir de mettre fin au bail commercial sans le concours du nu-propriétaire74, et a, seul, la qualité de bailleur dont il assume toutes les obligations à l’égard du preneur, notamment le paiement de l’indemnité d’éviction. Peu importe donc que le nu-propriétaire ait participé à l’envoi du refus de renouvellement, il n’en devient pas pour autant partie au contrat. Cette décision se justifie pleinement dans la mesure où l’usufruitière aurait pu se dispenser de l’accord de la nue-propriétaire pour rompre le contrat, et le paiement de l’indemnité d’éviction doit reposer sur celui qui a la qualité de bailleur quels que soient ses droits sur le local loué75.
Delphine SASSOLAS
III – Contrats publics
« L’imprévision, entre considérations économiques et juridiques » (CE, 21 oct. 2019, n° 419155, Sté Alliance).
Rares sont les décisions du Conseil d’État en matière d’imprévision. Plus d’un siècle après sa consécration76, l’abondance des écrits doctrinaux faisant référence à la théorie en droit positif est inversement proportionnelle à son application au contentieux. Cela s’explique principalement pour deux raisons : d’abord, le juge administratif n’accorde d’indemnisation pour préjudice économique anormalement grave que si l’ensemble des conditions juridiques de l’imprévision sont réunies, à savoir l’imprévisibilité de l’événement en cause, l’extériorité des circonstances à la volonté des parties, et le bouleversement économique du contrat. Ces conditions cumulatives manifestent le caractère exceptionnel de la situation en cause. Ensuite, il est devenu commun que les parties à un contrat administratif prévoient soit des clauses de renégociation du contrat en cas de bouleversement de ce dernier – dites clauses de hardship –, soit des mécanismes permettant de faire face, par anticipation, à de tels bouleversements – clauses de réindexation par exemple – ; en ce cas, par le jeu des clauses, le risque d’imprévisibilité est très largement circonscrit.
Néanmoins, et parce que de telles clauses ne sauraient se substituer intégralement au jeu de l’imprévision, les parties ont toujours la possibilité de faire appel au juge pour rétablir la justice contractuelle. Tel est le cas dans l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 21 octobre 2019, qui offre ainsi l’occasion aux hauts magistrats de revenir sur les strictes conditions de mise en œuvre de la théorie.
En l’espèce, une convention de délégation de service public, d’une durée de 5 ans, a été conclue en 2004 entre l’État et la société Alliance. Elle visait à confier à cette dernière l’exploitation et la gestion du service de desserte maritime en fret de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Après deux arrêtés de réquisition prononcés au mois de juillet 2008, visant à enjoindre à son partenaire de maintenir la continuité de l’activité malgré ses difficultés financières, le préfet, tirant les conséquences de l’interruption du service, prononce, le 16 septembre suivant, la déchéance de la concession. Saisi par l’entreprise privée d’une demande de résiliation de la convention, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon annule dans un premier temps l’arrêté de déchéance – celui n’ayant pas été précédé d’une mise en demeure –, et ordonne une expertise afin de déterminer les causes des difficultés économiques rencontrées par la société requérante. Dans un second jugement, les juges du fond prononcent la résiliation de la convention au motif d’un bouleversement de l’économie du contrat et rejettent les conclusions indemnitaires par lesquelles la société demandait réparation des préjudices découlant des conditions de l’exécution et de la résiliation contractuelles. Par un arrêt du 19 décembre 2017, contre lequel la société se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux conclut pareillement à un rejet des conclusions indemnitaires, tout en substituant le motif du rejet. Joignant le moyen tiré de l’imprévision et de la responsabilité fautive de l’État, c’est d’abord sur le premier terrain que le juge administratif apporte quelques précisions intéressantes, qui donnent à voir une lecture très largement économique du contrat (I). De manière plus indicible, l’analyse juridique pourrait être enrichie par la considération des principes de bonne foi et de loyauté contractuelle, censés animer les parties (II).
I. La lecture économique du contrat, un préalable au déclenchement de l’imprévision
La mise en œuvre de la théorie de l’imprévision par le juge administratif est d’une rigueur implacable. La situation d’imprévision – situation non fautive – est classiquement constituée par la réunion de trois éléments (imprévisibilité, extériorité, et bouleversement de l’économie du contrat), dont le juge apprécie l’existence à la lumière des faits qui lui sont rapportés. Au regard des espèces qui ont contribué à assurer le prestige de la théorie, l’évolution est néanmoins patente : l’office du juge est désormais largement conditionné par l’expertise économique et financière préalable qu’il commande.
En l’espèce, le bouleversement économique du contrat conclu entre l’État et son délégataire a été reconnu par les juges du fond. Le déficit d’exploitation de la société avéré, il y a tout lieu de penser que l’équilibre financier défini ab initio par les parties a été gravement perturbé.
Mais la véritable problématique réside ici dans les causes qui ont conduit à un tel déficit. Sur ce point, au titre des arguments avancés pour expliquer ses difficultés financières, la société requérante a fait valoir la baisse conséquente de son volume d’activité, à savoir une diminution du fret de 16 % par rapport aux prévisions de trafic réalisées au moment de l’élaboration du contrat. Le caractère imprévisible de l’événement peut sembler irréfutable, dès lors que cette variation de trafic du fret, conjoncturelle et provisoire, est constatée sur le plan international : le juge aurait pu y voir un changement de circonstances que les cocontractants n’auraient pu raisonnablement prévoir. Néanmoins, l’environnement économique du contrat a fait à ce stade l’objet d’évaluations basées sur des documents comptables et présentant un haut degré d’expertise77. De celles-ci, il a pu être déduit que la diminution de l’activité de fret n’était pas « principalement à l’origine des déficits d’exploitation (…), lesquels devaient être regardés comme étant largement la conséquence de l’état de fragilité financière initiale de la société (…) et des conditions dans lesquelles avaient été définis les termes de la délégation ». Dans ce contexte, le juge administratif n’a alors eu aucune difficulté à tirer les conséquences de l’expertise économique diligentée. D’une part, la situation financière originelle dans laquelle se trouvait la société et qui l’a empêchée de surmonter les difficultés liées à l’exploitation ne lui était pas extérieure, et d’autre part, les prévisions erronées des parties lors de la conclusion du contrat ne pouvaient pas, en toute logique, entrer dans le cadre de l’imprévision. Les conclusions de l’expertise économique ne laissent ici pas de place à l’interprétation. Les facteurs exogènes à l’exécution du contrat n’ont joué qu’un rôle mineur dans le bouleversement économique du contrat. Il va de soi que l’Administration n’a alors pas à venir en aide à son cocontractant pour que celui-ci supporte les charges extracontractuelles, marginales en l’occurrence78. Le juge administratif n’a ici nul besoin, comme il peut le faire parfois en pareilles circonstances, de recourir à un seuil pour fixer le point de départ de l’imprévision : « la part du déficit d’exploitation qui était directement imputable à des circonstances extérieures ne suffisait pas à caractériser un bouleversement de l’économie du contrat ». Tout l’enjeu était pour le juge dans cette affaire de mettre en évidence le lien causal entre le préjudice, dont se prévalait la société Alliance, et l’événement imprévisible. Le diagnostic de l’état financier de l’entreprise s’est révélé décisoire ; l’expertise financière a, à elle seule, permis de réfuter l’existence d’un tel lien de causalité. De fait, la haute juridiction peut aisément en conclure que le délégataire n’était pas fondé à solliciter le versement d’une indemnité d’imprévision, et rejeter le pourvoi. Plus que jamais, la théorie de l’imprévision est d’abord appréhendée sous l’angle économique du droit.
Au-delà de cette analyse rigoureusement mathématique, deux éléments peuvent également être mis en avant pour abonder, sur un plan plus juridique cette fois, dans le sens d’un rejet de la mise en œuvre de l’imprévision. D’abord et très classiquement, l’indemnité éponyme n’aurait pu être octroyée que dans l’hypothèse où le cocontractant privé aurait maintenu la continuité du service public dont il avait la charge79. Mais dès l’instant où ce dernier, n’envisageant pas d’exécuter le contrat à perte, a cessé de remplir ses obligations contractuelles, la finalité qui sous-tendait l’application du mécanisme a disparu. Parce que la théorie de l’imprévision ne joue encore qu’au nom de l’intérêt général postulant la continuité du service public, en cas de cessation d’activité, l’Administration n’entend pas prêter son concours financier à son cocontractant qui n’exécute plus ses obligations80.
Ensuite, il convient accessoirement de rappeler que la concession trouve sa raison d’être dans le transfert du risque au partenaire de l’Administration, ce qui implique que ce dernier n’est jamais assuré d’amortir les coûts liés à l’exploitation du service. Le cocontractant accepte une réelle exposition aux aléas du marché, « de sorte que toute perte potentielle supportée (…) ne doit pas être purement nominale ou négligeable »81. L’imprévision n’en est donc que plus difficilement reconnue dans le cadre de la concession. Puisque le délégataire accepte inévitablement de faire face à un aléa économique lorsqu’il contracte, l’imprévision ne se caractérisera que par la soudaineté des évènements qui l’entraînent, et l’intensité de leurs effets, engendrant un préjudice anormalement grave. Le risque ordinaire que le cocontractant a accepté de supporter doit rester à sa charge. Or la diminution du fret constitue sans nul doute un aléa que devait s’attendre à rencontrer le délégataire, sauf à considérer que les conditions d’exécution du contrat ont été définies ab initio de manière tout à fait déloyale. C’est justement sur ce terrain que s’aventure la société requérante. En dénonçant, en appel, les conditions dans lesquelles ont été définis les termes du contrat de délégation qui la lie avec l’Administration, la société – en plus de commettre une erreur grossière sur le plan contentieux – fait alors preuve d’une mauvaise foi incontestable.
II. La considération impérieuse de la bonne foi contractuelle dans la mise en œuvre de la théorie
La théorie de l’imprévision ne peut trouver à s’appliquer que dans le cadre d’une conception du contrat dominée par la commune intention des parties et fondée sur la bonne foi des cocontractants. Si la haute juridiction n’y fait pas expressément référence en l’espèce, la considération du principe de bonne foi, et par extension, l’exigence de loyauté contractuelle, ont pu également guider la démarche contentieuse. Plusieurs éléments attestent de l’intérêt de les replacer au centre de l’analyse.
Tout d’abord, la société requérante, en appel, a tenté de dénoncer l’existence d’une faute de l’État dans l’établissement de la convention « du fait du caractère erroné des prévisions de trafic données aux candidats pour établir leur offre ». Si le juge de cassation ne répond pas ici à ce moyen subsidiaire, qui n’a pas été formellement présenté, la cour administrative d’appel de Bordeaux a pris soin de préciser que les erreurs imputables à l’Administration dans l’établissement de la convention – consistant notamment en des contraintes trop importantes imposées à son cocontractant lors de la définition du schéma d’organisation du service – ne pouvaient justifier une action indemnitaire sur le fondement de la théorie de l’imprévision82. Le contentieux a certes été mal dirigé dès l’origine : d’abord fondé sur l’imprévision, donc sur le terrain extracontractuel, il n’était plus possible par la suite pour le juge d’appel de déférer à la demande indemnitaire de la société sur le fondement de la faute contractuelle. Mais au-delà de cette maladresse contentieuse, sur le fond, l’argument ne laisse pas indifférent. Peut-on imaginer que l’Administration se serait engagée dans des termes identiques dans la voie contractuelle en sachant à l’avance que l’économie du contrat en cours d’exécution serait bouleversée au point d’y perdre son intérêt ? Sauf à supposer qu’elle ait sciemment trompé son partenaire, ce qui relèverait d’une attitude dolosive, elle n’a pas plus d’intérêt que le cocontractant à ce que l’exécution du contrat soit interrompue, et l’activité de service public mise à l’arrêt. En appel, la société soutient au surplus « avoir constamment exécuté son service dans des conditions déficitaires sans que l’État ait accepté de revoir l’économie de la convention alors que les rapports de ses services ont confirmé que la délégation de service public n’était pas viable ». Il résulte néanmoins de l’instruction que sitôt qu’il a eu vent de l’infortune de son partenaire, l’État a spontanément coopéré en lui apportant son soutien immédiat. Procédant à une renégociation des termes contractuels, l’autorité délégante a augmenté le montant de la compensation forfaitaire due au délégataire, et a fait bénéficier la société du versement de plusieurs aides exceptionnelles. Le solidarisme contractuel, gage de la loyauté contractuelle de l’administration, a largement été mis en œuvre : le contrat a été adapté aux nouvelles conditions économiques. Tout porte ainsi à croire que c’est en réalité la société qui a fait preuve de légèreté en s’engageant dans la relation contractuelle. À son tour, en cherchant à profiter de la situation en obtenant un gain qui ne lui revient pas de droit, celle-ci pourrait voir sa perfidie sanctionnée par le juge administratif.
Car au-delà de la tentative de dissimuler sa propre imprévoyance, la société, qui a failli à ses calculs précontractuels, est dans le même temps à la recherche du profit indu. En attestent les conclusions présentées par elle et tendant à l’indemnisation « de son manque à gagner, de la perte de la valeur de son fonds de commerce et de ses frais d’établissement non amortis ». Si l’indemnité d’imprévision se met au service de la pérennité du lien contractuel, elle n’est pourtant pas destinée à réparer un préjudice, mais à compenser une perte occasionnée par l’exécution du service public dans des conditions particulièrement difficiles. Comme le rappelle le Conseil d’État, la société n’était en droit de réclamer au concédant qu’« une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter ». Et l’interprétation raisonnable du contrat à laquelle le Conseil d’État a procédé a permis de prendre la mesure de différents éléments, qu’il s’agisse de la situation économique de l’entreprise, des négligences des parties, ou de la mauvaise foi de la société requérante. En l’occurrence, il conviendrait de rappeler à cette dernière que « le devoir de loyauté du créancier n’est pas illimité, il s’arrête là où commence celui du débiteur »83.
Désormais appréhendée à la lumière de l’environnement économique du contrat, la théorie de l’imprévision n’en paraît que plus singulière ; son application semble relever du « quasi-cas d’école »84. Néanmoins, et parce que tout ne peut pas être anticipé au moment de la conclusion du contrat, parce que les parties n’ont pas – toujours – de talent divinatoire, cette théorie s’inscrit, en droit administratif comme en droit civil, dans une pérennité indiscutable. Il y a d’ailleurs fort à parier qu’au lendemain de ces temps extraordinaires de crise sanitaire bouleversant toutes les activités économiques, la théorie connaîtra une résurgence certaine. À moins que les circonstances exceptionnelles perdurent ; en ce cas, plus que l’imprévision c’est bien la force majeure, visant l’extinction du lien contractuel, qui polarisera l’attention des parties.
Marie COURRÈGES
IV – Contrats et numérique
« À propos de l’arrêt du 19 décembre 2019 rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne » (CJUE, 19 déc. 2019, n° C-390/18).
L’avènement de l’économie numérique a bouleversé des pans entiers de l’économie et a modifié le visage de certaines activités, parmi lesquelles la location immobilière. Cette reconfiguration des activités et des acteurs met à l’épreuve certains des concepts juridiques pourtant bien établis. Le développement du marché des locations de courte durée à l’aide de plates-formes telles que Airbnb participe à cette remise en cause. C’est sur ce point que nous permet de revenir l’arrêt rendu par Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 19 décembre 2019.
Dans cette affaire, la CJUE est saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 3 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.
En l’espèce, la demande adressée à la CJUE intervenait dans le cadre d’une procédure pénale introduite à la suite d’une plainte déposée par l’association pour un hébergement de tourisme professionnel (AhTop) avec constitution de partie civile pour l’exercice illégal d’activité d’entremise, de gestion d’immeuble et de fonds de commerce pour défaut de détention de carte professionnelle telle qu’imposée par l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet85. Pour l’association, la société Airbnb ne se contente pas de mettre en relation deux parties à un contrat de location de courte durée. Les services complémentaires qu’offre la société caractérisent une activité d’intermédiaire en opération immobilière qui relève de la loi Hoguet. De son côté, la société Airbnb conteste exercer une activité d’agent immobilier et réfute l’application de ladite loi en raison de son incompatibilité avec la directive n° 2000/31/CE. La société affirme que le service d’intermédiation qu’elle propose constitue, en principe, un service distinct du service dont elle facilite la réalisation – ici de la location immobilière proposée par les loueurs. Elle considère que le service qu’elle offre doit être qualifié de « service de la société de l’information », puisqu’il est distinct du service subséquent auquel il se rapporte. C’est dans ces conditions que la CJUE a été saisie pour répondre à la question de savoir si le service fourni par Airbnb doit être qualifié de service de la société de l’information au sens de la directive susvisée.
Pour la CJUE, le service fourni par Airbnb ne peut pas être considéré comme un service global dont l’élément principal serait la prestation d’hébergement, de sorte que l’activité de cette société relève de la directive n° 2000/31/CE. Ainsi, les prestations que fournit la société Airbnb présentent un caractère dissociable de l’opération immobilière dont elle permet la réalisation. De ce seul constat, elle déduit que la prestation de la société Airbnb doit être qualifiée de service de la société de l’information. Ainsi, la CJUE relègue au second plan le rôle d’intermédiation en opérations immobilières que joue cette société, en considérant que son activité ne consiste pas dans la réalisation d’une prestation immédiate d’hébergement au titre de la loi de 1970 (I). Pourtant, ce rôle d’intermédiaire permettrait de retenir la qualification (II).
I. Le refus de qualité d’intermédiaire d’opérations immobilières au sens de la loi de 1970
Pour rappel, la question posée à la CJUE est celle de savoir si l’activité de la société était soumise à la directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique ou à la loi Hoguet réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Pour répondre à cette question, la CJUE adopte un raisonnement par disqualification, laquelle est l’envers de la démarche de qualification. Celle-ci consiste à rapprocher théoriquement, de comparer l’inconnu et le connu. Le rapprochement ainsi opéré vise à qualifier juridiquement l’objet à découvrir – ici la qualification juridique de l’activité et du service proposé par Airbnb – et à le traduire ainsi dans les termes qui lui conviennent le mieux86. D’ailleurs, d’un point de vue procédural, la CJUE précise qu’elle ne pouvait prendre en considération, dans son raisonnement, les directives nos 2005/36/CE87 et 2007/64/CE88, sans modifier, en substance, les questions qui lui ont été déférées. En effet, selon la CJUE, une référence à ces textes aurait été nécessaire soit dans les questions préjudicielles soit dans la décision de renvoi pour souligner la nécessité d’interprétation de ces directives par la CJUE.
Toutefois, le fait pour la CJUE d’écarter ces directives, au motif d’une modification substantielle de la question préjudicielle, n’a pas d’incidence sur l’opération de qualification qu’elle devait effectuer pour trancher la question qui lui était posée. De même, l’inapplication, par la CJUE, des directives litigieuses ne rendait pas plus évidente la solution qu’elle a retenue.
En effet, la CJUE devait trancher la question de savoir si l’activité de la société Airbnb entrait dans la qualification retenue par la loi Hoguet (agent immobilier) ou celle retenue par la directive n° 2000/31/CE (« service de la société d’information »). Pour répondre à cette question, la CJUE devait nécessairement, quoiqu’implicitement, raisonner sur le modèle du mandat pour exclure ou reconnaître la qualité d’agent immobilier à la société Airbnb. En effet, aux termes de l’article 1984 du Code civil, le mandat, caractérisé par l’octroi d’un pouvoir de représentation, « est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Dans l’exercice de leur activité, les agents immobiliers apportent leurs concours aux transactions immobilières telles que l’achat, la vente ou la location d’immeubles et sont, à ce titre, investis d’un mandat89. Ce mandat, régi par les dispositions spéciales issues de la loi Hoguet, ne correspond pas au mandat tel que prévu par l’article 1984 du Code civil. Le mandat immobilier est un mandat dont l’essence est l’entremise et qui ne constitue un procédé de représentation que lorsque les parties en ont décidé ainsi. L’agent immobilier n’est donc pas à proprement parler investi d’un pouvoir de représentation au sens de l’article 1153 du Code civil90. Ainsi, l’assimilation par disqualification de l’activité de la société Airbnb aux services de la société de l’information peine à convaincre. Ce faisant, la CJUE fait abstraction du modèle du mandat d’entremise à partir duquel la société exerce ses activités. Or ainsi présenté, le raisonnement de la CJUE peut paraître réducteur, car il cantonne l’activité de la plate-forme à un rôle d’outil technique, en faisant totalement abstraction de la destination même de ce dispositif technique. Par ailleurs, le raisonnement paraît discutable, car il ne tient pas suffisamment compte du rôle d’entremetteur de la société Airbnb dans la conclusion des contrats entre les utilisateurs de la plate-forme et les propriétaires de biens.
Ainsi, le raisonnement de la CJUE laisse entières les interrogations autour du rôle d’intermédiation que joue Airbnb dans la réalisation d’opérations immobilières. Autrement dit, parce qu’elle admet la réalité du rôle d’intermédiaire de la société Airbnb, la CJUE aurait pu mobiliser d’autres qualifications disponibles pour désigner les intermédiaires d’opérations portant sur l’immobilier. Il en est ainsi de marchands de listes, dont l’activité consiste à diffuser auprès du public des publications contenant des offres de propriétaires désireux de vendre ou de louer leurs biens. Ces professionnels, dont l’activité relève également du champ de la loi de 197091, se contentent de donner, moyennant rémunération, la possibilité de se mettre en rapport avec les cocontractants potentiels. N’est-ce pas que la société Airbnb offre une liste structurée au regard des critères de recherche renseignés par l’utilisateur ? L’on nous objectera que la société Airbnb ne marchande pas de liste, dans la mesure où la mise à disposition aux voyageurs/convives de listes relatives aux biens disponibles pour locations se fait à titre gratuit. Or l’apparente gratuité ne doit pas tromper, dans la mesure où le paiement du prix intervient avec les données à caractère personnel, comme l’admet la directive du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques92. Du côté des loueurs dont l’annonce figure sur la plate-forme Airbnb, le paiement du prix par des données à caractère personnel se double d’une commission sur chaque opération réalisée.
Pour se délester de qualifier l’activité d’intermédiaire de la société Airbnb, la CJUE considère, conformément à sa jurisprudence93, que le service d’intermédiation fourni par Airbnb ne fait pas partie d’un service global dont l’élément essentiel relèverait d’une autre qualification juridique que le « service de société de l’information ». Dans son raisonnement, la CJUE retient pour rédhibitoire le caractère dissociable du service d’intermédiation de l’opération immobilière qu’elle permet. Elle indique que le rôle d’intermédiaire que joue la société ne tend pas à la réalisation immédiate d’une prestation d’hébergement, mais, plutôt, de fournir une liste d’hébergements disponibles à partir des critères de recherches retenus par le convive/voyageur. Dès lors, la société Airbnb fournit davantage un instrument facilitant la conclusion de contrats portant sur des opérations futures de location de courte durée.
Pourtant, l’argument ne convainc pas entièrement. Par définition, l’activité d’intermédiaire, investi ou non d’un pouvoir de représentation, ne peut constituer dans la réalisation d’une prestation immédiate. L’intermédiaire intervient dans un secteur d’activité pour favoriser une opération particulière ; un contrat de vente ou de bail (agent immobilier), un contrat d’assurance (courtier), un contrat entre un fournisseur et un distributeur (agent d’affaires) ou encore un contrat de réservation d’hôtel et de transport (agent de voyages). Dans l’absolu, quel que soit le secteur dans lequel il intervient, les prestations que peut fournir un mandataire sont en elles-mêmes dissociables de l’opération économique envisagée. De plus, selon l’étendue de son pouvoir (en cas de mandat) et de ses missions, l’intermédiaire (qui peut être un mandataire) – personne physique – exerce une influence plus ou moins directe sur la réalisation de l’opération projetée. Dès lors, s’agissant de l’opération de qualification, il ne paraît pas pertinent de rechercher si la société Airbnb réalise ou non une prestation immédiate, attendue par les parties au contrat de location de courte durée. L’essentiel réside ailleurs : dans les moyens qu’elle met en œuvre, en sa qualité d’intermédiaire, pour permettre la conclusion des contrats de location. C’est cet élément qui aurait pu constituer le point de repère de la qualification de l’activité d’Airbnb.
II. Le refus discutable de la qualité d’intermédiaire en opérations immobilières
Sans nier le modèle économique des entreprises qui offrent « un service de société d’information », la prise en compte de la qualité d’intermédiaire de la plate-forme aurait permis de nommer aussi un pan de l’activité de la société Airbnb. Pour générer de la richesse, le modèle économique de ces entreprises suppose que chacun des futurs contractants devient « l’entrepreneur » et effectue, à ce titre, un « partage » avec la plate-forme d’un certain nombre de tâches. Regardé sous l’angle de l’économie de partage, le recours au modèle de mandat au sens de la loi Hoguet ne paraît pas incongru. Le propre de ce modèle économique est de faciliter la réalisation de gains d’efficacité. À ce titre, les principaux gains d’efficacité ne proviennent pas du « partage », compris au sens de « l’utilisation d’une seule ressource à des fins multiples [par exemple : l’utilisation du logement à la fois pour les besoins personnels et son partage avec des invités] mais plutôt de la structure de marché que les plates-formes facilitent, tout en évitant aux prestataires de services occasionnels les coûts fixes et, souvent, la réglementation associée au service proposé »94.
La lecture de l’arrêt fait d’ailleurs apparaître plusieurs éléments en ce sens au paragraphe 19 : la mise en relation des loueurs et des locataires potentiels, la proposition de trame de l’offre de contracter, une responsabilité civile en cas de dommages causés au bien, l’estimation de loyer à fixer, un service de photographie visant à valoriser le bien à louer, la fourniture d’une liste de biens disponibles selon les critères choisis par le locataire, la réception des fonds et un service de recommandation permettant d’évaluer d’un côté le bien proposé et le loueur et de l’autre le voyageur-locataire. Ainsi, indépendamment du vocable employé par la CJUE (loueur et locataire pour désigner juridiquement l’« hôte » et le « convive » selon la terminologie adoptée par Airbnb), ces éléments décrivent non seulement le « service de société de l’information », que propose la société Airbnb, au sens de l’article 2, sous a), de la directive n° 2000/31/CE, mais également les divers moyens par lesquels cette entreprise permet aux offres des « hôtes » de rencontrer les demandes des « convives ».
Ces moyens sont autant d’outils qui visent à encourager la conclusion des contrats. La CJUE, en se référant à sa jurisprudence Uber95, considère qu’Airbnb n’exerce pas une influence décisive sur les conditions de prestation des services d’hébergement auxquels se rapporte son service d’intermédiation. Dans l’affaire Uber, l’influence décisive exercée par cette société résultait de plusieurs éléments : la possibilité pour Uber de fixer un prix maximum de la course, la collecte de ce prix auprès du client avant le versement partiel au chauffeur non professionnel du véhicule, l’exercice d’un certain contrôle sur la qualité des véhicules et de leurs chauffeurs ainsi que sur le comportement de ces derniers, pouvant entraîner, le cas échéant, leur exclusion. La caractérisation de cette influence conduisait la CJUE à retenir la qualification de « service dans le domaine des transports ».
Or pour déterminer si Airbnb exerce une influence décisive, la démarche de la société Airbnb et les moyens mis en œuvre pour encourager la conclusion des contrats doivent être compris à l’aune du modèle économique de cette société, du secteur d’activité dans lequel elle intervient et la structure du marché de location de courte durée qu’elle reconfigure en procurant différentes formes de gain d’efficacité96. À ce titre, peuvent être cités la réduction des coûts de transaction, l’amélioration de l’affectation des ressources et les gains d’efficacité en matière d’information et de tarification. En effet, le propriétaire du logement évite les frais liés à la publication de son annonce et la prospection de la clientèle. Il fait l’économie d’engager un mandataire ou plus largement un intermédiaire pour rechercher les potentiels clients ou négocier avec eux. Cette réduction des coûts de communication permet de diffuser plus largement les informations97. Grâce à la communication directe entre « l’hôte » et le « convive », avant et après la réservation, la société Airbnb facilite les discussions sur les exigences réciproques sur les caractéristiques du bien. L’analyse des informations ainsi recueillies permet une meilleure connaissance des acteurs de ce marché en vue de son optimisation.
Par ailleurs, le fonctionnement de ce modèle suppose l’adhésion d’un nombre élevé d’utilisateurs. Pour encourager cette adhésion, les outils employés par Airbnb sont de différents ordres : une assurance de responsabilité civile pour réparer les dégâts causés aux biens98, un remboursement du prix de la réservation, après déduction des frais de réservation, en cas d’annulation, par « l’hôte » de la réservation peu de temps avant la date prévue du séjour, d’entrave à l’hébergement (par exemple, en ne fournissant pas les clés et/ou le code de sécurité). Il en est de même lorsque la description ou la représentation de l’hébergement dans l’annonce comporte des inexactitudes importantes, telles que la taille ou l’emplacement du bien99.
De plus, la plate-forme standardise les normes explicites d’hospitalité pour les deux parties en leur recommandant l’attitude à adopter pour être un hôte ou un convive « recommandable »100. Ce choix d’effectuer des recommandations plutôt que de fournir des règles codifiées permet à cette plate-forme de faire échec à toute qualification qui viendrait s’ajouter à celle de simple fourniture de service de la société de l’information. Cette réflexion sur un possible cumul de qualification existe déjà en germe dans les travaux menés par la Commission européenne. En effet, dans sa communication faite en 2016, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions, fixant un agenda européen pour l’économie collaborative, la Commission101 soulignait que les plates-formes peuvent en plus du service de la société de l’information proposer d’autres services sous-jacents, tels qu’un service de transport ou service de location de courte durée. Or en tant que fournisseur du service sous-jacent, la plate-forme peut être soumise à la « réglementation sectorielle correspondante, y compris aux exigences en matière d’autorisations d’établissement et de licences généralement appliquées aux prestataires de services, dans les conditions énoncées dans les sections précédentes »102. Or la détermination de ce service sous-jacent permettant de qualifier la société Airbnb d’intermédiaire en opération immobilière, suppose, selon le communiqué de la Commission, la réunion cumulative de trois conditions, témoignant d’un niveau de contrôle élevé exercé par la plate-forme sur la relation des utilisateurs. Ces conditions sont la détermination (et non la simple suggestion) du prix, la détermination des conditions contractuelles, y compris l’obligation des utilisateurs de fournir un service, et la propriété des actifs principaux, en l’occurrence les biens qui sont essentiels à la fourniture du service. La réunion de ces conditions est une indication permettant de conclure à une « influence » accrue ou à un « contrôle » exercé par la plate-forme sur le prestataire du service sous-jacent, et partant, considérer que la plate-forme est elle-même le fournisseur du service sous-jacent, en plus de fournir un service de la société de l’information. Ainsi, d’un point de vue conceptuel, l’approche choisie par la Commission conduit à considérer « que ce pouvoir est décisif pour assumer également un rôle contractuel en ce qui concerne le service sous-jacent à fournir »103.
Or s’agissant d’Airbnb, si l’influence exercée par la plate-forme sur la détermination du prix et la détermination des obligations des parties peut être retenue, la plate-forme n’étant pas le propriétaire du parc immobilier – comme c’est d’ailleurs le cas pour les différents intermédiaires d’opérations immobilières –, les conditions ne pourraient être remplies. Il n’en demeure pas moins qu’à ce stade deux remarques peuvent être formulées.
D’une part, le modèle économique d’Airbnb conduit à ce que cette plate-forme exerce un contrôle souple sur les participants. Ainsi, elle recommande une conduite ou un choix à adopter plutôt qu’elle ne dicte ce choix104. Par exemple, elle suggère des prix en informant les hôtes sur l’état actuel de la concurrence sur le marché local. Mettant ainsi en concurrence les hôtes, la plate-forme récompense ceux qui suivent ses recommandations. C’est en ce sens que l’accès au marché du côté de l’offre fonctionne comme un mécanisme de récompense des comportements appropriés105. Ainsi, plus un hôte adhère aux normes et aux valeurs pour obtenir un indice d’hospitalité élevé106, plus la plate-forme le soutient matériellement (par exemple, obtenir un meilleur classement dans le résultat de la recherche) pour réussir sur le marché107. Cette concurrence incite par ailleurs les hôtes à diversifier les services proposés pour aller dans le sens d’une personnalisation des prestations offertes aux convives. De même, elle incite les hôtes à privilégier les recommandations tarifaires, afin que leur bien figure aux meilleures places dans la liste proposée aux convives. Sur ce point, Airbnb indique avoir constaté que « le prix est l’un des facteurs décisifs quand les voyageurs doivent choisir entre des annonces qui apparaissent dans une recherche. Pour cette raison, il est important de fixer un prix compétitif là où votre logement est situé »108. Ce prix compétitif est suggéré par Airbnb109.
D’autre part, on ne saurait ignorer le rôle joué par cette plate-forme sur la reconfiguration du marché de la location de courte durée, faisant également d’elle l’un des acteurs du marché de tourisme. Sur ce point, il convient de signaler qu’en novembre 2015 la plate-forme estimait son impact économique en France à 2,5 milliards d’euros110 et à 6,5 milliards d’euros en 2016111, avec 2 milliards d’euros pour la région parisienne. En outre, Airbnb estime que 23 % des voyageurs ne se seraient pas rendus à Paris sans les services de la plate-forme, ce qui aurait entraîné une baisse des dépenses locales liées au tourisme à hauteur de 980 millions d’euros112. Enfin, Airbnb contribue à la création d’une communauté dont les membres partageraient les mêmes valeurs : « vivre des expériences de voyage authentiques et de proximité au-delà des lieux hautement touristiques ; (…) vivre comme les locaux »113. S’ajoute à la recherche de l’authenticité pour les convives, un argument d’ordre économique, hissé, dans le discours de cet acteur économique, au rang d’un « droit [pour les hôtes] de partager leur maison pour payer les factures »114. En tant qu’acteur essentiel du marché locatif, la société Airbnb a su faire évoluer les pratiques et reconfigurer les règles du jeu de ce marché.
Conclusion
À la question de savoir si la société Airbnb pouvait être assimilée à un agent immobilier, la réponse, par la négative apportée par la CJUE se fait au prix d’une disqualification. Insatisfaisante, car réductrice et discutable, cette démarche offre peu d’éléments tangibles susceptibles de poser les jalons d’une qualification au regard de l’activité d’intermédiaire de cette entreprise. Ces éléments doivent être recherchés ailleurs. À ce titre, la démarche de standardisation de l’expérience authentique qui a conduit Airbnb à redéfinir une nouvelle culture115, c’est-à-dire de nouvelles pratiques, activités et croyances communes aux utilisateurs de la plate-forme éponyme116, d’une part, et la reconfiguration du marché de location immobilière par une démarche « collaborative », d’autre part, peuvent servir à la réflexion.
Motahareh FATHISALOUT BOLLON
Notes de bas de pages
-
1.
Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
-
2.
Cass. 3e civ., 15 déc. 1993, n° 91-10199.
-
3.
Résistance que l’on peut retrouver dans le refus de la troisième chambre civile d’opérer un revirement de jurisprudence pour les promesses conclues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. À cet égard, v. Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, nos 17-21170 et 17-21171 : D. 2019, p. 298, avis Brun P. et D. 2019, p. 301, obs. Mekki M. ; AJ Contrat 2019, p. 94, obs. Houtcieff D. ; RTD civ. 2019, p. 317, obs. Barbier H. ; RTD com. 2019, p. 398, obs. Lecourt A.
-
4.
Not. Fabre-Magnan M., « De l’inconstitutionnalité de l’exécution forcée des promesses unilatérales de vente. Dernière plaidoirie avant adoption du projet de réforme du droit des contrats », D. 2015, p. 826.
-
5.
V. not. Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-12875 : « la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée ».
-
6.
À cet égard, on renverra le lecteur à la démonstration fort éclairante in Gailliard A., « Atteinte à la liberté contractuelle et exécution forcée d’une promesse unilatérale de vente », Dalloz actualité, 3 déc. 2019 ; adde Barbier H., « L’irrévocabilité de la promesse unilatérale de vente est conforme à la Constitution ! », RTD civ. 2019, p. 851.
-
7.
Gailliard A., « Atteinte à la liberté contractuelle et exécution forcée d’une promesse unilatérale de vente », Dalloz actualité, 3 déc. 2019.
-
8.
En ce sens, v. par ex. Mekki M., « Réforme des contrats et des obligations : la promesse unilatérale de contrat », JCP N 2016, n° 40, act. 1071.
-
9.
Encore que le rapport remis au président de la République semble plus éloquent sur ce point : « l’article 1124, après avoir donné une définition de la promesse unilatérale (alinéa 1), prévoit la sanction de la révocation de cette promesse, avant la levée de l’option, par l’exécution forcée du contrat (alinéa 2). Cette solution met fin à une jurisprudence très critiquée : la Cour de cassation refuse en effet la réalisation forcée du contrat lorsque la levée de l’option par le bénéficiaire intervient postérieurement à la rétractation du promettant, et limite la sanction à l’octroi de dommages et intérêts. La nouvelle solution adoptée, conforme aux projets européens d’harmonisation, tend à renforcer la sécurité et l’efficacité de la promesse unilatérale ».
-
10.
V. infra II.
-
11.
La situation est en effet plus problématique lorsqu’une promesse synallagmatique est conclue. Les parties étant toutes deux engagées, le refus de l’acheteur de réitérer conduit nécessairement à une action en justice si le vendeur souhaite forcer l’exécution de la vente.
-
12.
Guillouard L., Traité de la vente et de l’échange, t. II, 2e éd., 1890, A. Durand et Pedone-Lauriel, n° 85 : l’objet de la promesse n’est pas « de contraindre le promettant à accomplir une obligation de faire plus ou moins personnelle ; [mais] de faire exécuter un contrat parfait, à l’exécution duquel le mauvais vouloir du promettant ne peut le soustraire ».
-
13.
Ancel P., « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ. 1999, p. 771, spéc. nos 21 et s. ; v. toutefois du même auteur, « La force obligatoire, jusqu’où faut-il la défendre ? », in La nouvelle crise du contrat, 2003, Dalloz, Thèmes et commentaires, n° 4, « j’admets volontiers cependant que sur cette question on puisse penser en termes d’obligation de contracter, d’obligation de passer le contrat définitif. Cette approche obligationnelle est évidemment plus souple, en ce qu’elle laisse au juge la possibilité de refuser l’exécution en nature, dont l’efficacité peut être discutée ».
-
14.
V. par ex. Cass. 3e civ., 26 sept. 2012, n° 10-23912, « qu’en statuant ainsi, sans relever que la promesse de vente était assortie d’une indemnité si importante par rapport au prix de vente qu’elle privait la société France Invest de sa liberté d’acheter ou de ne pas acheter, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (nous soulignons) ; contra, mais dans une situation où l’économie générale de l’avant-contrat semblait justifier le maintien de la qualification de promesse unilatérale, v. Cass. 1re civ., 10 déc. 2010, n° 09-65673.
-
15.
Fabre-Magnan M., « De l’inconstitutionnalité de l’exécution forcée des promesses unilatérales de vente. Dernière plaidoirie avant adoption du projet de réforme du droit des contrats », D. 2015, p. 826.
-
16.
En ce sens, v. Mekki M., « Réforme des contrats et des obligations : la promesse unilatérale de contrat », JCP N 2016, n° 40, act. 1071 ; sur cette question, v. également, Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 184.
-
17.
Laitihier Y.-M., « La distinction entre intérêt positif et intérêt négatif à l’épreuve des avant-contrats », in Deshayes O. (dir.), L’avant-contrat. Actualité du processus de formation des contrats, 2008, PUF, p. 153.
-
18.
V. par ex. Cass. 3e civ., 16 juin 2015, n° 14-14758. À cet égard, on peut relever avec Laithier Y.-M., « La perte de chance : “arme de dissuasion” contre la rétractation fautive de la promesse unilatérale de vente ? », obs. sous Cass. 3e civ., 16 juin 2015, n° 14-14758 : RDC 2015, p. 832, que l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir un gain n’est pas rationnellement l’équivalent de l’indemnisation de l’intérêt négatif, qui correspond pour sa part au fait de remettre le créancier dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat violé n’avait pas été conclu.
-
19.
L’on peut d’ailleurs ajouter à cet égard que, dès lors que la violation de la promesse est dolosive, le promettant devrait être tenu de réparer toutes les conséquences de l’inexécution et non uniquement les dommages prévisibles, en application de l’article 1231-3 du Code civil.
-
20.
En ce sens, v. Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 191.
-
21.
Pour un exemple, v. Cass. 1re civ., 21 févr. 1995, n° 93-14233.
-
22.
Cass. 3e civ., 28 mai 1997, n° 95-25098.
-
23.
Cass. com., 17 mars 1998, n° 95-21153.
-
24.
CA Agen, 1re ch. civ., 21 mars 2018, n° 14/01595.
-
25.
CA Agen, 1re ch. civ., 21 mars 2018, n° 14/01595.
-
26.
Gaz. Pal. 14 janv. 2020, n° 368e4, p. 36, note Berlaud C. ; Gaz. Pal. 10 mars 2020, n° 372r4, p. 74, note Brault C.-E. ; Rev. Loyers 2020, n° 1003, note Chaoui H. ; Loyers et copr. 2020, comm. 22, note Chavance E. ; JCP G 2020, 232, note Kilgus N. ; LEDC févr. 2020, n° 112w9, p. 3, note Leblond N. ; JCP N 2020, n° 3, act. 139, note Quément C. ; LEDIU févr. 2020, n° 113a8, p. 2, note Velardocchio D.
-
27.
Cass. 3e civ., 30 sept. 2009, n° 08-18209.
-
28.
CA Toulouse, 2e ch., 3 oct. 2018, n° 17/03556 : Rev. Loyers 2018, n° 992, note Brena S. : « En cas de démembrement de propriété, il résulte de l’article 595, dernier alinéa, du Code civil que l’usufruitier qui a la qualité de bailleur ne peut toutefois, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal et que de même, il ne peut délivrer seul congé en sorte que c’est à bon droit (qu’usufruitier et nu-propriétaire), agissant ensemble, ont fait délivrer le 5 mars 2004, un refus de renouvellement sans indemnité d’éviction en vertu de l’article L. 145-17 du Code de commerce. Il y a lieu d’en conclure qu’elles sont redevables ensemble de l’indemnité due au preneur évincé car il s’agit d’un acte qui excède les pouvoirs du seul usufruitier ».
-
29.
L. n° 65-570, 13 juill. 1965, portant réforme des régimes matrimoniaux.
-
30.
Aux termes de l’article 22 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, les dispositions du dernier alinéa de l’article 595 du Code civil ne sont pas applicables aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi ni à leur renouvellement (Cass. 3e civ., 4 févr. 1981, n° 79-12829 : Bull. civ. III, n° 25). La Cour de cassation a dès lors affirmé que l’usufruitier peut renouveler seul un bail conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’exigence de concours du nu-propriétaire (Cass. 3e civ., 15 janv. 1992, n° 90-16496 : Bull. civ. III, n° 13).
-
31.
Cass. 3e civ., 14 nov. 1972, n° 71-12924 : Bull. civ. III, n° 603.
-
32.
Il semble qu’il importe peu qu’il s’agisse d’un bail dérogatoire non soumis au statut des baux commerciaux. Dans ce sens, v. Rép. civ. Dalloz, v° Usufruit, 2012, n° 238, note Chamoulaud-Trapiers A. et Cass. 3e civ., 5 avr. 1995, n° 93-16963 : Bull. civ. III, n° 99.
-
33.
Cass. 1re civ., 25 nov. 1986, n° 85-10548 : Bull. civ. I, n° 282.
-
34.
Cass. 3e civ., 29 nov. 1995, n° 94-11735 : Bull. civ. III, n° 246.
-
35.
Cass. 3e civ., 5 déc. 2001, n° 00-12406.
-
36.
Cass. 3e civ., 5 mars 1986, n° 84-15430 : Bull. civ. III, n° 24.
-
37.
Cass. 3e civ., 2 févr. 2005, n° 03-19729 : Bull. civ. III, n° 30.
-
38.
Cass. 3e civ., 4 mars 1987, n° 85-17667, Bull. civ. III, n° 43 – Cass. 3e civ., 2 févr. 2005, n° 03-19729 : Bull. civ. III, n° 30.
-
39.
Cass. 3e civ., 24 mars 1999, n° 97-16856 : Bull. civ. III, n° 78.
-
40.
Et dont le bailleur ne peut se dispenser qu’en versant au preneur une indemnité d’éviction.
-
41.
Ainsi, c’est « son droit à une pleine propriété future » qu’il protège : JCP G 2020, 232, note Kilgus N.
-
42.
Alors que pour les baux non concernés par l’alinéa 4 de l’article 595 du Code civil, les trois premiers alinéas de cet article prévoient que l’usufruitier peut les conclure seul, mais les effets sont, à l’extinction de l’usufruit, transférés sur la tête du nu-propriétaire dans la limite de neuf années à compter de la conclusion du contrat ou de son renouvellement.
-
43.
Dans ce sens, v. Cass. 3e civ., 16 sept. 2009, n° 08-16769 : Bull. civ. III, n° 191, « consentir un bail rural de 9 ans constitue un acte de disposition ».
-
44.
La solution est la même lorsqu’à l’inverse, c’est le nu-propriétaire qui consent seul un bail sur un local dont la propriété est démembrée : Cass. 3e civ., 6 juill. 2017, n° 15-22482.
-
45.
Cass. 3e civ., 26 janv. 1972, n° 70-12594 : Bull. civ. III, n° 69 –Pour une critique de cette solution, v. Dross W., note sous Cass. 3e civ., 6 juill. 2017, n° 15-22482 : RTD civ. 2017, p. 903 : l’auteur se demande pourquoi autoriser le nu-propriétaire à agir en nullité du bail en cours d’exécution de l’usufruit alors qu’il n’est pas censé nuire à ses droits.
-
46.
Cass. 3e civ., 9 déc. 2009, n° 08-20133 : Bull. civ. III, n° 271 : la confusion des qualités de nu-propriétaire et d’usufruitier, du seul fait de la dévolution successorale, n’éteint pas le droit personnel du nu-propriétaire à se prévaloir de la nullité d’un bail rural consenti par le seul usufruitier. V. Blanchard C., « Le nu-propriétaire, héritier de l’usufruitier ; peut-il agir en nullité du bail rural consenti par l’usufruitier seul ? », D. 2010, p. 1332.
-
47.
Cass. 3e civ., 14 nov. 2007, n° 06-17412 : la nullité d’un bail portant sur des locaux à usage commercial consenti par l’usufruitier sans le concours du nu-propriétaire est une nullité relative ne pouvant être invoquée que par le nu-propriétaire et cette action en nullité, qui est une action personnelle, n’avait pu dès lors être transmise à l’acquéreur des locaux. La nullité du bail est une nullité relative qui ne peut pas être invoquée par le signataire du bail et l’opposition au bail formé par le nu-propriétaire ne constitue pas un vice caché du fonds de commerce cédé : Cass. com., 24 févr. 1998, n° 96-10457.
-
48.
Cass. 3e civ., 13 déc. 2005, n° 04-20567.
-
49.
Cass. 3e civ., 16 avr. 2008, n° 07-12381 : Bull. civ. III, n° 74 : en effet, pour la haute juridiction, l’usufruitier a seul l’obligation de s’assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir le bail ; v. aussi Cass. 3e civ., 23 nov. 2001, n° 09-72948.
-
50.
Cette indemnité qui répare le préjudice subi par le propriétaire qui a été privé de la jouissance de son bien est due à l’usufruitier pour la période comprise entre la date de l’arrêt ayant annulé le bail et celle de l’extinction de l’usufruit, v. Cass. 3e civ., 5 mars 1986, n° 84-14147 : Bull. civ. III, n° 25.
-
51.
Cass. 3e civ., 10 oct. 2001, n° 00-13376 : les juges doivent caractériser la connaissance que le nu-propriétaire a eue personnellement de la conclusion du bail à sa date, et, en tout état de cause, plus de 5 ans avant sa demande en nullité.
-
52.
Cass. 3e civ., 22 nov. 1995, n° 93-20464.
-
53.
Cass. 3e civ., 9 juill. 2003, n° 02-15061 : Bull. civ. III, n° 149.
-
54.
Cass. 3e civ., 21 janv. 1981, n° 79-13854 : Bull. civ. III, n° 17.
-
55.
Cass. 3e civ., 4 mai 1982, n° 81-11415 : Bull. civ. III, n° 111.
-
56.
Cass. 3e civ., 4 févr. 1998, n° 96-12302 : Bull. civ. III, n° 26.
-
57.
Cass. 3e civ., 15 janv. 1992, n° 90-16496 : Bull. civ. III, n° 13.
-
58.
Cass. 3e civ., 18 janv. 1995, n° 92-11572 : Bull. civ. III, n° 24.
-
59.
Cass. 3e civ., 13 déc. 2005, n° 04-15045.
-
60.
Cass. 3e civ., 5 avr. 1995, n° 93-16963 : Bull. civ. III, n° 99 – Tout au plus, pourra-t-il engager la responsabilité de l’usufruitier, v. aussi Cass. 3e civ., 16 avr. 2008, n° 07-12381.
-
61.
Cass. 3e civ., 24 mars 1999, n° 97-16856 : Bull. civ. III, n° 78.
-
62.
Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-16578 ; Cass. 3e civ., 19 oct. 2017, n° 16-19843.
-
63.
Cass. 3e civ., 31 mai 2012, n° 11-17534 : Bull. civ. III, n° 87.
-
64.
Sur la répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire, v. Viudès P., Joyeux B. et Roussel F., « Baux commerciaux et démembrement de propriété », Defrénois 29 août 2019, n° 149t6, p. 25.
-
65.
Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 05-15563 : Bull. civ. III, n° 165. La Cour de cassation a également considéré que l’indemnité due au preneur sortant pour les améliorations apportées au fonds loué est à la charge du bailleur, usufruitier, qui avait donné valablement son accord à la construction, sans l’autorisation du nu-propriétaire : Cass. 3e civ., 20 mai 1992, n° 90-18090 : Bull. civ. III, n° 163.
-
66.
Cass. 3e civ., 15 mars 2000, n° 98-18322 : Bull. civ. III, n° 57.
-
67.
Cass. 3e civ., 4 mai 1976, n° 74-13538 : Bull. civ. III, n° 186.
-
68.
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 17-27560.
-
69.
Cass. 3e civ., 29 janv. 1974, n° 72-13968 : Bull. civ. III, n° 48.
-
70.
Cass. 3e civ., 9 déc. 2009, n° 08-20512 : Bull. civ. III, n° 270.
-
71.
Cass. 3e civ., 5 févr. 1997, n° 95-12536 : Bull. civ. III, n° 28.
-
72.
Cass. 3e civ., 5 févr. 1997, n° 95-12536 : Bull. civ. III, n° 28.
-
73.
CA Paris, 16e ch., 18 févr. 2009, n° 08/02599.
-
74.
À la différence de l’indivision où le refus de renouvellement doit, sous peine de nullité, être autorisé par l’ensemble des coindivisaires ou à défaut d’un tel accord, par autorisation en justice prévue aux articles 515-5 ou 815-6 du Code civil : Cass. 3e civ., 18 avr. 1985, n° 84-10083 : Bull. civ. III, n° 65.
-
75.
Cass. 3e civ., 15 janv. 1974, n° 72-13749 : Bull. civ. III, n° 10.
-
76.
CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux : Lebon, p. 125, concl. Chardenet P. ; S. 1916, III, p. 17, concl. Hauriou M.
-
77.
Pour preuve, le champ lexical comptable est très largement utilisé ici : « Pertes, bénéfices, recettes, amortissement… ».
-
78.
Ainsi que le rappelle le juge, « l’indemnité d’imprévision ne peut venir qu’en compensation de la part de déficit lié aux circonstances imprévisibles ».
-
79.
Cela n’empêche pas en revanche que le bénéfice d’une application du régime d’imprévision puisse être demandé par le cocontractant après la fin de son exécution (CE, sect., 12 mars 1976, Département des Hautes-Pyrénées : Lebon, p. 155).
-
80.
Le nouveau Code de la commande publique s’appliquant à tous les contrats couverts par son champ d’application, la codification de l’imprévision (v. art. L. 6) devrait faire évoluer la finalité du mécanisme. Dans la mesure où, par exemple, même les marchés publics seront susceptibles d’être soumis à l’article L. 6, l’imprévision ne pourra plus être justifiée par la continuité du service public. C’est alors certainement dans l’équilibre économique qu’il faudra rechercher le nouveau fondement de l’imprévision (en ce sens, v. Labrot E., L’imprévision. Étude comparée droit public-droit privé des contrats, thèse, 2016, L’Harmattan).
-
81.
V. l’article 5 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
-
82.
V. CAA Bordeaux, 19 déc. 2017, n° 16BX03271.
-
83.
Picod Y., Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, thèse, 1989, LGDJ, p. 18.
-
84.
Clouzot L., « La théorie de l’imprévision en droit des contrats administratifs : une improbable désuétude », RFDA 2010, p. 937.
-
85.
L’article 14 de la loi du 2 janvier 1970.
-
86.
Carbonnier J., Droit civil. Introduction. Les personnes. La famille, l’enfant, le couple, t. 1, 2004, PUF, Quadrige, p. 55, n° 23 ; Atias C., « La controverse doctrinale dans le mouvement du droit privé », RRJ 1983-2, p. 427-456, spéc. p. 427.
-
87.
Dir. n° 2005/36/CE du PE et du Cons., 7 sept. 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
-
88.
Dir. n° 2007/64/CE du PE et du Cons., 13 nov. 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
-
89.
En effet, dans la mesure où il intervient pour le compte d’autrui, l’agent immobilier agit en qualité de mandataire de ses clients. Dès lors, pour exercer valablement son activité il doit disposer à cet effet d’un mandat écrit, signé et en cours de validité. Cette exigence, formulée par le législateur à l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, est appréciée de façon stricte par la jurisprudence. Le défaut d’un mandat régulier empêche l’agent immobilier de prétendre à une rémunération, en ce sens v. Cass. 1re civ., 25 janv. 2005, n° 02-10764 : AJDI 2005, p. 756 – Cass. 3e civ., 19 oct. 2010, n° 09-16786 : JCP N 2010, n° 44, act. 772 – Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 11-11533 : JCP N 2013, n° 3, 15472.
-
90.
Cass. 3e civ., 12 avr. 2012, n° 10-28637.
-
91.
Rép. com. Dalloz, v° Agent immobilier, 2017, spéc. n° 11, note Cruvelier E.
-
92.
Dir. n° 2019/770/UE du PE et du Cons., 20 mai 2019, relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.
-
93.
V. CJUE, 20 déc. 2017, n° C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi, pt 40 et CJUE, 10 avr. 2018, n° C-320/16, Uber France, pt 21.
-
94.
Sur ce point, v. Edelman B. G. et Geradin D., « Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How Should We Regulate Companies like Airbnb and Uber ? », (November 24, 2015). Stanford Technology Law Review 19 (2016) : 293-328 ; Harvard Business School NOM Unit Working Paper No. 16-026, v. https://ssrn.com/abstract=2658603.
-
95.
CJUE, 20 déc. 2017, n° C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi, pt 39 et CJUE, 10 avr. 2018, n° C-320/16, Uber France, pt 21. Dans ces décisions, la CJUE considère que Uber exerçait une influence décisive sur les conditions de la prestation de transport des chauffeurs non professionnels faisant usage de l’application mise à leur disposition par cette société.
-
96.
Edelman B. G. et Geradin D., « Efficiencies and Regulatory Shortcuts : How Should We Regulate Companies like Airbnb and Uber ? », (November 24, 2015). Stanford Technology Law Review 19 (2016) : 293-328 ; Harvard Business School NOM Unit Working Paper No. 16-026, v. https://ssrn.com/abstract=2658603.
-
97.
Sur la diffusion décentralisée d’information par les plateformes numériques, v. Rossotto C. M. et a., « Digital platforms : A literature review and policy implications for development », Competition and Regulation in Network Industries 2018, 19(1–2), 93–109, spéc. p. 95 : Ces auteurs soulignent qu’en organisant l’information décentralisée et en la mettant à la disposition des acteurs du marché, les plateformes numériques apportent une réponse au problème de Hayek d’un ordre économique rationnel dans le cadre d’une information décentralisée. En effet, pour Hayek, « un caractère particulier du problème de l’ordre économique rationnel est lié précisément au fait que la connaissance de l’environnement dont nous pourrions avoir besoin n’existe jamais sous une forme concentrée ou agrégée, mais seulement sous forme d’éléments dispersés d’une connaissance incomplète et fréquemment contradictoire que tous les individus séparés possèdent en partie » (Hayek F. A., « L’utilisation de l’information dans la société », Revue française d’économie 1986, vol. 1, n° 2, p. 117-140 ; spéc. p. 118).
-
98.
Conditions de service pour les utilisateurs européens à jour du 1er novembre 2019, § n° 7.1.8.
-
99.
Politique de remboursement des voyageurs Airbnb, § 1.
-
100.
Sur ce point, v. Constantiou I., Marton A. et Tuunainen V. K., « Four models of sharing economy platforms », MIS Quarterly Executive déc. 2017 (16 :4), p. 231-251, spéc. p. 240. Les auteurs précisent que « le principal mécanisme de coordination utilisé par Airbnb est la standardisation des normes (…). Contrairement à Uber et Handy, qui se concentrent sur les règles de l’offre, Airbnb gère la plateforme principalement en sensibilisant ses participants à l’hospitalité et, dans une moindre mesure, en utilisant des algorithmes (comme Uber) ou des règles descendantes (comme Handy) ».
-
101.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions, Un agenda européen pour l’économie collaborative {SWD (2016) 184 final}, spéc. p. 6 et s.
-
102.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions, Un agenda européen pour l’économie collaborative {SWD (2016) 184 final}, p. 7.
-
103.
Domurath I., « Platforms as contract partners : Uber and beyond” Maastricht Journal of European and Comparative Law », Revue 2018, vol. 25, n° 5, p. 565-581, spéc. p. 567.
-
104.
Constantiou I., Marton A. et Tuunainen V. K., « Four models of sharing economy platforms », MIS Quarterly Executive déc. 2017 (16 :4), p. 240.
-
105.
Constantiou I., Marton A. et Tuunainen V. K., « Four models of sharing economy platforms », MIS Quarterly Executive déc. 2017 (16 :4), p. 240.
-
106.
Sur le statut de Superhost, v. https://www.Airbnb.fr/superhost.
-
107.
C Constantiou I., Marton A. et Tuunainen V. K., « Four models of sharing economy platforms », MIS Quarterly Executive déc. 2017 (16 :4), p. 240.
-
108.
Sur ce point, v. la communication d’Airbnb, Qu’est-ce qui influence le classement de mon annonce dans les résultats de recherche ? : https://www.airbnb.fr/help/article/39/questce-qui-influence-le-classement-de-mon-annonce-dans-les-r%C3%A9sultats-de-recherche.
-
109.
Sur l’algorithme permettant la détermination du prix par Airbnb, v. The Secret of Airbnb’s Pricing Algorithm : https://spectrum.ieee.org/computing/software/the-secret-of-Airbnbs-pricing-algorithm.
-
110.
V. Economic Impact of Airbnb in France Grows to €2.5 Billion: https://www.Airbnb.fr/press/news/economic-impact-of-Airbnb-in-france-grows-to-2-5-billion.
-
111.
Airbnb, Economic impact report France 2016, cité par Study on the Assessment of the Regulatory Aspects Affecting the Collaborative Economy in the Tourism Accommodation Sector in the 28 Member States (580/PP/GRO/IMA/15/15111J), European Commission – Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), Task 4, Market Case study – Paris, p. 7.
-
112.
Airbnb economic impact in France: Paris : https://blog.atAirbnb.com/Airbnb-economic-impact-in-france-paris.
-
113.
V. Economic Impact of Airbnb in France Grows to €2.5 Billion: https://www.Airbnb.fr/press/news/economic-impact-of-Airbnb-in-france-grows-to-2-5-billion.
-
114.
Sur ce point, Chris Lehane, directeur du département de la stratégie globale et des relations publiques, a déclaré ce qui suit : « La communauté Airbnb est un mouvement qui soutient le droit des familles de travailleurs à partager leur maison pour payer les factures. Ce mouvement se développe et est soutenu par des citoyens ordinaires du monde entier qui croient au choix des consommateurs et à la possibilité pour les individus de contrôler leur propre destin. Ce mouvement a déjà battu la proposition F à San Francisco et continuera à défendre des règles équitables et progressistes en matière de partage de la maison dans le monde entier. » V. Economic Impact of Airbnb in France Grows to €2.5 Billion : https://www.Airbnb.fr/press/news/economic-impact-of-Airbnb-in-france-grows-to-2-5-billion.
-
115.
Cette culture, qui renvoie aux pratiques et croyances, doit également être mise en perspective avec de nouvelles formes et pratiques de consommation en matière de tourisme.
-
116.
Etienne J. et a., Dictionnaire de sociologie, 3e éd., 2012, Hartier, Initial, p. 120, v. le mot « culture ».