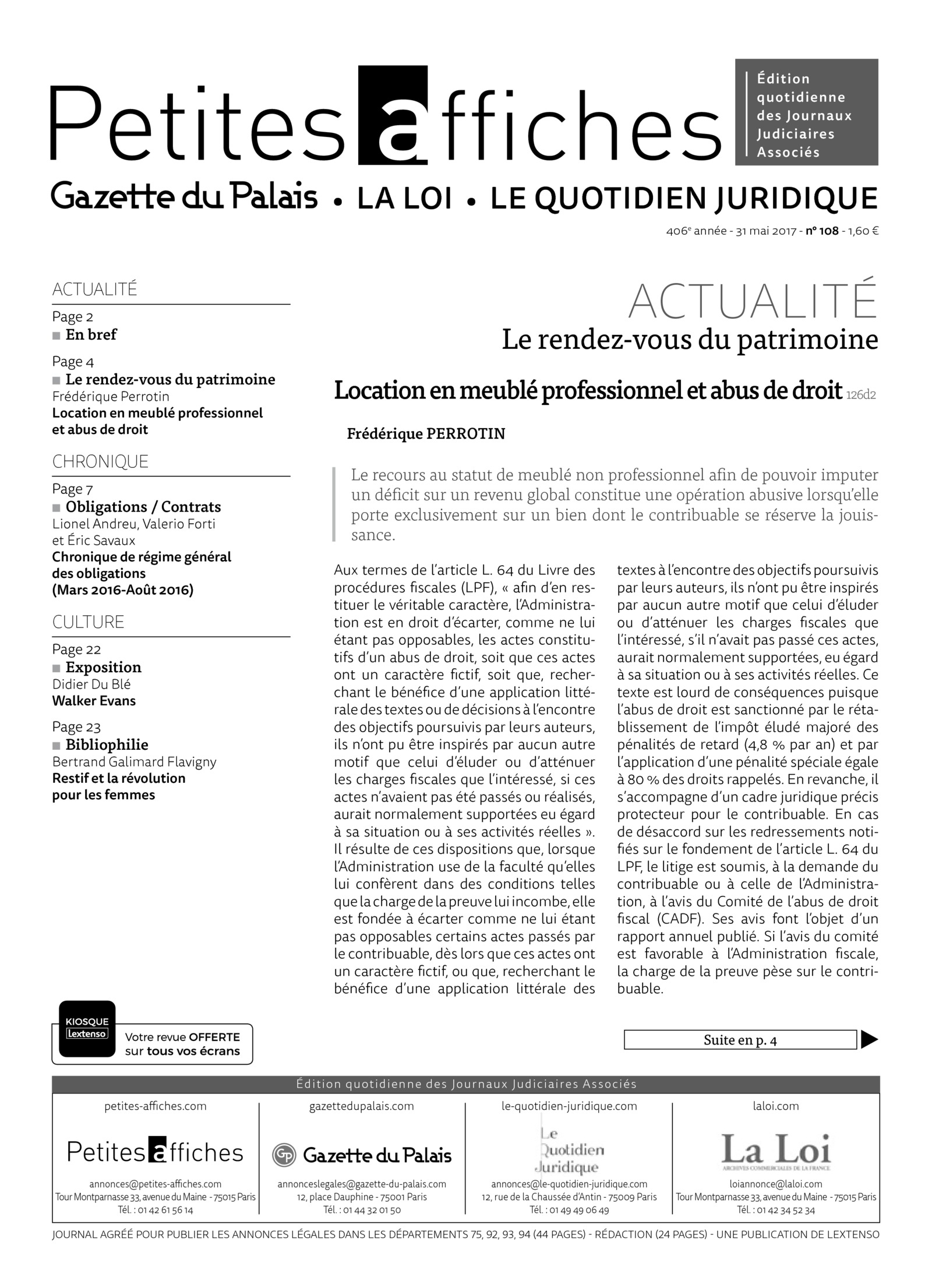Chronique de régime général des obligations (Mars 2016-Août 2016)
I – Les droits du créancier
A – Le droit à l’exécution (…)
B – Les actions protectrices
Le bail accordé au préjudice d’un créancier hypothécaire frappé d’inopposabilité paulienne (Cass. 3e civ., 31 mars 2016, n° 14-25604)
Il arrive qu’un débiteur obéré réalise des actes préjudiciables à ses créanciers en compromettant leurs droits. Dans l’arsenal offert par le législateur pour lutter contre de tels comportements (sanctions pénales, faillite personnelle, déchéances…), l’action paulienne occupe une place de choix, en sanctionnant d’inopposabilité l’acte d’appauvrissement effectué par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers. Les conditions de mise en œuvre de l’action paulienne suscitent néanmoins, depuis toujours, des difficultés. L’intérêt de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 2016 est de rappeler que l’action paulienne peut, dans certains cas, permettre à un créancier hypothécaire d’attaquer un bail conclu par le débiteur sur un immeuble lui appartement1.
Le recours à l’action paulienne dans la présente affaire n’allait pas de soi. La protection du créancier hypothécaire face aux baux de son débiteur est en effet parfois assurée par l’article L. 321-4 du Code de procédures civiles d’exécution, selon lequel « les baux consentis par le débiteur après l’acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur ». Lorsque le créancier hypothécaire a adressé un commandement de payer au débiteur, comme c’était le cas dans la présente affaire, ce débiteur ne peut normalement plus conclure de bail opposable aux créanciers ou à l’adjudicataire du bien – lequel n’hésitera donc pas à l’acquérir. Reste que ce texte n’assure pas toujours suffisamment la protection du créancier hypothécaire. Outre le cas du bail conclu avant le commandement, le créancier hypothécaire peut également se trouver écarté de la protection instituée par l’article L. 321-4 lorsque son commandement a été frappé de caducité pour l’une des causes prévues par le Code des procédures civiles d’exécution2. Tel était en l’espèce la situation du créancier hypothécaire, dont le commandement était caduc, ce qui empêchait d’annuler le bail conclu après celui-ci.
C’est alors que le créancier hypothécaire s’est astucieusement tourné vers le droit commun des obligations et son action paulienne. La cour d’appel l’avait néanmoins débouté, motif pris, en résumé, que le créancier ne prouvait pas que la conclusion du bail avait nui à l’adjudication du bien. Cette analyse est néanmoins écartée par la Cour de cassation qui censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1167 du Code civil. Pour elle, cet arrêt aurait dû rechercher « si les termes et conditions du bail ne constituaient pas, de la part du débiteur, un acte d’appauvrissement de nature à priver d’efficacité l’inscription hypothécaire conventionnelle de la banque sur l’immeuble ». Autrement dit, à suivre cet attendu, la conclusion d’un bail peut, en fonction de ses termes et conditions, constituer un appauvrissement contestable sur le fondement de l’action paulienne, et le créancier hypothécaire lésé est fondé à attaquer le bail dès lors qu’il prive d’efficacité sa sûreté.
Sur la qualification d’acte d’appauvrissement du bail, l’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure. Il est en effet acquis que les actes lésionnaires sont susceptibles d’être frappés d’inopposabilité paulienne3 et qu’il en va notamment ainsi des baux dont les conditions sont désavantageuses pour le débiteur. La Cour de cassation a par exemple admis dans un arrêt la sanction d’un bail « conclu à un prix anormalement bas (…) en raison des saisies dont commençait à faire l’objet la propriété »4. La censure de la cour d’appel dans la présente affaire n’étonne donc pas, de ce point de vue, dans la mesure où rien n’excluait en l’espèce que le bail ait pu constituer, en raison de ses termes et conditions, un acte d’appauvrissement.
L’arrêt ne s’arrête pas là et il précise également que le créancier hypothécaire lésé était fondé à attaquer l’acte « de nature à priver d’efficacité [son] inscription hypothécaire conventionnelle ». Par cette formule sibylline, la Cour de cassation paraît faire écho à sa jurisprudence autorisant l’exercice de l’action paulienne malgré la solvabilité du débiteur au jour de l’acte, dès lors qu’un droit personnel ou réel particulier est compromis par l’acte attaqué. C’est sur ce fondement que la Cour de cassation avait déjà admis par le passé la sanction paulienne d’un contrat de bail portant préjudice à un créancier hypothécaire. Selon la Cour, « au cas où le créancier est investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur a raison notamment de la constitution d’une hypothèque, le préjudice peut exister, en dehors même de l’insolvabilité du débiteur, dès lors que, par l’acte frauduleux contre lequel l’action révocatoire est dirigée, le débiteur réduit la valeur de ces biens de façon à diminuer l’efficacité de l’exercice des droits dont le créancier s’était assuré l’avantage »5. Dans la présente affaire, la logique à l’œuvre pourrait être la même et l’arrêt susceptible d’être compris comme signifiant que tout bail lésionnaire est attaquable par la voie paulienne dès lors qu’il compromet les droits d’un créancier hypothécaire. Ce faisant, l’arrêt témoigne de la plasticité de l’action paulienne qui lui a permis de traverser les âges, en s’adaptant à la multiplicité des fraudes susceptibles de voir le jour en pratique.
Lionel Andreu
Le partage par voie oblique d’une société civile immobilière non immatriculée (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-28243)
Dans la présente affaire, un débiteur, associé avec son épouse d’une société civile immobilière, avait été condamné à payer diverses sommes à son créancier. Les procédures de recouvrement forcé étant demeurées infructueuses, le créancier avait assigné les époux, sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du Code civil, pour faire juger que, faute d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la SCI était devenue une société en participation, que les biens sociaux étaient leur propriété indivise, et qu’il était dès lors en droit de demander la dissolution de la société et le partage de l’indivision. Il avait obtenu gain de cause au fond. Le pourvoi en cassation, articulé en quatre moyens, est rejeté par la troisième chambre civile.
Sans doute, l’arrêt rapporté intéresse-t-il principalement le droit des sociétés. En vertu de l’article 44 de la loi NRE n° 2001-420 du 15 mai 2001, les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 n’ayant pas procédé à leur immatriculation au RCS au plus tard le 1er novembre 2002, ont perdu la personnalité morale. Dans l’arrêt rendu le 4 mai 2016, la Cour de cassation fait application de cette règle en considérant que la SCI, faute d’avoir été immatriculée avant le délai, est dépourvue de la personnalité morale et qu’elle est donc soumise aux règles applicables aux sociétés en participation. Puis elle va plus loin : elle décide que malgré l’existence d’une clause fixant, dans les statuts, la durée de la SCI, la société en participation est en l’occurrence « nécessairement à durée indéterminée ». Diverses conséquences en découlent, pour la plupart desquelles on renverra aux observations formulées ailleurs6.
Pour autant, l’arrêt a sa place dans cette chronique car l’une de ces conséquences – celle qui a été tirée en l’espèce – intéresse l’action oblique. Dès l’instant où la SCI devient une société en participation à durée indéterminée, le créancier de l’un des associés peut en obtenir la dissolution, la liquidation et le partage sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil. La règle qui y figure est une application particulière de l’action oblique, régie par l’article 1166 du Code civil à l’époque des faits et par l’article 1341-1 du même code aujourd’hui, dont il suit dès lors le régime7. Tout au plus les coïndivisaires peuvent-ils contrer l’action en partage en payant le créancier agissant et en se remboursant ensuite par prélèvement sur les biens indivis8.
Valerio Forti
II – Les modalités de l’obligation
A – Les modalités temporelles
La condition résolutoire réputée défaillie (Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-10207)
Voilà un arrêt qui fournit l’occasion de revenir sur la fiction consistant à réputer la condition suspensive accomplie ou la condition résolutoire défaillie, lorsque l’accomplissement a été empêché ou provoqué par l’une des parties. Un couple avait vendu à un autre un bien immobilier, sous la condition résolutoire du non-versement, à titre de garantie, entre les mains du notaire rédacteur, d’une somme de 31 500 € au plus tard au jour fixé pour la réitération de la vente par acte authentique, et sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire. Le dépôt de garantie n’ayant pas été versé, les vendeurs avaient assigné les acquéreurs, en paiement de 31 500 € et en indemnisation de leurs préjudices matériel et moral. Le juge du fond avait décidé que la condition résolutoire de non-versement du dépôt de garantie était réputée défaillie et que la condition suspensive d’obtention d’un prêt était réputée accomplie. Il avait par conséquent condamné solidairement les acquéreurs à payer aux vendeurs 31 500 € au titre du dépôt de garantie, ainsi que 6 480,22 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. Les acquéreurs se sont pourvus en cassation. Les trois branches du moyen unique portent respectivement sur la condition résolutoire, la solidarité et la condition suspensive. Les deux dernières branches seront ici mises de côté – même si l’arrêt est cassé en se fondant sur le moyen pris en sa deuxième branche9 –, pour se concentrer sur la première. La première chambre civile n’y adhère pas au motif qu’« ayant retenu que le défaut d’accomplissement de la condition résolutoire, tenant au non-versement du dépôt de garantie, avait été provoqué de manière déloyale par les acquéreurs, la cour d’appel en a justement déduit que cette condition était réputée défaillie, que le contrat n’était pas anéanti et que l’obligation de payer ce dépôt de garantie perdurait, faisant ainsi ressortir qu’il n’était pas réputé versé ».
Le raisonnement mené dans le pourvoi tentait de prendre la fiction juridique à son propre piège. Les parties à la vente ont érigé le non-paiement du dépôt de garantie en condition résolutoire. Les acquéreurs ont provoqué l’accomplissement de celle-ci, en ne payant pas ce dépôt de garantie. Leur conduite est jugée déloyale car, semble-t-il, ils disposaient de la somme nécessaire. En vertu de l’ancien article 1178 du Code civil, la condition résolutoire est réputée défaillie. C’est dire que le dépôt de garantie est réputé avoir été payé et que les acquéreurs ne peuvent pas être condamnés à le payer, en quelque sorte une seconde fois. Raisonnement d’une logique imparable. La Cour de cassation parvient néanmoins à le réfuter : c’est la condition qui est réputée défaillie, non l’événement érigé en condition, nous dit-elle entre les lignes. Techniquement, la solution laisse dubitatif. L’ancien article 1178 du Code civil, autant que le nouvel article 1304-3 du même code, ne dispose pas que l’obligation conditionnelle devient pure et simple lorsque l’une des parties a forcé le hasard. À vrai dire, la solution se justifie surtout sur le plan de l’opportunité : autant y voir un escamotage permettant de sauver la fiction lorsqu’elle se heurte à la réalité crue.
Comment expliquer cet attachement au réputé accompli ou défailli ? Par une redistribution des places occupées par les sanctions en matière de condition10. La prohibition de la condition potestative a perdu du terrain en raison des critiques dont elle a été la cible, terrain occupé par l’accomplissement fictif11. Qu’on en juge : au cours des dix dernières années, l’ancien article 1178 du Code civil figure en moyenne une fois tous les quinze jours dans une décision de la Cour de cassation ou dans les moyens annexes, et le nombre de décisions en la matière a triplé par rapport à la décennie précédente12. La tendance devrait d’ailleurs s’accentuer suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Le nouvel article 1304-2 du Code civil cantonne la nullité pour potestativité à la condition qui dépend de la « seule » volonté du débiteur, à celle qui contredit l’idée même d’obligation. Il oriente ainsi encore plus le contentieux relatif aux autres conditions vers le nouvel article 1304-3 du Code civil, dont le champ d’application est formellement élargi par rapport à l’ancien article 1178. La fiction consistant à réputer la condition accomplie ou défaillie a de beaux jours devant elle.
Valerio Forti
B – Les modalités structurelles
L’absence de solidarité entre l’auteur d’une offre de reprise d’une entreprise en procédure collective et le cessionnaire substitué (Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-16389)
L’auteur d’une offre de reprise d’une entreprise en procédure collective, auquel s’est substitué un tiers cessionnaire, est-il tenu solidairement à l’exécution des contrats cédés ? Pendant un temps, la Cour de cassation a répondu par la négative13. Depuis la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l’article L. 642-9, alinéa 3, du Code de commerce avait instillé le doute. Il semblait en effet avoir pris le contre-pied de la jurisprudence, en disposant que « toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession (…). L’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits »14. Par un arrêt remarqué du 12 juillet 2016, la Cour de cassation dissipe ce doute. Elle donne une interprétation de l’article L. 642-9, alinéa 3, du Code de commerce compatible avec sa jurisprudence antérieure, parvenant par là à la reconduire.
Lors d’un redressement judiciaire, une offre de cession avait été retenue au profit de son auteur ou de toute personne qu’il se substituerait. Un contrat de location financière entre une banque et l’entreprise en redressement judiciaire avait été transmis au cessionnaire, qui était un tiers substitué. Ce dernier étant mis en liquidation judiciaire, la banque avait demandé à l’auteur de l’offre le montant d’une indemnité de résiliation en raison du non-paiement de loyers. La cour d’appel n’ayant pas accueilli la demande, la banque s’était pourvue en cassation. La chambre commerciale rejette le pourvoi au motif que s’« il résulte de l’article L. 642-9, alinéa 3, du Code de commerce que l’auteur de l’offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l’article L. 642-2 II, 1° du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan », en revanche « l’engagement de poursuivre ces contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s’étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué ».
Un argument par analogie militait contre cette solution. La substitution ressemble à s’y méprendre à une cession de contrat. En se substituant un tiers, l’auteur de l’offre retenue par le tribunal réalise en quelque sorte une cession (conventionnelle) de la cession (judiciaire) de l’entreprise et des contrats qui l’accompagnent. Tout comme le cédant est en principe tenu solidairement à l’exécution du contrat cédé15, de la même manière l’auteur de l’offre devrait être tenu solidairement à l’exécution des contrats cédés avec l’entreprise16.
Pour balayer ce raisonnement, la chambre commerciale invoque un argument a contrario. L’article L. 642-9, alinéa 3, du Code de commerce dispose que l’auteur de l’offre retenue par le tribunal est tenu solidairement de l’exécution des engagements « qu’il a souscrits ». À l’inverse, il n’est pas tenu solidairement des engagements qu’il n’a pas souscrits, c’est-à-dire des contrats conclus par le cédant avec ses cocontractants et qui sont cédés avec l’entreprise17. Il faut dire que la Cour de cassation a déjà pu juger que la substitution du bénéficiaire d’une promesse unilatérale n’est pas une cession de contrat, dans le but d’éviter de la soumettre aux contraintes prévues par l’article 1589-2 du Code civil18. Aussi est-il tentant de défendre l’autonomie de la substitution par rapport à la cession19. Il n’en demeure pas moins que la distinction est subtile. Tellement subtile qu’on ressent qu’elle relève plus d’une décision politique que d’une déduction logique des textes20. La solidarité ne risquerait-elle pas de décourager les offres de reprise ?
Cela étant dit, le rejet de la solidarité légale n’empêche pas une solidarité conventionnelle – certes peu probable. L’auteur de l’offre étant tenu solidairement des engagements qu’il a souscrits, il peut tout à fait s’engager à garantir l’exécution des contrats cédés. C’est du moins ce que laisse entendre la chambre commerciale lorsqu’elle affirme que les engagements souscrits en l’espèce par l’auteur de l’offre « ne comportaient aucune garantie expresse envers le cocontractant cédé de la bonne exécution du contrat par le repreneur substitué ».
Valerio Forti
III – Les opérations sur obligations
A – Les opérations modificatives
La passivité tolérée du cessionnaire Dailly qui n’a pas notifié la cession (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-24755)
On sait à quel point certaines cautions poursuivies en paiement font feu de tout bois pour échapper à l’exécution de leur engagement. L’arrêt rendu le 2 mars 2016 en fournit une nouvelle illustration, par laquelle la Cour de cassation revient sur la situation du cessionnaire de créance professionnelle qui n’a pas notifié l’opération21.
En l’espèce, une banque cessionnaire Dailly avait obtenu la condamnation au paiement de la caution du cédant – lequel est, on le sait, garant solidaire du paiement des créances cédées sur le fondement de l’article L. 313-24 du CMF. En cassation, la caution reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si la banque justifiait d’une demande amiable pour obtenir auprès des débiteurs cédés le recouvrement des créances qui lui avaient été transmises ou de l’impossibilité dans laquelle elle était de la formuler. Ce faisant, le demandeur au pourvoi invoquait à son profit une jurisprudence importante de la Cour de cassation selon laquelle « le cessionnaire d’une créance professionnelle qui a notifié la cession [est] tenu de justifier d’une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement »22.
En vain, car comme le rappelle la Cour de cassation, cette règle ne s’applique que lorsque la cession a été notifiée23, tandis que la caution n’avait ici jamais soutenu que tel était le cas.
En rejetant le pourvoi de la caution, la Cour de cassation rappelle ainsi la distinction qu’il y a lieu de faire entre la cession notifiée et la cession non notifiée : si, dans le premier cas, le cessionnaire ne peut se retourner contre le cédant qu’après une demande amiable, tel n’est pas le cas dans le second, où le cédant demeure habilité à réclamer paiement au cédé (art. L. 313-28, a contrario), ce qui peut être légitimement compris comme une dispense faite à la banque d’avoir à le faire elle-même.
Il est vrai qu’en l’espèce la prétention émanait d’une caution – et non du cédant lui-même –, ce qui aurait pu conduire à une solution différente. On connaît en effet la bienveillance dont le droit positif fait parfois preuve à l’égard des garants – au point qu’en jurisprudence certaines prérogatives qui sont traditionnellement regardées comme des facultés pour le créancier se transforment en obligation lorsqu’il est garanti par un cautionnement : il engage sa responsabilité en ne les exerçant pas24. À juste titre, ici, la Cour de cassation n’a pas succombé à un excès de faveur, qui l’aurait conduite à obliger le créancier n’ayant pas notifié la cession à réclamer paiement au débiteur cédé avant de se retourner contre la caution. Pour l’équilibre de l’opération, seule la décision du créancier de notifier la cession doit le conduire à prendre la tête des opérations de recouvrement et il ne serait pas bon que l’existence d’un cautionnement le prive de ce libre choix que le Code de commerce lui réserve.
Contrairement à ce que pourrait suggérer la jurisprudence antérieure25, serait d’ailleurs à notre sens sans intérêt ici l’invocation de la jurisprudence relative au non-exercice par le créancier d’une simple faculté en présence d’un cautionnement26. Cette jurisprudence oblige en effet seulement le créancier à exercer des prérogatives qui seraient profitables à la caution (transformer une sûreté provisoire en sûreté définitive, mettre en œuvre une faculté d’attribution du gage…) ; toute autre est la faculté dont il est question ici (notifier la cession pour prendre la tête des opérations de recouvrement), qui n’a rien de spécialement favorable à la caution : que le cédant ou le cessionnaire se charge du recouvrement ne change pas fondamentalement sa situation ! Où l’on comprend que si l’on peut reprocher au créancier de ne pas avoir exercé une simple faculté profitable à la caution, on ne peut lui reprocher le non-exercice d’une faculté qui se révèle neutre à son égard, ce qui est le cas de la notification d’une cession de créance.
Avec cet arrêt, la notification demeure ainsi le rouage essentiel de la cession de créance professionnelle, qui continue de la singulariser de la cession de créance de droit commun après la réforme du droit des obligations par l’ordonnance du 10 février 201627. On voit ainsi que la Cour de cassation n’a pas laissé la cession Dailly sombrer dans le feu que la caution avait en l’espèce tenté d’allumer.
Lionel Andreu
L’exercice du retrait litigieux à l’égard d’une créance cédée pour un prix pouvant faire l’objet d’un complément (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-15347)
Le retrait litigieux, conçu en droit romain, et les cessions en bloc de créances, élaborées en droit bancaire et financier contemporain, sont-ils compatibles28 ? La Cour de cassation répond une énième fois par l’affirmative. Une banque avait accordé un prêt immobilier à un couple d’emprunteurs. Après les avoir assignés en paiement, la banque avait cédé à un fonds commun de titrisation un portefeuille d’environ deux mille créances, parmi lesquelles figurait celle née du prêt. Au cours de l’instance engagée par la banque à l’encontre des emprunteurs, ceux-ci avaient demandé à exercer le retrait litigieux. Le juge du fond ne l’avait pas admis au motif que le prix de la créance litigieuse n’était pas déterminable. Le 28 juin 2016, la chambre commerciale casse cette décision.
Le principe que l’arrêt commenté déduit de l’article 1699 du Code civil n’est pas nouveau. Au contraire. Selon un courant jurisprudentiel qui a pris corps il y a une dizaine d’années29 mais dont les prémices remontent à la fin du XIXe siècle30, « la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible ». La formulation est simplement reprise au mot près.
Ce qui fait véritablement l’intérêt de l’arrêt, ce sont les circonstances particulières à propos desquelles il est rendu. Tour à tour, la première chambre civile et la chambre commerciale ont affirmé qu’un prix global, calculé statistiquement et non créance par créance, ne fait pas obstacle au retrait litigieux31. C’est pourquoi, à une exception près32, on peine à trouver des arrêts où le refus du retrait litigieux est toléré en raison du fait que le prix de la créance intégrée dans un bloc n’est pas déterminable. Le présent arrêt aurait toutefois pu être de ceux-là. En l’espèce, les parties n’avaient pas seulement fixé un prix initial global pour les quelque deux mille créances cédées. Elles avaient également convenu que, dans l’hypothèse où les sommes payées par les débiteurs cédés excédaient un certain montant, le cessionnaire (le fonds commun de titrisation) verserait au cédant (la banque) un complément de prix égal à 50 % de la différence positive entre les sommes nettes collectées et le seuil de déclenchement. Dit autrement, si les débiteurs cédés se révélaient plus solvables que prévu, les parties à la cession se repartiraient le surplus résultant de la différence entre les paiements espérés et ceux effectivement encaissés. Le juge du fond en avait déduit qu’à la date du retrait litigieux, le montant des sommes qui pouvaient être recouvrées n’était pas connu et que la détermination du prix de cession n’était dès lors pas possible. La motivation ne suffit pas à convaincre la Cour de cassation, qui décide que « l’existence d’un prix complémentaire, fonction du résultat de la procédure, qui ne présente aucun caractère aléatoire, puisqu’il est déterminable et seulement soumis à une condition de perception des fonds, ne fait pas obstacle au retrait litigieux ».
Alors bien sûr, en l’occurrence, on peut considérer qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuel complément de prix, puisque si le couple d’emprunteurs est admis à exercer son droit de retrait, la créance litigieuse ne pourra en toutes hypothèses pas faire l’objet d’un paiement dépassant les prévisions des parties à la cession. Il n’empêche que le calcul que la Cour de cassation exige, ici comme ailleurs, des juges du fond est aussi malaisé que l’opération dans laquelle s’inscrit la cession de la créance litigieuse est complexe. Les méthodes suggérées par la doctrine à leur adresse suffisent à s’en convaincre33. La méthode « savante » suppose de considérer l’ensemble de créances selon leur montant nominal et à tenter de dégager proportionnellement un coefficient d’abattement pour la créance litigieuse. La méthode de la « confiance dans le débiteur retrayant » revient à se référer à l’offre de prix raisonnable éventuellement formulée par le débiteur. La méthode de la « détermination du prix par le juge » lui laisse tout simplement la faculté de liquider le prix réel ou supposé tel.
Aussi, en dépit du fait que la solution choisie par la Cour de cassation soit techniquement justifiée car les régimes spéciaux de la cession de créance n’écartent pas l’application de l’article 1699 du Code civil34, son opportunité est pour le moins incertaine35. Deux voies pourraient alors être empruntées pour la renverser36. La voie jurisprudentielle consisterait à opérer un revirement, en s’appuyant sur le fait que l’objet de la cession est une universalité dont le prix est unique, et non une pluralité de créances individuelles dont les prix respectifs ont été additionnés37. La voie législative impliquerait, quant à elle, soit de modifier l’article 1701 du Code civil, pour ajouter aux trois hypothèses dans lesquelles le retrait litigieux est actuellement exclu, celle où la cession porte sur un bloc de créances, soit d’intégrer dans les droits spéciaux de la cession Dailly et de la titrisation une dérogation à l’article 1699 du Code civil.
Valerio Forti
Précisions relatives à la régularité de la notification à une personne morale d’une cession de créance (CA Versailles, 4 juill. 2016, n° Juris-data 2016-014059)
Un autre arrêt – de cour d’appel, cette fois – donne une précision intéressante, dans une perspective pratique, concernant la notification de la cession de créance. Elle présente d’autant plus d’intérêt qu’avec la réforme du droit des obligations, la simple notification est la forme ordinaire d’opposabilité au débiteur des opérations sur créance (art. 1324, nouv., pour la cession de créance et 1346-5, nouv., pour la subrogation) et que celle-ci joue également un rôle important dans la cession de contrat (art. 1216, nouv.) ou de dette (art. 1327-1).
La question posée à la cour d’appel de Versailles était de savoir si une notification est régulière lorsqu’elle a été adressée au siège social d’une société, mais réceptionnée par un préposé n’ayant pas d’habilitation pour ce faire. À cette question, la cour d’appel répond de manière positive, en retenant qu’ « est régulière la lettre de notification parvenue au lieu d’établissement d’une société, au sens de l’article 690 du Code de procédure civile, même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé ». Elle ajoute que peu importe, de ce point de vue, « que plusieurs sociétés, personnes morales distinctes, aient leur siège social à cet endroit et que la signature de la personne figurant sur l’accusé de réception ne soit pas clairement identifiable ».
Au fond, l’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure. En matière de notification par voie postale, la Cour de cassation avait déjà jugé qu’une notification faite à une personne morale était valable dès lors qu’elle était signée par un préposé du destinataire38. En opportunité, la solution n’est pas non plus choquante, à partir du moment où le notifiant n’a aucun moyen de savoir si celui qui réceptionne la lettre – en se présentant, d’ailleurs, comme une personnalité habile à le faire – a véritablement le pouvoir requis. Ainsi, dès lors que la lettre est réceptionnée par une personne que le destinataire a laissée dans ses locaux en mesure de réceptionner les plis à lui adresser, il n’est pas illogique d’admettre que la notification réalisée soit valable.
Lionel Andreu
L’exercice du retrait litigieux par la caution (Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-26174)
Dans un arrêt du 12 juillet 201639, la Cour de cassation fournit des précisions inédites sur le droit pour la caution d’exercer un retrait litigieux, en statuant sur une affaire dont elle avait déjà eu à connaître40. Une banque avait consenti deux prêts à une société, dont le gérant s’était porté caution personnelle et solidaire. La caution avait été condamnée à payer diverses sommes à la banque. Cette dernière avait cédé, au sein d’un portefeuille plus vaste, les deux créances nées des prêts à une société spécialisée dans le rachat de créances litigieuses. La caution avait alors assigné la société cessionnaire dans le but d’exercer le retrait litigieux – point sur lequel portait le précédent pourvoi en cassation. La cour d’appel, se prononçant sur renvoi après cassation, avait déclaré irrecevable la demande de la caution puisque le cautionnement est un accessoire de la créance cédée et que celle-ci n’était pas litigieuse, faute de contestation de la part du débiteur principal. La chambre commerciale casse cet arrêt au motif que « la cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du Code civil, ses accessoires, emportait au profit du cédant la cession de la créance sur la caution et (…), celle-ci ayant contesté le droit invoqué contre elle, qui était ainsi devenu litigieux, elle pouvait exercer le droit au retrait ».
L’arrêt appelle d’emblée deux remarques. L’une est que l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’a pas d’incidence sur la solution. Car la crainte que le retrait litigieux soit éradiqué du droit commun s’est révélée infondée41, ce mécanisme demeurant à sa place historique. Car, aussi, le nouvel article 1321, alinéa 3, du Code civil dispose, à l’instar de l’ancien article 1692 du même code, que la cession de créance s’étend à ses accessoires. L’autre remarque est que la formule employée par la Cour de cassation suppose, en arrière-plan, que les créances à l’encontre respectivement du débiteur principal et de la caution ne coïncident pas, contrairement à la thèse selon laquelle il y aurait là deux obligations distinctes portant sur une créance unique42.
Cela étant dit, quels enseignements peut-on tirer de cet arrêt ?
En le regardant de près, il ne revient pas sur le fait que la contestation ouvrant droit au retrait litigieux de la part du débiteur principal doive porter sur le principal et ne puisse en revanche pas porter sur l’accessoire43. Il affirme simplement que lorsque la créance invoquée contre la caution est litigieuse, celle-ci peut exercer le retrait.
En élargissant le plan, l’arrêt laisse apercevoir quatre hypothèses de retrait litigieux en cas d’articulation entre cession de créance et cautionnement. La première hypothèse, la plus classique, est celle où le débiteur principal exerce le retrait litigieux à l’occasion d’un litige relatif à la créance invoquée contre lui. Elle ne soulève pas de difficultés particulières. Dans une deuxième hypothèse, la caution décide d’exercer le retrait litigieux, au motif que la créance contre elle est litigieuse. Il ne fait plus aucun doute que cette faculté lui est ouverte : il s’agit de l’hypothèse sur laquelle la Cour de cassation s’est prononcée dans l’arrêt commenté. Troisième hypothèse : le débiteur principal demande à exercer le retrait litigieux en raison d’une contestation relative à la créance contre la caution, par exemple pour l’absence d’une mention obligatoire. Sa demande devrait être déclarée irrecevable, la contestation ne portant pas sur l’existence ou l’étendue du droit objet du retrait44. Reste une quatrième et dernière hypothèse, la moins évidente. C’est celle où la caution demande à exercer le retrait litigieux en s’appuyant sur une contestation relative à la créance contre le débiteur principal. Cette fois, la demande mériterait d’être accueillie45. S’il est vrai qu’un litige sur l’existence ou l’étendue de l’accessoire n’affecte pas le principal, l’inverse ne l’est pas : l’accessoire suit le principal.
Valerio Forti
Existence et étendue de la subrogation légale de l’assureur dommages-ouvrage condamné à indemniser l’assuré pour ne pas avoir notifié dans le délai légal sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-22961, PB)
L’assureur qui garantit le maître de l’ouvrage des dommages dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil dispose d’un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant à la mise en jeu des garanties prévues au contrat (C. assur., art. L. 242-1, al. 3). Cet arrêt précise les conséquences de la violation de cette obligation sur la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré contre le responsable. Les solutions qu’il énonce ne sont pas surprenantes au regard de la jurisprudence antérieure, mais elles reposent sur un fondement qui n’est pas indiscutable.
Bien que l’assureur ait bénéficié d’une quittance subrogative délivrée par le maître de l’ouvrage qu’il avait indemnisé, et bien qu’un moyen du pourvoi ait porté sur les conditions de la subrogation conventionnelle, l’arrêt ne concerne que la subrogation légale. Pas celle de l’ancien article 1251 du Code civil, mais celle de l’article L. 121-12 du Code des assurances, admise par la cour d’appel. L’attributaire du lot gros œuvre et terrassement déclaré responsable des désordres affectant l’immeuble contestait, à titre principal, l’existence même du recours subrogatoire de l’assureur et, accessoirement, son étendue.
Principalement, le demandeur en cassation soutenait que l’assureur ne pouvait pas être subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage parce qu’il n’avait pas indemnisé l’assuré « dans le cadre du contrat d’assurance », mais à titre de sanction pour ne pas avoir respecté le délai que lui impartit la loi pour notifier à l’assuré sa position. Autrement dit, la condition essentielle de la subrogation légale ferait défaut, l’assureur n’ayant pas payé une indemnité d’assurance en application du contrat, mais des dommages-intérêts (délictuels) pour avoir manqué à une obligation légale. La Cour de cassation approuve au contraire les juges du fond d’avoir déduit la subrogation du fait qu’une ordonnance de référé avait constaté que l’assureur, n’ayant pas notifié sa position dans le délai légal, ne pouvait pas opposer un refus de garantie à l’assuré, « ce dont il résultait que l’indemnité avait été payée en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance ». Pour une large part, la solution était prévisible. Plusieurs décisions antérieures ont en effet jugé que les sanctions du non-respect du délai de prise de position de l’assureur sont énumérées limitativement46. Or, la déchéance de la subrogation ne figure pas parmi celles-ci47. Au regard de la subrogation, la cour considère que les conditions sont réunies, la somme payée étant bien l’indemnité due en exécution du contrat d’assurance. Sur ce point crucial, les avis sont partagés. Certains approuvent en observant notamment que dans les assurances à contenu obligatoire, le contenu du contrat est imposé par la loi, comme ici pour le cas de non-respect de délai de prise de position48. Au contraire, d’autres contestent vigoureusement au motif que la sanction qui frappe l’assureur laisse subsister la cause de non-garantie éventuelle49. La rigueur juridique de la solution dépend donc finalement de la nature juridique de la sanction qui frappe l’assureur, qui n’est peut-être pas toujours la même. S’il s’agit de la déchéance de la possibilité d’invoquer une cause de déchéance de la garantie de l’assuré, l’analyse de la Cour de cassation est admissible. Elle l’est plus difficilement si la cause de non-garantie réside dans l’absence de garantie des dommages réalisés.
Une fois l’existence du recours subrogatoire admise, le demandeur au pourvoi attaquait sur une seconde ligne. Les juges du fond auraient eu tort d’admettre le recours subrogatoire de l’assureur pour le montant total de l’indemnité payée au maître de l’ouvrage alors que ce recours ne peut excéder la somme à laquelle l’assuré pouvait prétendre au titre de la garantie décennale. La Cour de cassation approuve encore la cour d’appel. D’abord, d’avoir relevé qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne limite le recours subrogatoire de l’assureur interdit, à titre de sanction, d’opposer un refus de garantie. Ensuite d’avoir déduit la subrogation de l’assureur de ses constatations souveraines concernant la réunion des conditions de la responsabilité contractuelle du constructeur. Là aussi, l’arrêt n’est pas surprenant, la Cour de cassation jugeant de manière constante qu’il résulte de l’article L. 121-12 du Code des assurances que le recours subrogatoire peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité50. Peu importait donc qu’il s’agisse, en l’espèce, de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la garantie décennale. Pourtant, le pourvoi reproduisait textuellement l’attendu d’un arrêt de la troisième chambre civile du 22 octobre 2014 selon lequel « le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait excéder la somme à laquelle l’assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l’assureur dommages-ouvrage avait été condamné à payer une somme supérieure »51. D’un arrêt à l’autre, il n’y a pourtant pas de revirement, le pourvoi ayant abusivement extrapolé la portée de l’arrêt du 22 octobre 2014 qui ne s’est pas prononcé sur la nature de la responsabilité pouvant donner lieu à la subrogation. Entre les deux arrêts, il y a même une grande continuité. Celui du 22 octobre limite en effet le recours subrogatoire de l’assureur au coût des travaux de réparation des dommages au paiement duquel l’assuré peut réellement prétendre, même si l’assureur a dû payer, à titre de sanction pour inobservation des délais légaux de prise en charge du sinistre, une somme supérieure correspondant au coût de la réfection totale d’une toiture qui s’est ultérieurement révélée non nécessaire pour remédier aux désordres. Dans les deux cas, la subrogation légale est donc limitée au montant de l’indemnité destinée à réparer le dommage, pas à des sommes qui seraient versées à un autre titre, particulièrement comme conséquence du manquement à une obligation légale de l’assureur. On en revient toujours à la cause et à la nature du paiement effectué par l’assureur, à titre d’indemnité due en exécution du contrat d’assurance ou pas.
Éric Savaux
B – Les opérations créatrices (…)
IV – L’extinction de l’obligation
A – Les modes d’extinction satisfactoires
La possible invocation de la compensation devant le juge de l’exécution (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-29893)
La question de l’invocation de la compensation soulève depuis quelques années en doctrine des interrogations gênantes52, que l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour le 18 février 2016 tente de dissiper s’agissant du rôle du juge de l’exécution dans la mise en œuvre de ce moyen de défense.
Lorsqu’un débiteur a été condamné à payer, la question se pose en effet de savoir s’il peut élever une contestation à l’exécution forcée mise en œuvre contre lui en saisissant le juge de l’exécution pour exciper de la compensation. La Cour de cassation l’admet dans le présent arrêt, en retenant qu’« il appartient au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l’exception de compensation »53. La portée de l’arrêt ne doit cependant pas être exagérée. Il faut en effet réserver le jeu de l’autorité de la chose jugée, car si la question de la compensation a déjà été tranchée, il n’est pas possible de la soumettre au juge de l’exécution. La jurisprudence antérieure était en ce sens et il n’y a pas lieu de penser que le présent arrêt la remette en cause54. Il faut ainsi retenir que le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur la compensation comme l’admet le présent arrêt que lorsque la question de son application n’a pas été tranchée par une décision ayant autorité de chose juge55. Reste que le maintien de cette jurisprudence devra être confirmé par la Cour de cassation compte tenu de l’évolution qu’a connue la procédure civile ces dernières années. Il serait en effet possible de se demander si l’exception de compensation ne devrait pas être soumise au principe de concentration des moyens résultant de l’arrêt Cesareo56, ce qui aurait pour effet d’empêcher parfois le plaideur de la soulever devant le juge de l’exécution faute de l’avoir fait dans le cadre de l’instance ayant abouti à la décision ayant force exécutoire57.
Quoi qu’il en soit, la question se pose du maintien de la solution retenue dans le présent arrêt sous l’empire des textes issus de l’ordonnance de réforme du droit des obligations. Cette ordonnance a en effet abandonné la règle de l’effet automatique de la compensation (anc. art. 1290) pour prévoir que si la compensation éteint les obligations, c’est « sous réserve d’être invoquée » (art. 1347, al. 2, nouv.). Cette formule a été comprise comme attribuant à la compensation une nature volontaire58 : c’est seulement à compter du jour où l’un des deux obligés se prévaut de la compensation qu’elle éteint les obligations – cette extinction étant néanmoins affectée d’un effet rétroactif opérant du jour où l’une des parties déclare vouloir éteindre sa dette par voie compensatoire59. Faut-il dès lors autoriser l’une des parties à exciper devant le juge de l’exécution la compensation ou faut-il considérer qu’elle doit l’invoquer dans l’instance ayant abouti à la décision assortie de la force exécutoire ? Pour y répondre, on peut faire valoir que lorsque le débiteur se prévaut de la compensation devant le juge de l’exécution, il satisfait son devoir d’invocation, aujourd’hui nécessaire à l’extinction de l’obligation. Ainsi, le débiteur visé par une décision ayant force exécutoire devrait conserver la possibilité d’invoquer cette compensation devant le juge de l’exécution aux conditions précédemment exposées. En quoi la réforme du droit des obligations ne bouleverse pas, ici, les habitudes.
Lionel Andreu
B – Les modes d’extinction non satisfactoires
Suspension et interruption de la prescription de l’action des créanciers contre le débiteur saisissant la commission de surendettement des particuliers (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-24968, PB)
Le droit de surendettement des particuliers suscite des difficultés d’application du droit commun de la prescription. Sur ce point, l’arrêt commenté contient deux apports : l’un concernant l’absence de suspension de la prescription de l’action du créancier le temps de l’examen, par la commission de surendettement, de la recevabilité de la demande du débiteur, l’autre l’absence d’interruption de cette prescription du fait du recours formé par le créancier contre la décision admettant la recevabilité de cette demande. L’addition aboutit à un traitement sévère des créanciers qui n’est sans doute pas de nature à les inciter à composer avec le débiteur, contrairement à l’objectif pourtant recherché par la loi. Mais il faut dire aussi que la matière n’est pas dépourvue de tensions, puisqu’une autre de ses préoccupations est d’éviter que les dettes du débiteur s’accumulent et grossissent d’intérêts ou de pénalités. Pour cela, le droit de la consommation favorise l’extinction par la prescription des dettes en disposant que l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (C. consom., art. L. 218-2, ancien art. L. 137-2), là où le droit commun prévoit en principe une prescription quinquennale (art. 2224). L’une des rares autres dispositions spéciales prévoit que par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties à un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peuvent ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci (art. L. 218-1 ; anc. art. L. 137-1). Pour le reste, il faut donc appliquer en principe le droit commun des articles 2219 et suivants du Code civil, notamment pour ce qui concerne justement la suspension et l’interruption. Mais comment le faire en présence d’une procédure conduite largement sous l’égide d’une commission administrative, alors que les textes du Code civil ont été pensés principalement en considération de procédures judiciaires60 ? L’arrêt du 17 mars 2016 illustre la difficulté d’articuler les deux corps de règles.
Il juge d’abord que « le délai de prescription n’est pas suspendu pendant l’examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d’instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur ». Le fondement de la solution, que la décision ne précise pas, se trouve justement dans le droit commun, plus précisément dans l’article 2240 du Code civil qui prévoit que la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit. Par un arrêt du 9 janvier 2014, la deuxième chambre civile a admis que des juges du fond pouvaient souverainement retenir qu’en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, le débiteur avait reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l’article 2240 du Code civil. C’est une approbation faible d’une solution qui pouvait pourtant s’autoriser du fait que le débiteur qui adresse une demande d’examen à la commission de surendettement fournit un état détaillé des éléments passifs de son patrimoine et indique le nom et l’adresse de ses créanciers (C. consom., art. R. 721-2, al. 2 ; ancien art. R. 331-8-1). L’ordonnance du 14 mars 2016 l’a érigée en règle en disposant que la demande de traitement de la situation de surendettement adressée à la commission par le débiteur interrompt la prescription et les délais pour agir (C. consom., art. L. 721-5). Le texte ne dit rien du régime de cette interruption. Par application de l’article 2231, in fine, la prescription qui recommence à courir est la prescription biennale. Par ailleurs, en rejetant implicitement l’argument du créancier selon lequel l’interruption avait produit son effet jusqu’à la décision du juge de l’exécution qui avait clôturé la procédure en constatant que le débiteur avait finalement refusé d’en bénéficier, l’arrêt écarte l’article 2242 qui prévoit que l’interruption qui résulte de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. La solution est justifiée par l’impossibilité de qualifier la saisine de la commission de demande en justice.
C’est la notion de demande en justice qui fonde également, de manière plus critiquable, le rejet du second argument du pourvoi. Selon la Cour, le recours formé par un créancier contre la décision de recevabilité de la demande prononcée par la commission « ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l’article 2241 du Code civil ». Porté devant le juge du tribunal d’instance (C. consom., art. R. 722-2 ; anc. art. L. 331-3, IV), le recours contre la décision de recevabilité constitue une demande en justice. Mais par son objet, elle ne serait pas apte à interrompre la prescription. Elle tend à contester les conditions de l’ouverture d’une procédure – l’existence du surendettement ou/et la bonne foi du débiteur –, alors que selon une opinion classique, la demande doit exprimer de façon suffisamment caractérisée la volonté du créancier d’agir en justice pour obtenir le paiement61. La jurisprudence considère certes que la décision de recevabilité, qui suspend les procédures d’exécution, n’interdit pas au créancier d’agir pour obtenir un titre exécutoire62. Mais ce n’est pas la seule manière pour le créancier de manifester son intention d’être payé. En contestant la recevabilité de la demande, il soutient l’exécution de l’obligation telle qu’elle a été initialement convenue et non telle qu’elle pourrait résulter d’un plan de surendettement. Comme par ailleurs on ne peut pas reprocher au créancier de ne pas avoir défendu son droit, la solution est également critiquable au regard du fondement de la prescription extinctive63.
Éric Savaux
Suspension de la prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance par la désignation en justice d’un expert (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-19792)
Bien qu’il ne soit pas promis à la plus large diffusion (seulement le Bulletin, pas le Rapport annuel), cet important arrêt tranche pour la première fois, positivement, la question de l’application à la prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance, de la suspension de la prescription par la désignation en justice d’un expert résultant de l’article 2239 du Code civil. La difficulté bien connue provient du fait que, depuis la réforme réalisée par la loi du 17 juin 2008, ce texte dispose que la prescription est suspendue « lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès », ce qui englobe la demande de désignation d’un expert, y compris en référé, alors que, de son côté, l’article L. 114-2 du Code des assurances, inchangé, prévoit que la prescription est interrompue, outre par l’une des causes ordinaires, « par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ». Que faut-il donc décider lorsque, après un sinistre, un expert est désigné en justice ? La prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur découlant de l’article L. 114-1, alinéa 1er du Code des assurances est-elle interrompue ou suspendue – à moins qu’elle ne puisse être l’objet des deux64 ? Les implications sont nombreuses. Dans le premier cas, c’est un nouveau délai de deux ans qui court à compter de la désignation de l’expert65, sans que la mission d’expertise suspende la prescription66. Dans le second, c’est le délai initial qui « recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » (C. civ, art. 2239), c’est-à-dire à compter du dépôt du rapport d’expertise. En pratique, alors que l’interruption qui fait repartir la prescription de zéro paraît a priori plus favorable à l’assuré, c’est souvent la suspension qu’il finit par invoquer pour faire écarter la prescription qui risque d’être acquise pendant les opérations d’expertise. L’argument est-il fondé ?
Théoriquement, la solution dépend de la manière dont les textes doivent s’articuler. À première vue, la règle spéciale au contrat d’assurance devrait l’emporter sur le droit commun de la prescription pour imposer l’interruption. Sauf à considérer que l’article 2239 énonce une règle spéciale concernant l’expertise judiciaire qui doit prévaloir, pour ce cas, sur l’article L. 114-2 du Code des assurances qui concerne toutes les expertises. Avant l’arrêt rapporté, la question n’avait pas de réponse sûre en jurisprudence. Un arrêt du 3 octobre 201367 avait bien jugé que les nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription, qui n’ont ni augmenté ni réduit le délai de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances, ne sont pas applicables aux mesures d’expertise ordonnées en référé avant cette date. Mais il fallait une certaine témérité pour en déduire que les expertises postérieures pouvaient suspendre la prescription en application du nouvel article 2239, ce qui nécessite une interprétation a contrario toujours périlleuse. Par ailleurs, il n’y avait pas grand-chose à tirer d’un autre arrêt du 16 avril 201568 qui avait déclaré irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen d’un pourvoi invoquant la suspension de la prescription après n’avoir soutenu que son interruption.
Désormais la question est clairement tranchée. Selon la troisième chambre civile, « les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du Code des assurances ne font pas obstacle à l’application de l’article 2239 du Code civil ; qu’il s’ensuit que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance ». La règle énoncée suscite des interrogations quant à son fondement et à sa portée. Pourquoi les dispositions spéciales du droit des assurances n’empêchent-elles pas l’application du texte du Code civil ? C’est, soit parce qu’il n’y a pas de contradiction entre eux, soit qu’il en existe bien une, mais qu’elle doit être tranchée en faveur de l’article 2239. Les deux sont difficiles à admettre. L’article L. 114-2 du Code des assurances vise toutes les désignations d’expert à la suite d’un sinistre, donc, entre autres, celles ordonnées par le juge. Et pour ce cas-là, le texte indique clairement que la prescription est interrompue, pas suspendue. L’application de l’article 2239 du Code civil de préférence à l’article L. 114-2 du Code des assurances est donc discutable69. À moins de considérer qu’interruption et suspension ne s’excluent pas. La portée de l’arrêt est incertaine à cet égard. L’article 2239 étant applicable, la désignation d’un expert en justice avait suspendu la prescription biennale. Mais rien ne dit que l’article L. 114-2 ne devrait pas s’appliquer par ailleurs, comme le soutiennent certains auteurs70. L’ordonnance désignant un expert interromprait la prescription et ferait courir un nouveau délai de deux ans, lequel serait immédiatement suspendu en application de l’article 2239. Le résultat est quand même un peu curieux. Il contredit indirectement la solution antérieure selon laquelle le nouveau délai de deux ans court à compter de la désignation de l’expert et la notion d’interruption même.
Discutable juridiquement, la règle énoncée par l’arrêt a un champ d’application à la fois vaste et limité. Vaste parce qu’elle concerne toutes les actions dérivant du contrat d’assurance, et pas seulement celles ayant pour objet la mise en œuvre de la garantie. Limité, parce que les expertises amiables, qui sont les plus nombreuses, ne sont pas concernées. Pourtant, l’opportunité indiscutable de la solution, qui évite à l’assuré qui attend le résultat d’une expertise d’être surpris par la prescription y est encore plus évidente. La différence de traitement des deux sortes d’expertise qui résulte de l’arrêt du 19 mai 2016 est injustifiée. Comme il est peu probable que le législateur intervienne à brève échéance pour modifier l’article L. 114-2 du Code des assurances ou l’article 2239 du Code civil, c’est à la Cour de cassation qu’il revient de prolonger cette nouvelle jurisprudence pour faire cesser cette disparité. Limitée par les textes dont elle a tiré tout le parti, elle ne pourrait guère le faire qu’en changeant de plan. Par exemple, en jugeant, pour toutes les expertises, que le nouveau délai de deux ans résultant de l’interruption court, non pas à compter de la désignation de l’expert, mais du jour du dépôt de l’expertise71.
Éric Savaux
La prescription applicable aux créances périodiques constatées par une décision de justice : la Cour de cassation garde le cap (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19614 ; Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16-70004)
En un peu moins d’un mois, la Cour de cassation aura répondu deux fois à la même question – signe que la réponse était attendue, en pratique, après la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription : le délai d’exécution de dix ans des titres exécutoires prévu par l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution est-il applicable aux créances échues postérieurement au jugement de condamnation ? La question est importante dans l’hypothèse où une personne a obtenu depuis un certain temps un jugement de condamnation de son débiteur qui concerne des échéances à venir. Sa situation n’est en effet pas la même selon que l’on applique le délai d’exécution de dix ans (compte tenu de l’existence d’un titre exécutoire éligible au délai allongé de l’article L. 111-4) ou le délai de prescription ordinairement applicable à sa créance compte tenu de sa nature (cinq ans, en principe, application de l’article 2224 du Code civil)72. D’où la question de savoir, dans l’arrêt rendu le 8 juin 201673, si le délai de mise en œuvre d’une créance périodique relève par principe de l’article 2224 du Code civil (délai de prescription de cinq ans) ou de l’article L. 111-4 précité (délai d’exécution de dix ans des titres exécutoires) et, dans l’avis rendu le 4 juillet 2016, si le délai de mise en œuvre d’une créance périodique d’un professionnel contre un consommateur relève de ce dernier texte ou de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (délai de prescription de deux ans lorsque la créance en cause est celle d’un professionnel, pour des biens ou services fournis à un consommateur).
La question s’était déjà posée dans des termes similaires sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 17 juin 2008 – si ce n’est qu’il n’y avait alors pas de texte équivalent à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution actuel et que le délai de mise en œuvre des titres exécutoires était le délai de prescription de droit commun de trente ans de l’article 2262 du Code civil. Par un arrêt d’Assemblée plénière, la Cour de cassation avait alors jugé que le délai de prescription quinquennal prévu par l’ancien article 2277 du Code civil continuait à régir les créances échues après un jugement de condamnation, de sorte que le créancier ne pouvait, en vertu de ce texte « applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande » (la « demande » renvoyant ici à celle faite par le créancier après obtention de son titre exécutoire pour être payé des échéances postérieures)74. Ainsi, il fallait distinguer entre les fractions de créance échues et celles non échues, car les secondes restaient soumises à leur délai ordinaire de prescription. En doctrine, on avait justifié cette solution par la nécessité d’éviter que le jugement de condamnation ne substitue le délai de prescription trentenaire de l’ancien article 2262 au délai quinquennal applicable aux créances périodiques, que le législateur avait institué à l’article 2277 ancien pour éviter une accumulation de dettes susceptible d’étouffer financièrement le débiteur75.
Avec la réforme de la prescription, la survie de cette jurisprudence était néanmoins discutée76, pour la triple raison suivante : d’abord, avec la loi du 17 juin 2008, les créances périodiques ont perdu en grande partie leur spécificité et elles sont aujourd’hui soumises au même délai quinquennal que les créances ordinaires (art. 2224) ; ensuite, le délai de mise en œuvre des titres exécutoires est passé de trente à dix ans (CPCE, art. L. 1111-4), ce qui est assurément moins long et rigoureux pour le débiteur ; enfin, le texte organisant ce délai décennal de mise en œuvre des titres exécutoires ne distingue pas selon que la créance qu’ils constatent est échue ou ne l’est pas, si bien qu’il était tentant de refuser d’opérer la distinction retenue antérieurement par la jurisprudence (ubi lex non distinguit…)77.
Ce n’est cependant pas l’analyse que retient ici la Cour de cassation. Dans l’arrêt commenté, elle juge ainsi que « si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ». Il s’agit de la reprise, presque mot pour mot, de l’attendu de l’arrêt d’assemblée plénière précité, qui conduit à considérer que la créance périodique reste par principe soumise, pour l’avenir, et en dépit de sa consécration dans un titre exécutoire, au délai de droit commun (C. civ., art. 2224). Quant à l’avis, il reprend cette analyse, dont il résulte que « le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire » et l’applique au délai biennal de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, motif pris que « ce texte ne distingue pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre ». Ainsi, le délai de prescription de deux ans résultant de ce texte doit être appliqué aux échéances à venir de créances périodiques constatées dans un titre exécutoire lorsque les créances en cause concernent des biens ou services fournis à un consommateur par un professionnel.
La solution est logique, car comme l’avait expliqué le professeur Libchaber dans une note lumineuse, l’interversion de prescription attachée aux décisions de justice ne saurait valoir pour tous les jugements, mais seulement « pour ceux qui débouchent sur une décision, qui peut être mise à exécution telle quelle : elle ne peut rationnellement concerner que ceux qui s’exécutent sans besoin d’une autre discussion judiciaire ». Or, toute autre est l’hypothèse ici considérée, dès lors que la décision de justice, quant aux échéances à venir, « ne pourra pas s’exécuter sans retour devant un juge (…) : s’il ne s’agit plus de statuer sur des questions de validité, il reste tout le contentieux de l’exécution et de ses circonstances. Dans ce type de condamnations, le juge se rapproche d’un notaire qui authentifie un contrat ou une créance, mais ne rend pas une décision qui se suffirait à elle-même. Et, logiquement, l’interversion ne devrait pas en découler »78.
Certes, le délai ainsi appliqué au créancier paraîtra sans doute un peu bref, et l’obligera en pratique à réaliser des actes interruptifs de prescription s’il entend obtenir paiement de son débiteur. Néanmoins, la solution retenue n’est pas excessivement gênante et elle présente l’avantage appréciable de prolonger la jurisprudence antérieure, ce qui est utile dans une matière réformée où les nouveautés sont déjà suffisamment perturbatrices pour les utilisateurs du droit.
Lionel Andreu
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. com., 31 mars 2016, n° 14-25604 : Defrénois 30 sept. 2016, n° 124j9, p. 935, obs. Gijsbers C. ; JCP G 2016, n° 46, doctr. 1224, obs. Delebecque P. ; JCP E 2016, 1451, n° 30-34, note Legrix de la Salle S. et Pastre-Boyer A.-L. ; RD bancaire et fin. 2016, n° 3, p. 60-61, obs. Piedelièvre S.
-
2.
V. en partic. l’article CPCE, art. R. 311-11.
-
3.
V., par ex., pour une vente d’un appartement à un prix inférieur à sa valeur vénale, Cass. 1re civ., 14 janv. 1993, n° 91-11871.
-
4.
Cass. 3e civ., 6 avr. 1976, n° 75-11165.
-
5.
Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-12489. V. égal. Cass. 1re civ., 18 juill. 1995, n° 93-13681 ; Cass. 1re civ., 10 déc. 1974, n° 72-11223 ; Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, n° 03-15392.
-
6.
Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-28243 : LPA 15 juill. 2016, n° 117q1, p. 11, note Niel P.-L. et Morin M. ; LPA 14 sept. 2016, n° 120e9, p. 11, note Moulin J.-M. ; Gaz. Pal. 6 sept. 2016, n° 272x0, p. 70, obs. Zattara-Gros A.-F. ; D. 2016, Actu., p. 998 ; AJDI 2016, p. 625, note Porcheron S. ; JCP E 2016, 1400, note Dondero B. ; Rev. sociétés 2016, p. 747, note Saintourens B. ; JCP N 2016, 1222, note Storck M. ; BJS août 2016, n° 115d7, p. 404, note Barbièri J.-F. ; Dr. sociétés 2016, n° 121, note Hovasse H. ; JCP G 2016, 1015, obs. Loiseau G.
-
7.
J.-Cl. Civil Code, art. 1341-1, par Dross W., n° 63.
-
8.
C. civ., art. 815-17, al. 3.
-
9.
Sur la deuxième branche du moyen, v. Sizaire C., obs. sous Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-10207 : Constr.-Urb. 2016, comm. 109.
-
10.
Forti V., « La réalisation fictive de la condition », in Forti V. et Andreu L., Le nouveau régime général des obligations, 2016, Dalloz, p. 31 et s.
-
11.
Gjidara S., « Le déclin de la potestativé dans le droit des contrats : le glissement de l’article 1174 à 1178 du Code civil », LPA 21 juin 2000, p. 4, et LPA 22 juin 2000 ; Dondero B., « De la condition potestative licite », RTD civ. 2007, p. 677 ; Dross W., « L’introuvable nullité des conditions potestatives », RTD civ. 2007, p. 701 ; Latina M., Essai sur la condition en droit des contrats, 2009, LGDJ, nos 350 et s. ; Borghetti J.-S., « Des obligations conditionnelles et à terme », in Terré F. (dir.), Pour une réforme du régime général des obligations, 2013, Dalloz, p. 64 ; Chénedé F., « Charles Demolombe, la condition potestative (2e partie) », RDC juill. 2013, p. 1131.
-
12.
D’après une recherche sur le site internet Légifrance, l’expression « 1178 du Code civil » figure dans 238 décisions de la Cour de cassation pendant la période allant du 1er mai 2006 au 30 avril 2016, et dans 87 décisions pendant la période allant du 1er mai 1996 au 30 avril 2006.
-
13.
Cass. com., 7 janv. 2003, n° 00-14120 : Bull. civ. IV, n° 5 ; JCP E 2003, 760, obs. Pétel P. – Cass. com., 27 sept. 2011, n° 10-24836 : Bull. civ. IV, n° 140 ; Gaz. Pal. 21 janv. 2012, n° I8492, p. 25, obs. Voinot D. ; Dalloz actualité, 6 oct. 2011, obs. Lienhard A. ; D. 2011, p. 2852, note Juillet C. ; JCP E 2011, 1743 ; Act. proc. coll. 2011, comm. 267, obs. Cagnoli P. ; BJE janv. 2012, n° 17, p. 15, note Vincent C. – Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-23901 : Bull. civ. IV, n° 121 ; Rev. proc. coll. 2014, comm. 165, Fraimout J. ; D. 2014, Actu., p. 1869 ; JCP E 2014, 1637, obs. Pétel P. ; Leden oct. 2014, n° 141, p. 5, obs. Le Corre P.-M. ; Act. proc. coll. 2014, alerte 273, par Vallansan J. ; Leden déc. 2014, n° 174, p. 3, obs. Rubellin P. ; BJE janv. 2015, n° 111t2, p. 21, note Vincent C.
-
14.
Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-16389 : Gaz. Pal. 18 oct. 2016, n° 277h4, p. 59, note Voinot D. ; D. 2016, Actu., p. 1559, obs. Lienhard A. ; Rev. sociétés 2016, p. 554, obs. Henry L.-C. ; JCP E 2016, 1519, note Brignon B. ; BJE nov. 2016, n° 113y3, p. 405, note Vincent C. ; Leden oct. 2016, n° 144, p. 4, obs. Pelletier N.
-
15.
C. civ., art. 1216-1, al. 2.
-
16.
Juillet C., note sous Cass. com., 27 sept. 2011, n° 10-24836, préc. – Brignon B., note sous Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-16389, préc.
-
17.
Pétel P., obs. sous Cass. com., 7 janv. 2003, n° 00-14120, préc. – Henry L.-C., note sous Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-16389, préc.
-
18.
Cass. 3e civ., 19 mars 1997, n° 95-12473 : Bull. civ. III, n° 68 ; JCP 1997 I, 4030, obs. Billiau M. ; D. 1997, p. 341, obs. Brun P.
-
19.
Boyer L., « Clause de substitution et promesse unilatérale de vente », JCP N 1988 I, 250 ; Jeuland E., « Proposition de distinction entre la cession de contrat et la substitution de personne », D. 1998, p. 356.
-
20.
Comp., au sujet de la promesse unilatérale, Gijsbers C., « Faut-il “rebaptiser” les clauses de substitution après la réforme du droit des obligations ? », JCP N 2016, n° 45, act. 1194.
-
21.
Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-24755 : Gaz. Pal. 7 juin 2016, n° 266y1, p. 67, obs Moreil S. ; Banque et droit 2016, n° 167, obs. Bonneau T. et Helleringer G. L’arrêt rappelle également que l’obligation d’information annuelle de la caution doit être exécutée jusqu’à l’extinction de la dette garantie (v. déjà, Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006, n° 04-12863). On laissera ici de côté cet aspect.
-
22.
Cass. com., 18 sept. 2007, n° 06-13736.
-
23.
Un arrêt avait néanmoins créé une (relative) incertitude : Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-18210, où la Cour de cassation avait, au visa de l’ancien article 1134 du Code civil, écarté toute diligence du cessionnaire, en raison d’une clause de l’acte de cession, ce qui pouvait conduire à se demander si l’absence d’obligation du cessionnaire ne se justifiait pas seulement par la présence d’une telle stipulation. En réalité, il n’en était rien, car si l’existence d’une clause dispense effectivement le cessionnaire d’avoir à accomplir des démarches – que la cession ait d’ailleurs été ou non notifiée – rien n’excluait que cette dispense se maintienne également, en l’absence de clause, lorsque la cession a été notifiée, comme l’illustre le présent arrêt. Comp., antérieurement, Cass. com., 26 nov. 2003, n° 00-16940 ; Cass. com., 11 déc. 2001, n° 98-18580.
-
24.
C’est tout le sens d’une jurisprudence qui s’est développée relativement au bénéfice de subrogation de l’article 2314 ; v. par ex. : Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-15407 : Bull. civ. IV, n° 73 ; Cass. com., 3 déc. 2003, n° 01-13761, D ; Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006, n° 04-19123.
-
25.
Cass. com., 11 déc. 2001, n° 98-18580, qui jugeait que « la notification des cessions étant, au regard de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, une faculté pour la banque, l’abstention de celle-ci d’y procéder ne peut être invoquée par les cautions de la société cédante comme constitutive de faute à leur égard ». Or, à partir du moment où la jurisprudence relative aux facultés du créancier en présence d’un cautionnement a évolué (v. note 24), il est légitime de se demander si cette solution ne mériterait pas d’être renversée.
-
26.
V. note 24.
-
27.
V. l’art. 1324, qui permet au débiteur à qui le cessionnaire n’a rien demandé de « prendre acte » de la cession.
-
28.
Sur cette question, v. Forti V., « Réforme du droit commun des obligations et droit spécial de la titrisation des créances », in Magnier V. (dir.), La titrisation des actifs : régime et garanties, SLC, à paraître ; du même auteur, « Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux », in Andreu L. et Mignot M. (dir.), Les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations, LGDJ, à paraître.
-
29.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 02-12451 : Bull. civ. I, n° 319 ; D. 2005, p. 2242 ; RTD civ. 2005, p. 793, obs. Gautier P.-Y. – Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 06-16746 : JCP E 2007, 2580, note Markhoff P. – Cass. com., 15 avr. 2008, n° 03-15969 : Bull. civ. IV, n° 88 ; D. 2008, p. 1732, note Forti V. ; RTD com. 2008, p. 606, obs. Legeais D. ; JCP E 2008, 1702, rapp. Cohen-Branche M. ; RD bancaire et fin. 2008, comm. 48 ; RTDF 2008, n° 2, p. 78, obs. Granier T. ; Banque et droit, juill.-août 2008, p. 18, obs. Bonneau T. – Cass. com., 6 déc. 2011, n° 10-17879 : RD bancaire et fin. 2012, comm. 67, par Bonneau T. ; ibid., comm. 39, par Crédot F.-J. et Samin T.
-
30.
Cass. req., 30 juin 1880 : S. 1881, 1, 59. – Cass. civ., 17 mars 1886 : DP 1887, 5, 441.
-
31.
Cass. req. 30 juin 1880, préc. – Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 07-11428 : Bull. civ. I, n° 319 ; RTD civ. 2005, p. 793, obs. Gautier P.-Y. – Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-11428 : RTD civ. 2008, p. 481, obs. Fages B. – Cass. com., 31 janv. 2012, n° 10-20972 : RDC juill. 2012, p. 838, obs. Libchaber R. – Cass. com., 15 janv. 2013, n° 11-27298 : RDC juill. 2013, p. 933, obs. Libchaber R.
-
32.
Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-17118, D.
-
33.
Gautier P.-Y., obs. sous Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, préc.
-
34.
Pollaud-Dulian F., « Le prix du retrait litigieux dans les cessions globales de créances », D. 2012, p. 834 ; Gout O., « Le rayonnement du droit au retrait litigieux », D. 2013, p. 542 ; Hinsinger-Cornileau E., « Le retrait litigieux : un vieil outil au service d’un droit moderne des affaires », LPA 22 sept. 2015, p. 3.
-
35.
Comp. Forti V., obs. sous Cass. com., 15 avr. 2008, préc. ; Fages B., obs. sous Cass. com., 27 mai 2008, préc. ; Savaux E., v° Cession de droits litigieux, préc., n° 86.
-
36.
Forti V., « Réforme du droit commun des obligations et droit spécial de la titrisation des créances », préc. ; du même auteur, « Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux », préc.
-
37.
Libchaber R., obs. sous Cass. com., 31 janv. 2012, préc. ; Savaux E., v° Cession de droits litigieux, Rép. civ. Dalloz, n° 86.
-
38.
Cass. soc., 10 mars 1988, n° 86-42018 ; Cass. soc., 25 avr. 1990, n° 87-40635 ; Cass. 2e civ., 22 janv. 1997, n° 95-11877.
-
39.
Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-26174 : LPA 24 oct. 2016, n° 121c5, p. 8, Goût E.-U. ; AJCA 2016, p. 435, obs. Assimopoulos C. ; LEDB oct. 2016, n° 142, p. 2, obs. Mignot M.
-
40.
Cass. com., 26 mars 2013, n° 11-27423 : Bull. civ. IV, n° 48 ; D. 2013, p. 542, obs. Delpech X. ; Gaz. Pal. 25 avr. 2013, n° 127t0, p. 9, note Mignot M. ; RDC juill. 2013, p. 997, obs. Pellet S. ; RTD civ. 2013, p. 376, obs. Barbier H.
-
41.
Danis-Fatôme A., « Le retrait litigieux, un article manquant ! », RDC sept. 2015, n° 112h1, p. 807 ; Hinsinger-Cornileau E., « Le retrait litigieux : un vieil outil au service d’un droit moderne des affaires », LPA 22 sept. 2015, p. 3 – Lécuyer H., obs. sous Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-23401 : Defrénois 30 janv. 2016, n° 122b3, p. 73.
-
42.
Goût E.-U., obs. sous Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-26174, préc.
-
43.
Cass. com., 26 févr. 2002, n° 99-12228 : Bull. civ. IV, n° 41 ; D. 2002, p. 1344 ; RTD civ. 2002, p. 532, obs. Gautier P.-Y. ; Defrénois 15 juin 2002, n° 35778-4, p. 767, obs. Savaux E.
-
44.
Savaux E., v° Cession de droits litigieux, Rép. civ. Dalloz, nos 28 et s.
-
45.
Comp. Savaux E., obs. sous Cass. com., 26 févr. 2002, n° 99-12228, préc.
-
46.
Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-11749, D ; v. égal, avec une autre formulation : Cass. 3e civ., 16 janv. 2013, n° 11-26780, D : RDI 2013, p. 165, obs. Dessuet P. – Cass. 3e civ., 4 mai 2015, n° 14-11150, D.
-
47.
Au demeurant, on ne voit pas ce qui justifierait que le responsable, tiers au contrat d’assurance, jouisse ainsi d’une immunité de recours du fait de la violation d’une obligation destinée à protéger l’assuré. L’article C. assur., art. L. 242-1, al. 5, prévoit la possibilité pour l’assuré d’engager les dépenses nécessaires pour la réparation des dommages et la majoration de l’indemnité due d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal. Cela implique que l’assureur ne peut plus décliner sa garantie.
-
48.
Rousel J., RDI 2016, p. 609.
-
49.
Groutel H., Rapp. C. cass. 2016, comm. 320.
-
50.
V. not. Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-15210 : Bull. civ. I, n° 191 – Cass. 1re civ., 9 nov. 1999, n° 97-16306 : Bull. civ. I, n° 293 – Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 08-21966, D : RGDA juill. 2010, p. 696, note Abravanel-Jolly S. – Cass. 3e civ., 16 janv. 2013, n° 11-26780, préc.
-
51.
Cass. 3e civ., 22 oct. 2014, n° 13-24420 : Bull. civ. III, n° 134 ; RDI 2015, p. 87, obs. Dessuet P.
-
52.
Sur lesquelles, v. Andreu L. et Martin D.-R., JCl. Civil Code, Art. 1347-4 à 1347-7 (à paraître), n° 4 et les auteurs cités.
-
53.
Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-29893 : Dr. & patr. hebdo 2016, n° 262, p. 83, note Lefort C.
-
54.
V. Cass. 2e civ., 31 janv. 2002, n° 00-17042, rejetant la compensation dès lors que « la créance dont se prévalait, à titre de compensation, [l’intéressé], était dans le débat devant le juge du fond et que si au fond le premier juge avait ordonné une compensation entre les créances réciproques des parties, la décision avait été infirmée en appel » ; v. égal. Cass. 1re civ., 16 nov. 2004, n° 01-03102 ; Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-20561 ; Cass. com., 21 févr. 2012, n° 11-18027.
-
55.
Perrot R., obs. sous Cass. 2e civ., 21 janv. 2002 : Procédures mai 2002, comm. 90.
-
56.
Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10672.
-
57.
À notre sens, la qualification de défense au fond paraît susceptible d’être retenue, du moins quand le débiteur prétend seulement échapper à condamnation sans réclamer un avantage autre que le simple rejet de la prétention averse. En revanche, lorsqu’il réclame la condamnation en paiement de l’autre partie (notamment lorsque sa créance n’est pas liquide ou lorsqu’il entend obtenir condamnation pour un montant supérieur à ce qui doit lui-même), il agit par voie reconventionnelle, même si c’est pour prétendre ensuite compenser sa dette partiellement ou totalement avec sa créance ainsi constatée. Comp., sur ces questions, l’analyse dualiste retenue par Cass. ass. plén., 22 avr. 2011, n° 09-16008.
-
58.
Andreu L., « L’extinction de l’obligation », Dr.& patr. mensuel 2016, n° 258, p. 86. Rappr. Hontebeyrie A., « La compensation », in Le nouveau régime général des obligations, 2016, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 151, v. spéc. n° 18.
-
59.
Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 1re éd., 2016, Gualino, nos 2249 et s.
-
60.
Sur les difficultés induites par la nature de la « procédure » de surendettement, v. Maumont B., « La procédure de surendettement à la lumière du droit de la prescription » (note sur l’arrêt rapporté), D. 2016, p. 1481.
-
61.
Rep. civil Dalloz, V° Prescription extinctive, par Hontebeyrie A., n° 409, et les auteurs cités.
-
62.
V. not. Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 04-15814 : Bull. civ. II, n° 89 – Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, n° 03-11936 : Bull. civ. II, n° 500.
-
63.
Mignot M., LEDB mai 2016, n° 78, p. 5.
-
64.
Sur l’ensemble de la question, antérieurement à l’arrêt commenté : Scattolin A., « L’incidence de la désignation d’un expert sur la prescription biennale », RGDA avr. 2016, n° 113g0, p. 212.
-
65.
La fixation de ce point de départ semble remonter à Cass. civ., 17 févr. 1948, JCP 1948, II, note P. L.-P., D. 1949, p. 422, note Besson.
-
66.
Dans une longue série, v. not. Cass. 1re civ., 8 nov. 1988, n° 87-13428 : Bull. civ. I, n° 307 – Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-00171, D ; D. 2004, som., p. 918, obs. Groutel H. – Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 04-15041 : Bull. civ. II, n° 283 ; Rapp. C. cass. 2006, comm. 42, obs. Groutel H.
-
67.
Cass. 2e civ., 3 oct. 2013, n° 12-22908, D : RDI 2014, p. 31, note Charbonneau C. ; RGDA janv. 2014, p. 18, note Kullmann J.
-
68.
Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, n° 14-14474, D : RGDA juin 2015, n° 112h2, p. 319, obs. Schulz R.
-
69.
En ce sens : Groutel H., Rapp. C. cass. 2016, comm. 262. Approuvant au contraire : Schulz R., RGDA juill. 2016, n° 113q1, p. 379.
-
70.
V. Mazeaud D., Procédures 2016, n° 7, p. 3. Contra Noguero D., RDI 2016, p. 418.
-
71.
En ce sens : Groutel H., op. cit.
-
72.
Sur lequel, v. par ex. Flour J., Aubert J.-L. et Savaux E., Le rapport d’obligation, t. 3, 8e éd., 2015, LGDJ.
-
73.
D. 2016. chron. C. Cass. 1881, obs. Guyon-Renard ; AJ fam. 2016, p. 388, obs. Casey ; RTD civ. 2016, p. 593, obs. Hauser ; Gaz. Pal. 6 déc. 2016, n° 281p7, p. 28, obs. Ansault J.-J. ; ibid. n° 44, p. 70, obs. Gaillard A. ; LPA 19 sept. 2016, n° 120k2, p. 9, note Morin M. et Niel P.-L.
-
74.
Cass. ass. plén., 10 juin 2005, n° 03-18922.
-
75.
Pour l’explication de cette singularité, v. par ex. Libchaber R., « Le point sur l’interversion des prescriptions en cas de condamnation en justice », note sous Cass. ass. plén., 10 juin 2005 : D. 2006, p. 254, spéc. n° 12.
-
76.
Sur le débat, v. Hontebeyrie A., Rép. civil Dalloz, Prescription extinctive, 2016, n° 146.
-
77.
En ce sens, par ex., Ansault J.-J., obs. préc.
-
78.
Libchaber R., note préc., n° 10.