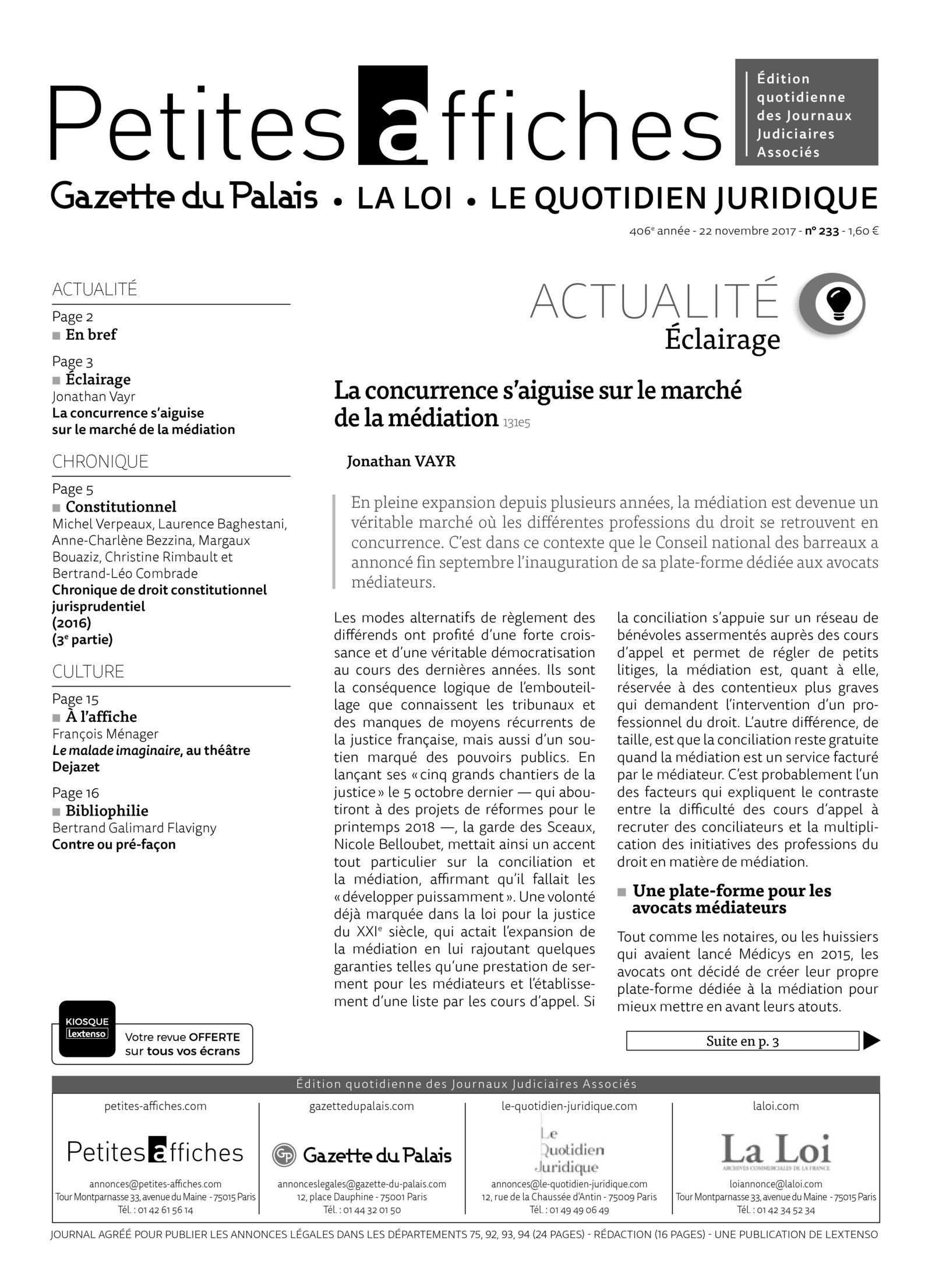Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (2016) (3e partie)
La chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel est ouverte à l’ensemble des décisions susceptibles d’intéresser le droit constitutionnel dans sa dimension contentieuse considérée de la manière la plus large. C’est ainsi que le contentieux électoral est intégré dans la présente chronique qui est divisée en quatre parties correspondant aux thèmes principaux du droit constitutionnel contemporain qui intègre aussi bien les questions institutionnelles que les problèmes de hiérarchie des normes et la place des droits et libertés.
La chronique présentée ci-dessous couvre l’année 2016 dans son intégralité.
I – Les institutions constitutionnelles
A – Les pouvoirs politiques : le pouvoir exécutif
B – Les pouvoirs politiques : le Parlement et la procédure législative
1 – Les validations législatives
2 – Le contrôle de la procédure législative
3 – La compétence et le domaine de la loi
a – Partage des compétences entre la loi et le règlement
b – Incompétence négative
c – Dispositions législatives expérimentales
d – Contenu normatif de la loi
C – Le pouvoir juridictionnel
D – Le pouvoir financier
E – Les collectivités décentralisées
F – Droits électoraux, contentieux des élections et des référendums
II – Le procès constitutionnel
A – Les acteurs et les actes devant le Conseil constitutionnel
B – La procédure devant le Conseil constitutionnel (…)
C – Les techniques contentieuses
D – L’autorité et les effets des décisions du Conseil constitutionnel
1 – Les dispositions « spécialement examinées » au sens de l’article 23-2 de la loi organique du 7 novembre 1958
2 – Les décisions d’abrogation des décisions avec effet immédiat
3 – Les décisions d’abrogation avec effet différé
4 – L’argument de la chose jugée dans le contrôle a priori
III – Les normes de référence
A – Les sources matérielles
1 – Les textes et principes constitutionnels
La « liberté de la femme » a été utilisée dans la décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé, à propos de la suppression par la loi du délai d’une semaine entre la demande de la femme d’interruption de sa grossesse et la confirmation écrite de cette demande1. La « liberté de la femme » était déjà présente dans la décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Le Conseil a estimé que le législateur n’a pas rompu l’équilibre que le respect de la constitution impose entre, d’une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d’autre part, la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, parce que ce même article fait obstacle à ce que la demande d’interruption de grossesse et sa confirmation écrite interviennent au cours d’une seule et même consultation. Cette réserve ne laisse pas cependant beaucoup de possibilités entre « une même consultation » et un délai d’une semaine.
L’article 7 de la Charte est à l’origine de nombreux contentieux. Il précise que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » et ce principe figure au nombre des droits et libertés que la constitution garantit. C’est néanmoins à la loi d’en déterminer les modalités de sa mise en œuvre, comme le rappelle la décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016 Association Avenir Haute Durance et autres. Si les décisions établissant les servitudes instituées par les dispositions contestées sont des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement au sens de cet article 7, les dispositions du Code de l’environnement et du Code de l’énergie organisent des modalités suffisantes de consultation du public dans le cadre de la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité (cons. 12).
Ce même article 7 de la Charte de l’environnement a donné naissance à une décision intéressante quant aux effets de son entrée en vigueur2. Le Conseil constitutionnel a jugé que, depuis l’entrée en vigueur de cette Charte, il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de l’article 7 (cons. 5) Par opposition, avant l’entrée en vigueur de la charte de l’environnement le 3 mars 2005, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la constitution garantit. Entre cette date et l’intervention de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, aucune disposition législative n’assurait, en revanche, la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques et le législateur a donc, pendant cette période, méconnu les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Dans un troisième temps, la loi précitée du 12 juillet 2010 a inséré dans le Code de l’environnement l’article L. 120-1, qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics ayant une incidence directe et significative sur l’environnement et a mis fin à l’inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente. À compter de cette date, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la constitution garantit.
L’avant-dernier né des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République est celui selon lequel il existe des règles particulières quant à la justice pénale des mineurs, visant à l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, à la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées3. Depuis cette date, le Conseil constitutionnel en a fait application à neuf reprises, six dans des décisions DC et trois dans des décisions QPC. La dernière en date est la décision n° 2013-356 QPC du 29 novembre 2013, M. Christophe D. Dans la décision n° 2016-601 QPC du 9 décembre 2016, M. Ibrahim B., il était reproché à l’article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de méconnaître ce PFRLR parce que l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre d’un mineur ne serait pas justifiée par la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants qui est au centre dudit principe. Dans la décision de 2016 et à la suite de sa jurisprudence antérieure, le Conseil constitutionnel a précisé que la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la constitution de 1946, source du PFRLR, ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives.
Il a été amené alors à juger que la possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants de prononcer l’exécution provisoire des mesures ou sanctions éducatives et des peines, autres que celles privatives de liberté, est justifiée par la nécessité de mettre en œuvre les mesures propres à favoriser leur réinsertion afin de contribuer ainsi à l’objectif de leur relèvement éducatif et moral (§ 7). En revanche, l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre d’un mineur, alors que celui-ci comparaît libre devant le tribunal pour enfants, qui entraîne son incarcération immédiate à l’issue de l’audience, y compris en cas d’appel, le prive ainsi du caractère suspensif du recours et de la possibilité d’obtenir, avant le début d’exécution de sa condamnation, diverses mesures d’aménagement de sa peine, en application de l’article 723-15 du Code de procédure pénale. Pour cette raison, l’article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945 a été déclaré contraire à la constitution. L’application du PFRLR donne lieu à un examen très précis des mesures législatives et les règles particulières de la justice pénale des mineurs n’interdisent pas l’édiction de mesures de nature répressive.
MV
2 – Les rapports de systèmes
Le Conseil constitutionnel a précisé sa jurisprudence relative à la question préjudicielle et confirmé la tendance de sa jurisprudence relative au contrôle des lois de transposition.
À propos de la question préjudicielle, il a précisé dans le cadre de la décision n° 512 DC que tant que « la validité » de l’acte européen (ici une décision cadre) était « sans effet sur l’appréciation de la conformité de la disposition contestée aux droits et libertés que la constitution garantit », toute conclusion à fin de question préjudicielle devrait être rejetée. L’identification de la décision n° 314-P QPC est donc rendue plus complète. Il est désormais acquis que seules les décisions européennes qui conditionnent l’appréciation des normes constitutionnelles nationales pourront conduire le juge constitutionnel à poser une question préjudicielle.
Concernant le contrôle des lois de transposition, le Conseil constitutionnel a précisé la marge de manœuvre du législateur national (2015-727 DC). Au sujet de la législation sur le tabac, très étroitement déterminée par une directive n° 2014/40/UE, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions législatives françaises relatives au tabac avec arôme, constituaient une exacte transposition de la directive, dès lors que leur entrée en vigueur dérogatoire était rendue possible par le texte même de la directive (cons. 7).
Enfin, le Conseil constitutionnel s’est référé à l’interprétation neutralisante de la directive mère-fille qu’avait opérée le Conseil d’État pour juger de la compatibilité de la loi déférée avec les objectifs de la directive (520 DC). Il a également confirmé dans cette décision qu’il distinguait à l’intérieur d’une même loi, d’une part les dispositions qui constituent l’exacte transposition d’une directive et d’autre part, celles qui se trouvent hors du champ de la transposition. Le dialogue des juges est plus que jamais en marche !
ACB
3 – Les droits et libertés
a – Sécurité et libertés
L’état d’urgence a été prononcé par décret en Conseil des ministres à la suite des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, puis a été prorogé par les lois du 20 novembre 2015, du 19 février 2016, du 20 mai 2016, du 21 juillet 2016 et du 19 décembre 2016. Les lois du 20 novembre 2015, du 21 juillet 2016 et du 19 décembre 2016 ont, en outre, apporté plusieurs modifications à la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Dans ce contexte difficile, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la constitution de plusieurs dispositions de cette loi attentatoires aux droits et libertés dans le cadre de quatre questions prioritaires de constitutionnalité. La décision n° 2016-535 était relative à l’article 8 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2011, habilitant le ministre de l’Intérieur (pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence) et le préfet (pour le département) à ordonner la fermeture de lieux de spectacle, de réunion et de débits de boisson. Les décisions n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, n° 567/568 QPC du 23 septembre 2016 et n° 2016-600 QPC du 2 décembre 2016 étaient relatives aux régimes de perquisition administrative respectivement prévus par la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015, dans sa version antérieure à la loi du 20 novembre 2015 et enfin dans sa version résultant de la loi du 21 juillet 2016.
Lors de sa saisine, le Conseil constitutionnel a examiné la constitutionnalité de ces différentes mesures en ayant principalement recours à deux types de contrôle. D’une part, il a apprécié l’équilibre de la conciliation opérée par le législateur entre l’atteinte portée à plusieurs droits et libertés reconnus par la constitution et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public (I). D’autre part, le Conseil a contrôlé la conformité de ces différentes dispositions à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui protège le droit au recours juridictionnel (II).
I. Le contrôle de la conciliation entre les droits et libertés garantis par la constitution et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public
En dégageant par la voie prétorienne des objectifs de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel met en lumière des intérêts collectifs avec lesquels le législateur est tenu de composer. Parmi ces objectifs figure, depuis la décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, la sauvegarde de l’ordre public. Dans les quatre décisions récentes précitées, c’est à la lumière de cet objectif qu’il a apprécié la constitutionnalité des dispositions relatives à l’état d’urgence dont il était saisi. Il a procédé ainsi lors du contrôle de l’article 8 de la loi du 3 avril 1955, dans sa version résultant de la loi du 17 mai 20114. En vertu de cet article, l’autorité administrative peut, dans le cadre de l’état d’urgence, ordonner la fermeture de salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature et interdire les réunions susceptibles de provoquer ou d’entretenir le désordre. Le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait opéré une conciliation entre le droit d’expression collective des idées et des opinions, défendu par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et l’objectif de sauvegarde de l’ordre public qui n’était manifestement pas déséquilibrée (cons. 10). Le Conseil a relevé que les mesures prévues par cet article ne pouvaient être appliquées que durant la durée de l’état d’urgence, laquelle « ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence », et qu’elles devraient être renouvelées en cas de prolongation de l’état d’urgence par une nouvelle loi (cons. 9).
C’est ce même contrôle de conciliation qui a été mis en œuvre lors de l’examen des trois versions des dispositions encadrant le recours aux perquisitions administratives. S’agissant des dispositions antérieures à la loi du 20 novembre 2015, qui ont été appliquées entre le 14 novembre 2015 et l’entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déploré que la faculté reconnue à l’autorité administrative de recourir à des perquisitions de jour comme de nuit ne soit soumise à aucune condition et que son application ne soit encadrée par aucune garantie. Par conséquent, ces dispositions ont été déclarées contraires à la constitution56.
Tel n’a pas été le sort des dispositions de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015, habilitant l’autorité administrative à procéder à des perquisitions, à accéder à des données stockées dans un système informatique sur le lieu de cette perquisition et à les copier. À cet égard, s’il a jugé que les perquisitions administratives et l’accès aux données informatiques, compte tenu des garanties dont ils étaient assortis, opéraient une conciliation non manifestement disproportionnée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde l’ordre public et l’article 2 de la Déclaration de 1789 défendant l’inviolabilité du domicile, il a considéré, en revanche, que les dispositions relatives à la collecte des données informatiques étaient dépourvues de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre cet objectif et le droit au respect de la vie privée. Le législateur aurait dû, en particulier, prévoir l’intervention d’un juge pour autoriser cette collecte, spécialement lorsque le propriétaire des données s’y oppose et qu’aucune infraction n’a été constatée7.
C’est cette déclaration d’inconstitutionnalité qui a conduit le législateur à adopter un nouveau régime de perquisition administrative dans la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. Cette fois, dans la décision n° 2016-600 QPC du 2 décembre 2016, le Conseil a jugé que les dispositions relatives à la saisie des données informatiques, compte tenu des garanties légales dont elles sont assorties (notamment l’autorisation préalable du juge) opéraient une conciliation non manifestement déséquilibrée entre le respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public (§ 13). En revanche, il a relevé que les dispositions prévoyant la conservation des données informatiques caractérisant une menace sans conduire à la constatation d’une infraction n’avaient prévu aucun délai à l’issue duquel ces données seraient détruites. Le Conseil en a déduit que le législateur n’avait pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public (§ 16).
II. Le contrôle du respect du droit au recours juridictionnel
L’article 16 de la Déclaration de 1789 sert traditionnellement de fondement à la protection du droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction8. Les dispositions des différentes versions de la loi relative à l’état d’urgence qui ont fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité ont donné l’occasion aux juges de la rue de Montpensier d’apprécier le respect de ce droit protégé par la constitution.
Dans la décision n° 2016-535 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 8 de la loi de 1955 autorisant la fermeture des salles de spectacle, des débits de boisson et des lieux de réunion ainsi que l’interdiction des réunions n’avait pas méconnu l’article 16. Il a relevé, en effet, que ces dispositions n’empêchaient pas la contestation de ces mesures devant le juge administratif, y compris en référé (cons. 14).
Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence fixant le régime des perquisitions administratives et de l’accès aux données informatiques, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015, ont également été confrontées à l’article 16 de la Déclaration de 1789. À cet égard, le Conseil constitutionnel a considéré que, en dépit de l’absence de voie de recours préalable à l’encontre d’une mesure de perquisition, les dispositions de cet article ne méconnaissaient pas le droit au recours juridictionnel effectif compte tenu de la faculté reconnue aux personnes visées par une telle mesure d’engager la responsabilité de l’État9. De façon comparable, mais sans que le Conseil constitutionnel ne développe son raisonnement, les dispositions de la loi relative à l’état d’urgence, dans sa version résultant de la loi du 21 juillet 2016 qui permettent la saisie et l’exploitation des données informatiques dans le cadre des perquisitions administratives, ont été déclarées conformes à l’article 1610.
b – Liberté individuelle, respect de la vie privée, principe de responsabilité
Selon une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel protège la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée et le principe de responsabilité sur le fondement des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. À l’occasion de la décision n° 2016-557 QPC du 29 juillet 2016, de façon innovante le Conseil constitutionnel a déduit des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 relatifs à la liberté personnelle une liberté de mettre fin au mariage. En l’espèce, la question se posait de savoir si le 1° de l’article 274 du Code civil, permettant au juge de subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties par l’époux débiteur d’une prestation compensatoire due sous la forme d’une somme d’argent, ne portait pas atteinte à cette liberté. Les juges de la rue de Montpensier ont d’abord relevé que les dispositions en cause, en assurant la protection du conjoint créancier de la prestation compensatoire en garantissant le versement du capital alloué au titre de cette prestation, poursuivaient un objectif d’intérêt général. Ils ont ensuite constaté que ces dispositions, en habilitant le juge à apprécier la nécessité de subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties et la capacité du débiteur à constituer celles-ci, ne pouvaient « avoir d’autre effet que de retarder le prononcé du divorce » (§ 7). Par conséquent, le Conseil a écarté le grief tiré de la méconnaissance de la liberté de mettre fin aux liens du mariage en considérant que l’atteinte portée à cette liberté par les dispositions en cause était proportionnée à l’objectif poursuivi (§ 7).
La décision n° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016 a permis de préciser, quant à elle, la portée du principe de liberté individuelle en examinant deux articles du Code de procédure pénale relatifs au mandat d’arrêt européen. Selon une jurisprudence traditionnelle, le Conseil considère que cette liberté, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire à l’article 66 de la constitution, ne doit pas « être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire »11. D’une part, le requérant estimait que cette exigence de nécessité de la rigueur était mise en cause par l’article 695-28 du Code de procédure pénale, en ce qu’il ne permettait pas au magistrat saisi aux fins de prononcer l’incarcération d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen de laisser en liberté la personne recherchée. Le Conseil constitutionnel a exercé un contrôle de proportionnalité de la conciliation opérée par le législateur entre la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions. À l’issue de ce contrôle, il a conclu à la constitutionnalité du dispositif sous réserve de deux interprétations qu’il avait déjà formulées dans sa décision n° 2016-561/562 QPC du 9 septembre 2016. Il a considéré, tout d’abord, que l’article 695-28 du Code de procédure pénale ne devait pas être interprété « comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège (…) de laisser en liberté la personne visée par un mandat d’arrêt européen sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation » (§ 15). Il a jugé, par ailleurs, que le respect des droits de la défense impliquait que la personne présentée au magistrat du siège puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général (§ 16). D’autre part, selon le requérant, le principe de liberté individuelle était également mis en cause par l’article 695-34 du Code de procédure pénale qui s’abstenait de fixer une durée maximale d’incarcération lors d’un mandat d’arrêt européen et qui n’envisageait pas de procédure de réexamen périodique de cette mesure. Le Conseil n’a pas accueilli ce moyen. Il a rappelé que les différentes phases de l’exécution du mandat d’arrêt européen étaient encadrées par des délais prévus par différents articles du Code de procédure pénale, ce qui garantissait que cette incarcération ne puisse excéder un délai raisonnable (§ 20 à 29).
Au cours de la période récente, le Conseil constitutionnel a précisé à plusieurs reprises les contours de la protection qu’il accordait au droit au respect de la vie privée par le biais de l’article 2 de la Déclaration de 1789, en examinant des dispositions susceptibles de porter atteinte à celui-ci.
Dans le cadre de sa saisine sur la loi de modernisation de notre système de santé, c’est à la lumière de cet article qu’il a apprécié la constitutionnalité de dispositions qui, dans l’optique d’un renforcement de la transparence des liens d’intérêt entre les acteurs du secteur de la santé et les entreprises du secteur sanitaire ou cosmétique, ont imposé de rendre publiques certaines informations relatives aux conventions conclues12. Après avoir relevé que l’atteinte portée au droit respect de la vie privée par ces dispositions était justifiée par l’exigence constitutionnelle de protection de la santé et par l’objectif d’intérêt général de prévention des conflits d’intérêts, le Conseil a estimé que « le législateur a[vait] opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les principes constitutionnels en cause » (§ 92).
La question de la conformité de la loi au droit au respect de la vie privée s’est également posée dans le cadre de la décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016. Dans cette affaire, étaient en cause, notamment, des dispositions encadrant les conditions dans lesquelles une personne détenue peut recevoir des visites. Constatant que le législateur n’avait pas prévu de voie de recours contre les refus de demande d’un permis de visite d’une personne placée en détention provisoire (hormis dans le cas où le permis est demandé par un membre de la famille pendant l’instruction) et contre les refus d’autorisation de téléphoner, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions en cause avaient privé de garanties légales la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale (§ 14). De même, il a estimé que ces deux droits étaient méconnus par les dispositions qui ne prévoyaient pas de délai imparti au juge d’instruction pour répondre à une demande de permis de visite d’un membre de la famille de la personne placée en détention provisoire. Le Conseil a estimé, en effet, que cette absence de délai déterminé imparti au juge d’instruction pour statuer n’ouvrait, en pratique, aucune voie de recours en l’absence de réponse du juge (§ 16).
Dans la décision n° 2016-580 QPC du 5 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité du droit au respect de la vie privée de l’article L. 522-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 novembre 2004. En vertu de ce dispositif, en cas d’« urgence absolue » l’expulsion d’un étranger du territoire français peut être prononcée sans qu’il ne soit entendu par une commission composée de trois juges. Le Conseil a rejeté le moyen tiré de la violation du droit au respect de la vie privée soulevé par les requérants. Il a considéré que le législateur avait opéré une conciliation qui n’était pas manifestement déséquilibrée entre, notamment, le droit au respect de la vie privée et la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions13. À l’appui de cette analyse, il a souligné, d’une part, que l’existence de cette « réserve d’urgence » répondait « à la nécessité de pouvoir, en cas de menace immédiate, éloigner du territoire national un étranger au nom d’exigences impérieuses de l’ordre public » (§ 9). D’autre part, il a relevé que la disposition ne privait pas la personne visée par la mesure d’expulsion d’exercer un recours devant le juge administratif dans le cadre d’un référé suspension (§ 10). Enfin, il a estimé qu’il appartenait au juge administratif de veiller, en cas de contestation de la décision concernant le pays de renvoi, de veiller au respect de l’interdiction de renvoyer un étranger « à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » (§ 11).
C’est également à la lumière du droit au respect de la vie privée que le Conseil constitutionnel a examiné l’article L. 811-5 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 201514. Les dispositions contestées permettaient aux pouvoirs publics de prendre des mesures de surveillance et de contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne en cas de risque d’atteinte à des intérêts nationaux. Selon les requérants, en s’abstenant de définir les conditions de collecte, d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements recueillis et de prévoir un contrôle de ces mesures, la loi portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel a accueilli le moyen en relevant, tout d’abord, que rien ne permettait d’exclure que ces dispositions contestées, destinées à mettre en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, soient utilisées « à des fins plus larges que la seule mise en œuvre de ces exigences » (§ 7). Ensuite, il a constaté que ces dispositions ne précisaient pas la nature des mesures susceptibles d’être prises par les pouvoirs publics, qu’elles ne les soumettaient à aucune règle de fond ou de procédure et enfin qu’aucune garantie n’encadrait leur mise en œuvre. Il en a déduit que l’article L. 811-5 du Code de la sécurité intérieur, compte tenu de son atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances, était contraire à l’article 2 de la Déclaration de 1789 (§ 9).
La décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016 a permis au Conseil, quant à elle, d’apprécier la constitutionnalité d’une disposition du Code général des impôts relative au recensement des trusts (institution juridique résultant de la décision d’une personne de confier des biens à un tiers qui les contrôle dans l’intérêt d’un bénéficiaire15) en la confrontant au droit à la vie privée. Selon le requérant, l’article 1649 AB de ce code, en instituant un registre public des trusts recensant « les trusts déclarés, le nom de l’administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust », méconnaissait l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. En réponse à ce moyen, le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé son considérant de principe qu’il applique depuis la décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, selon lequel « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ». À la lumière de celui-ci, il a considéré que le dispositif contesté portait au droit au respect de la vie privée une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Selon le Conseil, la volonté du législateur de favoriser la transparence sur les trusts traduisait bien la poursuite de l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (§ 5). Néanmoins, il a jugé que le législateur n’avait pas suffisamment proportionné son atteinte au droit au respect de la vie privée (matérialisée par les informations fournies sur la façon dont une personne entend disposer de son patrimoine) en ne précisant pas « la qualité ni les motifs justifiant la consultation du registre » et en ne limitant pas « le cercle des personnes ayant accès aux données de ce registre » (§ 6).
Depuis la décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982, le Conseil constitutionnel attribue une valeur constitutionnelle au principe de responsabilité pour faute, qui découle de la liberté reconnue à l’article 4 de la Déclaration de 178916. La décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016 lui a donné l’occasion de préciser la portée de ce principe. Était en cause, en l’espèce, une disposition d’un décret du 24 février 1957 dans sa rédaction résultant de la loi du pays du 19 juillet 2010 relative à la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer. L’article 34 de ce décret limitait la réparation de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur au seul versement d’une indemnité forfaitaire majorée. Selon le requérant, cette disposition, en faisant obstacle à la possibilité pour la victime d’obtenir la réparation de l’ensemble des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur, portait atteinte au principe de responsabilité. Dans le prolongement des décisions n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 et n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré que le système de réparation forfaitaire ne portait pas une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité compte tenu de l’objectif d’intérêt général poursuivi, à savoir la garantie de l’automaticité, de la rapidité et de la sécurité de la réparation des accidents du travail dus à une faute inexcusable de l’employeur (cons. 9). Le Conseil a néanmoins émis une réserve d’interprétation en estimant que le respect du droit des victimes d’actes fautifs excluait que les dispositions contestées puissent faire obstacle à « ce que ces mêmes personnes puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957 » (cons. 9).
c – Liberté d’expression/liberté de conscience
Dans le cadre de deux saisines récentes, le Conseil constitutionnel rappelé l’importance qu’il accorde à la liberté d’expression, reconnue par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. L’occasion lui en a été donnée, tout d’abord, par la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse1718. En vertu de ce dispositif, les propos négationnistes à l’égard des crimes contre l’humanité tenus par des membres d’une organisation déclarée criminelle par le tribunal militaire international, de même que ceux tenus par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Suivant une jurisprudence bien établie, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de proportionnalité des atteintes portée par ces dispositions à l’article 11 de la Déclaration de 178919. La liberté d’expression étant une « condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés », il a rappelé que les atteintes devaient être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi par le législateur (cons. 5). En l’espèce, le Conseil a rejeté le moyen tiré de la violation de cette liberté en soulignant, en particulier, « que seule la négation, implicite ou explicite, ou la minoration outrancière de ces crimes [était] prohibée ». Or « les dispositions contestées n’[avaient] ni pour objet ni pour effet d’interdire les débats historiques » (cons. 8). La disposition a donc été déclarée conforme à la constitution.
En dépit de la protection renforcée dont elle bénéficie, la liberté d’expression n’est pas sans limite. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016, elle doit être conciliée avec d’autres impératifs constitutionnels. En l’espèce, était en cause, notamment, une disposition relative à la protection du secret des sources des journalistes insérée dans la loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias du 14 novembre 2016. La disposition litigieuse modifiait le dispositif actuel de protection des sources en complétant le régime de l’immunité pénale applicable aux journalistes et en étendant son application « à toute personne exerçant des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction dans ces mêmes entreprises ou agences ainsi qu’à tout collaborateur de la rédaction » (§ 21). Ce renforcement du régime de protection des sources a été jugé contraire à la constitution. Le Conseil constitutionnel a estimé, en effet, que le législateur n’avait pas assuré une conciliation équilibrée entre la liberté d’expression et de communication et d’autres exigences de valeur constitutionnelle à savoir, d’une part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances, d’autre part, « les exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d’infractions et la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle » (§ 23). Compte tenu de la censure de cette disposition, c’est l’actuel régime de protection du secret des sources des journalistes, prévu par la loi du 4 janvier 2010, qui continue à s’appliquer.
d – Liberté d’entreprendre, liberté contractuelle
En vertu de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Parmi les libertés protégées par cet article figurent la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle. La liberté d’entreprendre a été la première des libertés à être expressément rattachée à cet article20. C’est au visa de celui-ci que le Conseil a contrôlé la constitutionnalité, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, de l’article L. 3121-10 du Code des transports dans sa rédaction issue de la loi du 1er octobre 201421. En vertu de cet article, l’exercice de l’activité de conducteur de taxi est incompatible avec l’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Selon le requérant, cette interdiction de cumul d’activités était contraire à la liberté d’entreprendre. La jurisprudence du Conseil constitutionnel témoigne du renforcement progressif de la protection accordée de cette liberté. Depuis la décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001, il considère que les restrictions apportées à cette liberté doivent être justifiées par une exigence constitutionnelle ou un motif d’intérêt général. En l’espèce, le Conseil a relevé que le législateur avait entendu « lutter contre la fraude à l’activité de taxi, notamment dans le secteur du transport de malades et (…) assurer la pleine exploitation des autorisations de stationnement sur la voie publique ». Néanmoins, il a estimé que le régime d’incompatibilité introduit portait à une atteinte à la liberté d’entreprendre qui n’était justifiée ni par les objectifs poursuivis, ni par un autre motif d’intérêt général. À l’appui de cette analyse, il a souligné, notamment, que l’activité de conducteur de taxi et celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur étaient exercées au moyen de véhicules comportant des signes suffisamment distinctifs et que, en outre, seuls les véhicules sanitaires légers et les taxis pouvaient être conventionnés avec les régimes obligatoires d’assurance maladie pour assurer le transport des malades. La disposition a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel.
L’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, en ce qu’il protège la liberté d’entreprendre, a également servi de norme de référence pour le contrôle de plusieurs dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 201622. Le Conseil a considéré, en particulier, que l’interdiction de la publicité à l’intérieur des débits de tabac, compte tenu de son caractère proportionné au regard de l’objectif de protection de la santé, portait une atteinte qui n’était pas manifestement disproportionnée à cette liberté. Il a souligné que la mesure n’interdisait « ni la production, ni la distribution, ni la vente du tabac ou des produits du tabac » et que les débits de tabac conservaient la faculté de vendre d’autres produits (cons. 11). Suivant un raisonnement comparable, il a considéré que la mesure relative au « paquet neutre », compte tenu du fait qu’il était établi que le tabac nuit à la santé, portait une atteinte non manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif poursuivi de protection de la santé (cons. 21). C’est cette même absence de disproportion manifeste dans l’atteinte portée à cette liberté qui a justifié le refus de censurer de la mesure imposant aux entreprises de rendre publics sur internet l’objet précis, la date, le bénéficiaire direct, le bénéficiaire final et le montant des conventions conclues avec les acteurs du secteur de la santé (cons. 87). S’agissant de la disposition relative au tiers payant, permettant de dispenser d’avance de frais les bénéficiaires de l’assurance maladie qui reçoivent des soins de ville, le Conseil a jugé qu’elle ne portait aucune atteinte à la liberté d’entreprendre des professionnels de santé (cons. 49). Il a en jugé de même pour le mécanisme de contrôle, par les agences régionales de santé, de l’absence de surcompensation financière accordée aux établissements de santé pour leurs charges de service public (cons. 74).
À l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 30 mai 2008, le Conseil a examiné la conformité à la constitution de l’accès dérogatoire à la profession d’avocat ouvert à des personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités23. Contrairement à l’opinion du requérant, qui estimait que cette disposition portait atteinte à la liberté d’entreprendre, les juges de la rue de Montpensier ont considéré que la loi n’opérait pas une conciliation manifestement déséquilibrée entre le respect de cette liberté et le respect des droits de la défense garantis par l’article 16 de la constitution. Ils ont relevé, d’une part, qu’en posant comme condition d’accès à la profession d’avocat l’exercice d’une activité à caractère juridique pendant une durée suffisante sur le territoire national, le législateur entendait garantir un niveau de maîtrise suffisante du droit français. D’autre part, ils ont considéré que ce régime dérogatoire ne privait pas les personnes ne remplissant pas les conditions du droit d’accéder à la profession d’avocat dans les conditions du droit commun. La disposition a donc été déclarée conforme à la constitution (cons. 11).
Dans la décision n° 2015-511 QPC du 7 janvier 2016, c’est à la lumière du principe de liberté contractuelle que le Conseil constitutionnel a apprécié la constitutionnalité d’une disposition contenue dans l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques. La disposition contestée attribuait à une commission spécialisée composée d’éditeurs la faculté de résilier tout contrat conclu entre une société de messagerie de presse (chargée de la distribution de la presse écrite) et un dépositaire central de presse (chargé de la distribution de la presse à l’ensemble des diffuseurs) en retirant l’agrément du dépositaire ou en modifiant sa zone de chalandise. Cette commission, précisait la disposition, « est tenue de se prononcer selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges ». Depuis que le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle24, il a progressivement étendu son contrôle et considère désormais que les limitations apportées par le législateur à cette liberté doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un intérêt général, « à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi »25. En application de ce considérant de principe, le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé « qu’il était loisible au législateur de prévoir les conditions dans lesquelles un organisme indépendant composé d’éditeurs, tiers au contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse, peut prendre des décisions aboutissant à la résiliation de ce contrat, afin de mettre en œuvre l’objectif de pluralisme et d’indépendance des quotidiens d’information politique et générale » (cons. 9). Il a considéré, cependant, qu’en ne soumettant les décisions de retrait d’agrément à aucune condition tenant à l’exécution ou à l’équilibre du contrat et à aucune procédure d’examen contradictoire, la loi avait « insuffisamment encadré les conditions dans lesquelles la décision d’un tiers au contrat (…) peut conduire à la résiliation de ce contrat » (cons. 10). Par conséquent, la disposition a été déclarée partiellement contraire à la constitution.
BLC
B – Le droit de propriété
Le Conseil fait usage de la règle désormais établie selon laquelle en l’absence de privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la DDHC de 1789, le contrôle de constitutionnalité porte, aux termes de l’article 2 de la DDHC, sur les atteintes aux conditions d’exercice de ce droit. Faute d’être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi, elles encourent la censure. Si aucune des questions de constitutionnalité afférant au droit de propriété n’a abouti, courant de l’année 2016, à la reconnaissance d’une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la DDHC, le Conseil a néanmoins relevé des cas de limitation de l’exercice du droit de propriété, toutefois justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Ainsi en va-t-il, dans la décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016 des servitudes nées de la déclaration d’utilité publique relative à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité qui confère au concessionnaire le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes26. Elles seraient toutefois assimilables à une privation de propriété si l’ampleur des conséquences qui s’y attachent, sur une jouissance normale de propriété grevée, venait à vider le droit de propriété de son contenu, comme le précise le Conseil dans une réserve d’interprétation. Dans le cas contraire, les servitudes instituées restent attachées à la poursuite d’un but d’intérêt général en facilitant la réalisation des infrastructures de transport et de distribution de l’électricité. Par ailleurs, les limites apportées à l’exercice du droit de propriété sont effectivement proportionnées à l’objectif poursuivi compte tenu des garanties qui les entourent : l’établissement de la servitude est subordonnée à une déclaration d’utilité publique et ouvre droit à une indemnité en cas de préjudice direct, matériel et certain ; la servitude ne peut grever que des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; elle ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir, lequel conserve la possibilité d’opérer toutes modifications de sa propriété conformes à son utilisation normale.
Dans la décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016, le Conseil a également considéré, à propos de la servitude qui interdit ou limite l’usage en période hivernale des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive non desservis par des voies et réseaux, qu’elle crée non pas une privation de propriété mais une limitation à l’exercice du droit de propriété sans qu’elle ne soit disproportionnée à l’objectif d’intérêt général de garantie de la sécurité des personnes.
Le champ d’application de la servitude est, tout d’abord, circonscrit. Seuls sont concernés les chalets d’alpage et bâtiments d’estive conçus à usage saisonnier non desservis par des voies et réseaux ou desservis par des voies et réseaux non utilisables en période hivernale. La servitude ne peut être instituée qu’à l’occasion de la réalisation de travaux exigeant un permis de construire ou une déclaration de travaux. Son application est limitée à la période hivernale.
Le champ d’application de la servitude est, ensuite, encadré. La décision de l’établir est placée sous le contrôle du juge administratif, le propriétaire du bien objet de la servitude ayant la faculté, à tout moment, d’en demander l’abrogation à l’autorité administrative. L’ensemble de ces garanties ne permet pas de retenir de grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la DDHC.
Tel est également le cas en ce qui concerne les dispositions du Code civil (second alinéa de l’article 792) qui prévoient l’extinction des créances non déclarées dans un délai de 15 jours alors qu’elles devraient l’être, lorsqu’un héritier accepte la succession à concurrence de l’actif net. C’est ce que précise le Conseil dans la décision nos 2016-574/575/576/577/578 QPC du 5 octobre 2016. L’objectif d’intérêt général poursuivi est de faciliter la transmission des patrimoines en prévoyant des garanties suffisantes pour qu’il ne soit pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de propriété. Cette exigence est, en l’espèce, remplie : le délai de 15 jours dont disposent les créanciers pour déclarer leurs créances ne court qu’à compter de la publicité nationale de la déclaration d’acceptation de la succession, sachant que les créances assorties d’une sûreté réelle échappent à l’extinction et que le délai n’est pas opposable aux créanciers dans l’hypothèse où l’héritier qui a omis sciemment de signaler l’existence d’une créance au passif de la succession se trouve déchu de l’acceptation à concurrence de l’actif net.
Le Conseil tient un raisonnement analogique dans la décision n° 2016-581 QPC du 5 octobre 2016 à propos de l’obligation de relogement des occupants d’immeubles affectés par une opération d’aménagement. Aucune privation du droit de propriété n’est relevée pas plus que d’atteinte disproportionnée à son exercice au regard des garanties qui entourent l’obligation de relogement laquelle répond à l’objectif de protection des occupants évincés et de compensation de la perte définitive de leur habitation du fait de l’action de la puissance publique.
Dans la décision nos 2016-583/584/585/586 QPC, relativement aux saisies spéciales des biens ou droits mobiliers incorporels, le Conseil décide également d’une conformité aux exigences qui découlent des articles 2 et 17 de la DDHC des dispositions de l’article 706-153 du Code de procédure pénale qui en déterminent les règles de procédure, les juges compétents pour autoriser ou ordonner la saisie, les modalités de mise à disposition du dossier de la procédure et les voies de recours devant la chambre de l’instruction. Plus particulièrement, le Conseil précise que l’absence d’un délai déterminé imposé à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel de l’ordonnance autorisant ou prononçant la saisie ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété27, là où pourtant, et en principe, le juge doit toujours statuer dans un délai raisonnable. Même s’il est possible de considérer pour justifier l’absence d’atteinte que la saisie intervient à la suite d’une décision rendue par un magistrat laquelle pouvant elle-même faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction, le dispositif reste toutefois discutable, selon nous, au regard des exigences qui entourent le droit à un recours effectif parmi lesquelles se trouve celle d’un délai déterminé à statuer.
LB
(À suivre)
C – Le principe d’égalité
1 – Principe d’égalité devant la loi
2 – Principe d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques – droits et libertés en matière fiscale
D – Les droits sociaux
E – Les principes du droit répressif
1 – Cumul de sanctions et principe non bis in idem
2 – Principe de légalité des délits et des peines
3 – Principe de proportionnalité des peines
4 – Principe de la présomption d’innocence
F – Les droits processuels
1 – Le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, l’égalité devant la justice et le principe d’impartialité et d’indépendance des juridictions
2 – Le principe de sécurité juridique
Notes de bas de pages
-
1.
CSP, art. L. 2212-5.
-
2.
Cons. const., 18 nov. 2016, n° 2016-595 DC, Sté Aprochim et a.
-
3.
Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-461 DC, Loi d’orientation et de programmation pour la justice.
-
4.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-535 QPC.
-
5.
Cons. const., 23 sept. 2016, n° 567/568 QPC, § 8.
-
6.
V. supra la rubrique II. D. « L’autorité et les effets des décisions du Conseil constitutionnel ».
-
7.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC, cons. 14.
-
8.
Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, cons. 11.
-
9.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC, cons. 12.
-
10.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC.
-
11.
Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-71 QPC.
-
12.
Cons. const., 21 janv. 2016, n° 2015-727 DC.
-
13.
V. infra la rubrique III. B. « Les droits processuels ».
-
14.
Cons. const., 21 oct. 2016, n° 2016-590 QPC.
-
15.
Assemblée nationale, Rapport de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011, 1er juin 2011, M. Gilles Carrez, spéc. p. 55-56.
-
16.
Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, cons. 39.
-
17.
Cons. const., 8 janv. 2016, n° 2015-512 QPC.
-
18.
V. supra la rubrique II. A. « Les acteurs et les actes devant le Conseil constitutionnel » et infra la rubrique III. B. « Les droits et libertés ».
-
19.
Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC.
-
20.
Cons. const., 16 janv. 1982, n° 81-132 DC, cons. 16.
-
21.
Cons. const., 15 janv. 2016, n° 2015-516 QPC, aff. Uber III.
-
22.
Cons. const., 21 janv. 2016, n° 2015-727 DC.
-
23.
Cons. const., 23 mars 2016, n° 2015-529 QPC.
-
24.
Cons. const., 10 juin 1998, n° 98-401 DC.
-
25.
Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC.
-
26.
C. énergie, art. L. 323-4, 3°.
-
27.
V., a contrario, sur la question de l’absence de délai selon des situations différentes, Cons. const., 16 oct. 2015, n° 2015-494 QPC et Cons. const., 24 mai 2016, n° 2016-543 QPC.