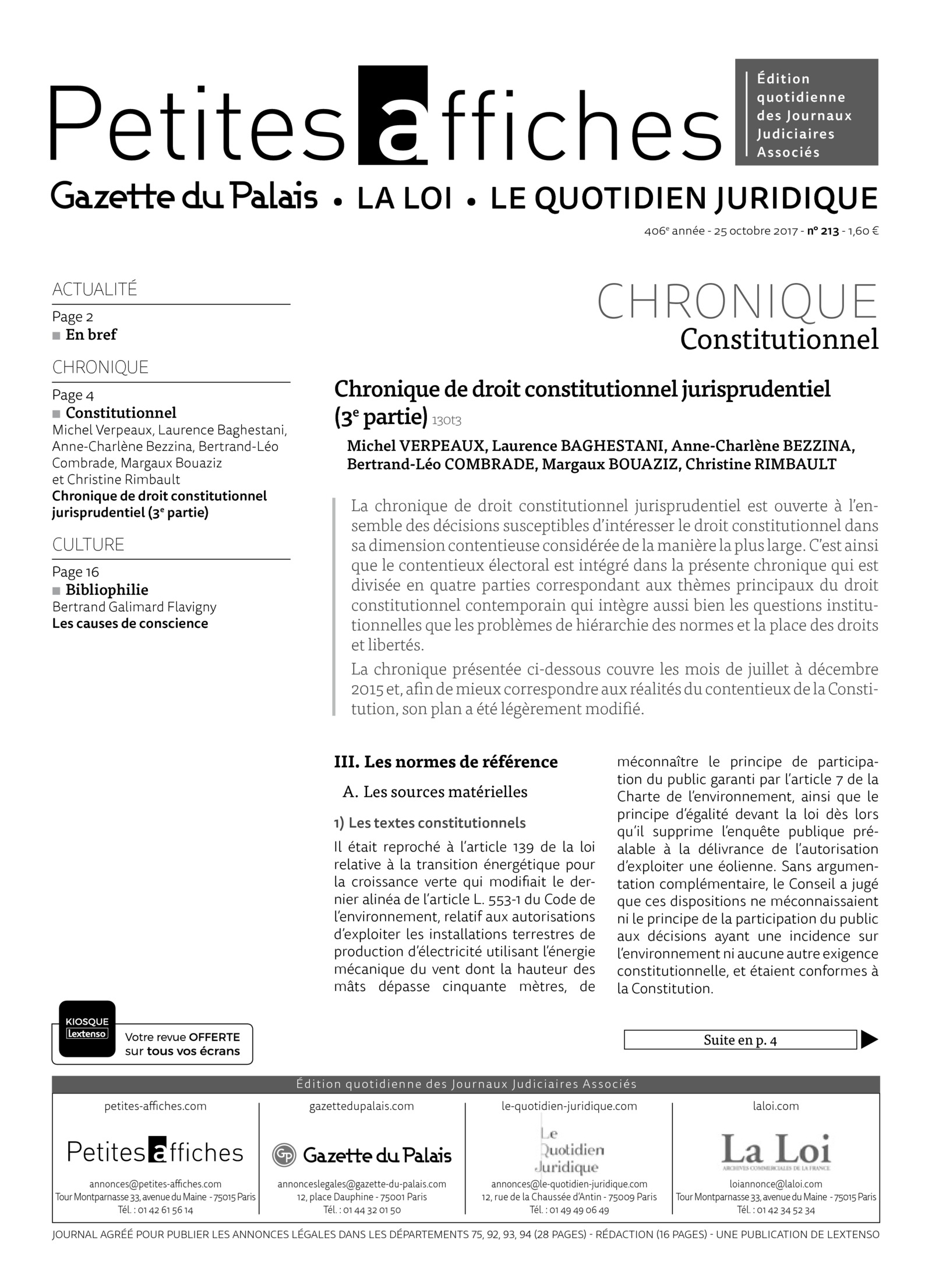Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (3e partie)
La chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel est ouverte à l’ensemble des décisions susceptibles d’intéresser le droit constitutionnel dans sa dimension contentieuse considérée de la manière la plus large. C’est ainsi que le contentieux électoral est intégré dans la présente chronique qui est divisée en quatre parties correspondant aux thèmes principaux du droit constitutionnel contemporain qui intègre aussi bien les questions institutionnelles que les problèmes de hiérarchie des normes et la place des droits et libertés.
La chronique présentée ci-dessous couvre les mois de juillet à décembre 2015 et, afin de mieux correspondre aux réalités du contentieux de la Constitution, son plan a été légèrement modifié.
I – Les institutions constitutionnelles
A – Les pouvoirs politiques : le pouvoir exécutif
B – Les pouvoirs politiques : le Parlement et la procédure législative
1 – Les validations législatives (…)
2 – Le contrôle de la procédure législative
3 – Le principe de séparation des pouvoirs en faveur du Parlement
4 – La compétence et le domaine de la loi
a – Le recours aux travaux préparatoires de la loi
b – L’incompétence négative
c – La répartition des compétences normatives entre la loi et le règlement
C – Le pouvoir juridictionnel (…)
D – Le pouvoir financier
E – Les collectivités territoriales
F – Droits électoraux, contentieux des élections et des référendums
II – Le procès constitutionnel
A – Les acteurs et les actes devant le Conseil constitutionnel
B – La procédure devant le Conseil constitutionnel
C – Les techniques contentieuses
D – L’autorité et les effets des décisions du Conseil constitutionnel
III – Les normes de référence
A – Les sources matérielles
1 – Les textes constitutionnels
Il était reproché à l’article 139 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui modifiait le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du Code de l’environnement, relatif aux autorisations d’exploiter les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres, de méconnaître le principe de participation du public garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement, ainsi que le principe d’égalité devant la loi dès lors qu’il supprime l’enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation d’exploiter une éolienne. Sans argumentation complémentaire, le Conseil a jugé que ces dispositions ne méconnaissaient ni le principe de la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement ni aucune autre exigence constitutionnelle, et étaient conformes à la Constitution1.
Parce que le préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés et que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle, il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d’exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne2. Le législateur doit alors fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues, ces dernières devant bénéficier des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention. Il doit ainsi assurer la conciliation entre, d’une part, l’exercice de ces droits et libertés que la Constitution garantit et, d’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ainsi que les finalités qui sont assignées à l’exécution des peines privatives de liberté.
Cette compétence du législateur peut ne pas être neutre car, comme le rappelle de manière un peu « orientée » le Conseil constitutionnel, il lui est loisible de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits (cons. 11). Il faut rappeler que le Conseil avait été déjà été saisi de cette question très sensible du travail des personnes détenues qui avait mobilisé l’opinion3.
MV
2 – Les rapports de systèmes
Dans le cadre de la décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015 LFR pour 2015, le Conseil constitutionnel a précisé sa jurisprudence relative au contrôle des lois de transposition des directives. Était en question la constitutionnalité de l’article 29 de la loi relative au régime fiscal des sociétés-mères qui transpose la « clause anti-abus » prévue par la directive du 30 novembre 2011 modifiée par celle du 27 janvier 2015. Le grief principal des requérants consistait à pointer l’existence d’une précédente décision du Conseil rendue sur l’article L 64 du LPF et qui déclarait inconstitutionnelle sa rédaction élargie par la loi de 2013 ; c’est précisément cette rédaction censurée qui a été reprise par la loi déférée en parfaite transposition de la directive. Il revenait donc au Conseil de déterminer la marge de manœuvre qui était la sienne au regard de la transposition.
Cette réponse ne pouvait se faire qu’en deux temps au vu de l’objet élargi de la loi qui avait institué le dispositif « anti-abus » dans le régime fiscal des sociétés-mères, tant pour les échanges entre mère et fille dans le champ d’application des échanges transfrontaliers entre États membres de l’Union européenne, que hors de ce champ (à des mères-filles en France même ou dans le cadre de pays tiers à l’Union européenne), sans y être tenu par la directive. Le Conseil était donc mis en face d’une situation jurisprudentielle inédite qui questionnait son contrôle de constitutionnalité des lois de transposition de directives lorsque la loi de transposition élargit le bénéfice du dispositif à des situations juridiques non directement appelées par la directive. Il avait donc deux séries de dispositions à contrôler : celles qui transposaient directement et celles qui sortaient de ce champ.
Relevons à titre liminaire que cette situation dans laquelle le législateur choisit d’élargir le bénéfice d’un dispositif juridique qui résulte d’une situation européenne, consiste généralement à éviter que les situations nationales soient moins bien traitées créant ainsi une « discrimination à rebours ». Ces cas sont réguliers en droit fiscal en QPC et le Conseil aurait pu vérifier cette question en l’espèce ; ce qu’il n’a pas fait.
Concernant la première série de dispositions, le Conseil devait vérifier l’application de sa jurisprudence traditionnelle. Fixée depuis 20044, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, précisée en 20065 et rappelée en 20106 consiste à contrôler la constitutionnalité des lois de transposition des directives, en vertu de l’obligation de remplir ses obligations communautaires que l’article 88-1 de la Constitution imprime à l’État français. Deux conditions alternatives ouvrent dans ce cadre le contrôle de constitutionnalité de la loi qui sont tirées de la mise en cause de l’identité constitutionnelle de la France ou de l’erreur manifeste de transposition. En l’espèce, après avoir examiné si la loi était bien la conséquence directe d’une directive inconditionnelle et précise, ce qui était incontestablement le cas pour les échanges intra-communautaires, le Conseil a noté qu’alors que les dispositions ne mettaient pas en cause l’identité constitutionnelle de la France – quand bien même le grief tiré de l’autorité de chose jugée aurait pu prospérer – il ne lui appartenait pas de se prononcer.
Mais c’est la deuxième série de dispositions qui était problématique.
Les commentaires aux Cahiers développent l’ensemble des solutions offertes au juge, au nombre de deux : soit contrôler la constitutionnalité de la loi de transposition même dans ses dispositions ne relevant pas directement de la directive, soit distinguer entre ces dispositions, auxquelles il conviendrait d’appliquer un contrôle classique.
La première option était douteuse en ce qu’elle conduisait le Conseil à exercer un contrôle de constitutionnalité de la loi de transposition et donc à interpréter la directive – ce qui est l’apanage de la Cour de justice de l’Union – et donc à contrôler sa conventionalité. Si, au contraire, le contrôle avait été aussi limité que l’impose la jurisprudence de 2004, une immunité bien large aurait alors été accordée à la loi de transposition hors du champ de la directive, ce qui semblait parfaitement incohérent.
La seconde option a donc été choisie par le Conseil (cons. 8). Pourtant, sous les apparences de la clarté, cette solution interroge à plusieurs titres. L’immunité donnée aux dispositions de transposition directes de la directive contraste avec le contrôle opéré à l’égard de celles qui en élargissent le bénéfice et introduit donc une distinction du contrôle à l’intérieur d’une même législation. N’y a-t-il pas une discrimination créée par le Conseil dans le fait de contrôler mieux les dispositions de non-transposition intégrales ? Qu’adviendra-t-il en cas de non-conformité des dispositions d’élargissement de la transposition ? Le dispositif transposé sera-t-il indirectement remis en cause, devant quel juge ? Des questions émergeront sûrement encore mais des réponses aussi, on peut l’espérer…
ACB
B – Les droits et libertés
1 – Les libertés
a – Sécurité et libertés : décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, loi sur le renseignement
Cette loi et la décision n° 713 DC qui y est relative sont intervenues dans un contexte dans lequel les menaces sur la sécurité ont été exacerbées. Le Conseil constitutionnel n’a pas voulu courir le risque d’être accusé de faciliter la commission d’attentats et a préféré valider, pour l’essentiel, une loi dont il reste à démontrer qu’elle remplira sa fonction de prévention des risques nombreux et diffus, sans porter des atteintes inconciliables avec les libertés fondamentales que ces attentats ont précisément pour objectif de limiter, sinon d’interdire.
I. Des saisines originales
Pour la première fois depuis 1959, le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel d’une loi ordinaire, la loi n° 2015-912 sur le renseignement. Le président Hollande a été rejoint par une saisine du président du Sénat et par une autre, signée par plus de soixante députés. L’addition des saisines venues de divers auteurs n’a cependant aucune incidence sur la qualité de la décision. La diversité de ces derniers oblige néanmoins le Conseil à examiner un plus grand nombre de dispositions, si les saisines ne sont pas identiques, ce qui est le cas dans cette décision.
Ces saisines, qui constituent l’un des intérêts majeurs de la décision, n’obéissaient cependant pas aux mêmes objectifs, au moins sur le terrain politique. Celle émanant du président de la République avait pour but de faire vérifier par le Conseil constitutionnel que la loi était bien conforme à la Constitution, afin de faire taire les critiques qui avaient été adressées à ce texte avant et au cours de la discussion parlementaire et au nom de la mission que la Constitution lui a confié, fondée notamment sur l’article 5 de la Constitution. Contrairement aux saisines présidentielles relatives aux engagements internationaux, le président de la République a souhaité défendre un certain nombre d’articles de la loi qu’il supposait peut-être plus fragiles du point de vue constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s’est donc senti « obligé » d’examiner spécialement ces dispositions. Est-ce à dire que si la saisine présidentielle s’était contentée de transmettre la loi au Conseil constitutionnel en étant totalement dépourvue d’argumentation, ce dernier se serait refusé à prendre en compte cette première saisine présidentielle relative à une loi ? L’avenir, si d’autres saisines présidentielles venaient à être effectuées, pourra répondre à cette question.
La saisine du président du Sénat, quant à elle, se veut une saisine de précaution, évitant de critiquer une disposition en particulier. Les saisines antérieures du président du Sénat étaient, habituellement, des saisines blanches, c’est-à-dire non motivées7. Il est vrai qu’entre 2010 et 2015, est intervenue la décision n° 2011-630 DC du 26 mai 2011 (loi relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016), dont la doctrine a cru pouvoir tirer la conséquence que les saisines blanches, si elles n’étaient pas prohibées, comportaient le risque que le Conseil ne se livre pas à un examen approfondi de la loi8. Eu égard à la portée de ce texte, et aux nombreuses interrogations qu’il a suscitées et à la brièveté des délais laissés au Parlement pour l’examiner, le président du Sénat a estimé devoir le soumettre à l’examen du Conseil constitutionnel, afin d’être certain que le dispositif adopté répondra pleinement aux exigences en matière de protection des libertés, posées par la Constitution. Pour autant, même si la saisine n’est pas véritablement « blanche », le président du Sénat n’invoque aucun grief particulier, comme le fait remarquer le Conseil constitutionnel. Quant à la saisine des parlementaires, elle était nécessairement plus politique et située dans une perspective d’opposition à la loi même si la liste des signataires était composite. Mais, du fait de l’objet de ce texte présenté comme une réponse aux menaces sur la sécurité et du contexte français et international de l’année 2015 marqué par des attentats, la tonalité générale de la saisine est cependant plus interrogative que strictement critique et combative.
La décision n° 2015-713 DC est accompagnée par la décision n° 2015-714 DC du 23 juillet 2015, rendue à propos de la loi organique relative à la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement9. Au terme de la décision n° 713 DC, longue de 93 considérants, le Conseil constitutionnel n’a censuré que quelques dispositions, une seule l’étant d’office. Il s’est bien gardé de délivrer à l’ensemble du texte un quelconque brevet de constitutionnalité, permettant d’ouvrir la loi à d’éventuelles QPC. Le Conseil a rappelé quelles étaient les normes de référence applicables à l’examen de la loi relative au renseignement, avant d’examiner les différentes dispositions législatives contestées.
II. La multiplicité des normes constitutionnelles invocables
Le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2015-713 DC, a jugé nécessaire d’énumérer les normes de référence qu’il entendait utiliser dans sa décision et qui constituent le fondement de son raisonnement. Les normes invoquées par le président de la République étaient le droit au respect de la vie privée, la liberté de communication et le droit à un recours juridictionnel effectif, tandis que les parlementaires contestaient de manière générale la conformité de la loi à la Constitution, mais, en particulier, au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’expression.
Le Conseil constitutionnel a donc consacré les considérants 2 à 5 à un exposé de ces normes de référence. Il a, tout d’abord, rappelé le rôle du législateur, compétent au titre de l’article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, dans la conciliation des normes constitutionnelles de même valeur que sont, « d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis ; qu’au nombre de ces derniers figurent le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 » (cons. 2). Le rôle du législateur dans cette conciliation est affirmé de manière assez régulière par le Conseil10.
S’agissant du respect de la vie privée, le rattachement aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits est relativement ancien11. La vie privée est ainsi séparée, dans son fondement constitutionnel, de la « liberté individuelle » dont la consécration est expressément prévue à l’article 66 de la Constitution, au titre des compétences de l’autorité judiciaire. Ce dernier article est d’ailleurs mentionné expressément en tant que norme de référence distincte au considérant 4, sans que le Conseil n’en tire une conséquence particulière. Est également mentionné l’article 16 de la Déclaration des droits, dont le Conseil déduit depuis de nombreuses années le « droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire »12. Quant à la liberté de communication, le Conseil n’y fait pas autrement référence que dans le rappel des griefs invoqués par les députés requérants.
De manière moins fréquente, le Conseil mentionne les articles 5, 20 et 21 relatifs aux attributions respectives du président de la République et du Premier ministre, ce dernier étant notamment responsable de la Défense nationale. Il en déduit, de manière nouvelle et prétorienne, « que le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, au nombre desquels figurent l’indépendance de la nation et l’intégrité du territoire » (cons. 3). Cette notion des intérêts fondamentaux de la nation ne figure dans aucune disposition constitutionnelle expresse, mais elle se trouve consacrée à l’article 410-1 du Code pénal qui dispose que « Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel ». Cette disposition, qui ne dispose que d’une valeur législative, n’apparaît pas dans la décision 713 DC, mais seulement dans son commentaire et il faut alors comprendre que les missions du pouvoir exécutif, énoncées de manière large aux articles 5, 20 et 21, consistent à défendre ces intérêts considérés comme faisant partie de la Constitution. Quant au « secret défense », qui lui non plus n’est inscrit dans aucune disposition constitutionnelle expresse, le Conseil constitutionnel considère qu’il trouve son assise constitutionnelle via les intérêts fondamentaux de la nation que sont l’indépendance de la nation et l’intégrité du territoire13. Sans le secret défense, il faut en déduire que les missions du président de la République et du Premier ministre ne pourraient pas être exercées de manière adéquate et suffisante.
En dehors des normes de référence faisant l’objet de cet énoncé préliminaire aux considérants 2 à 5, le Conseil utilise d’autres normes de référence pour l’examen de la composition, qui était contestée, de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qualifiée d’autorité administrative indépendante par la loi du 24 juillet 2015. La composition de cette Commission était contestée par les parlementaires sur deux points. D’une part, ils estimaient qu’elle méconnaissait la séparation des pouvoirs, garantie par l’article 16 de la Déclaration des droits, parce que les parlementaires y étaient minoritaires. Il aurait été possible de soutenir, au rebours, que la séparation des pouvoirs aurait été davantage méconnue si les membres du Parlement avaient été majoritaires dans une instance administrative soumise à l’étroit contrôle du Premier ministre. Le Conseil, sans argumenter, répond que la présence des membres du Parlement, quel que soit leur nombre, n’est pas contraire à la séparation des pouvoirs puisqu’ils sont astreints « en vertu du troisième alinéa de l’article L. 832-5 du Code de la sécurité intérieure, au respect des secrets protégés aux articles 226-13 et 413-10 du Code pénal » (cons. 43). Quant à la présence d’un unique membre choisi eu égard à ses compétences en matière de communications électroniques, le Conseil a considéré que cette seule présence était sans incidence sur le respect du principe invoqué (cons. 42). Cette personne, quelles que soient ses qualités, n’aura vocation à représenter aucun « pouvoir ».
L’une des censures prononcées par le Conseil dans cette décision n° 2015-713 DC repose sur une autre disposition constitutionnelle, à l’occasion de la seule question soulevée d’office. L’inscription des crédits de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement au programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l’action du gouvernement», empiète, aux yeux du Conseil constitutionnel, sur le domaine exclusif d’intervention des lois de finances, et elle est contraire à la Constitution, ce que précise la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), à laquelle renvoie l’article 34 de la Constitution (cons. 45). La mention de l’article 34 de la Constitution démontre, s’il en est besoin, que le contrôle opéré est bien un contrôle de constitutionnalité et non un contrôle de la loi ordinaire par rapport à ladite loi organique.
III. Des inconstitutionnalités en nombre limité
C’est au regard de ces normes de référence entendues de manière globale que le Conseil passe en revue, dans cette décision n° 2015-713 DC très détaillée, les articles contestés ou ceux sur lesquels son attention a été attirée par les différents requérants. Trois questions principales sont ainsi mises en lumière.
A. L’incompétence négative du législateur
Ce grief (sur ce sujet, v. supra) est très souvent invoqué dans le cadre du contrôle a priori. Compte tenu de l’impact attendu de la loi sur le renseignement sur les libertés, il était assez logique que ce soient les députés qui défendent ainsi les prérogatives du Parlement qui pourraient être menacées par un renvoi jugé inconstitutionnel au pouvoir réglementaire. L’article 34, dans son alinéa 2, confie, en effet, à la loi la compétence pour « fixer les règles concernant (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Ce grief a été soulevé à trois reprises, mais avec un succès inégal pour les requérants. L’article L. 811-4 nouveau du Code de la sécurité intérieure renvoie à un décret en Conseil d’État la désignation des services, autres que les services spécialisés de renseignement, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques définies par la loi. C’est également un décret qui doit délimiter, pour chaque service, des finalités et des techniques qui peuvent donner lieu à autorisation. Le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur n’était « pas resté en deçà de la compétence que lui attribue l’article 34 de la Constitution » puisqu’il avait défini les techniques de recueil de renseignement qui peuvent être mises en œuvre par les services de renseignement et les finalités pour lesquelles elles peuvent l’être tout en confiant au pouvoir réglementaire le soin d’organiser ces services (cons. 15). Dans ce cas, le partage traditionnel entre la « mise en cause » réservée à la loi et la « mise en œuvre » qui relève du pouvoir réglementaire d’exécution de la loi, a bien été respecté.
De même, selon le Conseil constitutionnel, la loi a suffisamment défini les données de connexion pouvant faire l’objet d’un recueil par les autorités administratives afin de recueillir les informations ou documents relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace, parce que ces données de connexion ne peuvent pas porter sur le contenu des correspondances ou les informations consultées (cons. 53).
En revanche, s’agissant de la disposition du Code de la sécurité intérieure qui autorisait, aux seules fins de protection des intérêts fondamentaux de la nation, la surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger, le législateur n’a pas défini les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés et il n’a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés (cons. 78). Le Conseil a ainsi préféré censurer cette disposition particulièrement sensible sur le terrain de la compétence du législateur, ce qui pourra permettre à ce dernier d’intervenir de nouveau en précisant mieux ces conditions, plutôt que de statuer, au fond, sur le respect de la vie privée qu’implique cette surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger.
B. Les atteintes à la vie privée plus ou moins proportionnées
Compte tenu de l’objet de la loi, cette question devait se trouver au centre de la décision n° 2015-713 DC. Est, tout d’abord, conforme à la Constitution, l’article L. 821-1 qui prévoit que les techniques de recueil de renseignement sont mises en œuvre sur le territoire national par des agents individuellement désignés et habilités, sur autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cette compétence du Premier ministre de délivrer des autorisations de police administrative, fondée sur l’article 21 de la Constitution, ne méconnaît pas, en effet, le droit au respect de la vie privée, ni l’inviolabilité du domicile ni le secret des correspondances (cons. 19).
Le Conseil a examiné, ensuite, l’essentiel des dispositions soulevées par les différents requérants à la lumière du principe constitutionnel du respect de la vie privée. Le Conseil vérifie, dans ce cadre, si les atteintes au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances sont ou non disproportionnées : en-deçà de ce seuil, la disposition est jugée constitutionnelle, au-delà, il est conduit à prononcer une censure. Par conséquent, la procédure dérogatoire de délivrance de l’autorisation de mettre en œuvre des techniques de recueil de renseignement en cas d’urgence absolue, prévue à l’article L. 821-5 du Code de la sécurité intérieure, n’est pas contraire à la Constitution, parce qu’elle est réservée à des finalités qui sont relatives à la prévention d’atteintes particulièrement graves à l’ordre public, et parce qu’elle doit être motivée par le caractère d’urgence absolue du recours à la technique de recueil de renseignement (cons. 25). Il en est de même des articles L. 851-1 à L. 851-6 du CSI relatifs aux techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation qui ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée ou qui assurent une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre le respect de la vie privée des personnes et la prévention des atteintes à l’ordre public et celle des infractions (cons. 50 et s.), ou de l’article L. 853-1 du Code de la sécurité intérieure (cons. 68 et s.).
En revanche, l’article L. 821-6 qui institue une procédure dérogatoire d’installation, d’utilisation et d’exploitation des appareils ou dispositifs techniques de localisation en cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, a été jugé contraire à la Constitution parce que portant une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances (cons. 29). Le Conseil précise que, à la différence des autres procédures dérogatoires, celle de l’article L. 821-6 permet de déroger à la délivrance préalable d’une autorisation par le Premier ministre ou par l’un de ses collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale ainsi qu’à la délivrance d’un avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. C’est donc une lacune dans la procédure d’autorisation de l’opération envisagée qui justifie la censure dans ce cas.
C. La protection suffisante du droit à un recours effectif
L’article 16 de la Déclaration des droits garantit, selon le Conseil constitutionnel, ce droit, en même temps que le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire. La méconnaissance de ce droit était invoquée à propos des diverses modalités de saisine du Conseil d’État concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement, que ce soit par toute personne souhaitant vérifier qu’elle ne fait pas, ou n’a pas fait, l’objet d’une surveillance irrégulière, ou par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou encore par une juridiction administrative ou une autorité judiciaire saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une technique de recueil de renseignement. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions mettaient en œuvre le droit à un recours juridictionnel effectif mais il a prononcé néanmoins la censure des mots « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-1 du présent code » qui est relatif à la surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger (cons. 49).
La loi modifie aussi le Code de justice administrative pour attribuer au Conseil d’État la compétence en premier et dernier ressort des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État (art. L. 773-1 à L. 773-8). Ces dernières dispositions organisent et adaptent les procédures jugées par le Conseil d’État dans le respect du secret de la défense nationale, notamment quant aux exigences de la contradiction et elles pouvaient être considérées comme susceptibles de porter atteinte au droit à un procès équitable, dès lors qu’elles n’opèrent pas une juste conciliation entre le respect de la procédure contradictoire et celui du secret de la défense nationale. Cette méconnaissance serait particulièrement patente à propos de la possibilité accordée au juge de relever d’office tout moyen. Le Conseil constitutionnel a cependant jugé que cette conciliation n’était pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire et, d’autre part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, dont participe le secret de la défense nationale (cons. 86). De la même manière, il a validé les dispositions dérogatoires en matière de motivation des décisions du Conseil d’État, ce dernier pouvant ainsi se contenter d’indiquer au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement lorsqu’il considère qu’aucune illégalité n’entache la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement. Le droit à un procès équitable n’est pas méconnu dans la mesure où les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble des pièces, y compris celles relevant du secret de la défense nationale, en possession soit de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, soit des services spécialisés de renseignement ou des autres services administratifs. Le secret de la défense nationale couvre ainsi des entorses multiples au droit commun, mais il participe, comme le rappelle une nouvelle fois le Conseil constitutionnel, « des exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation » (cons. 82).
MV
La période récente, marquée par les attentats terroristes perpétrés sur le sol français contre le magazine Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 puis au Bataclan, dans des cafés du XIe arrondissement de Paris et au stade de France de Saint-Denis le 13 novembre de cette même année, a été particulièrement propice à l’adoption de lois visant à renforcer la sécurité de la population. Dans ce contexte difficile, il est revenu au Conseil constitutionnel la responsabilité de contrôler la constitutionnalité de la loi relative au renseignement, promulguée le 24 juillet 2015, ainsi que de dispositions de loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions.
Dans le cadre de ces contrôles, l’une de ses tâches a consisté à apprécier l’articulation opérée par le législateur entre l’impératif de sécurité et l’impératif de liberté. En effet, selon une jurisprudence constante, il vérifie que le législateur assure « la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis »14.
En application de ce considérant de principe, le Conseil constitutionnel a apprécié cette conciliation opérée par le législateur lors du contrôle de trois dispositions de loi relative au renseignement, dans la décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.
Le Conseil a d’abord rappelé que les techniques de renseignement prévues par ces trois dispositions étaient mises en œuvre dans « les conditions et avec les garanties rappelées au considérant 51 ». Selon ce considérant, ces techniques doivent être autorisées par le Premier ministre sur demande écrite et motivée du ministre de la Défense, du ministre de l’Intérieur ou des ministres chargés de l’Économie, du Budget ou des Douanes, après avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, laquelle constitue une autorité administrative indépendante. En outre, ces recueils de renseignements sont réalisés sous le contrôle de cette même commission et du Conseil d’État. Enfin, les opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces techniques de recueil ne peuvent être exécutées que par des agents qualifiés des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des Communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications.
Ensuite, pour chacune de ces dispositions, le Conseil a relevé les garanties complémentaires qu’elles prévoyaient dans le cadre de la mise en œuvre des techniques de renseignement. S’agissant des articles autorisant l’autorité administrative à procéder à des réquisitions de données techniques de connexion auprès d’opérateurs de communications électroniques et à recueillir en temps réel des informations sur les réseaux pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il a estimé que le législateur avait suffisamment défini les données de connexion en disposant que cette autorisation de recueil de renseignements portait exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices des services fournis et non sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées (cons. 55). Concernant les articles autorisant l’autorité administrative à utiliser une technique de localisation en temps réel ou un appareil permettant d’intercepter des paroles ou des correspondances sans le consentement de leur auteur, le Conseil constitutionnel a notamment rappelé que cette autorisation était délivrée pour une durée de 2 mois renouvelable, que les appareils utilisés dans le cadre de cette procédure faisaient l’objet d’une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et que les informations recueillies étaient détruites dans un délai maximal de 90 jours à compter de leur recueil (cons. 63).
Finalement, dans toutes ces hypothèses, en raison des garanties apportées par la loi, le Conseil en a conclu que le législateur avait assuré une conciliation qui n’était pas manifestement déséquilibrée entre le respect de la vie privée des personnes et la prévention des atteintes à l’ordre public et celle des infractions.
Le Conseil constitutionnel a également contrôlé la conciliation opérée par le législateur entre la prévention de l’ordre public et les droits et libertés garantis par la Constitution dans la décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 M. Cédric D., à l’occasion de l’examen de l’article 6 de la loi de prorogation de l’état d’urgence (dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015) fixant le régime juridique des assignations à résidence. Était plus précisément en cause le respect de la liberté d’aller et venir, que le Conseil rattache aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen15. Traditionnellement, il considère qu’« il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; parmi ces droits et libertés figure la liberté d’aller et de venir »16.
Dans la présente décision, après avoir rappelé que la Constitution n’excluait pas la « possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence », le Conseil a considéré que le législateur avait opéré une conciliation correcte entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect de la liberté d’aller et venir en estimant que les dispositions de l’article 6 ne portaient pas une atteinte disproportionnée à cette liberté (cons. 14). Il a néanmoins assorti son analyse de trois précisions. D’abord, il a souligné que ces assignations ne peuvent être prononcées que lorsque l’état d’urgence a été déclaré (cons. 11) et qu’elles doivent être « justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence » (cons. 12). Ensuite, il a rappelé que le juge administratif exerçait un contrôle de proportionnalité de ces mesures (idem). Enfin, il a indiqué que les assignations à résidence prennent fin au plus tard en même temps que prend fin l’état d’urgence et doivent être renouvelées dans l’hypothèse où ce régime serait prolongé (cons. 13).
b – Liberté individuelle, respect de la vie privée, principe de responsabilité
Sans qu’elle bénéficie d’un rattachement textuel explicite, la liberté individuelle fait partie, selon le Conseil constitutionnel, des droits et libertés garantis par la Constitution. Ce dernier a eu l’occasion de contrôler son respect dans la décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015 M. Amir F. En l’espèce, se posait la question de la constitutionnalité de dispositions du Code pénal ayant pour effet de permettre le recours à la garde à vue prolongée de 96 heures pour les infractions de blanchiment ou de recel du produit, des revenus, des choses provenant du délit d’escroquerie en bande organisée et pour les infractions d’association de malfaiteurs lorsqu’elles ont pour objet la préparation de ce même délit. Le Conseil s’est référé à la décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 M. Maurice L. et autre, dans laquelle il avait déjà jugé que le recours à la garde à vue prolongée de 96 heures pour une infraction comparable à celles concernées dans le cas d’espèce portait « à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi dès lors que ce délit n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes » (cons. 13). Raisonnant par l’analogie, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions en cause dans la décision n° 2015-508 QPC étaient également inconstitutionnelles (cons. 14). Toutefois, il s’est abstenu de se prononcer sur l’abrogation du dispositif au motif de l’adoption d’une loi le 17 août 2015 qui a mis fin à l’inconstitutionnalité constatée (idem).
Selon le Conseil constitutionnel la protection du droit au respect de la vie privée17, qui protège « la sphère d’intimité de chacun »18 a pour fondement l’article 2 de la Déclaration de 1789. À plusieurs reprises dans la période récente, le Conseil a apprécié la conformité de dispositions législatives à ce droit.
L’occasion lui en a été donnée dans le cadre de sa saisine sur la loi relative au renseignement19. Il s’est d’abord borné à relever que la procédure d’autorisation préalable par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour la mise en œuvre des techniques de renseignement, ne portait pas, en elle-même, atteinte au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile et au secret des correspondances (cons. 19).
En revanche, il a considéré que d’autres dispositions de cette loi portaient bien une atteinte au droit au respect de la vie privée. Ainsi qu’il le fait classiquement, il a apprécié si ces atteintes étaient manifestement disproportionnées en vérifiant si le législateur avait assuré « la conciliation entre le respect de la vie privée et d’autres exigences constitutionnelles »20. Le Conseil a alors jugé que la plupart des dispositions de la loi Renseignement ne portaient pas d’atteintes manifestement disproportionnées au droit au respect de la vie privée. C’est le cas de la procédure dérogatoire de délivrance de l’autorisation de mettre en œuvre des techniques de recueil de renseignements en cas d’urgence absolue, dont le Conseil a relevé qu’elle ne remettait pas en cause l’inviolabilité du domicile, qu’elle ne s’appliquait qu’en cas d’atteintes particulièrement graves à l’ordre public, qu’elle devait être motivée par un caractère d’urgence absolue et qu’elle n’excluait pas l’information sans délai de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (cons. 23 à 25). Le mécanisme de protection des parlementaires, des magistrats, des avocats et des journalistes contre le recueil de renseignements n’a pas non plus été jugé insuffisant au regard du droit au respect de la vie privée et ce, compte tenu de l’examen systématique de ces techniques de recueil par la Commission nationale de contrôle des techniques de recueil de renseignements, laquelle doit veiller à la proportionnalité des atteintes portées à la vie privée et à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats et ce, sous le contrôle du Conseil d’État (cons. 34 à 37). De la même façon, la disposition prévoyant la possibilité d’imposer aux opérateurs la mise en œuvre de traitements automatisés destinés à détecter une menace terroriste, a été jugée comme ne portant pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Le Conseil a justifié son analyse en relevant, notamment, que cette technique de renseignement n’était autorisée que pour une durée limitée (cons. 60). À l’inverse, le Conseil constitutionnel a considéré que la disposition instituant une procédure dérogatoire d’installation, d’utilisation et d’exploitation des appareils ou dispositifs techniques de localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet en cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement portait une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée. La censure a été motivée par le constat que, à l’inverse des autres procédures dérogatoires, cette disposition permettait de déroger à trois exigences prévues par la loi : d’une part, la délivrance préalable d’une autorisation par le Premier ministre ou par l’un de ses collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale ; d’autre part, la délivrance d’un avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; enfin l’absence d’obligation d’information préalable du Premier ministre et du ministre concerné (cons. 28 et 29).
La censure de certaines dispositions de la loi relative au renseignement a conduit à l’adoption d’une loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales qui a, à son tour, été soumise au Conseil constitutionnel21. Ce dernier s’est notamment prononcé sur la conformité au droit à la vie privée de quatre articles fixant les modalités de surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger et le contrôle exercé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il a considéré, en l’espèce, que les dispositions adoptées ne portaient pas d’atteintes manifestement disproportionnées au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances au motif, notamment, que le législateur avait précisément circonscrit les finalités pour lesquelles il était possible d’autoriser ces surveillances et qu’il n’avait pas retenu des critères en inadéquation avec l’objectif poursuivi par ces mesures de police administrative (cons. 10 à 15).
Le droit au respect de la vie privée est également susceptible d’être affecté dans les cas où le législateur méconnaît l’étendue de ses compétences, comme le montre la décision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015, relative à la constitutionnalité de dispositions du code de la sécurité intérieur modifiées par la loi relative au renseignement mais encore applicables au présent litige. Le Conseil constitutionnel a accepté d’examiner les griefs tirés de l’incompétence négative résultant de la définition insuffisante des données de connexion et des conditions de leur collecte ainsi que de l’absence de garanties de nature à protéger le secret professionnel des avocats et des journalistes. Dans les deux cas, en effet, la méconnaissance alléguée de la Constitution était susceptible de remettre en cause le droit au respect de la vie privée. Sur le fond, il a cependant considéré que le législateur avait épuisé sa compétence en établissant des garanties suffisantes permettant d’assurer le respect de ce droit (cons. 11 à 14).
Enfin, le Conseil constitutionnel a été saisi d’un moyen tiré de la violation du droit au respect de la vie privée dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur des dispositions du code civil prévoyant les conditions dans lesquelles une indemnité peut être octroyée, à titre exceptionnel, à l’époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé. Or, selon l’interprétation donnée de ces dispositions par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 avril 1990, cette indemnité n’était pas révisable (cons. 4). Dans sa décision n° 2015-488 QPC du 7 octobre 2015, le Conseil n’a pas accueilli le moyen soulevé par le requérant selon lequel l’impossibilité de réviser cette indemnité portait atteinte à la vie privée et au maintien d’une vie familiale normale en raison de la charge financière excessive que représentait le paiement de cette somme pour le débiteur dès lors que sa situation financière se détériore. Il s’est borné à considérer que l’absence de possibilité de réviser cette indemnité ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée (cons. 15).
Le principe de responsabilité, en vertu duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » (ancien article 1382 du Code civil), s’est vu attribuer une valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982 (cons. 3). Il considère, en outre, que ce principe compte parmi les droits et libertés invocables dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité22. Le Conseil a mobilisé le principe de responsabilité dans le cadre de la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, lors du contrôle d’une disposition du Code du travail introduisant un régime de solidarité de paiement entre un donneur d’ordres et la personne ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. En l’espèce, il a considéré que ce dispositif, parce qu’il ne portait que sur des sommes déterminées en fonction, notamment, de la valeur des travaux réalisés et de la rémunération en vigueur dans la profession, ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité (cons. 10).
c – Liberté d’expression / liberté de conscience (…)
d – Liberté d’entreprendre, liberté contractuelle
La liberté d’entreprendre, rattachée par le Conseil constitutionnel à l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, protège à la fois l’accès à une profession ou une activité économique et l’exercice de cette profession ou de cette activité23. Traditionnellement, le Conseil considère qu’« il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre (…) des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi »24.
Plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité récemment transmises au Conseil constitutionnel l’ont conduit à examiner les atteintes apportées par le législateur à cette liberté.
L’exercice de ce contrôle implique cependant, au préalable, que l’atteinte à la liberté d’entreprendre soit avérée. Tel n’était pas le cas, dans la décision n° 2015-487 QPC du 7 octobre 2015, des dispositions permettant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre d’un dirigeant de société en redressement ou liquidation judiciaire. Le Conseil a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance de cette liberté était inopérant puisque ces dispositions n’avaient en elles-mêmes « ni pour objet ni pour effet d’interdire au dirigeant de la personne morale d’exercer une activité économique ou de diriger une personne morale » (cons. 16). De la même manière, il a écarté les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre lors de sa saisine sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur un article du Code du travail énumérant les catégories d’établissements d’enseignement habilités à recevoir un versement de la part des employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage25. D’une part, le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions ne portaient pas atteinte au caractère propre de l’enseignement privé (cons. 11). D’autre part, il a relevé qu’elles n’avaient « pas pour effet, en elles-mêmes, d’empêcher de créer, de gérer ou de financer un établissement privé d’enseignement » (idem). En conséquence de quoi il a estimé que l’exclusion de la possibilité pour les établissements privés d’enseignement de percevoir certaines ressources publiques n’était pas de nature à porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Dans la décision n° 2015-720 DC du 13 août 2015 portant sur la loi relative au dialogue social et à l’emploi, le Conseil constitutionnel n’a pas non plus retenu d’atteinte à cette liberté. Il a considéré que la disposition permettant aux membres d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle d’accéder aux locaux des entreprises ne portait aucune atteinte à la liberté d’entreprendre et ce, au motif que cet accès est subordonné à l’autorisation de l’employeur (cons. 14). Enfin, le Conseil constitutionnel a également refusé d’accueillir le moyen tiré de la violation de la liberté d’entreprendre lors du contrôle de la loi de finances pour 2016, dans la décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015. Alors que les requérants estimaient que cette liberté était méconnue par l’article 121 de cette loi dans la mesure où il imposait aux sociétés de divulguer des informations stratégiques pouvant être transmises à des États étrangers sans que soit garanti le respect de la confidentialité de ces informations, le Conseil n’a décelé aucune inconstitutionnalité et ce, au motif que les informations en cause ne pouvaient être rendues publiques (cons. 33).
En revanche, dans la décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015, le Conseil a considéré que la liberté d’entreprendre était bien affectée par la peine complémentaire de fermeture d’un débit de boisson par jugement, lorsque le propriétaire ou le titulaire de la licence n’est pas l’auteur de l’infraction et n’est pas poursuivi. Néanmoins, il n’a pas retenu d’atteinte manifestement disproportionnée à cette liberté. Le Conseil a relevé, en effet, qu’en souhaitant prévenir et réprimer la violation de la réglementation relative aux débits de boissons, le législateur a poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle et que la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons conservait la possibilité de demander le relèvement de la peine complémentaire de fermeture du débit de boissons (cons. 13).
Le grief tiré de la violation de la liberté d’entreprendre a, en revanche, été accueilli en partie dans la décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015 relative à un article prévoyant la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires. En l’espèce, le Conseil a jugé que, si la disposition prévoyant la suspension de l’importation et de la mise sur le marché national des produits contenant du bisphénol A ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée à cette liberté (cons. 7), la suspension de la fabrication et de l’exportation de ces produits en France ou depuis la France, en revanche, apportait des restrictions à la liberté d’entreprendre qui n’étaient pas en lien avec l’objectif poursuivi (cons. 8). Dans la décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, c’est également en confrontant les dispositions en cause avec l’objectif poursuivi par le législateur que le Conseil constitutionnel a apprécié la conformité de dispositions relatives à l’information des salariés en cas de cession de leur société à la liberté d’entreprendre. Il a ainsi relevé que, compte tenu de l’encadrement établi par le législateur, l’obligation d’information pesant sur le cédant n’était pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi (cons. 9). À l’inverse, il a considéré que l’action en nullité de la cession prévue en cas de méconnaissance de l’obligation d’information portait une atteinte manifestement disproportionnée à cette liberté, et ce, « au regard de l’objet de l’obligation dont la méconnaissance est sanctionnée et des conséquences d’une nullité de la cession pour le cédant et le cessionnaire » (cons. 13).
Enfin, depuis la décision n° 2000-437 DC en date du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel déduit également de l’article 4 de la Déclaration de 1789 le principe de liberté contractuelle. En application de ce principe, il considère que « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant de l’article 4 de la Déclaration de 1789 ».
La saisine sur la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques l’a conduit à contrôler la conformité à la liberté contractuelle de l’article 31 de cette loi, relatif aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail26. Selon les députés requérants, l’obligation fixée par cet article de prévoir dans ces types de contrats une échéance commune, en n’assurant pas une individualisation de la relation contractuelle, méconnaissait le principe de liberté contractuelle et le droit au maintien des conventions légalement conclues. Le Conseil n’a pas accueilli ce moyen. Après avoir relevé que l’individualisation de la relation contractuelle n’était pas un droit protégé par le principe de liberté contractuelle, il a estimé, notamment, que la fixation d’une échéance commune traduisait la volonté du législateur d’« assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l’exploitant d’un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié », laquelle constitue un objectif d’intérêt général. Par conséquent, il n’a décelé « aucune atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle et aux conventions légalement conclues » (cons. 24).
BLC
2 – Le droit de propriété
3 – Le principe d’égalité
a – Principe d’égalité devant la loi
b – Principe d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques – droits et libertés en matière fiscale
c – Principe d’égal accès aux emplois publics (…)
4 – Les droits sociaux
5 – Les principes du droit répressif
a – Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines (art. 8 de la Déclaration des droits)
b – Principe de la présomption d’innocence (art. 9 de la Déclaration des droits).
6 – Les droits processuels
a – Le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, l’égalité devant la justice et le principe d’impartialité et d’indépendance des juridictions
b – Principe de sécurité juridique
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Cons. const., 13 août 2015, n° 2015-718 DC, cons. 46.
-
2.
Cons. const., 25 sept. 2015, n° 2015-485 QPC, cons. 4, M. Johnny M.
-
3.
Cons. const., 19 nov. 2009, n° 2009-593 DC, loi pénitentiaire, cons. 4 ; Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-320/321 QPC, M. Yacine T. et a., absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées ; Cons. const., 25 avr. 2014, n° 2014-393 QPC, M. Angelo R., organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires, cons. 5.
-
4.
Cons. const., 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, loi pour la confiance dans l’économie numérique.
-
5.
Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, loi relative au DADVSI.
-
6.
Cons. const., 12 mai 2010, n° 2010-605 DC, dite Jeux de hasards.
-
7.
Pour un dernier exemple en date, v. Cons. const., 7 oct. 2010, n° 2010-613 DC, loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
-
8.
V. Bezzina A.-C. et Verpeaux M., « Carton rouge pour les saisines blanches », JCP G 2011, p. 912.
-
9.
V. supra.
-
10.
V. Cons. const., 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, loi pour la sécurité intérieure, et dans le cadre de la QPC ; Cons. const., 29 nov. 2013, n° 2013-357 QPC, Sté Westgate Charters Ltd, cons. 5.
-
11.
V. Cons. const., 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, loi portant création d’une couverture maladie universelle, cons. 45 ; Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cons. 75 ; Cons. const., 25 févr. 2010, n° 2010-604 DC, loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, cons. 21.
-
12.
Cons. const., 9 avr. 1996, n° 96-373 DC, loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. 83.
-
13.
Cons. const., 10 nov. 2011, n° 2011-192 QPC, cons. 3, Mme Ekaterina B. et a., cons. 20 : « Le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la Charte de l'environnement, au nombre desquels figurent l'indépendance de la nation et l'intégrité du territoire ».
-
14.
Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-631 DC, loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, cons. 66.
-
15.
Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, cons. 2.
-
16.
Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-631 DC, loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, cons. 78.
-
17.
Cons. const., 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, loi portant création d'une couverture maladie universelle.
-
18.
Commentaire aux Cahiers de Cons. const., 7 oct. 2015, n° 2015-488 QPC, M. Jean-Pierre E., p. 14.
-
19.
Cons. const., 23 juill. 2015, n° 2015-713 DC.
-
20.
Cons. const., 17 janv. 2012, n° 2011-209 QPC, M. Jean-Claude G., cons. 3.
-
21.
Cons. const., 26 nov. 2015, n° 2015-722 DC, loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.
-
22.
Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC, Mme Vivianne L., cons. 7.
-
23.
Cons. const., 30 nov. 2012, n° 2012-285 QPC, M. Christian S., cons. 7.
-
24.
Cons. const., 16 janv. 2001, n° 2000-439 DC, loi relative à l’archéologie préventive, cons. 14.
-
25.
Cons. const., 21 oct. 2015, n° 2015-496 QPC, association Fondation pour l’École.
-
26.
Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC.