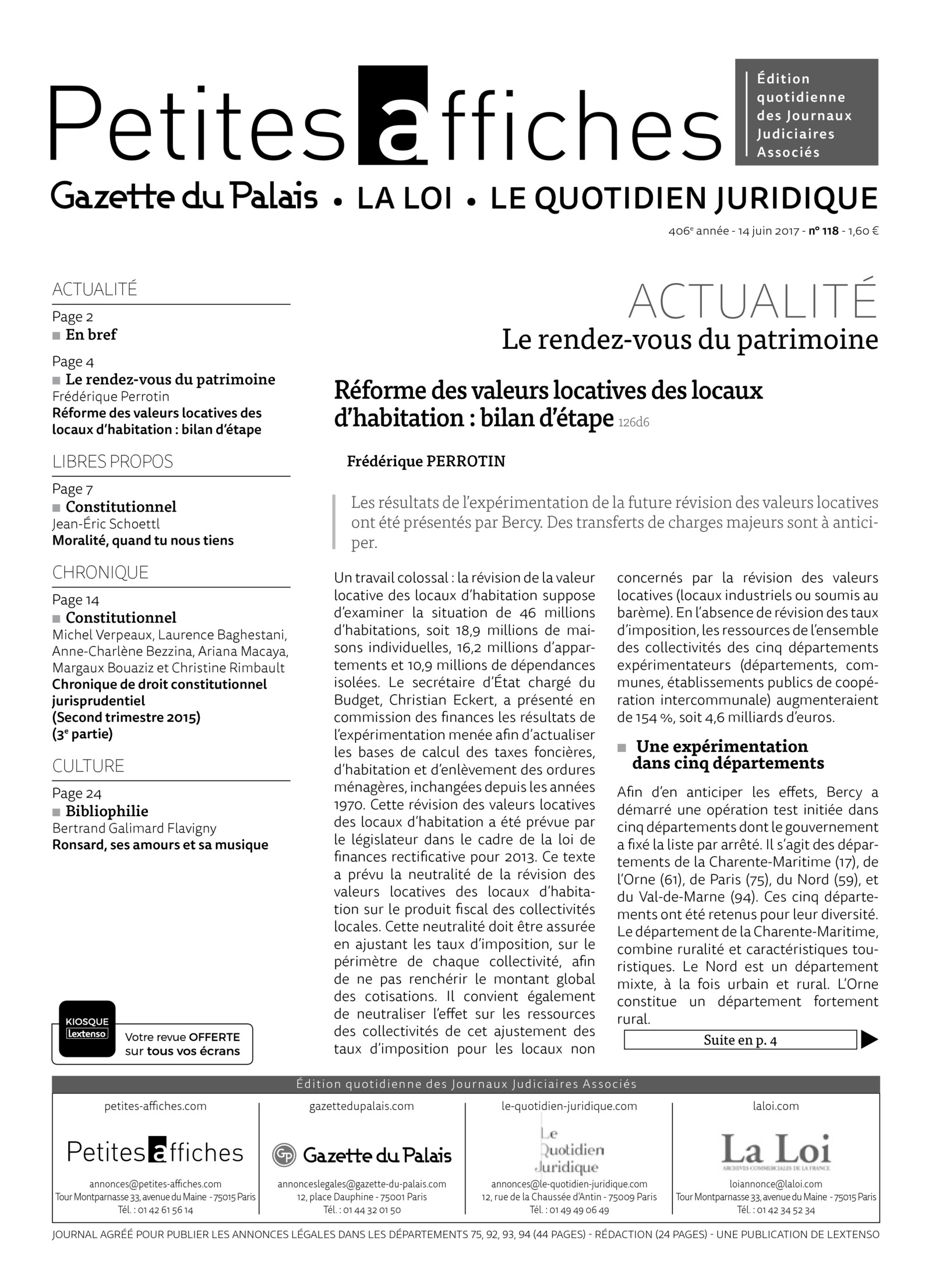Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (Second trimestre 2015) (3e partie)
La chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel est ouverte à l’ensemble des décisions susceptibles d’intéresser le droit constitutionnel dans sa dimension contentieuse considérée de la manière la plus large. C’est ainsi que le contentieux électoral est intégré dans la présente chronique qui est divisée en quatre parties correspondant aux thèmes principaux du droit constitutionnel contemporain qui intègre aussi bien les questions institutionnelles que les problèmes de hiérarchie des normes et la place des droits et libertés.
Afin d’être plus réactive, cette chronique sera désormais trimestrielle et celle présentée ci-dessous couvre les mois d’avril à juin 2015.
I – Les sources du droit constitutionnel et les normes de référence
A – Les normes de la Constitution
1 – La compétence du législateur
2 – Le contrôle du domaine de la loi et du règlement
3 – La Constitution numérotée
4 – La Déclaration de 1789
5 – Le Préambule de la Constitution de 1946
6 – Les PFRLR
7 – La Charte de l’environnement (…)
8 – Les objectifs de valeur constitutionnelle
B – Normes constitutionnelles non invocables dans le cadre de la QPC (…)
C – L’articulation entre le droit interne et les normes internationales et européennes (…)
II – Le procès constitutionnel
A – Les acteurs devant le Conseil constitutionnel (…)
B – La procédure devant le Conseil constitutionnel (…)
C – Les techniques contentieuses (…)
D – L’autorité et les effets des décisions du Conseil constitutionnel (…)
E – Les actes susceptibles de contrôle
III – Les institutions constitutionnelles
A – Les pouvoirs politiques : le pouvoir exécutif (…)
B – Les pouvoirs politiques : le Parlement et la procédure législative (…)
1 – Les validations législatives (…)
2 – Le contrôle de la procédure législative
C – Le pouvoir juridictionnel (…)
D – Le pouvoir financier (…)
E – Les collectivités décentralisées (…)
F – La régulation des élections et des référendums
IV – Les droits et libertés
A – Les libertés
Le Conseil constitutionnel et l’uberisation de la liberté d’entreprendre
Cons. const., 22 mai 2015, n° 2015-468/469/472 QPC, Société Uber France SAS et a. La décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 Société Uber France SAS, est une décision de son époque. Elle permet d’illustrer l’avancée des technologies, l’évolution des modes de vie et leur influence sur le droit. Chaque année, en suivant les mœurs, le dictionnaire s’enrichit de mots ; la jurisprudence aussi.
L’uberisation est partout. Par ce terme, on désigne l’économie du partage, la dérégulation des relations commerciales. On uberise pour passer hors des circuits traditionnels, en suivant une forme moderne de troc que la numérisation des échanges a induit. Que vous cherchiez un hôtel ou une tondeuse à gazon, un bref aperçu sur un moteur de recherche vous permettra de découvrir qu’un particulier peut vous offrir ce service, sans contrainte ni coût supplémentaire. Airbnb, eBay et autres noms de plates-formes communautaires enrichissent ainsi une nouvelle forme d’échange qui pourrait presque apparaître para-légale mais qui mérite assurément d’être encadrée par le droit.
Le Conseil constitutionnel a déjà eu plusieurs fois à se pencher sur la question, en particulier à travers la modernisation du service de transport de personne en voiture, qu’il s’agisse du co-voiturage ou encore des plateformes de réservation de véhicules particuliers à qui l’on doit le nom du mouvement lui-même puisqu’il s’agit d’Uber. C’est à un feuilleton de réactions en chaîne de la part d’un législateur perplexe que l’on doit ces nombreuses décisions du Conseil1. L’uberisation du marché du transport particulier des personnes n’a pas réellement conduit à une désorganisation du marché mais a mis en lumière sa profonde complexité2.
Après une première loi du 22 juillet 2009, la prolifération des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) avait conduit le jurislateur à se préoccuper de la protection de l’activité des taxis. C’est ce que tenta de faire le décret du 27 décembre 2013 qui fut successivement suspendu3, puis annulé4 par le juge administratif, démontrant déjà toute la pugnacité juridique des acteurs du marché du transport. Le législateur produisit alors, au cours de l’année 2014, deux lois5 visant à fonder de nouvelles obligations pour les VTC, créant une forme de code de cette profession renouvelée. Ces deux lois ont pris en compte les tensions très vives (qui ne semblent pas prêtes d’être apaisées) existant sur ce marché entre les taxis, les VTC et l’apparition des chauffeurs Uber. Pour cerner l’enjeu des décisions du Conseil constitutionnel, il convient donc de se plonger dans un maquis d’obligations techniques propres à la circulation des véhicules.
En l’espèce, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 13 mars 2015 par la Cour de cassation6 d’une QPC portant sur le paragraphe III de l’article L. 3120-2 du Code des transports, puis d’une autre QPC du même jour portant sur l’article L. 3122-2 du même code7. Quelques jours plus tard, le Conseil d’État posait au Conseil une dernière QPC portant sur les deux mêmes articles en y ajoutant L. 3122-9 du même code. Les sociétés requérantes développaient des griefs assez similaires au sujet des trois articles – si l’on met à part celui tiré de la violation du principe de propriété et de nécessité des peines – essentiellement tirés des inégalités et des entraves à la liberté d’entreprendre. Elles entendaient surtout solliciter l’arbitrage du Conseil constitutionnel sur les questions controversées des autorisations de stationnement, de l’interdiction de la maraude électronique, de la tarification. Le Conseil constitutionnel se trouvait ainsi placé dans un rôle délicat consistant à fixer les limites juridiques de l’introduction de l’économie collaborative dans un marché déjà torturé.
Si plusieurs QPC avaient déjà été examinées par le Conseil constitutionnel dans ce domaine, cette dernière décision en date l’a conduit à confirmer son intérêt assez limité pour la liberté d’entreprendre ainsi que le caractère profondément modulable du principe d’égalité. La haute instance semble en effet limitée par la violence des tensions sociales que l’uberisation de la vie économique a créées et contrainte par un cadre constitutionnel qui peut parfois ressembler à une coquille vide que seule la pratique serait en mesure d’incarner.
I. Une égalité torturée
Pour procéder comme le Conseil constitutionnel, il est important de se replonger dans une relation duale dans le marché du transport de personnes, entre les taxis et les VTC. Comme le relève le Conseil : « en vertu de son article L. 3120-1 (…) le législateur a distingué, d’une part, l’activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d’autre part, l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable » ; ces deux régimes sont ceux de la maraude et de la réservation préalable.
La maraude permet au conducteur d’accepter son client sur la voie publique, soit en l’attendant sur des emplacements réservés, soit en étant directement hélé sur la voie. La réservation préalable consiste, pour le conducteur, à être réservé directement par son client ; le conducteur ne pouvant rechercher ses clients en circulant sur la voie puisque la maraude est réservée aux taxis qui sont soumis à des obligations découlant de ce régime « monopolistique » (autorisations administratives et tarifs réglementés pour l’essentiel).
Pour se prononcer en droit, la question « vertébrale » des différentes décisions Uber consistait à déterminer l’écart juridique – différence de situation ou intérêt général – s’attachant au cloisonnement des deux marchés au regard de la jurisprudence relative au principe d’égalité. Seul le droit était en effet en mesure de donner les limites de la différence des deux marchés dès lors que – du fait de l’arrivée en force d’une forme de troisième marché avec Uber – les faits l’amenuisent. Initialement, le développement du téléphone et d’internet avait amené les taxis à trouver une place dans le marché de la réservation préalable. Ils furent directement concurrencés par les VTC8 qui n’ont pas de licence à obtenir. Enfin, une nouvelle concurrence a vu le jour avec les plates-formes de mise en relation d’Uber qui permettent un service d’autant plus rapide. Il convient de rappeler que Uber n’est qu’un VTC plus intelligent qui a entendu mettre directement en contact les conducteurs professionnels (ou amateurs, ce fut le service UberPop rendu impossible en France9) avec leurs clients par une application qui simplifie et accélère la mise en relation. Cette concurrence « agressive »10 est attaquée de toute part pour sa « déloyauté » mais peut-on réellement interdire aux pratiques de changer et à l’économie d’être plus compétitive ?
Ainsi, le Conseil constitutionnel se trouvait positionné face à une différence de régime qui ne correspond plus à une différence de situation du fait de la rapidité croissante des réseaux de réservation. Ses différentes décisions ont démontré que la différence de traitement ne correspond pas à une différence de situation entre les taxis et les VTC11. Le Conseil avait pourtant tout lieu de considérer que la différence de traitement législative méritait d’être conservée au vu des objectifs avancés par le législateur pour justifier les contraintes pesant sur les taxis, tirées de la police de la circulation sur le domaine public. En ce sens, le Conseil semblait tenu de reconnaître la particularité de la maraude notamment pour justifier son régime administratif. Partant, il se devait d’admettre qu’une insuffisance dans la différence de traitement par le droit serait dommageable aux taxis. Pourtant, dans la QPC commentée, les VTC entendaient au contraire considérer que les différentes restrictions imposées à leur activité dans le but de ne pas défavoriser le marché de la maraude, avaient étouffé leur liberté d’entreprendre. De plus, sur le marché de la réservation préalable, les taxis et les VTC méritant d’être traités également12, l’argumentation des requérants consistait à soutenir que les obligations particulières pesant sur les VTC étaient inégales.
Trois articles de la loi, menant à des réponses identiques, ont été soumis au Conseil Constitutionnel.
Tout d’abord, le Conseil constitutionnel a fait la sourde oreille à l’argumentation des requérants consistant à établir l’inégalité de l’interdiction de la « maraude électronique » posée par l’article III de l’article L. 3120-2 du Code des transports et qui désigne l’impossibilité faite au VTC de signaler à leurs clients leur localisation et la disponibilité d’un véhicule. Néanmoins, il a considéré que cette interdiction protégeait la maraude en la réservant aux seuls taxis. Cette protection étant nécessaire puisque la maraude n’est autre qu’une autorisation administrative fondée sur des objectifs d’ordre public. Le juge constitutionnel se refuse ainsi à confondre les régimes et les marchés en tentant de préserver une distinction qui n’a plus le bénéfice de la clarté par le fait.
Quant à l’interdiction de la tarification horokilométrique pour les VTC (griefs portant sur l’article L. 3122-2 du Code des transports), la censure de la disposition par le Conseil fondée sur la liberté d’entreprendre l’a conduit, par économie de moyens, à écarter le grief de la violation de l’égalité devant la loi qui aurait, à notre avis, tout autant pu fonder la censure.
Vient enfin la motivation posée par l’article L. 3122-9 – la plus fournie – quant au retour à la base imposé aux seuls VTC. Il s’agit de la dernière étape par la requête du détricotage de la nouvelle législation entendant encadrer l’activité des VTC.
Concernant l’article L. 3122-9, les sociétés requérantes considéraient que le principe d’égalité était atteint par l’obligation faite exclusivement aux VTC de « retour à la base », alors même que concernant le marché de la réservation préalable, les VTC et les taxis se trouvent dans la même situation. C’est d’ailleurs ce que le Conseil a décidé (cons. 25). Il a vu néanmoins dans le retour à la base obligatoire des VTC une nouvelle justification fondée sur les soucis de police de la circulation et du stationnement sur la voie, objectif que semble définitivement poursuivre le législateur pour l’ensemble de la législation applicable aux VTC.
Mais un questionnement subsiste : si la législation préservant la maraude poursuit nécessairement un objectif d’ordre public, la législation relative aux VTC qui poursuit l’objectif de permettre une préservation de la maraude, poursuit-elle pour autant le même objectif d’ordre public ? Cela n’est pas certain, il y a en effet une confusion entre la préservation de l’ordre public, qui est liée au marché de la maraude, et la législation relative à la réservation préalable qui régule un autre marché, en l’incitant à ne pas se rapprocher de celui de la maraude, au mépris d’un certain réalisme. Pour préserver l’autorisation administrative des taxis, le législateur entend nier la montée en puissance du marché de la réservation préalable, et le Conseil semble protéger cet aveuglement.
On comprend dès lors mieux pourquoi, en tête de décision, le Conseil a voulu rappeler qu’il entendait considérer la différence de marchés entre la réservation et la maraude qu’installe la législation, comme un acquis qui bornerait son contrôle de constitutionnalité.
II. Une liberté éclipsée
Au sujet de la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel avait à exercer un contrôle de constitutionnalité assez proche de celui qu’il a exercé relativement au principe d’égalité. Il est en effet de jurisprudence constante que la liberté d’entreprendre peut être limitée par des objectifs d’intérêt généraux, pourvu qu’il n’en résulte pas de disproportion – qui pourrait s’apparenter à une privation – manifeste de cette dernière liberté. La doctrine a pu assimiler ce considérant de principe à un contrôle minimal, une forme de désintérêt de la part du juge à l’égard de cette liberté. Une telle jurisprudence est associée à certaines libertés dont l’étendue mérite avant tout d’être façonnée par le législateur lui-même en raison de leur proximité avec le choix d’une politique constitutionnelle, qu’elle concerne l’entreprise, l’économie ou encore les mœurs, par exemple. Dans le champ d’une liberté économique où l’État a un rôle particulier à jouer pour fixer le curseur, notamment en créant des activités réglementées, le Conseil constitutionnel se trouve lui-même contraint par la régulation. Quant à l’activité réglementée – en l’espèce, celle des taxis – le Conseil exerce un contrôle restreint de l’objectif du législateur qui consiste à préserver le stationnement sur la voie publique et c’est à ce titre que l’on retrouve l’objectif d’ordre public et « notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique », qui avait à lui seul, justifié toutes les distorsions au principe d’égalité de traitement. Ce même objectif du législateur qui anime la législation relative à la maraude est transposé par le Conseil au marché de la réservation préalable.
En définitive, la liberté d’entreprendre des VTC est limitée par la particularité de l’activité des taxis et le Conseil entend protéger la particularité de ce marché de la maraude – d’une trop grande proximité avec le marché de la réservation préalable – sans prendre en compte les contraintes qui pèsent sur ce dernier qui, lui, n’est pas réglementé.
C’est ainsi que le Conseil a rejeté le grief tiré de la violation de la liberté d’entreprendre concernant l’interdiction de la maraude électronique dès lors « qu’en adoptant les dispositions contestées (…) le législateur, poursuivant des objectifs d’ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, a ainsi entendu garantir le monopole légal des taxis qui en découle ». En vertu de sa jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel a considéré que les limites pesant sur la liberté d’entreprendre étaient ainsi « proportionnées » puisque l’interdiction de la maraude électronique ne prive pas les VTC d’indiquer séparément les informations tirées de la situation du véhicule et de sa disponibilité. Cela conduit les VTC à devoir se priver des avancées technologiques de la géolocalisation, ce qui semble très paradoxal comme le révèle la possibilité que conservent les VTC de pouvoir prévenir les clients du « temps d’attente » relatif à leur réservation (cons. 13).
C’est toujours sur le fondement de la liberté d’entreprendre que le nouvel article L. 3122-2 du Code des transports encadrant la tarification des services de VTC, a été critiqué. La loi du 1er octobre 2014 avait prévu que les VTC pouvaient proposer uniquement soit un prix de prestation avant qu’elle n’ait lieu, soit prévoir une tarification de la réservation qui dépendrait de la durée de celle-ci13, et se voyaient ainsi refuser la tarification kilométrique. Ce mode de calcul semblerait donc être l’apanage des taxis alors pourtant qu’il apparaît assez clairement qu’une telle tarification n’a aucun lien particulier avec le monopole de maraude. Ce n’est d’ailleurs pas en se fondant sur le traditionnel motif d’ordre public de la circulation que le législateur avait entendu justifier cette discrimination, mais sur la protection des consommateurs, voire de la sécurité routière. Les deux fondements sont loin d’être probants. Pas de justification d’ordre public ni d’intérêt général donc, dès lors que l’on peine à comprendre en quoi les consommateurs sont mieux protégés par cette différence de tarification. Le Conseil constitutionnel a ainsi confirmé que « les dispositions contestées ont porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien direct avec l’objectif poursuivi » (cons. 20). Le « lien » est important. On sait que l’objectif de préservation de la maraude pour les taxis – qui passe par la préservation de l’ordre public de la circulation – est considéré par le Conseil comme un objectif d’intérêt général ; ici, c’est donc l’absence de lien avec cet objectif qui semble être pointé.
Cette interdiction a donc été déclarée contraire à la Constitution, mais c’est une bien faible victoire pour la liberté d’entreprendre. En effet, le même objectif d’ordre public lié à la police de la circulation justifie la limitation à la liberté d’entreprendre qu’induit l’obligation de « retour à la base » pour les seuls VTC, posée par l’article L. 3122-9. N’étant pas étranger aux lourdes contraintes économiques que ce retour systématique peut induire pour les VTC, le Conseil admet qu’il s’agit bien d’une limitation à la liberté d’entreprendre (cons. 23). Si la législation interdit aux VTC de circuler en quête de clients – ce qui équivaudrait à concurrencer le marché de la maraude14 – cette interdiction est néanmoins considérée comme liée à celle du retour à la base et donc justifiée.
Au final, le Conseil englobe chaque limitation à l’exercice de l’activité de VTC à une réponse à l’objectif de préservation de la maraude des taxis qui protège elle-même la police de la circulation. La décision offre ainsi l’exemple d’une liberté distendue par l’objectif du législateur qui justifie également toutes les inégalités ; le Conseil se retranchant derrière cet objectif d’ordre public.
Une question demeure donc : la liberté d’entreprendre n’aurait-elle pas elle-même été uberisée ?
ACB
1 – Liberté individuelle, respect de la vie privée
Le Conseil constitutionnel a été confronté, dans la décision n° 2015-464 QPC du 9 avril 2015, M. Marc A., à la question de savoir si l’incrimination instituée à l’article L. 480-12 du Code de l’urbanisme, du fait de la définition insuffisamment précise du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme, lorsque la visite s’effectue dans un domicile, porte atteinte au droit au respect de l’inviolabilité du domicile et à la liberté individuelle. L’article L. 461-1 institue un droit de visite des constructions en cours ou achevées au profit des agents assermentés de l’État, durant toute la durée du chantier et jusqu’à trois ans après le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux. Quant à l’article L. 480-12, il résulte de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, prise sur le fondement de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Cette ordonnance a été ratifiée par l’article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Le Conseil a jugé que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile (cons. 3). Ce principe a notamment été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 : « la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile » (cons. 6).
Il résulte alors de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, bien établie depuis la décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, que, hors du cadre des actes de police judiciaire, l’intervention de l’autorité judiciaire pour autoriser la pénétration dans un domicile n’est pas une exigence constitutionnelle. Toutefois, des garanties légales assurant le respect des exigences constitutionnelles découlant de l’article 2 de la Déclaration de 1789 doivent encadrer la pénétration dans un domicile. Dans le cas de l’article L. 480-12, le Conseil a refusé de considérer, eu égard au caractère spécifique et limité du droit de visite, que l’incrimination modifierait la nature du droit de visite et permettrait une violation de domicile. Le Conseil constitutionnel a donc rejeté le grief tiré de l’atteinte au respect de l’inviolabilité du domicile. Quant au grief tiré de la méconnaissance de la liberté individuelle, fondée quant à elle sur l’article 66 de la Constitution, il a été jugé purement et simplement inopérant, compte tenu de la définition précise désormais retenue de cette liberté. Depuis la décision précitée du 16 juin 1999, la décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, le Conseil retient une définition de la liberté individuelle limitée au domaine des privations de liberté (garde à vue, détention, rétention administrative, hospitalisation sans consentement, ce qui n’était pas le cas dans la loi considérée…).
2 – Liberté d’entreprendre, liberté contractuelle
Ces deux libertés ont été invoquées ensemble par la société requérante dans la décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015, Société Saur SAS, à propos de l’interdiction faite aux distributeurs d’eau d’interrompre la distribution d’eau dans les résidences principales, pour défaut de paiement et figurant à l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles qui était la disposition contestée. Selon la Société Saur, cette interdiction générale et absolue n’était pas justifiée par la situation de précarité des usagers, ni par un motif d’intérêt général et elle méconnaissait par conséquent la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre.
La liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle découlent toutes deux de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, et selon une jurisprudence bien acquise15, elles ne peuvent être limitées que par des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (cons. 4). S’ajoute à ces deux libertés le respect des contrats légalement conclus auxquels seule une atteinte justifiée par un motif d’intérêt général suffisant peut justifier la méconnaissance des exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 (cons. 5). Si le fondement constitutionnel est différent c’est qu’est en cause le respect des conventions, c’est-à-dire, une forme de sécurité juridique rattachée à la garantie des droits fondée sur l’article 16 de la Déclaration16.
Dans le cas d’espèce, c’est l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent, tel qu’il résulte des premier, dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui permet de considérer que l’atteinte aux libertés invoquées peut être justifiée. Le législateur a, en effet, entendu garantir l’accès à l’eau pour toute personne occupant une résidence et ce, pendant l’année entière. En garantissant dans ces conditions l’accès à l’eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, la loi a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle susvisé. Par là-même, le Conseil consacre, sans l’exprimer expressément, une forme de droit à l’eau qui, dans les circonstances environnementales actuelles, risque de prendre une place grandissante et qui dépasse la seule possibilité de disposer d’un logement décent.
Le Conseil examine aussi longuement le respect de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre, à propos desquelles il juge que l’interdiction d’interrompre la distribution d’eau n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur. La distribution d’eau potable étant un service public industriel et commercial qui relève de la compétence de la commune, quel que soit le mode d’exploitation, (en régie, en affermage ou par concession), l’usager de ce service public n’a pas le choix de son distributeur et le distributeur d’eau ne peut refuser de contracter avec un usager raccordé au réseau qu’il exploite. En outre, les règles de tarification de la distribution d’eau potable sont encadrées par la loi et, ainsi, les distributeurs d’eau exercent leur activité sur un marché réglementé. Il faut comprendre de cette longue justification apportée par le Conseil constitutionnel (cons. 8) que ces libertés doivent être appréciées de manière particulière et en quelque sorte relative. Enfin, même si la disposition contestée est une dérogation à l’exception d’inexécution du contrat de fourniture d’eau, elle ne prive pas le fournisseur des moyens de recouvrer les créances correspondant aux factures impayées.
MV
B – Le droit de propriété
L’interdiction légale de la « maraude électronique » est conforme au principe constitutionnel du droit de propriété. Elle protège, à ce titre, le monopole légal des taxis qui sont seuls autorisés à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport. Si elle peut conduire, pour les personnes qui exercent l’activité de transport individuel sur réservation préalable, à limiter l’usage de technologies qui leur permettent d’informer le client, avant la réservation préalable, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule, elle n’impacte pas pour autant leurs droits de propriété sur ces technologies. C’est ce qu’a décidé le Conseil dans la décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société Uber France SAS et a.
LB
C – Le principe d’égalité
1 – Principe d’égalité devant la loi
Le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel en matière d’égalité devant la loi est l’exemple d’un contrôle ouvert à la variabilité des objectifs législatifs. Il n’est en effet pas une seule décision qui ne soit confrontée à ce problème : l’objectif législatif justifie-t-il la différence de traitement, l’intérêt général allant de pair avec le rôle dévolu à la loi ?
Dans la QPC n° 443, le Conseil constitutionnel était confronté à la question de la discrimination en fonction de la nationalité. Le requérant, dirigeant de société, avait en effet soumis une QPC portant sur la conformité du 1° de l’article L. 612-7 du Code de la sécurité intérieure (CSI) au principe d’égalité devant la loi, en ce que cet article réserve aux seuls nationaux français la possibilité de solliciter un agrément pour exercer des activités professionnelles de sécurité privée17.
La matière de la sécurité justifie qu’un étroit contrôle soit exercé par l’Administration sur les professions qui en découlent : d’abord par une autorisation d’exercice, puis du fait de l’agrément que doivent obtenir la personne morale ainsi que les employés soumis à autorisation pour obtenir une carte professionnelle. La sécurité, parce qu’elle engage la survie de l’État et la vie dans l’État, justifie une législation appropriée et notamment, l’ensemble des conditions posées par l’article L. 612-7 du CSI, dont la condition de nationalité, était questionné en l’espèce. Sur la question délicate de la nationalité, le Conseil constitutionnel a assez constamment considéré qu’une marge de manœuvre législative était de mise. Néanmoins, les engagements européens et internationaux de la France (on pense aux conventions internationales de l’OIT concernant les travailleurs) ont assez largement rogné cette marge pour imposer certaines conditions d’entraide ; on pense naturellement au principe de libre circulation des travailleurs qui a imposé de nombreuses mutations au droit du travail et de la fonction publique française18. L’objectif avancé par le législateur en matière d’activités de sécurité exercées par des personnes privées pouvait assez largement se réclamer de cette protection de la souveraineté nationale et du risque d’atteinte à l’ordre public qui justifient traditionnellement que cette activité soit l’apanage des personnes publiques. Le caractère sensible des activités justifiait en ce sens la discrimination en fonction de la nationalité – activité qui est d’ailleurs en lien étroit avec l’État et ses prérogatives de puissance publique – mais également le contrôle étroit exercé par l’État sur ce type d’activité. Le motif d’intérêt général de protection de l’ordre public et de la sécurité des personnes fondait ainsi directement la différence de traitement (cons. 5).
C’est la même relativité du principe d’égalité devant les procédures, qui est à l’œuvre dans la décision du 24 avril 2015 n° 2015-461 QPC Mme Christine M. épouse C. Le Conseil constitutionnel était confronté à la question de la constitutionnalité des articles 698-1 et 2 du CPP tant au regard du principe d’égalité que du principe des droits de la défense. Issus de la loi du 21 juillet 1982 – qui a supprimé pour le temps de paix les tribunaux des forces armées – les deux articles mettent en œuvre une procédure qui ouvre au seul procureur de la République le pouvoir de mettre en mouvement l’action publique en cas de commission d’une infraction militaire en temps de paix. Les deux premiers alinéas de l’article 698-1 du CPP prévoient la sollicitation d’un avis des autorités militaires avant que cette action publique ne soit mise en mouvement, et le premier alinéa de l’article 698-2 du même code pose des restrictifs dans lesquels la personne lésée peut mettre exceptionnellement en œuvre cette action publique. La requérante dénonçait une inégalité avec la poursuite des infractions ordinaires pour laquelle la mise en œuvre de l’action publique n’est pas l’apanage du seul procureur de la République. En effet, la victime, dans le cas de la poursuite d’infractions militaires, voit son action soumise à l’avis du ministre de la Défense et se trouve dans l’impossibilité d’une citation directe.
Le principe d’égalité est ici appliqué dans son volet relatif à l’équilibre des droits des parties dans une procédure, il est donc étroitement lié aux droits de la défense dans la procédure. Le Conseil a construit, en matière pénale, une jurisprudence véritablement homogène qui lui a permis de vérifier que les différentes parties à un procès disposent des mêmes droits. Reconnaissant la réelle discrimination entre les victimes d’infractions militaires et autres que militaires, cette différence de traitement devait encore être confrontée à l’équilibre général de la procédure et à un intérêt général poursuivi par le législateur. La discrimination pouvait, en l’espèce, se justifier par la spécificité de l’armée et la nécessité d’éviter des poursuites déstabilisant l’institution. Cet objectif était directement issu des travaux parlementaires et de la spécificité de la fonction militaire et la nécessité d’établir sa protection, ce qui justifie l’existence d’une procédure particulière qui restreint la citation directe par la victime (cons 7). Dans le même sens, au sujet des restrictions posées par l’article 698-1 du CPP relativement à l’avis du ministre, le Conseil a jugé que le législateur a entendu préserver « les spécificités du contexte militaire » (cons. 8), d’autant plus que cet avis n’est pas requis dans les cas les plus graves.
ACB
2 – Principe d’égalité devant les charges publiques
Les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, desquels le principe d’égalité devant les charges publiques tire sa substance, autorise la loi à déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. Il faut toutefois que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et qu’elle repose sur des critères objectifs et rationnels.
Ces conditions sont remplies, selon la décision n° 2015-466 QPC du 7 mai 2015, par le 3° du 7 du paragraphe III de l’article 150-0 A du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, et depuis abrogé par la loi de finances pour 2014. Cette disposition soumettait le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu, prévue pour les plus-values de cession de parts de société relevant du statut de jeune entreprise innovante, à la condition que « le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants (n’aient) pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés ».
Le plafond de détention ainsi retenu participe au but d’intérêt général de favoriser le financement de jeunes entreprises innovantes par des investisseurs susceptibles d’accompagner le développement de ces entreprises sans néanmoins déterminer leurs décisions. L’octroi de cet avantage fiscal qui est effectivement fondé, selon le Conseil constitutionnel, sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi19, est conforme aux exigences du principe d’égalité devant les charges publiques.
Dans les différences de traitement instituées, l’essentiel, tel que l’impose l’article 13 de la Déclaration des droits, est que la contribution commune aux charges de la nation soit également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Ce rappel est fait dans la décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015, Société Saur SAS à propos de l’interdiction qui pèse sur les distributeurs d’eau d’interrompre la distribution d’eau potable tout au long de l’année lorsque l’usager ne s’acquitte pas de ses factures (cons. 15). Pour autant, cette exigence constitutionnelle est hors d’application lorsqu’une telle interdiction légale d’interruption de service emporte pour conséquence un risque de report par le distributeur d’eau sur l’ensemble des usagers, du surcoût provenant du non-paiement des factures par certains usagers. Le Conseil constitutionnel qui précise que l’interdiction est « sans effet sur les créances des distributeurs d’eau sur les usagers » (cons. 16) en conclut que le grief de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques manque en fait. Ainsi, pour apprécier la faculté contributive, le Conseil ne prend pas en compte l’impact d’une mesure d’interdiction.
L’égalité de répartition de la contribution commune selon les facultés des citoyens se mesure à l’absence de caractère confiscatoire de l’impôt ou à l’absence d’une charge excessive que ferait peser l’impôt sur une catégorie de contribuables au regard de leurs facultés contributives. Sur la base de ces conditions, le Conseil souligne, dans la décision n° 2015-473 QPC du 26 juin 2015, Époux P., que l’appréciation du respect du principe d’égalité devant les charges publiques résulte de la prise en compte de l’ensemble des impositions qui pèsent sur le même revenu et qui sont acquittées par le même contribuable (cons. 8). En l’espèce, le Conseil réfute le caractère excessif de la charge née de l’application de l’article f du 3° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’exclusion de l’application aux revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l’impôt sur le revenu, de l’abattement proportionnel de 40 % lorsque le contribuable a, par ailleurs, opté en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire pour d’autres revenus de capitaux mobiliers au cours de la même année ne crée pas de différence de traitement telle, entre les contribuables, qu’elle puisse mettre en cause le principe d’égalité devant les charges publiques.
LB
3 – Principe d’égal accès aux emplois publics (…)
D – Les droits sociaux (…)
E – Les principes du droit répressif
1 – Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines (…)
V. cette chronique, IV. Les droits et libertés, A. Les libertés.
2 – Droits de la défense et respect des garanties procédurales
La QPC du 7 mai 2015, n° 2015-467 QPC, M. Mohamed D., entendait critiquer la procédure de réclamation contre l’avis d’amende forfaitaire majorée, en ce qu’elle suppose de joindre des documents à toute demande de réclamation (exigés par CPP, art. 529-10), ce que le requérant estimait contraire aux droits de la défense. C’est la loi du 20 décembre 2007 qui a de nouveau modifié le dernier alinéa de l’article 530 du CPP, afin de moderniser les conditions de réclamation en prévoyant que cette dernière « doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ».
Il convient d’ajouter qu’une jurisprudence constante déclare irrecevable toute demande qui ne joindrait pas les pièces demandées.
Pour assouplir ces effets de la législation et de la jurisprudence, la Cour de cassation a admis que des recours devaient être prévus à l’encontre de certaines décisions d’irrecevabilité de réclamation devant le juge de proximité, dans les cas les plus graves20.
Dans la décision commentée, le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence constante concernant le droit au recours et les restrictions qui peuvent lui être apportées. Si l’édiction de règles de recevabilité – et partant d’irrecevabilité – peuvent valablement entourer l’exercice du droit au recours « effectif », pour le rester, celui-ci ne doit pas être atteint substantiellement. Ainsi, lorsque les irrecevabilités sont particulièrement strictes – comme c’est le cas en matière d’amendes forfaitaires majorées et comme le Conseil a déjà eu à le juger – ces règles doivent pouvoir être contestées et les droits de la défense préservés21. Aussi, dès lors que le requérant doit pouvoir faire valoir ses droits en justice il doit pouvoir contester l’irrecevabilité dans des cas que le Conseil prend d’ailleurs le soin de sérier (cons. 6). De plus, le Conseil reconnaît que la bonne administration de la justice peut justifier l’exigence de ces règles de recevabilité, ce qui le conduit à considérer que la disposition n’est pas contraire au droit au recours ni aux droits de la défense (cons. 7).
De même dans la décision 461 QPC, le Conseil constitutionnel a rejeté le grief tiré d’une atteinte au droit au recours qui était directement lié à celui de l’inégalité des procédures. Il reconnait, de jurisprudence constante, que la victime ne dispose pas d’un droit à la mise en œuvre de l’action publique qui soit directement associé à la protection constitutionnelle du droit au recours. Par conséquent, la mise en œuvre de cette action par le ministère public, et lui seul, n’a jamais été constitutive d’une violation des exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Néanmoins, s’il apparaît au vu d’un déséquilibre de la procédure qu’une partie se trouve privée de l’exercice effectif de son droit au recours, il y a là matière à censure des dispositions législatives22. En l’espèce, la nullité de toute action engagée en l’absence de sollicitation de l’avis du ministre de la Défense pour la poursuite des infractions militaires, et qui a pour objet de ne pas pouvoir faire naître une procédure, alors que la victime apparaît vraisemblablement lésée, n’a pas été jugée susceptible « d’éteindre » l’existence du droit au recours dès lors que la victime conserve d’autres voies pour agir en justice (cons. 9).
ACB
F – La garantie des droits
1 – Le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d’impartialité et d’indépendance (…)
V. cette chronique, IV. Les Libertés, E. Les principes du droit répressif.
2 – Le principe de sécurité juridique
Dans sa décision du 26 juin 2015 n° 2015-474 QPC, Société Icade, le Conseil constitutionnel a réaffirmé sa jurisprudence sur le principe de sécurité juridique, plus précisément sur la rétroactivité de la loi fiscale au regard de l’article 16 de la Déclaration des droits de 1789.
Reprenant la formulation de la décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006 (cons. 45), complétée par la décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (cons. 14), le Conseil rappelle, sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de 1789, « qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ». Ce pouvoir reconnu au législateur est limité : « ce faisant, [celui-ci] ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; en particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations » (cons. 12 de la décision présentée).
En l’espèce, lorsque les actifs supports des plus-values latentes des Sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) deviennent éligibles au régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu par l’article 208 C du Code général des impôts, postérieurement à l’exercice de l’option, par la société, les dispositions contestées de cet article 208 C ter, introduit par la loi de finances pour 2005 prévoient un mécanisme d’étalement de l’imposition, consistant en un fractionnement des plus-values sur quatre années et leur imposition au taux applicable au titre de chacune de ces années.
Ce mécanisme diffère de celui prévu pour les plus-values latentes constatées lors de l’option exercée par une société pour le régime des SIIC, pour lesquelles l’article 1663 du Code général des impôts prévoit que le paiement de l’imposition est étalé sur quatre ans, en quatre fractions égales, et que le taux demeure celui applicable lors de l’option.
Ainsi, dès la loi de finances pour 2005, les contribuables ont eu connaissance de la nouvelle règle posée par l’article 208 C ter du CGI, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
Le Conseil constitutionnel a considéré que lors de l’exercice de l’option pour le régime des SIIC, les sociétés ne pouvaient attendre l’application des règles d’imposition prévues par l’article 208 C du Code général des impôts aux plus-values latentes postérieures à l’exercice de l’option.
Il a jugé que, par suite, les dispositions contestées n’ont pas porté atteinte à des situations légalement acquises, ni remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.
Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 (cons. 13) et déclaré les dispositions contestées de l’article 208 C ter du Code général des impôts conformes à la Constitution (cons. 14).
CR
Notes de bas de pages
-
1.
Cons. const., 7 juin 2013, n° 2013-318 QPC ; Cons. const., 17 oct. 2014, n° 2014-422 QPC ; Cons. const., 22 mai 2015, n° 2015-468/469/472 QPC ; Cons. const., 22 sept. 2015, n° 2015-484 QPC.
-
2.
V. le comm. de Haquet A., RFDA 2015, p. 1135.
-
3.
CE, ord., 5 févr. 2014, n° 374524, Sté SAS Allocab.
-
4.
CE, 17 déc. 2014, n° 374525.
-
5.
L. n° 2014-344, 17 mars 2014, relative à la consommation a d’abord renforcé les obligations des VTC ; L. n° 2014-1104, 1er oct. 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.
-
6.
Cass. com., 13 mars 2015, n° 14-40054.
-
7.
Cass. com., 13 mars 2015, n° 14-40053.
-
8.
L. n° 2009-888, 22 juill. 2009, art. 4.
-
9.
Cons. const., 22 sept. 2015, n° 2015-484 QPC.
-
10.
V. comm. préc., RFDA, op. cit.
-
11.
Cons. const., 17 oct. 2014, n° 2014-422 QPC.
-
12.
Ibid., cons. 7 : « Le principe d’égalité n’imposait pas que les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur soient traités différemment » sur le marché de la réservation préalable.
-
13.
C. transp., art. L. 3122-2.
-
14.
Cons. const., n° 2013-318 QPC.
-
15.
V. chronique 2015-1.
-
16.
V. infra.
-
17.
CE, 11 févr. 2015, n° 385359.
-
18.
Cons. const., 23 juill. 1991, n° 91-293 DC, loi portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
-
19.
Cons. const., 29 avr. 2011, n° 2011-121 QPC, Sté Unilever France, considérant n° 3.
-
20.
Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-80170.
-
21.
Cons. const., 29 sept 2010, n° 2010-38 QPC.
-
22.
Cons. const., 23 juill. 2010, n° 2010-15/23 QPC, région Languedoc-Roussillon et a.