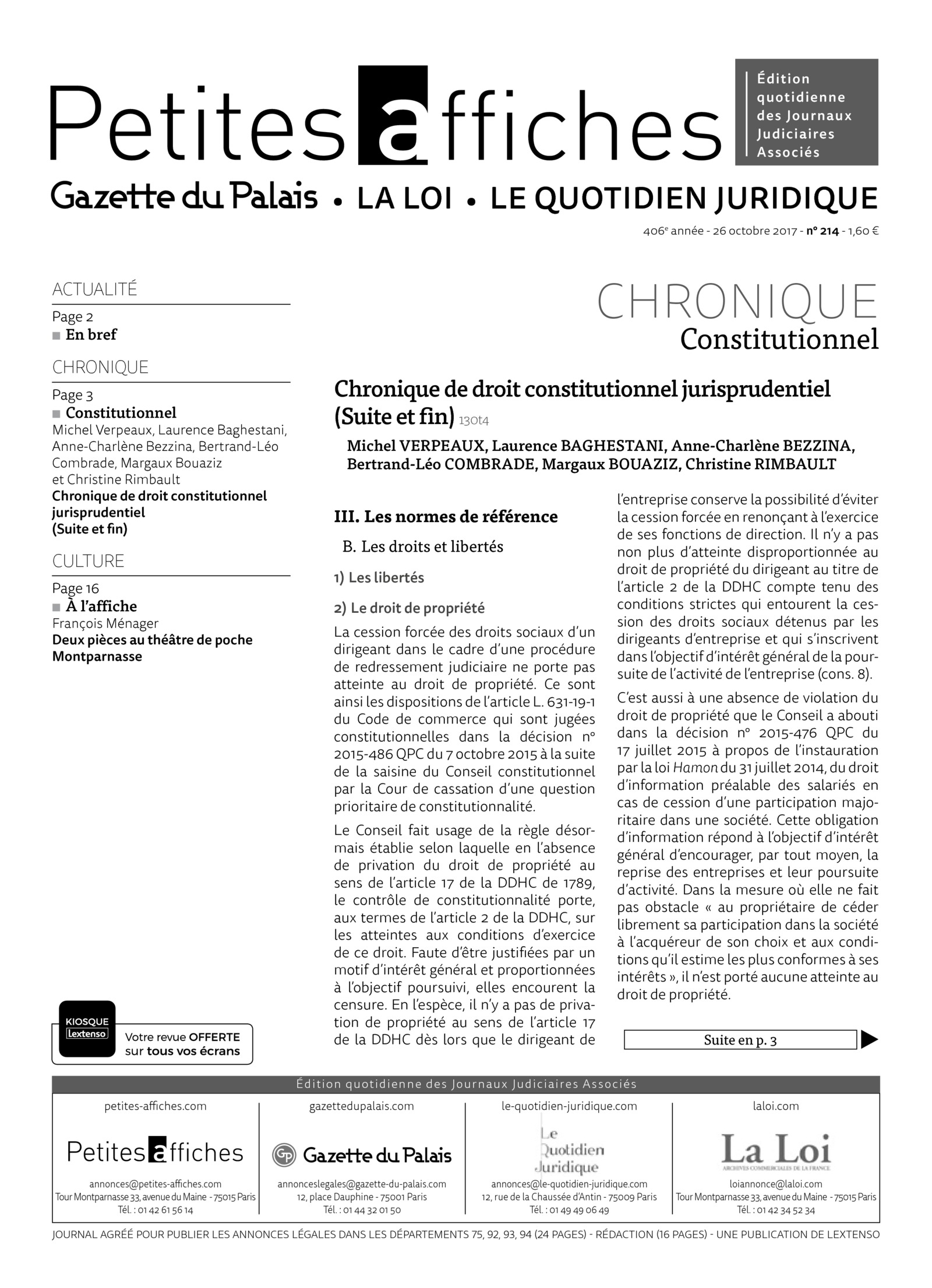Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (Suite et fin)
La chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel est ouverte à l’ensemble des décisions susceptibles d’intéresser le droit constitutionnel dans sa dimension contentieuse considérée de la manière la plus large. C’est ainsi que le contentieux électoral est intégré dans la présente chronique qui est divisée en quatre parties correspondant aux thèmes principaux du droit constitutionnel contemporain qui intègre aussi bien les questions institutionnelles que les problèmes de hiérarchie des normes et la place des droits et libertés.
La chronique présentée ci-dessous couvre les mois de juillet à décembre 2015 et, afin de mieux correspondre aux réalités du contentieux de la Constitution, son plan a été légèrement modifié.
I – Les institutions constitutionnelles
A – Les pouvoirs politiques : le pouvoir exécutif
B – Les pouvoirs politiques : le Parlement et la procédure législative
1 – Les validations législatives (…)
2 – Le contrôle de la procédure législative
3 – Le principe de séparation des pouvoirs en faveur du Parlement
4 – La compétence et le domaine de la loi
a – Le recours aux travaux préparatoires de la loi
b – L’incompétence négative
c – La répartition des compétences normatives entre la loi et le règlement
C – Le pouvoir juridictionnel (…)
D – Le pouvoir financier
E – Les collectivités territoriales
F – Droits électoraux, contentieux des élections et des référendums
II – Le procès constitutionnel
A – Les acteurs et les actes devant le Conseil constitutionnel
B – La procédure devant le Conseil constitutionnel
C – Les techniques contentieuses
D – L’autorité et les effets des décisions du Conseil constitutionnel
III – Les normes de référence
A – Les sources matérielles
1 – Les textes constitutionnels
2 – Les rapports de systèmes
B – Les droits et libertés
1 – Les libertés
a – Sécurité et libertés : décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, loi sur le renseignement
b – Liberté individuelle, respect de la vie privée, principe de responsabilité
c – Liberté d’expression / liberté de conscience (…)
d – Liberté d’entreprendre, liberté contractuelle
2 – Le droit de propriété
La cession forcée des droits sociaux d’un dirigeant dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ne porte pas atteinte au droit de propriété. Ce sont ainsi les dispositions de l’article L. 631-19-1 du Code de commerce qui sont jugées constitutionnelles dans la décision n° 2015-486 QPC du 7 octobre 2015 à la suite de la saisine du Conseil constitutionnel par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Le Conseil fait usage de la règle désormais établie selon laquelle en l’absence de privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la DDHC de 1789, le contrôle de constitutionnalité porte, aux termes de l’article 2 de la DDHC, sur les atteintes aux conditions d’exercice de ce droit. Faute d’être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi, elles encourent la censure. En l’espèce, il n’y a pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la DDHC dès lors que le dirigeant de l’entreprise conserve la possibilité d’éviter la cession forcée en renonçant à l’exercice de ses fonctions de direction. Il n’y a pas non plus d’atteinte disproportionnée au droit de propriété du dirigeant au titre de l’article 2 de la DDHC compte tenu des conditions strictes qui entourent la cession des droits sociaux détenus par les dirigeants d’entreprise et qui s’inscrivent dans l’objectif d’intérêt général de la poursuite de l’activité de l’entreprise (cons. 8)1.
C’est aussi à une absence de violation du droit de propriété que le Conseil a abouti dans la décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015 à propos de l’instauration par la loi Hamon du 31 juillet 2014, du droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’une participation majoritaire dans une société. Cette obligation d’information répond à l’objectif d’intérêt général d’encourager, par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d’activité. Dans la mesure où elle ne fait pas obstacle « au propriétaire de céder librement sa participation dans la société à l’acquéreur de son choix et aux conditions qu’il estime les plus conformes à ses intérêts », il n’est porté aucune atteinte au droit de propriété.
3 – Le principe d’égalité
a – Principe d’égalité devant la loi
La jurisprudence en matière d’égalité devant la loi est classiquement fondée sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Il en découle que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
Au cours de la période considérée, le Conseil a censuré à deux reprises des dispositions législatives qui ne répondaient pas à cette exigence. A failli à cet impératif, le dispositif instituant une cotisation de solidarité due par les pluriactifs indépendants qui n’exercent pas à titre principal l’activité de chef d’exploitation agricole. En assujettissant parmi cette catégorie de personnes, seules celles qui n’avaient pas une activité leur assurant une affiliation au régime d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, la loi a opéré, selon la décision n° 2015-509 QPC du 11 décembre 2015, M Christian B., une différence de traitement entre personnes percevant des revenus de même nature en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi (cons. 4).
Dans la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, est jugée contraire au principe d’égalité devant la loi, la différence de traitement entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l’entreprise. Afin de favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche, le versement d’une indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut être plafonné à condition, toutefois, que les critères retenus présentent un lien avec le préjudice subi par le salarié. Si tel était le cas du critère de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, il en allait autrement du critère des effectifs de l’entreprise qui créait une différence de traitement injustifiée du fait de ne pas être en adéquation avec l’objet de la loi (cons. 152).
À l’inverse, cette condition est remplie par les dispositions de la loi relative aux règles de postulation des avocats qui ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la justice (cons. 58) ainsi que par celles qui définissent les conditions d’installation de certains officiers publics et ministériels en vue d’une meilleure couverture du territoire national par les professions règlementées et d’une augmentation progressive du nombre d’offices (cons. 71).
C’est aussi sur le fondement de l’égalité devant la justice mais aussi de l’égalité devant la loi que le Conseil a reconnu, dans la décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015, M. Anis T., la constitutionnalité des dispositions qui font courir le délai à l’issue duquel une personne condamnée à titre principal à une peine d’interdiction définitive du territoire français peut former une demande en réhabilitation judiciaire à compter de l’expiration de la sanction subie. Il n’y a pas pour cette catégorie de personnes condamnées une perte de bénéfice de la réhabilitation judiciaire étant entendu qu’elles sont dans une situation différente de celles condamnées à la même peine à titre complémentaire, qui, quant à elles, peuvent bénéficier d’un effacement de cette peine par l’effet d’une réhabilitation judiciaire. Pour ces dernières, l’objectif est de favoriser leur reclassement2, ce qui autorise, dans cette perspective, une différence de traitement en conformité avec le principe d’égalité devant la loi. Dès lors qu’il est reconnu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits, que la loi est « la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », la loi qui fixe les règles de la procédure pénale en vertu de l’article 34 de la Constitution, peut effectivement prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent. La seule condition imposée, en l’espèce remplie, est que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que des garanties égales soient assurées aux justiciables (cons. 4).
Dans la décision n° 2015-477 QPC du 31 juillet 2015, M. Jismy R., c’est au regard du principe d’égalité devant la loi pénale qui, selon une jurisprudence établie, induit qu’il « ne fait pas obstacle à ce qu’une différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de nature différente »3, que le Conseil a validé les différents régimes d’exonération de responsabilité pénale pour sévices commis envers des animaux. Pour les courses de taureaux ainsi que pour les combats de coqs, l’exonération de responsabilité pénale est fondée sur « l’existence d’une tradition ininterrompue ». En revanche, l’interdiction posée par la loi du 8 juillet 19644 de créer tout nouveau gallodrome résulte d’une volonté de ne tolérer que les pratiques existantes. De fait, l’objet de la loi justifie la différence de traitement.
Dans le même sens, dans la décision n° 2015-495 QPC du 20 octobre 2015, le Conseil n’a relevé aucune rupture d’égalité devant la loi par la différence de traitement entre régimes obligatoires de base d’assurance-vieillesse selon qu’ils ont en charge des salariés ou des non-salariés. Pour autant, la conformité au principe d’égalité est ici justifiée par des considérations historiques liées directement « aux modalités selon lesquelles s’est progressivement développée l’assurance-vieillesse en France ainsi qu’à la diversité corrélative de ces régimes » (cons. 9)5.
Dans la décision n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015, Syndicat Confédération générale du travail, la différence de traitement opérée en conformité avec l’objet de la loi découle de la différence de nature des intérêts que défendent les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. Pour les premières, il s’agit de défendre les droits et les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des salariés. Pour les secondes, ceux des employeurs. À ce titre, les règles du paritarisme peuvent s’appliquer différemment notamment en ce qui concerne la répartition du montant des crédits qui leur sont alloués au titre de la mission liée au paritarisme. S’il est réparti uniformément pour les organisations syndicales de salariés, tel n’est pas le cas pour les organisations professionnelles d’employeurs sans que, pour autant, une rupture d’égalité de traitement n’en découle.
b – Principe d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques – droits et libertés en matière fiscale
Les exigences issues du principe d’égalité devant les charges publiques qui découlent des dispositions de l’article 13 de la DDHC de 1789 imposent que l’appréciation des facultés contributives dont il appartient au législateur de déterminer les règles, repose sur des critères objectifs et rationnels afin d’éviter toute rupture caractérisée du principe. Toute la tâche du Conseil repose donc sur la recherche de l’existence ou non dans la loi de tels critères au regard du but qu’elle poursuit.
Dans la décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015, le Conseil considère que l’exigence de ces critères est remplie par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 qui institue un crédit d’impôt pour des contrats d’assurance maladie complémentaire labellisés destinés aux personnes de plus de 65 ans (article 33 de la LFSS). L’octroi de cet avantage fiscal qui est destiné à encourager pour ces personnes une offre de complémentaire santé à un prix raisonnable et de qualité est conforme à l’article 13 de la DDHC (cons. 14).
Il en a également décidé ainsi dans la décision n° 2015-475 QPC du 17 juillet 2015 à propos des modalités des règles de déduction des moins-values de cession de titres de participation (cons. 13). C’est aussi sur des critères objectifs et rationnels qu’est fondée la détermination du périmètre des établissements habilités à percevoir les versements libératoires de la taxe d’apprentissage. C’est ainsi que sont écartés, dans la décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015, les griefs tirés de l’atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
Par ailleurs, le respect de ce principe soumet la contribution à l’impôt à conditions. L’impôt ne peut revêtir un caractère confiscatoire, pas plus qu’il ne pourrait faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives6. Ni dans la décision n° 2015-482 QPC du 17 septembre 2015, ni dans la décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015, le caractère confiscatoire de la contribution n’est retenu. Il en va ainsi, respectivement, pour l’imposition que le redevable de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets non dangereux est autorisé à répercuter sur son cocontractant en vertu des dispositions du 4 de l’article 266 decies du Code des douanes, et pour la contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau » dont le caractère confiscatoire a été apprécié « en rapportant le total des impositions que l’employeur doit acquitter à la somme de ce total et des rentes versées » (cons. 5). En l’espèce, pour la première fois, le Conseil se prononce, là, sur une imposition sur une « retraite chapeau » mise à la charge de l’employeur7 dont il considère que le cumul avec la contribution de base, prévue par le paragraphe I de l’article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale, n’atteint pas un niveau de taxation susceptible de faire peser sur l’employeur une charge excessive (cons. 5). Toutefois, l’effet de seuil créé, en l’espèce, par la législation fiscale, que le Conseil est amené à contrôler sur le fondement de l’article 13 de la DDHC, est jugé excessif. En rapportant cet effet au total de l’imposition additionnelle et de l’imposition principale (cons. 7), l’ampleur de l’effet de seuil, qui multiplie par près de trois l’imposition de l’employeur, est telle que les dispositions contestées du paragraphe II bis de l’article 137-11 du Code de la sécurité sociale créent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques (cons. 7).
Il résulte des exigences tirées de l’article 13 de la DDHC que, dans tous les cas, une imposition doit garantir le respect des capacités contributives des contribuables sans faire peser sur eux une charge supplémentaire injustifiée. C’est le sens de la décision n° 2015-483 QPC du 17 septembre 2015 à propos des règles d’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits des contrats d’assurance-vie « multi-supports » qui imposent aux titulaires de ce type de contrats d’acquitter une imposition supérieure à celle due, sur la durée d’ensemble du contrat. Le fait de ne pas avoir prévu un mécanisme de réparation du préjudice financier subi par le contribuable conduit le Conseil à valider le dispositif législatif prévu sous réserve, toutefois, que le contribuable puisse prétendre au bénéfice d’intérêts moratoires (cons. 6). Il en va ainsi de l’exigence de l’égalité devant les charges publiques.
LB
c – Principe d’égal accès aux emplois publics (…)
4 – Les droits sociaux
Dans la décision n°2015-502 QPC du 27 novembre 2015, Syndicat Confédération générale du travail, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions du 1° de l’article L. 2135-13 du Code du travail. Ces dispositions fixent les modalités de répartition des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme entre organisations syndicales de salariés, d’une part, et entre organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part. En vertu de la seconde phrase du 1° de l’article L. 2135-13, les crédits sont répartis, entre les premières, de façon uniforme et, entre les secondes, en fonction de l’audience ou du nombre de mandats paritaires exercés.
Le syndicat requérant faisait valoir notamment qu’en traitant identiquement toutes les organisations syndicales de salariés sans tenir compte de leur différence de représentativité, ces dispositions méconnaissent la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail garantis par les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (cons. 2).
Après avoir indiqué les principes des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il appartient au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical, de fixer les conditions de mise en œuvre du droit des travailleurs de participer par l’intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. S’appuyant sur ces dispositions constitutionnelles, le Conseil a écarté le grief : « en prévoyant que les crédits du fonds paritaire sont répartis de manière uniforme entre les organisations syndicales de salariés, les dispositions contestées, loin de porter atteinte à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, mettent en œuvre ces exigences constitutionnelles » (cons. 4 et 5).
La décision 512 QPC s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle il incombe au législateur de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par le préambule de 1946, les modalités de leur mise en œuvre8.
Dans sa décision n° 2015-507 QPC du 11 décembre 2015, Syndicat réunionnais des exploitants de stations-service et autres, le Conseil constitutionnel a été amené à valider certaines dispositions de l’article L. 671-2 du Code de l’énergie qui organisent, pour certaines collectivités d’outre-mer, les conditions de mise en œuvre du plan de prévention des ruptures d’approvisionnement de produits pétroliers.
Les requérants reprochaient à ces dispositions de les priver de la possibilité d’interrompre leur activité de distribution de produits pétroliers en méconnaissance, pour les gérants salariés de station-service, du droit de grève, et, pour les indépendants, de la liberté d’entreprendre.
Le Conseil a d’abord rappelé ses considérants de principe relatifs à la protection constitutionnelle de la liberté d’entreprendre fondée sur l’article 4 de la Déclaration des droits de 1789 (cons. 5) et du droit de grève fondé sur le septième alinéa du préambule de 1946 (cons. 6). Le Conseil relève ainsi que « les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu’il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte » (cons. 6).
Le Conseil fixe donc sa jurisprudence relative aux limitations du droit de grève et à la compétence conférée au législateur9.
Quant à la liberté d’entreprendre, elle a été définie par le Conseil constitutionnel avec une double composante, la liberté d’accéder à une profession ou une activité économique, et la liberté dans l’exercice de cette profession et de cette activité10. La décision 507 QPC s’inscrit dans la jurisprudence du Conseil donnant compétence au législateur pour apporter des limitations à la liberté d’entreprendre11.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu’en adoptant le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement prévoyant l’établissement d’une liste de détaillants distribuant des produits pétroliers, comprenant au moins un quart des détaillants répartis sur le territoire pour assurer au mieux les besoins de la collectivité, qui ne peuvent interrompre leur activité, le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général de préservation de l’ordre public économique (cons. 8).
Le Conseil a ensuite relevé que le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement n’est applicable que dans des collectivités d’outre-mer où le secteur des produits pétroliers est soumis à une réglementation des prix et qu’il impose également aux entreprises du secteur de la distribution de gros d’assurer la livraison de produits pétroliers aux détaillants de leur réseau de distribution qui figurent dans la liste arrêtée par le plan. En prévoyant que le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement comprend au moins un quart de ces détaillants, le législateur a confié au représentant de l’État le soin de veiller à ce que ce plan soit adapté aux contraintes propres de la collectivité ultra-marine concernée (cons. 9).
Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées n’apportaient ni une limitation excessive à l’exercice du droit de grève des gérants de stations-service qui sont placés dans une relation de subordination avec un employeur ni une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers (cons. 10).
Enfin, dans sa décision 723 DC du 17 décembre 2015, le Conseil a enfin validé diverses dispositions du PLFSS pour 2016
Premièrement, s’agissant de l’instauration d’une protection universelle maladie, les députés requérants contestaient l’article 59 du PLFSS en ce qu’il provoquait la rupture du lien entre cotisations et prestations instaurée par le législateur. Ils soutenaient qu’en modifiant le fondement des critères d’affiliation, le législateur déliait totalement cotisations, dont le paiement est inhérent à une activité professionnelle, et droit à prestation. Selon les députés, « cela bouleversait les conditions générales d’affiliation et, pour la première fois dans l’histoire de la sécurité sociale, déliait dans son principe même le droit général à prestation et les cotisations ». Serait ainsi méconnue la « nature des cotisations sociales ». Les auteurs de la saisine relevaient aussi que la suppression du lien entre les cotisations acquittées par les assurés sociaux et la prise en charge des frais de santé rendrait également les dispositions de l’article L.111-2-1 du Code de la sécurité sociale inintelligibles.
De manière constante dans sa jurisprudence, et s’appuyant sur le 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles (cons. 19).
Le Conseil a relevé qu’en instaurant un régime d’assurance sociale pour couvrir les charges de maladie et de maternité de l’ensemble des personnes résidant en France de façon stable et régulière ainsi que pour garantir contre les risques susceptibles de réduire ou de supprimer les revenus des travailleurs, le législateur a mis en œuvre les exigences énoncées par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Cette formulation n’est pas sans rappeler celle utilisée dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, Époux L. (cons. 11).
Le Conseil a ensuite noté que, par les dispositions contestées, le législateur a uniquement modifié des règles de gestion de la prise en charge des frais de santé des personnes auxquelles est assurée cette protection sociale. Il a ainsi jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (cons. 20 in fine).
Le Conseil a écarté l’argument tiré de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi au motif que les dispositions contestées ne remettent pas en cause le financement des régimes obligatoires de base d’assurance maladie au moyen de cotisations sociales ainsi que d’impositions de toutes natures dont le produit est affecté à ces dépenses (cons. 21 et 22).
Deuxièmement, s’agissant du maintien du statut d’ayant-droit pour certains mineurs, les députés requérants contestaient au regard du principe d’égalité la disposition qui prévoyait la dérogation au régime unique d’affiliation automatique sous réserve de résidence en France, applicable aux mineurs, qui ouvrait la possibilité pour les enfants mineurs âgés de plus de 16 ans de demander, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à être gérés de manière autonome en tant qu’assurés, ou qui devront l’être s’ils poursuivent des études supérieures.
Le Conseil a rejeté le grief en considérant que les différences de traitement instituées par le législateur étaient en rapport avec l’objectif poursuivi et que le principe d’égalité devant la loi n’était pas méconnu (cons. 24 à 29)12.
Troisièmement, s’agissant des organismes chargés de la prise en charge des frais de santé, les députés requérants contestaient la nouvelle rédaction de l’article L. 160-17 du Code de la sécurité sociale qui, concernant la prise en charge des frais de santé, prévoyait une nouvelle répartition entre les différents organismes de gestion des différentes personnes majeures affiliées. Ils invoquaient une méconnaissance des exigences du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
Le gouvernement indiquait dans ses observations que la délégation de tâches de gestion purement administratives aux mutuelles ne porte aucune atteinte aux dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946. Il rappelait que les caisses de sécurité sociale étaient souvent des organismes de droit privé.
Avec le même raisonnement qu’adopté précédemment pour juger des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 160-1 du Code de la Sécurité sociale, le Conseil a considéré que les dispositions de l’article L. 160-17 instaurent des règles relatives à la gestion de la prise en charge des frais de santé au titre des régimes obligatoires de base d’assurance maladie. En elles-mêmes, de telles dispositions, qui n’introduisent aucune discrimination, ni entre les personnes qui bénéficient de cette protection sociale, ni entre les organismes pouvant se voir déléguer cette gestion, ne méconnaissent pas le principe d’égalité. Elles ne méconnaissent pas davantage les exigences du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (cons. 32).
CR
5 – Les principes du droit répressif
a – Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines (art. 8 de la Déclaration des droits)
Le Conseil constitutionnel rappelle, dans la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 Société Gecop, que les principes résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition. La responsabilité solidaire du donneur d’ordre pour le paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, instituée par les dispositions contestées, n’entre pas dans le champ de l’article 8. Elle constitue une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale, et n’a pas le caractère d’une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789. En effet, conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d’ordre qui s’est acquitté du paiement des sommes exigibles dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires (cons. 8).
La décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015 Uber II fait application du principe de légalité des délits et des peines, méconnu selon les sociétés requérantes parce les dispositions contestées (à savoir le premier alinéa de l’article L. 3124-13 du Code des transports) qui sanctionnaient pénalement toute personne qui organise un système de mise en relation de particuliers en vue d’effectuer une prestation de transport « à titre onéreux », ne précisaient pas les modalités, la destination et la forme de rétribution du service rendu.
Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire. C’est le cas en l’espèce, le législateur ayant défini de manière claire et précise l’incrimination contestée.
Tel est aussi le cas dans la décision n° 2015-490 QPC du 14 octobre 2015 M. Omar K., à propos des dispositions des dixième et onzième alinéas de l’article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure car les conditions nécessaires au prononcé de l’interdiction de sortie du territoire étaient insuffisamment déterminées. Les infractions, qui ne peuvent être constituées que lorsqu’une interdiction de sortie du territoire a été prononcée, sont définies de manière claire et précise (cons. 15).
Les principes résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition, rappelle le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2015-487 QPC du 7 octobre 2015, M. Patoarii R. Les dispositions contestées du paragraphe I de l’article L. 624-5 du Code de commerce, qui instituent un mécanisme ayant pour objet de faire contribuer le dirigeant personne physique au comblement du passif de la personne morale ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines, car l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard du dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire n’a pas le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789.
Les autres principes du droit répressif souvent invoqués dans les décisions publiées au cours de ce semestre intéressent la nécessité et la proportionnalité des peines. Dans la décision n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015 Époux B., à propos du régime de l’amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 61-1 de la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Néanmoins, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. Il en résulte que le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu’une amende fiscale ne puisse être appliquée que si l’Administration, sous le contrôle du juge, l’a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, tout en permettant au législateur de fixer des règles assurant une répression effective de la méconnaissance des obligations fiscales.
L’article 1649 A du Code général des impôts a, par la sanction ayant le caractère d’une punition qu’il a instaurée, entendu faciliter l’accès de l’administration fiscale aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus à l’étranger et a ainsi poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Les sanctions prévues par cet article n’ont pas été jugées manifestement disproportionnées à la gravité des faits qu’il entend réprimer, s’agissant du manquement à une obligation déclarative poursuivant l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (cons. 6). En outre, la loi a assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés en prévoyant deux montants forfaitaires distincts, selon que l’État ou le territoire dans lequel le compte est ouvert a, ou non, conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Enfin, pour chaque sanction prononcée, le juge décide après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’Administration, en fonction de l’une ou l’autre des amendes prononcées, soit de maintenir l’amende, soit d’en dispenser le contribuable si ce dernier n’a pas manqué à l’obligation de déclaration de l’existence d’un compte bancaire à l’étranger. La proportionnalité est ainsi non seulement garantie par la définition par la loi des infractions et des peines encourues par les contribuables mais aussi par les pouvoirs reconnus au juge.
Le principe d’individualisation des peines, qui découle aussi de l’article 8 de la Déclaration des droits implique qu’une sanction ayant le caractère d’une punition infligée par une autorité administrative indépendante exerçant un pouvoir de sanction ne puisse être appliquée que si l’autorité l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ce principe n’est pas méconnu par l’article L. 464-2 du Code de commerce qui laisse à l’Autorité administrative indépendante, le soin de fixer le montant de la sanction pécuniaire, dans la limite du maximum déterminé par les dispositions contestées, et de proportionner cette sanction à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel elle appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées13.
Avec une argumentation identique à celle utilisée dans les décisions précédentes quant au pouvoir du juge constitutionnel et au rôle du législateur, le Conseil constitutionnel a également jugé que les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines doivent être écartés, parce que le législateur a entendu assurer le respect de la réglementation de l’activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux14. Il est possible, néanmoins, de considérer que cet objectif est celui que la loi a fixé et qu’il ne résulte d’aucune exigence constitutionnelle.
Dans la décision n° 2015-489 QPC, du 14 octobre 2015 précitée, le paragraphe I de l’article L. 464-2 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 a institué une sanction pécuniaire destinée à réprimer les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par des entreprises. Le législateur a ainsi poursuivi l’objectif de préservation de l’ordre public économique qui implique que le montant des sanctions fixées par la loi soit suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention des infractions assignées à la punition. Compte tenu des modalités d’application de la sanction, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines (cons. 16).
Pour apprécier l’existence ou l’absence de disproportion entre l’infraction et la peine encourue, le juge constitutionnel doit tenir compte du régime juridique d’exécution de cette peine15. Les dispositions de l’article 786 du Code de procédure pénale qui étaient susceptibles, selon le requérant, de priver une personne condamnée à titre principal à une peine d’interdiction définitive du territoire français de la possibilité de former une demande en réhabilitation judiciaire alors même que cette personne ne bénéficie d’aucune procédure susceptible d’effacer la peine, ne portent pas une atteinte manifeste au principe de proportionnalité des peines (cons. 11). En effet, lorsqu’une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l’emprisonnement ou l’amende, les dispositions contestées font varier le délai à l’issue duquel la réhabilitation peut être obtenue en fonction de la durée de cette peine ou de la nature de l’infraction qu’elle sanctionne. Si le condamné ne peut ni former une demande en réhabilitation judiciaire ni bénéficier d’une réhabilitation légale ou d’un relèvement, il peut toutefois être dispensé d’exécuter la peine s’il est gracié et sa condamnation peut être effacée par l’effet d’une loi d’amnistie. En application de l’article 789 du Code de procédure pénale, il peut bénéficier d’une réhabilitation judiciaire s’il a rendu des services éminents à la France et il bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l’article 769 du Code de procédure pénale qui prévoient le retrait du casier judiciaire des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de 40 ans. C’est l’addition de toutes ces mesures de clémence, tirées de textes de valeur diverse, constitutionnelle et législative, qui conduisent le Conseil à considérer qu’il n’y pas de disproportion entre l’infraction et la peine encourue.
b – Principe de la présomption d’innocence (art. 9 de la Déclaration des droits).
Le principe de la présomption d’innocence est énoncé à l’article 9 de la Déclaration des droits de 1789. En vertu de ce dernier, tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable. Il en résulte qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive. Le grief tiré de la méconnaissance de ce principe manque dans la décision n° 484 précitée car les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’instaurer une présomption de culpabilité (cons. 14).
Dans la décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015, Société Grands Moulins de Strasbourg SA, le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait résulte de la combinaison des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits. Ce principe s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition (cons. 18). Le fait que le maximum de la sanction pécuniaire permettant de réprimer des pratiques anticoncurrentielles commises par une entreprise soit déterminé par référence au chiffre d’affaires du groupe auquel l’entreprise appartient n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner le groupe pour des actes qu’il n’a pas commis et ne peut être une cause d’inconstitutionnalité.
MV
6 – Les droits processuels
a – Le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, l’égalité devant la justice et le principe d’impartialité et d’indépendance des juridictions
Le Conseil constitutionnel reconnaît, sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, un droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif16. Ce droit peut donc être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité17. Sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789, le Conseil reconnaît également le droit à un procès équitable18, le principe du contradictoire19 et les droits de la défense20.
Dans sa décision n° 2015-713 DC précitée, le Conseil a contrôlé le respect de ces exigences. L’article L. 821-1 du CSI prévoit que les techniques de recueil de renseignement définies aux articles L. 851-1 à L. 853-3 du même code sont mises en œuvre sur le territoire national par des agents individuellement désignés et habilités, sur autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la CNCTR (cons 16). Le Conseil a estimé que ces dispositions « ne privent pas les personnes d’un recours juridictionnel à l’encontre des décisions de mise en œuvre à leur égard des techniques de recueil de renseignement » ; elles sont simplement « relatives à la délivrance d’autorisations de mesures de police administrative par le Premier ministre après consultation d’une autorité administrative indépendante » (cons. 20). En conséquence, il considère qu’elles n’ont pas méconnu les exigences de l’article 16 (cons. 20).
Par ailleurs, l’article L. 841-1 du CSI organise la compétence du Conseil d’État pour connaître des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement. Il prévoit que le Conseil d’État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu’elle ne fait pas, ou n’a pas fait, l’objet d’une surveillance irrégulière, sous réserve de l’exercice d’une réclamation préalable auprès de la CNCTR. Le Conseil d’État peut aussi être saisi par la CNCTR lorsqu’elle estime que ses avis ou recommandations n’ont pas été suivis d’effet ou que les suites qui y ont été données sont insuffisantes, ou par au moins trois de ses membres. Enfin, une juridiction administrative ou une autorité judiciaire saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une technique de recueil de renseignement a la faculté de saisir le Conseil d’État à titre préjudiciel (cons. 48). Le Conseil relève que cet article « met en œuvre le droit à un recours juridictionnel effectif » (cons. 49).
Les article L. 773-3 à L. 773-5 sont relatifs à la prise en compte du secret de la défense nationale pour l’organisation de la procédure contradictoire : la CNCTR est informée de toute requête présentée sur le fondement de l’article L. 841-1 du CSI, reçoit communication de l’ensemble des pièces produites par les parties et est invitée à présenter des observations écrites ou orales ; la formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale ; le huis-clos est ordonné lorsqu’est en cause ce secret (cons. 84). La procédure n’est donc pas pleinement contradictoire. En outre, les articles L. 773-6 et L. 773-7 du Code de justice administrative prévoient que : lorsque le Conseil d’État considère qu’aucune illégalité n’entache la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement, la décision se borne à indiquer au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement (cons. 88) ; lorsqu’il constate qu’une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre irrégulièrement ou qu’un renseignement a été conservé illégalement, il est compétent pour annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés, informer la personne intéressée ou la juridiction qu’une illégalité a été commise, sans révéler aucun élément couvert par le secret de la défense nationale. Les requérants faisaient valoir que « la motivation des décisions du Conseil d’État rendues lorsqu’aucune illégalité n’a été commise dans la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement ne permet pas à la personne intéressée de savoir si elle a fait ou non l’objet d’une mesure de surveillance » (cons. 90). Le Conseil constitutionnel a déclaré l’ensemble de ces dispositions conformes à la Constitution en s’appuyant sur l’idée que le secret de la défense serait un principe à valeur constitutionnelle21. Il a estimé que le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire et, d’autre part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, dont participe le secret de la défense nationale (cons. 86 et 91).
Dans la décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015, loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, le Conseil a contrôle la conformité à la Constitution du dispositif de contrôle des mesures de surveillance des communications électroniques internationales. Le quatrième alinéa de l’article L. 854-9 du CSI prévoit que la CNCTR peut contrôler la régularité de la mise en œuvre de ces mesures, de sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune mesure de surveillance n’est ou n’a été mise en œuvre irrégulièrement à son égard. En cas de réclamation, elle indique seulement « qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance » (cons. 16). Le quatrième alinéa de l’article L. 854-9 du CSI est relatif aux pouvoirs dont dispose la commission en cas d’irrégularité : elle peut simplement adresser au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. C’est seulement si le Premier ministre n’a pas donné suite ou a insuffisamment donné suite à cette recommandation, que le président de la commission ou trois de ses membres peuvent saisir le Conseil d’État d’une requête (cons. 17). Dans ces conditions, la personne objet de la surveillance ne dispose donc d’aucune voie de droit pour savoir si elle en fait l’objet et a fortiori pour la contester. Comme l’a relevé le Conseil, « la personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance internationale ne peut saisir un juge pour contester la régularité de cette mesure » (cons. 18). Le Conseil a pourtant déclaré les dispositions conformes au droit à un recours juridictionnel effectif. Il a alors considéré « qu’en prévoyant que la commission peut former un recours à l’encontre d’une mesure de surveillance internationale, le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et le secret de la défense nationale » (cons. 18).
Dans la décision n° 2015-490 QPC du 14 octobre 2015, le Conseil a été conduit à apprécier la conformité à la Constitution du dispositif d’interdiction administrative de sortie du territoire. L’article L. 224-1 du CSI, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014, autorise le ministre de l’Intérieur à prononcer une telle interdiction. Il prévoit également à son sixième alinéa que : « La personne qui fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du Code de justice administrative. ». Le Conseil a estimé que l’intéressé disposait d’un recours obligeant le juge à statuer au fond dans un délai de 4 mois et des procédures de référés suspension et liberté (cons. 9). Le juge administratif est alors chargé d’opérer un contrôle de nécessité et de proportionnalité de la mesure (cons. 9). En conséquence, il considère que le droit à un recours juridictionnel effectif n’a pas été méconnu (cons. 11).
Dans sa décision n° 2015-715 DC précitée, le Conseil a estimé que des dispositions simplifiant les règles de représentation devant les juridictions de l’ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l’ensemble des juridictions de la cour d’appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu’ils ne sont pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie, ne méconnaissent « ni le principe d’égalité devant la justice, ni l’objectif de bonne administration de la justice » (cons. 58).
Selon une jurisprudence constante, le principe du respect des droits de la défense « implique l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties »22. Dans sa décision n° 2015-715 DC précitée, le Conseil a examiné la conformité à ce principe de deux dispositifs permettant à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de rechercher et constater les manquements à l’obligation pour un avocat et pour un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires et prévoyant qu’elle en informe le bâtonnier, dans le premier cas, et le président du Conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le second. Le Conseil a estimé que « ces investigations, conduites dans les conditions prévues par les articles précités du Code de la consommation, ont pour seul objet de déterminer l’existence d’un manquement à l’obligation pour un avocat de conclure une convention d’honoraires » et « par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel » (cons. 63 et 101). Il en a déduit qu’elles ne méconnaissaient donc pas les droits de la défense (cons. 63 et 101).
Dans la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil avait à connaître de l’article 1724 quater du Code général des impôts et des deux premiers alinéas de l’article L. 8222-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2007. Ces dispositions prévoient que le donneur d’ordre, qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du Code du travail, est tenu solidairement responsable avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor public et aux organismes de protection sociale (cons. 3). Il était soutenu qu’en « ne permettant pas au donneur d’ordres de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes mises à la charge de celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, les dispositions contestées méconnaissent les exigences des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 » (cons. 11). Le Conseil, après avoir rappelé le droit à un recours juridictionnel effectif fondé sur l’article 16 de la Déclaration de 1789 (cons. 12) et le principe d’égalité devant la justice fondé sur l’article 6 de la Déclaration de 178923 (cons. 13), a énoncé une réserve d’interprétation sur le fondement de l’article 16 : le donneur d’ordres a le droit de « contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » (cons. 14). Comme souvent, le Conseil préfère émettre une réserve d’interprétation plutôt que de déclarer la disposition non-conforme, mais il crée ainsi une voie de droit qui n’est organisée et définie par aucun texte.
Dans la décision n° 2015-499 QPC du 20 novembre 2015, le Conseil constitutionnel avait à connaître de l’article 308 du Code de procédure pénale (ci-après CPP). Ce dernier prévoit l’enregistrement des débats de la cour d’assises. Cependant, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure (cons. 1). Le Conseil estime que « le législateur a conféré aux parties un droit à l’enregistrement sonore des débats de la cour d’assises » (cons. 4). Il considère alors « qu’en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d’inobservation de cette formalité, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 » (cons. 4). Il semble ainsi inaugurer une nouvelle ligne jurisprudentielle en estimant que le non-respect d’une règle procédurale conférant un droit aux parties doit pouvoir être sanctionnée par l’annulation de la décision.
Dans la décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2016, le Conseil constitutionnel avait à connaître de l’article 99 du CPP. Cet article prévoit que, le procureur de la République, la personne mise en examen, la partie civile ou toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut former une requête en restitution devant le juge d’instruction au cours de l’information ; ce dernier doit statuer par une ordonnance motivée, laquelle peut faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction (cons. 1 et 5). Cependant, aucun délai n’est prévu pour que le juge statue (cons. 7). Le Conseil estime que « l’impossibilité d’exercer une voie de recours devant la chambre de l’instruction ou toute autre juridiction en l’absence de tout délai déterminé imparti au juge d’instruction pour statuer conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 » (cons. 7).
Dans sa décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil a contrôlé la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du Code du travail. Cet article prévoit que, lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait appel à un expert agréé en cas de risque grave dans l’établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail, les frais de l’expertise décidée par le comité sont à la charge de l’employeur (cons. 8). Il prévoit également que l’employeur peut former un recours devant le juge judiciaire afin de contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise (cons. 9). Le Conseil a estimé que l’absence d’obligation pour le juge judiciaire saisi d’un recours de l’employeur de statuer dans un délai déterminé, l’obligation de payer les honoraires correspondant aux diligences accomplies par l’expert alors même qu’il a obtenu l’annulation de la décision et l’absence d’effet suspensif du recours conduisent à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours (cons. 10). Il considère en conséquence que « la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété » (cons. 10).
Sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits, le Conseil constitutionnel considère également que « les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice des fonctions juridictionnelles »24.
Dans sa décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015, le Conseil avait à connaître de la possibilité pour le Conseil de la concurrence de se saisir d’office de certaines pratiques anticoncurrentielles qui est prévue par l’article L. 462-5 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 septembre 2000 (cons 2). Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une autorité administrative indépendante exerce un pouvoir de sanction, les principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doivent être respectés25. Lorsqu’il avait eu à connaître des dispositions du paragraphe III de l’article L. 462-5 du Code de commerce autorisant l’Autorité de la concurrence à se saisir d’office de certaines pratiques ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration, il les avait déclarées conformes à la Constitution26. En ce qui concerne le Conseil de la concurrence, il a relevé que la disposition en cause ne le conduit pas à préjuger la réalité des pratiques susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions ; l’instruction de l’affaire est ensuite assurée sous la seule direction du rapporteur général ; le collège du Conseil de la concurrence est, pour sa part, compétent pour se prononcer sur les griefs notifiés par le rapporteur général et, le cas échéant, infliger des sanctions (cons. 7). Il a donc estimé, comme pour l’Autorité de la concurrence, que « compte tenu de ces garanties légales, dont il appartient à la juridiction compétente de contrôler le respect, la décision du Conseil de la concurrence de se saisir d’office n’opère pas de confusion entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction et, d’autre part, les pouvoirs de sanction » (cons. 6).
Dans la décision n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015, le Conseil constitutionnel estime, pour la première fois, que « le principe du secret du délibéré » découle du principe d’indépendance des juridictions, il lui confère ainsi valeur constitutionnelle (cons. 13). Le Conseil constitutionnel considère que ce principe ne fait pas obstacle à ce que le législateur permette la saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré (cons. 15). Cependant, « il lui appartient de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe d’indépendance peut être mise en œuvre afin que celle-ci demeure proportionnée » (cons. 16). Dans le cas présent, l’article 56 du CPP, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011, ne prévoyait pas à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi par un officier de police judiciaire, lors d’une enquête de flagrance. Il estime donc que « le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent par elles-mêmes le principe d’indépendance des juridictions » (cons. 15).
b – Principe de sécurité juridique
Depuis sa décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, loi de finances pour 2006, le Conseil constitutionnel considère que la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 implique que le législateur ne doit pas porter aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. Depuis sa décision n° 2013-336 QPC en date du 19 décembre 2013, loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, il estime que la garantie des droits implique également que le législateur ne remette pas en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, sans motif d’intérêt général suffisant.
Dans la décision n° 2015-475 QPC du 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel avait à connaître de dispositions, applicables aux résultats des exercices clos à compter de son entrée en vigueur, modifiant des modalités de déduction des moins-values de cession à court terme de titres de participation. Le Conseil a estimé que les dispositions n’avaient pas d’effet rétroactif puisqu’elles n’affectent pas les règles applicables aux cessions réalisées au cours d’exercices clos antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi (cons. 6). Il refuse donc de constater une atteinte à l’article 16 de la Déclaration. Il précise d’ailleurs que « l’acquisition de titres de participation en contrepartie d’un apport ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime quant au traitement fiscal du produit de la cession de ces titres quelle que soit l’intention de leur acquéreur et quel que soit leur prix de cession » (cons. 6), refusant ainsi de faire application de sa jurisprudence relative aux attentes légitimes.
Dans sa décision n° 2015-718 DC précitée, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur pouvait imposer que la majorité du capital d’un éco-organisme constitué sous forme de société soit détenue par des producteurs, importateurs et distributeurs représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés. Cependant, en imposant une telle obligation nouvelle aux sociétés et à leurs associés et actionnaires sans que soient prévues des garanties de nature à assurer la protection du droit de propriété et de la garantie des droits, qui ne sauraient relever du décret en Conseil d’État prévu par le paragraphe X de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement dans lequel les dispositions contestées s’insèrent, le législateur a porté atteinte au droit de propriété et à la garantie des droits (cons. 36).
Dans sa décision n° 2015-723 DC précitée, le Conseil constitutionnel a, après avoir rappelé qu’il ne lui appartenait pas « de se prononcer sur le défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France », estimé que « l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 n’a pas fait naître de situations légalement acquises auxquelles seraient susceptibles de porter atteinte les dispositions contestées » (cons. 9), en l’occurrence l’article 24 de la LFSS ayant notamment pour objet d’affecter le produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement de prestations sociales non contributives.
MB
Notes de bas de pages
-
1.
V. dans le même sens, Cons. const., 12 nov. 2010, n° 2010-60 QPC, M. Pierre B.
-
2.
V. dans le même sens, Cons. const., 7 juin 2013, n° 2013-319 QPC, Philippe B.
-
3.
Cons. const., 5 août 2010, n° 2010-612 DC, loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale.
-
4.
L. n° 64-690, 8 juill. 1964, modifiant la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux.
-
5.
V. pour un précédent, Cons. const., 26 mars 2015, n° 2015-460 QPC, Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et a.
-
6.
V. pour rappel, Cons. const., 6 mars 2015, n° 2014-456 QPC, Sté Nextradio TV.
-
7.
Pour une imposition sur les retraites chapeau due par le bénéficiaire d’une rente viagère, v. Cons. const., 13 oct. 2011, n° 2011-180 QPC, M. Jean-Luc O. et a.
-
8.
Cons. const., 29 avr. 2004, n° 2004-494 DC, loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, cons. 7 et 8 ; Cons. const., 28 avr. 2005, n° 2005-514 DC, loi relative à la création du registre international français, cons. 25 ; Cons. const., 28 déc. 2006, n° 2006-545 DC, loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, cons. 4.
-
9.
Cons. const., 28 juill. 1987, n° 87-230 DC, loi portant diverses mesures d’ordre social, cons. 7 ; Cons. const., 22 oct. 1982, n° 82-144 DC, loi relative au développement des institutions représentatives du personnel, cons. 9 ; Cons. const., 25 juill. 1979, n° 79-105 DC, loi modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail, cons. 2.
-
10.
Cons. const., 24 juin 2011, n° 2011-139 QPC, Association pour le droit à l’initiative économique ; Cons. const., 30 nov. 2012, n° 2012-285 QPC, M. Christian S., cons 7.
-
11.
Cons. const., 16 janv. 2001, n° 2000-439 DC, loi relative à l’archéologie préventive, cons. 4 ; Cons. const., 12 mai 2010, n° 2010-605 DC, loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, cons. 24.
-
12.
V. cette chronique, III. B. 3 : le principe d’égalité.
-
13.
Cons. const., 14 oct. 2015, n° 2015-489 QPC, Sté Grands Moulins de Strasbourg SA, cons. 21.
-
14.
Cons. const., 22 sept. 2015, n° 2015-484 QPC, préc., Uber II, cons. 12.
-
15.
Cons. const., 27 nov. 2015, n° 2015-501 QPC, M. Anis T.
-
16.
Implicitement : Cons. const., 21 janv. 1994, n° 93-335 DC, loi portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction et, explicitement ; Cons. const., 9 avr. 1996, n° 96-373 DC, loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française .
-
17.
Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC.
-
18.
V. par ex. Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, cons. 11.
-
19.
V. par ex. Cons. const., 13 mai 2011, n° 2011-126 QPC, Société Système U Centrale Nationale et a.[action du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence], cons. 6.
-
20.
V. par exemple Cons. const., 30 mars 2006, n° 2006-535 DC, loi pour l'égalité des chances, cons. 24.
-
21.
Après l'avoir fondé, de manière très peu convaincante, sur la charte de l'environnement (Cons. const., 10 nov. 2011, n° 2011-192 QPC, Mme Ekaterina B., épouse D., et a. [secret défense], cons. 20), le Conseil a fini par se « rabattre », de manière toute aussi insatisfaisante, sur les articles 5 et 21 de la Constitution (Cons. const., 23 juill. 2015, n° 2015-713 DC, préc.).
-
22.
Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier cons. 44.
-
23.
V. par ex. Cons. const., 20 janv. 2005, n° 2004-510 DC, loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, cons. 22.
-
24.
Cons. const., 26 mars 2006, n° 2010-110 QPC.
-
25.
V. par ex. : Cons. const., 12 oct. 2012, n° 2012-280 QPC, Sté Groupe Canal Plus et a. [Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction], cons. 16.
-
26.
Idem, cons. 20