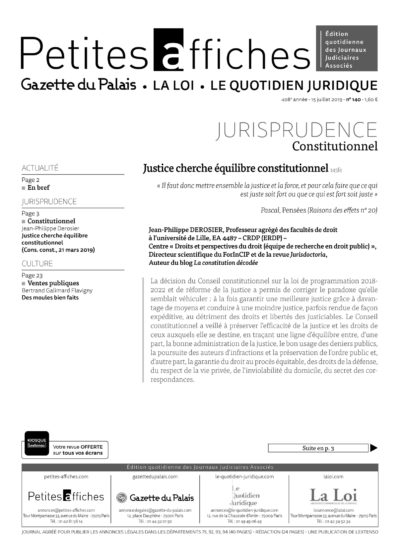Justice cherche équilibre constitutionnel
La décision du Conseil constitutionnel sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a permis de corriger le paradoxe qu’elle semblait véhiculer : à la fois garantir une meilleure justice grâce à davantage de moyens et conduire à une moindre justice, parfois rendue de façon expéditive, au détriment des droits et libertés des justiciables. Le Conseil constitutionnel a veillé à préserver l’efficacité de la justice et les droits de ceux auxquels elle se destine, en traçant une ligne d’équilibre entre, d’une part, la bonne administration de la justice, le bon usage des deniers publics, la poursuite des auteurs d’infractions et la préservation de l’ordre public et, d’autre part, la garantie du droit au procès équitable, des droits de la défense, du respect de la vie privée, de l’inviolabilité du domicile, du secret des correspondances.
Cons. const., 21 mars 2019, no 2019-778 DC, loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice
Autrefois chien de garde de l’exécutif, devenu gardien de la constitution, on le croyait assoupi depuis quelques temps. Mais le gardien se réveilla et la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice1, adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 18 février 2019, nous rappela que le Conseil constitutionnel est effectivement l’ultime rempart face aux atteintes à la constitution par le Parlement et, à travers lui, par le gouvernement. Il faut dire qu’il ne nous avait plus habitué à une telle vigilance constitutionnelle, entre la validation de la loi sur le secret des affaires2 ou celle sur la manipulation de l’information3, en passant, surtout, par la décision sur la loi Asile et immigration, par laquelle il a notamment reconnu conforme à la constitution une différenciation des règles d’acquisition de la nationalité française, à partir d’un critère territorial4. S’agissant de la première décision rendue depuis l’entrée en fonction de Jacques Mézard, François Pilet et Alain Juppé, certains pourraient y voir un effet de leurs nominations, ce qui confirmerait le devoir d’ingratitude du nommé à l’égard du nommant. Ce serait faux car, parmi les trois, seul Alain Juppé a siégé, les deux autres s’étant déportés face à une loi dont ils ont eu à connaître au cours de leurs précédentes fonctions.
La décision rendue le 21 mars 2019 par le Conseil constitutionnel se distingue déjà sur un plan strictement formel, étant la décision de tous les records, ou presque. Ses 395 paragraphes (autrefois « considérants »), sur 93 pages en font la plus longue de l’histoire, tandis que son dispositif s’étend sur quatre pages et demi, en raison du nombre de dispositions attaquées. Ce ne sont pas moins de quatre saisines distinctes qui furent adressées au Conseil, signées par un total de 344 parlementaires5. Éléments purement statistiques, ils ne laissent cependant pas de susciter des commentaires. En effet, si rien n’interdit que plusieurs saisines parallèles soient déposées contre une loi, se pose la question du point de départ effectif du délai d’un mois dont dispose le Conseil pour rendre sa décision6 : aucune disposition constitutionnelle ou organique ne le précise et le Conseil retient habituellement la date de dépôt de la première saisine.
Mais le délai étant déjà restreint par nature, on peut imaginer la difficulté dans laquelle le Conseil serait plongé si, dans le cas d’une loi longue et technique, il était saisi d’une première requête déposée le jour de l’adoption définitive de la loi et d’une dernière déposée à l’expiration du délai de quinze jours, dont disposent les parlementaires pour le saisir7. Une solution serait de faire débuter ce délai à compter du dépôt de la dernière saisine et plusieurs raisons peuvent plaider en ce sens. Pratique, d’abord, car cela éviterait au Conseil d’être enfermé dans un délai ne lui permettant pas d’effectuer valablement son office. Procédurale, ensuite, car les saisines sont transmises au gouvernement, qui formulent des observations, puis soumises au rapporteur : or ces observations ne peuvent effectivement être formulées qu’à partir du moment où tous les arguments de tous les requérants sont connus. Juridique, enfin, car le gouvernement a la possibilité, en cas d’urgence, de ramener le délai de 1 mois à 8 jours : si ce délai débutait à la première saisine, déposée le jour de l’adoption de la loi, celle-ci aurait pour conséquence d’enfermer d’autres requérants dans un délai bien plus court que celui que leur offre la constitution.
À cela s’ajoute une interrogation sur les saisines elles-mêmes qui, parfois, multiplient les dispositions attaquées. En effet, ce ne sont pas moins de 56 articles qui étaient partiellement ou totalement contestés par les quatre saisines, ainsi que la procédure d’adoption de la loi. Mais l’une d’entre elles contestait 52 dispositions à elle seule, sans que les moyens soulevés soient systématiquement étayés, laissant supposer que les requérants n’y croyaient guère eux-mêmes. D’ailleurs, plus que 52, elle contestait 54 dispositions (portant le total des dispositions contestées à 58), mais le Conseil constitutionnel en a écarté deux d’entre elles, concernant les articles 80 et 818.
Une telle multiplication peut avoir des conséquences préjudiciables aux justiciables dont les requérants se veulent pourtant les défenseurs, car le Conseil constitutionnel est alors amené à examiner les dispositions contestées, pour les déclarer conformes à la constitution, empêchant ainsi que de futures questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ne soient soulevées, à moins de parvenir à justifier un changement de circonstances, ce qui n’est guère aisé. Afin de contenir de telles conséquences, le Conseil a renoué avec une ancienne pratique en examinant certaines dispositions contestées, sans les déclarer expressément conformes dans les motifs, ni les inscrire dans le dispositif. Il en est ainsi des dispositions concernant les majeurs protégés (articles 9, 10, 12, 29 et 30), le divorce par consentement mutuel (article 22), les litiges relatifs au secret des affaires (article 41) et des modalités d’exécution de l’article 71 de la loi qui modifie des dispositions relatives aux peines, notamment correctionnelles (article 82).
Sous couvert d’excès de zèle, ici purement politique et non juridique, les parlementaires diminuent en réalité les chances de voir leurs prétentions un jour satisfaites par une autre voie, la QPC, celle-là purement juridique et non politique. D’autant plus que, à multiplier ainsi des saisines peu argumentées, ils risquent de s’exposer, au mieux, à ce que le Conseil décide d’autorité de ne plus examiner pleinement les dispositions contestées devant lui dans le cadre d’un recours a priori (ce qui est marginalement le cas en l’espèce) et, au pire, à ce que ce recours lui-même soit supprimé. Il n’y a pas ici d’autre solution à proposer que celle d’en appeler à la bonne conscience des parlementaires, qui seraient bien avisés de mener le combat politique seulement en séance, pour se réserver un combat juridique au Conseil : leurs électeurs et les justiciables ne leur en seront que davantage reconnaissants.
C’est toutefois sur le fond que cette décision mérite la plus grande attention, même si sa longueur aura raison d’un commentaire exhaustif et justifie donc qu’il soit sélectif. Certains articles, vivement contestés sur le plan politique, ont été validés par le Conseil, sans surprise : c’est notamment le cas de l’habilitation à réformer, par ordonnance, les règles relatives à la justice pénale des mineurs9. Alors que dans de récentes décisions, de telles habilitations avaient été censurées faute, pour le législateur, d’avoir défini avec une précision suffisante les finalités de l’habilitation10, le gouvernement avait veillé, en l’espèce, à circonscrire clairement le domaine d’intervention et la finalité des mesures qu’il se proposait de prendre. Si les parlementaires peuvent donc déplorer la multiplication du recours aux ordonnances, sur des sujets importants et sensibles, ils ne peuvent le contester constitutionnellement, dès lors que les conditions de l’habilitation sont respectées.
Au-delà, composée de 110 articles, cette loi nourrissait bien d’autres objectifs. Ce sont certaines modalités de mise en œuvre de deux d’entre eux qui n’ont pas résisté à l’examen de leur constitutionnalité. Un premier objectif de la loi était de simplifier et d’alléger l’organisation et les procédures juridictionnelles, ce qui ne saurait toutefois se faire au détriment des droits des justiciables à voir leur cause entendue par des tribunaux impartiaux, en disposant des moyens de faire valoir leur défense. Le gouvernement peut donc simplifier la justice, mais l’État ne saurait se désengager de la justice. Un deuxième objectif de la loi était de renforcer les pouvoirs d’enquête, ce qui ne peut cependant pas opérer sans considération de la gravité et de la complexité de l’infraction poursuivie. Ici, la préservation de la sécurité collective se heurte au respect de la vie privée des individus. En définitive, cette loi de réforme de la justice tendait à rompre certains équilibres que le Conseil constitutionnel a donc dû rappeler, entre volonté de simplification et exigence de justice (I), entre garantie de la sécurité collective et respect de la vie privée (II). Au moment même de livrer la version finale de cette brève réflexion, nous revient à l’esprit l’une des Pensées de Blaise Pascal, qui figure au fronton de la faculté de droit de l’université de Lille et qui ne pouvait pas mieux guider et expliquer l’équilibre auquel a veillé le Conseil constitutionnel : que la justice soit forte, que la force soit juste.
I – Que la justice soit forte, ou simplifier sans se désengager
La loi entend simplifier le fonctionnement de la justice, qu’il s’agisse de la procédure civile, administrative ou pénale. Cela se traduisait notamment par un allégement des compétences des magistrats, permettant d’accélérer les procédures, donc de gagner du temps, et donc, de l’argent. Ce même souci, qui participe de la bonne administration de la justice et du bon usage des deniers publics, tous deux objectifs de valeur constitutionnelle, justifiait également une certaine réorganisation de l’audience. Néanmoins, ces objectifs ne sauraient être atteints au détriment des droits des justiciables à une justice impartiale et respectueuse de leurs droits de la défense, impliquant que la justice soit non seulement présente (A), mais aussi visible (B).
A – Préserver la présence de la justice
Sur certains points, la loi paraissait véhiculer un paradoxe. D’une part, en tant que loi de programmation, elle vient renforcer les moyens de la justice, sur le plan humain et budgétaire, afin de « lui permettre d’accomplir les réformes nécessaires à l’amélioration du service dû à nos concitoyens »11. D’autre part, on y relevait un certain recul de la fonction juridictionnelle, du rôle du juge et, partant, de l’autorité judiciaire, qui se concrétisait tantôt par un retrait des magistrats du siège, tantôt par une disparition des magistrats du parquet. Saisi de certains de ces reculs, le Conseil ne les a pas tous censurés.
Il valide ainsi le recul de la présence du magistrat du parquet opéré par l’article 48 de la loi qui fait de la présentation devant un procureur, en cas de prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures, une simple faculté et non plus une obligation à laquelle il était possible de déroger à titre exceptionnel. La présentation devant ce magistrat pouvait être considérée comme une modalité essentielle du respect de la liberté individuelle, au sens de l’article 66 de la constitution, en ce qu’elle lui permettait d’assurer un contrôle effectif du déroulé de cette garde à vue en entendant le prévenu. Le Conseil retient cependant que les droits de la défense du gardé à vue ne sont pas méconnus, le magistrat conservant le contrôle du déroulement de la garde à vue et la faculté d’ordonner à tout moment que la personne concernée soit présentée devant lui12.
De même, il valide la suppression du pouvoir du magistrat du siège d’homologuer une composition pénale, dès lors qu’elle concerne un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans et qu’elle porte sur une amende n’excédant pas le montant prévu pour les contraventions, soit 3 000 €. Dans ce cas, la composition est exclusivement le fait du procureur de la République, ce qui est contraire au principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement, pourtant bien ancré dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel13. Il découle en effet du principe d’impartialité des juridictions, lui-même issu de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 178914. Mais le Conseil s’appuie ici sur le seuil, tant de la peine encourue que du montant de la composition – et l’on suppose que c’est surtout ce dernier qui a emporté sa conviction –, pour considérer que ce principe n’est pas remis en cause ou, plus précisément, que l’atteinte dont il fait l’objet est contrebalancée par « les exigences d’une bonne administration de la justice et d’une répression effective des infractions »15. Le même raisonnement l’avait préalablement conduit à valider l’extension du champ de l’amende forfaitaire délictuelle.
À l’inverse, il a censuré deux autres reculs : celui d’un magistrat du siège, au profit des caisses d’allocations familiales (1) et celui d’un magistrat du parquet, au profit des officiers et agents de police judiciaire (2), indiquant ainsi que ce n’est pas tant le recul que la disparition de l’autorité judiciaire qui conduit à une contrariété à la constitution.
1. La loi prévoyait, certes à titre expérimental, que les caisses d’allocations familiales (CAF) délivrent des titres exécutoires sur la modification du montant de la pension alimentaire (plus exactement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants). En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil et de l’article 1084 du Code de procédure civile, cette compétence relève aujourd’hui du juge aux affaires familiales. S’agissant d’une expérimentation, d’une durée de 3 ans et dans certains départements seulement, ce dessaisissement du juge au profit d’organismes de droit privé chargés d’une mission de service public ne pouvait être contesté sur le terrain d’une rupture d’égalité. C’est donc sur celui de l’impartialité des juridictions que le Conseil s’est appuyé pour la censurer.
La loi prévoyait malgré tout que les CAF devaient agir « en application d’un barème national ». Mais les enjeux attenants aux montants des pensions alimentaires sont tellement nombreux et variables qu’un tel barème ne pouvait servir de référent global mais, au mieux, de source d’inspiration. Ils dépendent effectivement de la situation personnelle et professionnelle de chacun des parents, du montant de leurs rémunérations, des autres personnes qu’ils pourraient avoir à charge, de l’âge des enfants, de leur lieu de résidence, etc. Surtout, ces montants peuvent faire l’objet d’un désaccord entre les parents et leur fixation ou leur révision doit alors relever d’un organe impartial.
Pour autant, le principe même de confier des fonctions juridictionnelles à des organes non juridictionnels n’est pas contraire à la constitution. Mais, dans ce cas, le Conseil s’assure toujours que des garanties d’impartialité soient instituées par la loi. En effet, le principe d’impartialité est indissociable des fonctions juridictionnelles16. Le Conseil veille alors à ce que « ni le législateur, ni le gouvernement, non plus qu’aucune autorité administrative » n’y empiète, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs17. Au stade de l’avis sur le projet de loi, le Conseil d’État avait d’ailleurs relevé qu’il était nécessaire de prévoir « les garanties de compétence et d’impartialité que devront présenter les personnels affectés à cette activité » au sein des CAF18.
Or la loi se contentait d’indiquer que des « garanties d’impartialité » devront être respectées, sans rien dire de leurs modalités. Elle ne prévoyait ainsi aucune garantie légale à l’exigence constitutionnelle d’impartialité, d’autant moins qu’en vertu des articles L. 523-1 et suivants et L. 581-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les CAF doivent parfois se substituer à un parent mauvais payeur, qui ne verserait pas ou ne verserait que partiellement la pension alimentaire qu’il doit. Elles pourraient donc avoir un intérêt direct et personnel à réévaluer le montant de cette pension alimentaire, comme l’a d’ailleurs relevé le Conseil dans sa décision, pour conforter la censure de cette disposition, faute « de garanties suffisantes au regard des exigences d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 »19.
2. L’article 47, VI, de la loi prévoyait, quant à lui, que le procureur n’avait plus à donner son autorisation pour certaines réquisitions, formulées par des officiers ou même des agents de police judiciaire et adressées à un organisme public ou à toute autre personne, si leur exécution donnait lieu à des frais de justice inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire. En pratique, cela aurait permis à tout officier ou agent de police judiciaire (un policier stagiaire, par exemple) d’obtenir des informations personnelles et, le cas échéant, sensibles d’individus, auprès de l’administration fiscale, de la caisse nationale d’assurance maladie, de la caisse nationale des allocations familiales. Cela aurait alors opéré sans le moindre contrôle ni la moindre supervision, car ils n’auraient pas eu à informer quiconque et les agents n’auraient pas été placés sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, comme c’est le cas pour d’autres procédures.
On aurait pu admettre que les objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et du bon usage des deniers publics requièrent un accès facilité à des données détenues par des organismes publics. Mais des économies en matière de justice ne sauraient opérer au prix d’exigences constitutionnelles fondamentales, telles que le placement de la police judiciaire sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire, qui participe de la garantie de la liberté individuelle. En effet, outre contrevenir au droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 2 de la DDHC, cette disposition portait surtout atteinte à ce principe du placement de la police judiciaire sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire, que le Conseil déduit de l’article 66 de la constitution, qui préserve la liberté individuelle20.
Et c’est incontestablement cette dernière que le Conseil s’est attaché à préserver, dans l’ensemble de sa décision, car il censure ici l’effacement total de la présence de l’autorité judiciaire, alors qu’il a validé le seul effacement d’un magistrat du siège, en faveur d’un magistrat du parquet, à propos de l’homologation de la composition pénale (v. supra).
B – Préserver la visibilité de la justice
La même dynamique et les mêmes objectifs de valeur constitutionnelle (bonne administration de la justice, bon usage des deniers publics) présidaient à une réorganisation de certaines audiences et, en particulier, à la question de débats à huis clos ou à la possibilité d’organiser des procédures sans audience (1) et au recours accru à la vidéo-audience (2).
1. Le principe de publicité des audiences juridictionnelles découle directement du principe démocratique : c’est parce que la justice est rendue au nom du peuple qu’elle doit être rendue devant le peuple. Pour autant, certaines circonstances peuvent justifier qu’une audience se tienne à huis clos. Le Conseil constitutionnel avait déjà reconnu un principe constitutionnel de publicité des audiences, en le limitant à la matière pénale et en ce qu’il résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la DDHC. Initialement limité à « une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté »21, il a récemment été étendu à toute la matière pénale, « sauf circonstances particulières nécessitant, pour un motif d’intérêt général, le huis clos »22.
La décision du 21 mars 2019 l’étend désormais à l’ensemble des juridictions, puisqu’elle vient reconnaître « le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives [auquel] il est loisible au législateur d’apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles, justifiées par l’intérêt général ou tenant à la nature de l’instance ou aux spécificités de la procédure, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi »23. Cela met la jurisprudence du Conseil davantage en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui pose, en son article 6, le principe de la publicité des audiences, sans distinguer la matière pénale de la matière civile. Une telle reconnaissance s’imposait d’autant plus qu’il n’y avait pas de divergence justifiant, sur ce point particulier, que la matière pénale bénéficie d’un traitement spécifique vis-à-vis de la matière civile ou administrative.
Le Conseil constitutionnel confère ainsi à ce principe de publicité des audiences en matière civile et administrative un fondement quasi-identique à celui relatif à la matière pénale, en ce qu’il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, les articles 8 et 9 étant propres au droit pénal. Un autre fondement s’offrait pourtant au Conseil, sur lequel il a choisi de ne pas s’appuyer : il aurait pu identifier un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR). On connaît les conditions nécessaires à ce qu’un tel principe puisse être reconnu : il doit bénéficier d’un support législatif, donc d’une loi, qui doit avoir été adoptée sous un régime républicain, antérieur à l’entrée en vigueur de la constitution du 27 octobre 1946. Par ailleurs, ce principe ne doit jamais avoir fait l’objet d’une remise en cause depuis son adoption et la norme qui en est le support doit être suffisamment générale et non contingente24.
Tel est le cas du principe de la publicité des audiences juridictionnelles. En effet, l’article 14 de la loi des 16 et 24 août 1790 reconnaissait déjà que, « en toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics ». S’il est incontestable que cette loi a été adoptée à une époque où la France était encore une monarchie, cela n’a pas empêché le Conseil de s’y référer pour identifier le PFRLR de l’existence de la juridiction administrative25. De surcroît, le principe de publicité des audiences a été repris ensuite par des textes républicains, de valeur constitutionnelle. D’abord, l’article 208 de la constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) a posé que « les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent en secret ; les jugements sont prononcés à haute voix ». Ensuite, l’article 81 de la constitution du 4 novembre 1848 a reconnu que « les débats [du pouvoir judiciaire] sont publics, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ». Alors que toutes les conditions paraissaient réunies pour reconnaître la publicité des audiences en tant que PFRLR, le Conseil a préféré ne pas s’aventurer dans cette voie et confirmer la proximité, en cette matière, entre les instances pénale, civile et administrative en retenant un fondement constitutionnel (partiellement) identique.
La reconnaissance de ce principe constitue le principal apport de la décision en cette matière, le Conseil ne prononçant aucune censure sur son fondement. Il est néanmoins essentiel à l’heure où le législateur cherche parfois à désincarner et à accélérer la justice. Tel est le cas de la procédure résultant de l’article 26 de la loi, qui étend les possibilités de juger sans audience, en matière civile. Si le Conseil ne prononce ni censure ni réserve à son égard et ne se réfère donc pas, ici, à ce principe constitutionnel qu’il reconnaît plus avant dans sa décision (à l’égard de l’article 33, qui réformait le huis clos en matière civile), il veille toutefois à bien préciser le sens de la loi, en indiquant qu’il n’est possible de recourir à une telle procédure sans audience qu’à l’initiative et donc avec l’accord exprès des parties.
2. À l’inverse, l’extension de la vidéo-audience se heurte à un frein de la part du Conseil constitutionnel et c’est heureux. Il en avait validé l’extension à certains contentieux des étrangers, opérée par la loi Asile et immigration, sans que la justification paraisse parfaitement fondée ni sa motivation parfaitement limpide26. En l’espèce, alors que l’article 54, X, de la loi étendait la possibilité d’imposer une vidéo-audience à un prévenu placé en détention provisoire, lorsqu’il s’agissait de statuer sur la prolongation de son placement en détention, le Conseil censure le dispositif. Ici encore, c’étaient les objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et du bon usage des deniers publics qui justifiaient de supprimer l’accord du prévenu pour recourir à la vidéo-audience, alors même qu’elle ne serait pas justifiée par des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.
Par nature, en supprimant la confrontation humaine entre le juge et le prévenu, cette vidéo-audience porte atteinte au droit au procès équitable, aux droits de la défense et au droit à exercer un recours juridictionnel effectif, dont la garantie constitutionnelle est issue de l’article 16 de la DDHC27. Néanmoins, la possibilité de recourir à la vidéo-audience, y compris sans le consentement de l’intéressé, est déjà prévue et autorisée par l’article 706-71 du Code de procédure pénale. Toutefois, le Conseil n’en avait encore jamais spécifiquement examiné la constitutionnalité, dans ce cadre particulier de la procédure pénale et n’en avait admis et validé la possibilité que dans le contentieux des étrangers, en la subordonnant initialement au consentement de l’intéressé28, pour l’admettre ensuite lorsque le requérant se trouvait en outre-mer29 et, dernièrement, lors de la loi Asile et immigration (v. supra).
Le Conseil avait ainsi relevé que « le recours à ces moyens de communication audiovisuelle est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet (…) et située dans des locaux relevant du ministère de la Justice »30. Ces garanties légales étaient considérées comme indispensables pour permettre le respect du droit au procès équitable et des droits de la défense31 et c’est donc sans surprise que le Conseil retient que, « eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent dans le cadre d’une procédure de détention provisoire et en l’état des conditions dans lesquelles s’exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense »32. Il confirme ainsi dans une décision ce qu’il annonçait déjà dans un commentaire, à savoir que, « en faisant ainsi référence aux caractéristiques des procédures en cause, le Conseil constitutionnel a entendu signifier que sa décision ne saurait être comprise comme permettant au législateur, dans tout contentieux et en toute hypothèse, de recourir à des dispositifs de vidéo-audience sans le consentement de l’intéressé »33. Les économies en matière de justice ne sauraient définitivement pas se faire au prix des droits des justiciables et de la présence réelle et physique de la justice.
II – Que la force soit juste, ou protéger sans excéder
Non plus dans un souci de simplification des procédures, mais afin de renforcer l’efficacité de l’enquête pénale, la loi élargissait ou octroyait de nouvelles prérogatives aux enquêteurs. Le législateur se prévalait également d’objectifs constitutionnels, puisqu’il agissait afin de prévenir des atteintes à l’ordre public et de rechercher des auteurs d’infractions, ce qui est nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle34. Mais l’usage systématique de techniques d’enquête intrusives les rend excessives, en particulier au regard de la liberté d’aller et venir, du droit au respect de la vie privée, de l’inviolabilité du domicile et du secret des correspondances. Par conséquent, le recours à des techniques spéciales d’enquête (A) ou l’extension des pouvoirs des enquêteurs, notamment dans le temps (B) doivent être encadrés, justifiés et proportionnés.
A – Des enquêtes aux techniques proportionnées
La loi prévoyait l’extension de techniques d’enquête que le Conseil constitutionnel a jugées excessives au regard du droit au respect de la vie privée, du secret des correspondances et de l’inviolabilité du domicile. Il s’agissait de l’interception des communications électroniques (1) et de ce qui est communément appelé les « techniques spéciales d’enquête »35 (2), qui obéissaient à des régimes relativement similaires et prévoyaient un régime d’urgence, dérogatoire.
1. L’article 44 de la loi permettait de recourir à des interceptions des communications électroniques, dans le cadre d’une enquête portant sur un crime ou un délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement, dès lors qu’elles étaient exigées par les nécessités de l’enquête et autorisées par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République. Ce procédé était ainsi généralisé à la quasi-totalité des crimes et des délits de droit commun, alors qu’il n’est actuellement autorisé que pour les crimes et les délits les plus graves et complexes. Surtout, en cas d’urgence et dans certains cas énumérés par la loi (risque imminent d’atteinte grave aux personnes, risque imminent de dépérissement des preuves portant sur un crime ou une infraction commis en bande organisée), l’autorisation pouvait être délivrée par le seul procureur et devait être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de 24 heures, par une ordonnance motivée.
En elles-mêmes, ces interceptions de correspondances électroniques portent atteinte à la vie privée et au secret des correspondances, dont le respect est constitutionnellement garanti en ce qu’ils résultent des articles 2 et 4 de la DDHC36. Elles peuvent toutefois être autorisées, le Conseil veillant alors au respect de deux conditions : la gravité des infractions poursuivies et la complexité de leur poursuite37. Tel est le cas des infractions commises en bande organisée ou de la délinquance financière, notamment certains délits de corruption ou de trafic d’influence, de fraude fiscale aggravée ou douaniers38. Le Conseil se montre particulièrement vigilant sur ce point, ce qui l’a conduit à émettre une réserve d’interprétation quant à leur utilisation à l’égard du vol commis en bande organisée, qui ne porte pas, en soi, une atteinte grave à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes : cette technique ne peut être utilisée dans ce cadre que si ledit vol « présente des éléments de gravité suffisants pour justifier les mesures dérogatoires en matière de procédure pénale [et], dans le cas contraire, ces procédures spéciales imposeraient une rigueur non nécessaire au sens de l’article 9 de la Déclaration de 1789 »39.
La loi abandonnait purement et simplement ces deux critères. D’une part, en autorisant d’y recourir pour tous les délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement, soit la quasi-totalité des délits de droit commun, à l’exception des infractions routières, des dégradations légères et des délits d’outrage et de rébellion, exit le critère de la gravité. D’autre part, en ne prévoyant aucune exigence quant à la complexité de la poursuite des infractions commises, qu’il s’agisse des crimes ou des délits, exit le critère de la complexité. Le Conseil n’aurait donc pu valider cette disposition que s’il faisait évoluer sa jurisprudence, ouvrant alors la porte à une généralisation de techniques d’enquête intrusives et attentatoires aux droits et libertés. En rappelant au contraire que « si une infraction d’une particulière gravité et complexité est de nature à justifier le recours à de telles mesures, tel n’est pas nécessairement le cas d’infractions ne présentant pas ces caractères »40, il s’érige en garant effectif de ces droits et libertés, même dans un contexte où la sécurité publique est devenue un sujet politique essentiel.
À cela s’ajoute l’absence de supervision d’un magistrat du siège, qui devait certes autoriser le recours à cette technique, mais n’avait pas accès à l’ensemble des éléments de la procédure ni ne disposait de la possibilité d’ordonner la cessation des interceptions. Surtout, il disparaissait presque totalement du processus en cas d’urgence, car l’autorisation émanait alors du seul procureur de la République, le juge des libertés et de la détention étant seulement appelé à la confirmer dans un délai de 24 heures. Pendant ce délai, aucun contrôle d’un magistrat du siège ne pouvait opérer. Ces deux aspects heurtaient de front des exigences constitutionnelles, qu’il s’agisse des droits précédemment évoqués ou de la nécessité que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire.
À l’égard du procédé d’urgence, le législateur s’était inspiré d’un procédé similaire, mais dont les divergences ont précisément motivé la censure en l’espèce. En matière de géolocalisation, l’article 230-35 du Code de procédure pénale permet qu’« en cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens », les opérations de géolocalisation « peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire [qui] en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d’instruction », lequel peut en ordonner la mainlevée. Lors de son examen et de sa validation, le Conseil avait rappelé les garanties qui l’encadraient, précisées par la loi : l’information immédiate, par tout moyen, du procureur ou du juge et la possibilité, pour ce dernier, d’en ordonner la mainlevée41. Ici, alors que les interceptions de communications électroniques sont plus intrusives que la géolocalisation, le juge n’est pas informé immédiatement, mais dans un délai de 24 heures, ce qui le prive de tout contrôle sur les actes accomplis, pendant les premières heures. Dès lors, le juge du siège ne pouvait plus exercer la plénitude de son contrôle en cas d’urgence, alors qu’il s’agissait de l’hypothèse où le risque d’atteinte aux libertés fondamentales était le plus fort, en particulier concernant le droit au respect de la vie privée et le droit au secret des correspondances. C’est ce que retient donc le Conseil en relevant que le procédé est dépourvu « des garanties permettant un contrôle suffisant par le juge du maintien du caractère nécessaire et proportionné de ces mesures durant leur déroulé »42.
2. Le même raisonnement va conduire à la censure du dispositif prévu à l’égard des techniques spéciales d’enquête, encore plus intrusives que la technique précédente. Sans aller jusqu’au même type d’extension que dans le cas précédent, l’article 46 de la loi autorisait d’y recourir pour tous les crimes et pour les délits commis en bande organisée, là où elles ne peuvent être actuellement utilisées que pour les crimes et délits commis en bande organisée. En d’autres termes, la loi maintenait le double critère de la gravité et de la complexité de l’infraction à l’égard des délits, mais faisait de la seule qualification de crime le critère justifiant de recourir à ces techniques spéciales d’enquête.
En permettant notamment de procéder, « sans le consentement des intéressés, [à] la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé »43, ces techniques portent atteinte au droit au respect de la vie privée et au droit au secret des correspondances. De surcroît, l’atteinte ici en cause ne concerne pas seulement les personnes poursuivies, mais également des tiers qui se trouveraient dans leur proximité immédiate et à leur insu, dans un lieu public. Enfin, en permettant l’installation des dispositifs nécessaires à leur réalisation dans des lieux privés, elles portent également atteinte au principe de l’inviolabilité du domicile.
À partir d’une motivation identique, le Conseil va conclure à la violation de la constitution, indiquant précisément que la seule qualification de « crime » ne suffit pas à conférer à une infraction un degré de gravité et de complexité suffisant, justifiant que de telles techniques soient utilisées : c’est donc seulement la généralisation à tous les crimes qui est censurée, les techniques pouvant encore être utilisées à l’égard des délits commis en bande organisée, comme c’était le cas auparavant. De même, la loi ayant prévu le même procédé d’urgence à l’égard de ces techniques qu’à l’égard des interceptions des communications électroniques, il est également censuré, à partir du même raisonnement.
En définitive, cette décision ne fait que confirmer une jurisprudence établie, mais elle est rassurante : sur la route de la sécurité au détriment des libertés, le gouvernement trouvera bien le Conseil constitutionnel.
B – Des enquêtes à la durée encadrée
Le renforcement des pouvoirs d’enquête en matière pénale a également conduit le législateur à étendre la durée possible de celle-ci, mais dans des conditions qui n’offraient pas des garanties suffisantes aux exigences constitutionnelles de respect de la vie privée ou de l’inviolabilité du domicile. Cela vaut tant pour la durée de l’enquête de flagrance (1) que pour la poursuite de certains actes d’enquête postérieurement à l’ouverture d’une information judiciaire (2).
1. L’article 49 offrait quatre nouvelles prérogatives aux enquêteurs. D’abord, il allongeait la durée de l’enquête de flagrance de 8 à 16 jours à l’égard des crimes et délits commis en bande organisée. Ensuite, il étendait aux délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement, contre 5 auparavant, d’une part, la possibilité de prolonger l’enquête de flagrance, d’une durée légale de 8 jours, de 8 jours supplémentaires et, d’autre part, de procéder à des perquisitions sans l’assentiment de la personne concernée, lors de l’enquête préliminaire. Enfin, il autorisait la pénétration dans un domicile afin de faire comparaître par la force une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou tout délit puni d’une peine d’au moins 3 ans d’emprisonnement.
Une seule de ces quatre nouvelles prérogatives a été validée par le Conseil qui considère que l’abaissement du seuil de 5 à 3 ans d’emprisonnement pour pouvoir procéder à des perquisitions sans assentiment n’engendre pas de conciliation déséquilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile44. Cela conduit, en réalité, à les autoriser pour la quasi-totalité des délits de droit commun, mais aucun critère de gravité n’avait ici été préalablement évoqué par le Conseil. Le fait que de telles perquisitions soient placées sous le double contrôle d’un magistrat du siège (le juge des libertés et de la détention qui les autorise) et du parquet (le procureur de la République qui les requiert) suffit donc à apporter des garanties légales suffisantes à ces exigences constitutionnelles.
En revanche, l’allongement de la durée de l’enquête de flagrance (16 jours pour les infractions commises en bande organisée et le renouvellement de 8 jours supplémentaires pour tous les délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement) viole le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile. En effet, contrairement à l’enquête préliminaire, l’enquête de flagrance est menée du seul chef de l’officier de police judiciaire, lequel dispose de prérogatives étendues (perquisitions, saisies, relevés d’empreintes, etc.)45, sans y être spécifiquement autorisé par un magistrat. Or l’étendue de ces prérogatives ne se justifie que par la proximité de l’infraction commise : plus on s’en éloigne dans le temps, moins il fait sens qu’elles puissent être invoquées sans autorisation de l’autorité judiciaire, dont la dispense ne sert qu’à gagner du temps, dans une situation où il peut être précieux pour la manifestation de la vérité et l’interpellation des auteurs supposés de l’infraction. C’est ce qui justifie la censure du Conseil constitutionnel46.
La pénétration dans un domicile aux fins d’exécution d’un ordre de comparaître, quant à elle, n’était pas justifiée par de simples considérations de délais, mais participait de la même dynamique de renforcement des pouvoirs des enquêteurs, afin d’éviter que des auteurs supposés d’infractions ne leur échappent. Ce n’est donc pas tant le défaut de supervision ou de contrôle de l’autorité judiciaire qui est en cause, car cette dernière est bien présente s’agissant d’un ordre de comparaître délivré par le procureur de la République, mais bien l’étendue des prérogatives, qui est disproportionnée au regard de la gravité des infractions poursuivies. En effet, la pénétration dans un domicile pouvait être délivrée à propos de toute infraction punie d’au moins 3 ans d’emprisonnement et concernait tout domicile ou la personne soupçonnée est susceptible de se trouver, y compris s’il s’agit du domicile d’un tiers. De telles prérogatives ne pouvaient pas se passer de l’autorisation d’un magistrat du siège47.
Enfin, afin d’apporter des garanties face à l’assouplissement du recours aux perquisitions dans le cadre de l’enquête préliminaire et de tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel48 et de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)49, le législateur a introduit une possibilité de contester une perquisition ou une visite domiciliaire chez une personne qui n’a finalement pas été poursuivie devant les juridictions d’instruction ou de jugement. Pour tenir compte de cette jurisprudence, le législateur a prévu qu’un tel recours pouvait être introduit devant le juge des libertés et de la détention de la juridiction où la procédure a été menée. Toutefois, en vertu de l’article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale, une perquisition menée dans le cadre d’une enquête préliminaire, si elle est effectuée sans l’assentiment de la personne concernée, doit être précisément ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
Par conséquent, cette mesure, apparemment soucieuse de garantir le droit au procès équitable, viole ce même droit car un même juge aurait pu décider de la perquisition et juger ensuite de sa légalité. Sauf que la censurer aurait fait naître une autre inconstitutionnalité, puisqu’une personne qui n’a pas été poursuivie n’aurait disposé d’aucun moyen de recours juridictionnel contre une perquisition éventuellement illégale. Le Conseil a donc préféré émettre une réserve d’interprétation en précisant que le juge qui a autorisé la perquisition « ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité, statuer sur la demande tendant à l’annulation de sa décision »50.
2. C’est encore par la voie d’une réserve d’interprétation que le Conseil a pallié l’inconstitutionnalité de la poursuite des investigations du procureur de la République, après qu’il a requis l’ouverture d’une information judiciaire et pendant une durée ne pouvant excéder 48 heures. Or il s’agit de mesures qui non seulement sont attentatoires aux droits et libertés (respect de la vie privée, inviolabilité du domicile, secret des correspondances) mais qui sont aussi, parfois, inscrites dans des délais légaux, en ce que la loi en prévoit une durée maximale, ou qui doivent être autorisées par un magistrat du siège, pour une certaine durée. Par conséquent, leur prorogation de 48 heures du seul fait de requérir l’ouverture d’une infirmation judiciaire par le procureur de la République aurait pu avoir pour conséquence de les prolonger au-delà de leur délai légal et conduire à ce que ce dernier s’empare d’une compétence que la loi n’attribue qu’à un magistrat du siège.
Mais cela a pu être aisément corrigé en précisant que cette prolongation de 48 heures ne saurait « conduire à excéder la durée initialement fixée par le juge des libertés et de la détention »51. En tenant donc compte de la nécessité de ne pas interrompre des investigations qui permettent la manifestation de la vérité, tout en assurant la bonne conduite et la bonne administration de la justice, soit des objectifs de valeur constitutionnelle, le Conseil a émis cette réserve afin de préserver néanmoins les droits et libertés qui pouvaient être violés.
Conclusion
En définitive, le paradoxe initial qui pouvait ressortir de cette loi, qui tendait à la fois à garantir une meilleure justice grâce à davantage de moyens et à conduire à une justice parfois rendue de façon expéditive, au détriment des droits et libertés des justiciables, a été corrigé par le Conseil. Il a veillé à préserver l’efficacité de la justice et les droits de ceux auxquels elle se destine, en traçant une ligne d’équilibre entre, d’une part, la bonne administration de la justice, le bon usage des deniers publics, la poursuite des auteurs d’infractions et la préservation de l’ordre public et, d’autre part, la garantie du droit au procès équitable, des droits de la défense, du respect de la vie privée, de l’inviolabilité du domicile, du secret des correspondances. En renforçant l’équilibre constitutionnel de la réforme de la justice, le Conseil constitutionnel a ainsi contribué à ce que la balance soit exemplaire.
Notes de bas de pages
-
1.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JORF, 24 mars 2019, texte n° 2.
-
2.
Cons. const., 26 juill. 2018, n° 2018-768 DC, loi relative à la protection du secret des affaires.
-
3.
Cons. const., 20 déc. 2018, n° 2018-773 DC, loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information.
-
4.
Cons. const., 6 sept. 2018, n° 2018-770 DC, loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
-
5.
93 députés « Les Républicains », 62 députés de gauche (Socialistes, Insoumis et Communistes), 120 sénateurs « Les Républicains » et 69 sénateurs « Socialistes ».
-
6.
Constitution, art. 61, al. 3.
-
7.
En vertu de l’article 10 de la constitution qui enserre dans un délai de 15 jours la promulgation à laquelle doit procéder le président de la République.
-
8.
L’article 80 n’est pas relevé au titre des dispositions contestées aux § 1 à 3 de la décision, mais il est évoqué au § 327, sans qu’une déclaration de conformité à la constitution ne soit expressément prononcée, ni dans les motifs ni dans le dispositif de la décision. L’article 81, quant à lui, n’est nullement mentionné.
-
9.
Article 93 de la loi.
-
10.
Cons. const., 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC, loi relative à l’égalité et à la citoyenneté et Cons. const., 4 sept. 2018, n° 2018-769 DC, loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
-
11.
Rapport annexé à la loi, alinéa 2.
-
12.
§ 180 et 181 de la décision.
-
13.
En matière pénale, cette séparation s’applique particulièrement pour la poursuite et la sanction des crimes et des délits, v. Cons. const., 2 févr. 1995, n° 95-360 DC, loi relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : Rec., p. 195 – v. égal. Cons. const., 8 juill. 2011, n° 2011-147 QPC, M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants] : Rec., p. 343.
-
14.
Cons. const., 28 déc. 2006, n° 2006-545 DC, loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social : Rec., p. 138.
-
15.
§ 252 et 270 de la décision.
-
16.
Cons. const., 8 juin 2012, n° 2012-250 QPC, M. Christian G. [Composition de la commission centrale d’aide sociale] : Rec., p. 281.
-
17.
Cons. const., 1er mars 2007, n° 2007-551 DC, loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats : Rec., p. 86.
-
18.
Cons. const., avis, 12 avr. 2018, n° 394535, § 23.
-
19.
§ 41 de la décision.
-
20.
Cons. const., 10 mars 2011, n° 2011-625 DC, loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : Rec., p. 122.
-
21.
Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : Rec., p. 66.
-
22.
Cons. const., 21 juill. 2017, n° 2017-645 QPC, M. Gérard B. [Huis clos de droit à la demande de la victime partie civile pour le jugement de certains crimes].
-
23.
§ 102 de la décision.
-
24.
Cons. const., 21 févr. 2008, n° 2008-563 DC, loi facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général : Rec., p. 100.
-
25.
Cons. const., 23 janv. 1987, n° 86-224 DC, loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence : Rec., p. 8.
-
26.
Cons. const., 6 sept. 2018, n° 2018-770 DC, préc. : compréhensible et soumise à de strictes garanties légales à l’égard de certaines instances relevant de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction nationale unique, la vidéo-audience a également été étendue à certaines instances relevant des tribunaux administratifs ou du juge des libertés et de la détention, présents sur tout le territoire, sans que les garanties légales soient identiques à celles applicables à la CNDA ni que la décision du Conseil n’en étende clairement l’application ; pour une position également réservée, v. Parrot K. et a., « Droit des étrangers et de la nationalité, déc. 2017-déc. 2018 », in Recueil Dalloz 2019, p. 354.
-
27.
Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.
-
28.
Cons. const., 20 nov. 2003, n° 2003-484 DC, loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
-
29.
Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-631 DC, loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
-
30.
Cons. const., 6 sept. 2018, n° 2018-770 DC, préc., § 27 et 28.
-
31.
Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-631 DC, préc., cons. 93.
-
32.
§ 234 de la décision.
-
33.
Commentaire de Cons. const., 6 sept. 2018, n° 2018-770 DC, préc., p. 18-19.
-
34.
Il s’agit d’une formulation de principe, reprise plusieurs fois dans la présente décision, not. § 140.
-
35.
Leur détail ressort du § 161 de la décision : interception de données de connexion, sonorisation de lieux privés ou publics, interception de données informatiques, etc.
-
36.
Le Conseil constitutionnel l’avait notamment retenu dans ses décisions : Cons. const., 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, loi portant création d’une couverture maladie universelle : Rec., p. 100 – Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, préc., et il l’a confirmé dans la décision commentée, § 140.
-
37.
§ 143 de la décision.
-
38.
Cons. const., 4 déc. 2013, n° 2013-679 DC, loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : Rec., p. 1060.
-
39.
Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, préc., cons. 17.
-
40.
§ 143 de la décision.
-
41.
Cons. const., 25 mars 2014, n° 2014-693 DC, loi relative à la géolocalisation.
-
42.
§ 146 de la décision.
-
43.
CPP, art. 706-96, al. 1er.
-
44.
§ 193 de la décision.
-
45.
Les prérogatives sont listées aux articles 53 et suivants du Code de procédure pénale.
-
46.
§ 191 de la décision.
-
47.
§ 195 de la décision.
-
48.
Cons. const., 29 nov. 2013, n° 2013-357 QPC, Sté Wesgate Charters Ltd [Visite des navires par les agents des douanes] : Rec., p. 1053 et Cons. const., 4 avr. 2014, n° 2014-387 QPC, M. Jacques J. [Visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail].
-
49.
CEDH, 21 févr. 2008, n° 18497/03, Ravon et a. c/ France.
-
50.
§ 198 de la décision.
-
51.
§ 214 de la décision.