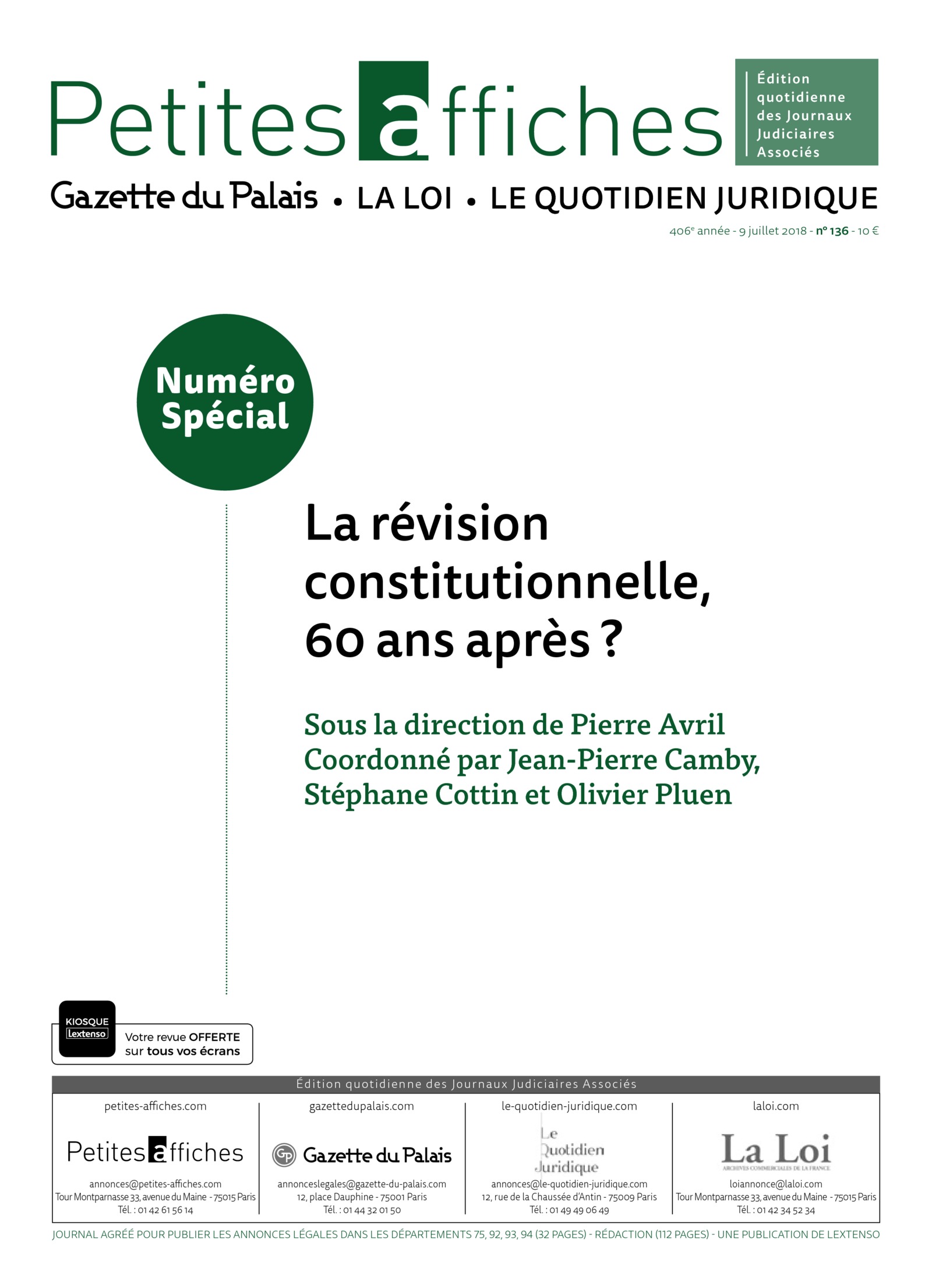La cohérence de l’écriture constitutionnelle
Alors que le droit et plus spécialement la loi se trouvent soumis à une exigence de qualité allant croissant, qu’en est-il du projet de loi constitutionnelle qui pourrait bientôt aboutir à la vingt-cinquième révision de la norme suprême ? Tel est l’objet du présent article qui cherche à porter ce regard à travers les prismes de la légistique formelle (accessibilité, intelligibilité) et matérielle (efficacité, effectivité), aidé par l’avis du Conseil d’État du 3 mai 2018.
« Je ne sais si la magistrature juge mal, mais je sais qu’elle avance bien »1. Ces propos acerbes prononcés par le duc de Pasquier dans la première moitié du XIXe siècle, vis-à-vis d’une magistrature judiciaire assujettie au pouvoir politique par des leviers de fidélisation aussi divers que l’avancement et les décorations, pourraient aisément être transposés, dans un tout autre domaine, aux révisions de la constitution de la Ve République : « Je ne sais si la norme suprême est bien rédigée, mais elle change bien sur le plan rédactionnel (…) ».
Avec 24 révisions entre 1958 et 20182, celle-ci a connu plus de modifications qu’il n’y a eu de constitutions et de réformes constitutionnelles de la Révolution française à la chute de la IVe République, période pourtant marquée par une succession des régimes politiques restée inégalée dans la sphère des grandes démocraties. Et ce chiffre constitue seulement la « partie émergée de l’iceberg », puisque, sur ses 60 ans d’existence qu’elle atteindra le 4 octobre prochain, la constitution du 4 octobre 1958 aura aussi vu sept projets de loi constitutionnelle échouer après être allés jusqu’au stade de la soumission au référendum de l’article 11 ou de l’adoption en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat dans le cadre de l’article 893. De même, 18 autres projets de loi constitutionnelle auront simplement été déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées ou propositions de loi constitutionnelle auront fait l’objet d’un simple début d’examen dans l’une d’elles4. Ces données, qui donnent le « vertige des grands sommets », seraient pourtant revues très largement à la hausse s’il fallait y ajouter toutes celles des propositions de loi législatives ou sénatoriales qui se trouvent simplement enregistrées en flots continus, sous chacune des législatures depuis 1958, à la présidence de la chambre intéressée.
Ainsi, alors que l’exposé des motifs de l’avant-projet de constitution du 29 juillet 1958 pointait avec contentement que le dispositif recouvrait « un préambule et 78 articles », tandis que, hors préambule, la constitution du 27 octobre 1946 « comportait 106 articles »5, le texte entré en vigueur le 4 octobre 1958 en comprenait déjà 93, dont quatre à caractère transitoire (ex-articles 90 et s.), et celui issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 en possède désormais 109. À ces derniers articles s’ajoutent, avec à chaque fois un préambule les précédant, les 17 articles de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et les 18 alinéas du préambule de la constitution de 1946, qui ont été intégrés au bloc de constitutionnalité en 1971 par le Conseil constitutionnel créé par le constituant de 1958, mais également les 10 articles de la charte de l’environnement de 2004, rédigés à l’occasion d’une procédure de révision engagée sous la Ve République et qui a abouti en 2005, dont la mention est venue compléter celle des deux déclarations de droits de la Révolution et de la Libération dans le préambule de l’actuelle constitution.
Un tel excès n’est bien entendu pas sans interroger dans un pays qui, dès son entrée dans l’ère constitutionnelle – après que l’Assemblée nationale issue des États généraux se soit proclamée « constituante » –, s’est efforcé de mettre la cohérence de l’écriture constitutionnelle au cœur de l’entreprise de régénération de la société française. Ce souci a d’ailleurs parfois suscité l’étonnement des observateurs étrangers, tel l’agronome britannique Arthur Young, dont les Voyages en France de 1787, 1788 et 1789, parus en 1792, donnent de la formule alors très à la mode de « confection de la constitution », l’explication suivante : « [C’]est la nouvelle expression qu’on a adoptée, et dont on se sert comme si la constitution était un pudding, que l’on peut confectionner au moyen d’une recette »6. Sans aller jusque-là, il n’en est pas moins exact que le premier texte à vocation constitutionnelle rédigé à cette époque – la déclaration des droits précitée –, a subsisté malgré les changements de régime, les périodes de mise à l’écart et les tentatives de refonte, au point d’être aujourd’hui présenté le premier dans l’essentiel des recueils sur la constitution de la Ve République. Or, au-delà de son caractère symbolique, la place de cette déclaration s’explique en grande partie, selon les mots du député Target lors de la séance du 20 août 1789, par le fait qu’elle « ne contient pas des principes contestés ; elle est courte, simple, exacte »7.
Curieusement, ce souci de qualité de l’écriture constitutionnelle a été peu à peu éludé, sans doute en raison de la relégation au rang de document politique et philosophique dont a fait l’objet la constitution avant 1958, puis de son érection au rang de norme souveraine ensuite. Au contraire, la loi, incontestée jusqu’à l’avènement de la Ve République, a ensuite d’abord été enfermée dans un domaine organiquement et matériellement limité au titre du parlementarisme rationalisé, avant d’être soumise, après une longue parenthèse allant de 1982 à 1999, aux exigences de la légistique, impliquant de rechercher à la fois l’accessibilité et l’intelligibilité de la norme (légistique formelle), d’une part, et l’effectivité et l’efficacité de celle-ci (légistique matérielle), d’autre part. Pourtant, comme l’écrivait déjà le doyen Vedel en 1998, à l’occasion du quarantième anniversaire de la constitution, cette dernière « n’est plus alternativement, comme très souvent dans le passé, un majestueux document philosophique ou un code de la route parlementaire, dans les deux cas étrangers au citoyen et à sa vie personnelle et quotidienne. Elle est descendue parmi les hommes »8. Et ce mouvement s’est renforcé avec, 10 ans plus tard, l’introduction du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, dans un nouvel article 61-1 de la constitution.
À l’heure du dépôt, le 9 mai 2018, du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace9, initié par la majorité présidentielle et législative issue des urnes aux mois de mai et juin 2017, il est en conséquence possible de questionner la cohérence de ce qui pourrait devenir dans quelques mois la vingt-cinquième révision aboutie, et qui constitue déjà la cinquantième tentative significative de réforme de la constitution depuis 1958. De manière sous-jacente, ce sujet est aussi une occasion d’envisager le rôle du Conseil d’État qui, après avoir effleuré ce sujet de la qualité de l’écriture constitutionnelle dans deux premiers avis de 2013 et 2015 relatifs à l’autorisation de ratifier la charte européenne des langues régionales ou minoritaires10, a abordé plus largement la question de son office sur ce plan avec son avis sur l’actuel projet de loi constitutionnelle.
Sans rechercher l’exhaustivité, le projet de réforme suscite des remarques non seulement sur la procédure de la révision et la forme de la constitution (I), mais aussi sur respectivement la nécessité et la cohérence de celles-ci (II).
I – Des interrogations sur la procédure de révision et la forme de la constitution
Loin de l’article 124 de la constitution de l’an I qui prévoyait que la « déclaration des droits et l’acte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du corps législatif et dans les places publiques », reflétant par-là la publicité de son adoption par la convention et la simplicité de sa lettre, l’actuel projet de loi constitutionnelle permet de rappeler que la procédure choisie conditionne l’accessibilité du projet (A), tandis que sa rédaction poursuit en principe un objectif d’intelligibilité du texte constitutionnel (B).
A – Une procédure conditionnant l’accessibilité du projet
Destiné à modifier la norme suprême, un projet ou une proposition de loi constitutionnelle est supposé pouvoir être accessible à tout citoyen qui souhaite en connaître l’économie. Cependant, deux écueils peuvent ici être relevés s’agissant du projet déposé le 9 mai dernier.
Le premier concerne le véhicule normatif choisi. Dans son allocution de Matignon du 4 avril 201811, le Premier ministre avait effectivement indiqué que la réforme des institutions envisagée, au lieu de reposer seulement sur un projet de loi constitutionnelle (art. 89) qui, une fois adopté, serait éventuellement suivi d’une ou plusieurs lois organiques et ordinaires d’application, intégrerait ici également, dès la première phase, un projet de loi organique (art. 46) et un autre de loi ordinaire (art. 39). Ces deux derniers textes, qui devaient être déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale avec une semaine de décalage par rapport au premier, ont en principe pour objet la réduction du nombre de députés et de sénateurs, l’introduction d’une part de scrutin proportionnel aux élections législatives, et l’interdiction du cumul des mandats dans le temps pour certaines catégories d’élus. Or, au 1er juin 2018, le dépôt de ces textes n’avait toujours pas eu lieu et le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle, a pu « regrett[er] de ne pas avoir été saisi en même temps des trois projets qui traitent de sujets parfois communs, une disposition du [premier] étant même (…) la conséquence d’une mesure qui figure dans le projet de loi organique »12. Dans le prolongement de cette première difficulté, parce que la procédure de révision de l’article 89 de la constitution prévoit l’obligation d’une adoption du projet de loi constitutionnelle en termes identiques, avant soumission au référendum ou au Parlement convoqué en Congrès, l’Exécutif avait semble-t-il conçu la possibilité de recourir à la procédure contestée de l’article 11 en cas de blocage du Sénat. La majorité au sein de ce dernier, en effet, ne coïncide pas avec les majorités présidentielle et législative. Cependant une telle option, utilisée en 1962 et 1969 par le général de Gaulle, pose la question, au-delà de l’incertitude entourant la constitutionnalité d’une telle procédure, de l’absence d’examen au Parlement de nature à garantir l’organisation et une publicité des débats. Si cette voie est désormais exclue pour le projet de loi constitutionnelle, puisque, comme le précise son exposé des motifs, il est « soumis (…) en application de l’article 89 »13, il en va différemment pour les deux projets de loi organique et de loi ordinaire encore en attente, sachant que, de même que les avis du Conseil constitutionnel ne sont pas publiés en cas de recours à cette procédure14, il devrait assez logiquement en aller de même pour celui du Conseil d’État qui pourrait estimer celle-ci inappropriée pour la raison figurant dans son avis du 3 mai15.
La seconde limite se rapporte à la maturation et à l’approfondissement du projet de révision constitutionnelle. En effet, il apparaît, d’une part, que le projet de loi constitutionnelle n’a pas été précédé de l’institution d’un comité d’experts spécialement chargé de faire des recommandations en matière d’évolution constitutionnelle. Cette absence pourra sembler regrettable dans la mesure où de telles instances, généralement composées de personnalités issues des sphères politique, juridique et scientifique, permettent d’apporter un éclairage sur l’opportunité de modifications à opérer, tout en offrant au public une première publicité sur la réforme à venir16. Surtout, le recours à ces commissions a coïncidé avec l’accélération des révisions constitutionnelles à partir du début des années 1990 et, même si leur nombre – sept depuis 199317 – est resté très inférieur aux révisions ou tentatives de révisions – quarante-et-une depuis cette année-là – il est possible d’établir une corrélation entre leur recours et l’ampleur ou la notoriété de la réforme envisagée. Notamment, les deux révisions les plus importantes sur le plan à la fois quantitatif et symbolique – celle du 1er mars 2005 relative à la charte de l’environnement et celle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République – font suite respectivement au rapport de la Commission de préparation de la charte de l’environnement, présidée par le paléoanthropologue Yves Coppens, et à celui du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par l’ancien Premier ministre Édouard Balladur18. D’autre part, peut-être aurait-il été utile de faire précéder ce projet de loi constitutionnelle d’un bilan de l’application des révisions et tentatives de révision les plus récentes. En effet, si, comme le précise l’exposé des motifs : « Depuis 10 ans, la constitution du 4 octobre 1958 n’a pas connu de révision19 », cette période a été marquée par l’intervention de six projets de loi constitutionnelle allant du stade du dépôt jusqu’à l’adoption en termes identiques, et dont l’échec, s’il tient pour partie à des causes politiques, est aussi lié dans plusieurs cas à un manque de préparation et de pédagogie. L’abandon du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation en constitue la meilleure illustration20.
B – Une forme conditionnant l’intelligibilité de la constitution
Au-delà de celle de la procédure utilisée, se pose la question de l’impact de la révision projetée sur le plan formel. Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis du 3 mai 2018, « s’agissant de la constitution plus encore que des autres textes, il convient d’accorder la plus grande importance à la rédaction du projet. La plume du constituant, outre qu’elle se doit d’être la plus élégante possible, doit être limpide, concise et précise »21. Si ce commentaire, qui emporte plusieurs conséquences, est important sur le plan de l’intelligibilité du texte, sans doute est-il dommage que l’institution n’ait pas mis celui-ci à contribution pour formuler un obiter dictum sur l’intérêt pour le constituant de réparer, à l’occasion de son ouvrage, les imperfections déjà existantes dans le texte constitutionnel. Partant de là, plusieurs remarques peuvent être formulées.
Premièrement, le projet de loi constitutionnelle, qui comprend « dix-huit articles » comme le note le Conseil d’État, touche la constitution sur vingt-trois points. Plus précisément, il modifie un titre, à savoir le XI qui, aujourd’hui intitulé : « Le Conseil économique, social et environnemental », deviendrait : « La chambre de la société civile ». Il modifie également dix-neuf articles, sachant que ces modifications intègrent elles-mêmes la suppression d’un alinéa et l’ajout de sept autres. Il supprime encore deux articles, en l’occurrence les 68-2 et 68-3 qui figurent dans le titre X sur « la responsabilité pénale des membres du gouvernement », et en crée inversement un nouveau dans le titre XII relatif aux « collectivités territoriales ». Ce nouvel article, le 72-5, concernerait la « collectivité de Corse ». Dans l’hypothèse où le projet serait adopté en l’état, la constitution perdrait dès lors un article, mais gagnerait trois alinéas, garantissant globalement la stabilité du texte constitutionnel en termes de volume. Un aspect positif à mettre en exergue est que le nombre d’articles « à tiret », apparus en 1992 avec la révision destinée à permettre la ratification du traité de Maastricht et au nombre de vingt-neuf depuis 200822, reculerait d’un point. De même, si la suppression des articles 78 à 86 relatifs à la « communauté » franco-africaine et malgache, devenue sans objet en 1961 avec la fin du processus de décolonisation, a laissé un vide depuis la révision du 4 août 1995, tel n’est pas le cas pour celle des articles 68-2 et 68-3, qui permet au contraire de réduire l’écart entre les articles 68-1 et 69 de la constitution.
Deuxièmement, le projet soulève, avec la modification du titre XI mentionnée plus haut, la question de l’opportunité d’un réagencement des titres. En effet, le choix de remplacer la notion de « Conseil » par celle de « chambre » insiste sur le rapprochement opéré entre l’institution en devenir et le Parlement. Ce faisant, n’aurait-il pas été approprié de faire remontrer cette « chambre de la société civile » du titre XI au titre V, situé juste après celui relatif au Parlement ? De la même façon, les rapports de la République française à l’Europe et au monde ayant fortement évolué depuis 1958, il aurait pu être imaginé un regroupement des titres sur « l’Union européenne », « la francophonie et [les] accords d’association », et les « traités et accords internationaux », en les plaçant dans ce nouvel ordre.
Dernièrement, la réforme en cours aurait pu être l’occasion de remédier à certains défauts de langue dont souffre le texte constitutionnel23, et qui étonnent dans l’État qui a édicté l’ordonnance royale de Villers-Cotterêts de 1539, qui a créé l’Académie française et dont l’article 2 de la constitution dispose : « La langue de la République est le français ». D’abord, une réflexion sur l’emploi de certains termes pourrait s’imposer. Dans son avis, le Conseil d’État s’est ainsi interrogé sur le recours, pour l’institution appelée à remplacer le Conseil économique, social et environnemental, à la notion de « société civile » « figurant à l’article 11 du traité sur l’Union européenne et à l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne »24. De même, un regard pourrait être porté sur des formules qui appartiennent à l’histoire… ou, qui sait, au futur, comme celle : « en Nouvelle-Calédonie », employée aux articles 13 et 74-1 de la constitution. Préférée à celle : « à la Nouvelle-Calédonie », la première renvoie pourtant, selon le site de l’Académie française, à des territoires qui « ont été des États souverains », comme cela a été le cas pour Arles et Avignon. Dans un autre registre, l’actuel projet de loi constitutionnelle aurait pu s’intéresser à la faute d’orthographe, rappelée par le site Légifrance lui-même, de la première phrase de l’article 16 de la constitution qui, presque 60 ans après 1958, continue à ne pas accorder le participe passé « menacés », avec un sujet qui recouvre pourtant « les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux »25. De manière plus anecdotique, le projet déposé le 9 mai dernier est susceptible d’interroger sur l’emploi des capitales dans le texte constitutionnel. Effectivement, son article 18, qui porte sur les conditions d’application de certaines de ses dispositions, se réfère au « conseil des ministres ». Or, depuis 1958, la forme « Conseil des Ministres », notamment utilisée à l’article 39, alinéa 2, de la constitution, s’est systématiquement imposée dans les lois constitutionnelles. À l’inverse, « Assemblée nationale », écrit de cette façon dans les révisions successives ayant mentionné cette institution, est rédigée « Assemblée Nationale » dans la constitution initiale du 4 octobre 1958, seule version consolidée de l’ensemble du texte constitutionnel à avoir, depuis cette époque, été publiée au Journal officiel.
II – Des interrogations sur la nécessité du projet et la cohérence de la constitution
L’accélération des révisions constitutionnelles depuis le début des années 1990, si elle peut conduire à des questionnements quant à la procédure suivie et à la forme du texte constitutionnel, peut également engendrer un risque sur le fond de ce dernier. D’ailleurs, dans son avis du 3 mai 2018, il est caractéristique de noter que le Conseil État s’est presque entièrement focalisé sur ce dernier aspect, qui recouvre les questions de la nécessité de la révision (A) et de la cohérence de la constitution qui en résulterait (B).
A – Une nécessité conditionnant l’efficacité de la révision
À l’aune de l’avis du Conseil d’État, la première série de remarques susceptible d’être formulée concerne, sur le plan de la nécessité de la révision, sa plus-value et le fait qu’elle relève bien de l’instrument constitutionnel. La haute institution précise ainsi qu’elle « vérifie (…) que les mesures envisagées sont de niveau constitutionnel », dans la mesure où la « dignité de la norme suprême exige (…) qu’elle ne soit pas surchargée de dispositions de rang inférieur »26. Puis, plus loin, elle ajoute qu’elle « examine également, comme [elle] le fait à l’égard des autres textes, si les mesures envisagées sont à même d’atteindre l’objectif poursuivi par le gouvernement, si d’autres mesures n’y parviendraient pas mieux ou si les dispositions existantes ne le permettent pas déjà »27.
En ce sens, le Conseil d’État a exprimé son scepticisme vis-à-vis de l’article 2 du projet de loi constitutionnelle qui, dans sa première rédaction, visait à compléter le quinzième alinéa de l’article 34 de la constitution, qui prévoit que la loi détermine les fondamentaux « de la préservation de l’environnement », par les termes : « et de la lutte contre les changements climatiques ». Le Conseil d’État a ainsi observé que « cette disposition aura sans doute peu d’incidence sur les compétences respectives du législateur et du pouvoir réglementaire, qui sont l’objet de l’article 34 de la constitution ». Néanmoins, rompant immédiatement avec cette position, il a finalement donné un avis favorable à cet ajout, sous réserve de remplacer les mots : « la lutte », par les termes : « l’action », « eu égard au caractère primordial de l’action contre les changements climatiques et à l’intérêt qui s’attache à ce que ses principes fondamentaux soient décidés par la représentation nationale »28. Cette posture, essentiellement politique, paraît avoir été justifiée par le rôle d’impulsion joué par la France pendant la COP 21, qualifiée dans l’exposé des motifs de « prolongement éminent »29 des conventions internationales préexistantes en matière d’environnement. En sens contraire, l’hôte du Palais Royal a porté un regard positif sur le renforcement des dispositions de l’article 41 relatif aux irrecevabilités législatives, dont l’article 3 du projet de loi constitutionnelle prévoit qu’elles recouvriraient désormais, outre le rejet des propositions de loi et amendements ne relevant pas du domaine de la loi, celui des mêmes instruments dépourvus de caractère normatif, ainsi que des amendements sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture. Ici, comme le souligne le Conseil d’État, l’évolution proposée s’inspire de l’abondante « jurisprudence du Conseil constitutionnel et également, s’agissant du domaine de la loi, (…) du Conseil d’État », et se trouve légitimée « par l’augmentation régulière et importante du nombre des amendements, qui a pu nuire à l’efficacité de la procédure parlementaire et à la qualité de la loi, les règles d’irrecevabilité déjà prévues par la constitution étant très peu utilisées »30.
Mais, si la nécessité des dispositions figurant dans le projet de loi constitutionnelle revêt une intensité variable, les arbitrages politiques ou l’absence de réflexion approfondie ont peut-être aussi conduit à éluder des principes ou règles qui trouveraient aujourd’hui toute leur place dans la constitution, confortés en cela par l’histoire et l’actualité. Le texte ayant été déposé la veille de la commémoration de l’abolition de l’esclavage en France, et alors que cette dernière, plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour manquement à ses obligations positives découlant de l’article 4 de la convention éponyme, s’est finalement dotée avec la loi du 5 août 2013 d’un dispositif néanmoins insuffisant de lutte contre les formes contemporaines d’esclavage31, l’opportunité de constitutionnaliser expressément un principe d’interdiction dans ce domaine aurait pu objectivement se poser32. Une telle inscription aurait paru d’autant plus souhaitable, que, outre l’existence expresse d’une telle prohibition dans cent-vingt-neuf constitutions à travers le monde en 2015, les textes constitutionnels de la convention (constitution de l’an I), du Directoire (constitution de l’an III), de la Seconde République (constitution de 1848) et du Second Empire (Sénatus-consulte de 1854) avaient pourtant joué ici un rôle précurseur, inspirant même d’autres États. Plus encore, si cette interdiction a cessé de bénéficier d’une assise dans le texte constitutionnel à partir de la IIIe République, ce recul apparent a été pallié, selon René Capitant en 1929, par le fait qu’elle figurait au tout premier rang des règles que « la coutume (…) a faites constitutionnelles et mêmes supraconstitutionnelles », ou, pour citer Léon Duguit 6 ans plus tôt, parce que « ce principe (…) s’impose à la conscience moderne avec une évidence lumineuse et [que sa] vérité est aujourd’hui incontestée pour tout homme civilisé »33…
La seconde série de remarques, à propos de la nécessité de la révision, porte sur la pérennité de cette dernière. Ainsi que le rappelle le Conseil d’État : « La constitution a vocation à s’inscrire dans la longue durée. Il convient par conséquent de s’assurer que les modifications qui lui sont apportées ne sont pas liées à des circonstances particulières ou à des considérations contingentes qui l’exposeraient au risque d’être rapidement remise en cause »34.
Si, dans la suite de son avis, l’institution ne paraît pas relever dans le projet qui lui a été soumis de dispositions ne répondant pas à cette exigence de durabilité, il n’en reste pas moins que, au regard des incertitudes créées par certaines réformes, une réflexion mériterait d’être menée concernant la possibilité d’intégrer à la constitution des dispositions à caractère expérimental. Éventuellement placées dans un titre XVII : « Dispositions expérimentales »35, elles seraient ou non pérennisées par le constituant à l’occasion d’une révision suivante. Un tel mécanisme aurait, semble-t-il, un sens à l’égard des dispositions des articles 15, 16 et 17 du projet de loi constitutionnelle prévoyant un « droit à la différenciation des collectivités territoriales » hexagonales, de Corse et relevant de l’article 73 de la constitution, « une nouvelle forme de décentralisation, celle de la norme, succédant à celle des compétences »36.
B – Une cohérence conditionnant l’effectivité de la constitution
Dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle, le Conseil d’État s’est inscrit dans la continuité de ses deux avis du 7 mars 2013, rendu sur le projet de loi constitutionnelle portant renouveau de la vie démocratique et n’ayant finalement pas été déposé, et du 30 juillet 2015, formulé à propos du projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires37. L’hôte du Palais Royal, bien que rejetant à cette occasion toute idée de hiérarchie entre les principes et règles constitutionnels, semble néanmoins s’être inspiré de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande qui, dans un arrêt du 23 octobre 1951, Südweststaat-Streit, avait jugé qu’une « disposition constitutionnelle particulière ne peut être considérée comme une disposition isolée devant être interprétée isolément. La constitution jouit d’une unité intrinsèque, et chacun de ses éléments revêt une signification liée à celle des autres dispositions »38. Une telle affirmation paraît, pour le Conseil d’État, revêtir deux dimensions.
D’abord, l’existence d’un projet de réforme est susceptible d’entrer en conflit avec les principes qui sont au cœur de l’édifice constitutionnel français. Le Conseil indique ainsi dans son avis, qu’il lui « revient (…) de relever, le cas échéant, qu’une disposition ne s’inscrit pas dans les grands principes qui fondent notre République, énoncés particulièrement au préambule, lequel renvoie notamment à la déclaration [de 1789], et aux trois premiers articles de la constitution ». Dans la continuité, il ajoute qu’il lui « appartient (…) de signaler qu’une disposition contreviendrait à l’esprit des institutions, porterait atteinte à leur équilibre ou méconnaîtrait une tradition républicaine constante »39.
C’est ainsi que, dans sa consultation de 2015, faisant écho à celle de 2013, l’hôte du Palais Royal estime que « la faculté de ratifier la charte donnée par la nouvelle disposition constitutionnelle aurait introduit dans la constitution une incohérence entre, d’une part, les articles 1er, 2 et 3 qui affirment les principes constitutionnels mentionnés dans la décision du Conseil constitutionnel du 15 juin 1999 et sont au fondement du pacte social dans notre pays et, d’autre part, la nouvelle disposition qui aurait permis la ratification de la charte »40. Il en est alors résulté, très logiquement dans les deux cas, un avis défavorable. Vis-à-vis du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, le Conseil d’État a, semble-t-il, relevé, quoique de manière plus feutrée, un risque d’incohérence au niveau des articles 15 et 16 relatifs aux collectivités territoriales et à la collectivité de Corse. Il s’est en effet arrêté sur la possibilité offerte aux collectivités territoriales par le premier article de déroger aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l’exercice de leurs compétences, et sur celle donnée à la collectivité de Corse par le second d’être habilitée à décider par elle-même d’adaptations à la loi ou au règlement pour tenir compte de ses spécificités liées « à son insularité [et] à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales ». Or, dans les deux cas, si la haute institution émet finalement un avis favorable, c’est sous la « réserve d’interprétation consultative » que « les mesures prises dans ce cadre (…) ne pourront porter atteinte au principe d’égalité entre les personnes auxquelles elles s’appliquent »41, sachant que l’égalité figure au premier rang des principes qui, pour reprendre une formule du Conseil d’État citée précédemment, « fondent notre République ».
Ensuite, un projet de révision constitutionnelle peut susciter une incompatibilité entre des principes ou règles qui risquerait d’introduire « une contradiction interne génératrice d’insécurité juridique »42. Dans son avis du 3 mai 2018, le Conseil d’État indique ainsi qu’il « vérifie la cohérence interne des mesures envisagées, ainsi que leur articulation avec les dispositions existantes et leurs incidences sur le fonctionnement des institutions et des services publics »43.
Sur cet aspect, et pour conclure la présente étude sur ce dernier, il peut sembler dommage que l’hôte du Palais Royal n’ait pas pointé la contradiction que ferait naître l’adoption de l’article 12 du projet, qui vise à modifier l’article 65 de la constitution pour que les magistrats du parquet de l’ordre judiciaire soient « désormais nommés sur l’avis conforme de la formation compétente [du Conseil supérieur de la magistrature] et que celle-ci statue (…) à leur égard comme conseil de discipline »44, au regard du dernier alinéa de l’article 64 qui prévoit que seuls les « magistrats du siège sont inamovibles ». Effectivement, faute pour cette notion pluriséculaire d’être définie dans la constitution de 1958, l’habitude a été prise sous la Ve République de se référer à l’article 4 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature qui, après avoir repris dans un premier alinéa la phrase précitée, dispose dans l’alinéa suivant : « En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement ». Or, sous réserve de rares auteurs45, la question de savoir si la garantie énoncée dans ce deuxième alinéa est une conséquence suffisante ou non de l’inamovibilité n’est jamais soulevée, sachant que cette disposition ayant été adoptée par la voie d’une ordonnance de l’ex-article 92 de la constitution, ses travaux préparatoires ne sont pas connus. Pourtant, née en France avec l’ordonnance royale du 21 octobre 1467, l’inamovibilité s’est encore trouvée définie par la constitution de la Seconde République du 4 novembre 1848 comme le fait pour ses bénéficiaires de ne pouvoir « être révoqués ou suspendus que par un jugement, ni mis à la retraite que pour les causes et dans les formes déterminées par les lois » (art. 87). En droit comparé, le ministère de la Justice du Canada, pays qui a la particularité d’utiliser à la fois le français et l’anglais, donne au terme « inamovibilité » la traduction suivante : to hold office during good behaviour46, ce qui signifie qu’un juge peut être uniquement évincé par un organe juridictionnel ou indépendant, ou tout du moins selon une procédure juridictionnalisée. En fait, propriétaires de leur charge sous l’Ancien Régime, puis le plus souvent propriétaires terriens au XXe siècle et pendant une partie du suivant, les magistrats ont longtemps bénéficié d’une garantie de fait contre les déplacements non souhaités. Au surplus, l’inamovibilité, qui recouvre celle « des fonctions » et celle « de résidence », était jugée préservée si les décisions en matière de déplacement étaient confiées à un organe indépendant. C’est précisément la position qu’avait adoptée la Cour de cassation dans un avis de 1885, à propos de l’article 15 de la loi des 30-31 août 1883 qui confiait au Conseil supérieur de la magistrature – alors constitué par la haute juridiction elle-même – le pouvoir de déplacer d’office un magistrat du siège dans l’intérêt du service. Selon elle, cette disposition, « édictant une exception au principe de l’inamovibilité absolue, détermine les conditions auxquelles peut (…) avoir lieu le déplacement d’un magistrat, et suppose par conséquence qu’il soit inamovible »47. Huit ans plus tard, le commissaire du gouvernement Le Vavasseur de Précourt, dans ses conclusions sur l’arrêt du Conseil d’État Bariat, n’opinait pas autrement : « L’inamovibilité s’applique d’ordinaire et à la fonction et à la résidence même ; mais elle peut, par exception, ne s’appliquer qu’à la fonction »48.
Pour en revenir à la réforme en cours, la modification envisagée de l’article 65 de la constitution rapprocherait ainsi la France de l’Italie, dont l’article 107 prévoit, sans opérer de distinction entre les membres du siège et ceux du parquet : « Les magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être privés ou suspendus de leur service ni affectés à d’autres sièges ou à d’autres fonctions si ce n’est à la suite d’une décision du Conseil supérieur de la magistrature, adoptée soit pour les motifs et avec les garanties de la défense prévus par les règles sur l’organisation judiciaire, soit avec le consentement des intéressés »…
Notes de bas de pages
-
1.
Cité par Jeanvrot V., L’inamovibilité : sous l’ancienne monarchie, sous la Révolution, et depuis le dix-huit brumaire, 1882, A. Cotillon et Cie et A. Marescq Ainé, p. 111-212.
-
2.
V. Pluen O., Constitution de la Ve République : de sa rédaction initiale à sa version aujourd’hui en vigueur. Approche historique et légistique, 2e éd., 2017, LGDJ-Institut Universitaire Varenne, Colloques & Essais, n° 12, p. 205-225.
-
3.
Ibid., p. 225-231.
-
4.
Ibid., p. 231-239.
-
5.
DPS, vol. 1, 1987, p. 518.
-
6.
Cité in ibid, p. 45. V. égal. la reprise de la formule par Robert Verdier, à l’Assemblée nationale, le 24 mai 1955, lors d’une séance consacrée à l’examen d’une proposition de résolution tendant à la révision de la constitution, in DPS, vol. 1, 1987, p. 32.
-
7.
Cité par Morange J., « L’élaboration de la déclaration de 1789 », in Conac G., Debène M., Teboul G. (dir.), La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : histoire, analyse et commentaires, 1993, Economica, p. 66.
-
8.
Vedel G., « Qu’est-ce que la constitution ? », La Constitution de 1958 a 40 ans, quest. n° 1, www.conseil-constitutionnel.fr.
-
9.
Projet de loi constitutionnelle n° 911 du 9 mai 2018, pour une République plus représentative, responsable et efficace, www.assemblee-nationale.fr.
-
10.
CE, avis, Intérieur, 30 juill. 2015, n° 390268, sur le projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
-
11.
Philippe É., « Réforme des institutions », discours du 4 avr. 2018 à l’Hôtel Matignon, www.gouvernement.fr.
-
12.
CE, avis, Intérieur, 3 mai 2018, n° 394658, sur le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, p. 1, pt 1.
-
13.
Projet de loi constitutionnelle n° 911, préc., p. 2.
-
14.
Cons. const., « Les attributions du Conseil constitutionnel lors d’un référendum », 2005, www.conseil-constitutionnel.fr.
-
15.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le Conseil d’État s’est prononcé dès 1962 contre le recours à la procédure de l’article 11 : v. Fougère L. (dir.), Le Conseil d’État, son histoire à travers les documents d’époque (1799-1974), 1974, Éd. du CNRS, p. 900. Il a notamment réaffirmé cette position, sur le plan contentieux, par un obiter dictum formulé dans CE, ass., 30 oct. 1998, nos 200286 et 200287, M. Sarran, M. Levacher et a.
-
16.
Dans l’hypothèse de la réforme en cours, les réflexions sur le sujet sont beaucoup plus diffuses. Ainsi, à propos de la modification de l’article 65 de la constitution pour renforcer l’indépendance du parquet (art. 12), le Conseil d’État note dans son avis que « le projet s’inscrit dans la continuité des révisions constitutionnelles de 1993 et de 2008 ». De même, s’agissant de celle de l’article 72 de la constitution, destinée à accroître la compétence normative des collectivités territoriales (art. 15), la haute institution relève qu’elle reprend « les préconisations faites par le Conseil d’État dans son avis du 7 décembre 2017 relatif aux compétences des collectivités territoriales ». V. CE, avis, Intérieur, 3 mai 2018, n° 394658, préc., p. 11, pt 48 et p. 15, pt 65.
-
17.
Vedel G. (pdt), Comité consultatif pour la révision de la constitution, « Propositions pour une révision de la constitution », 1993, La Documentation française, Collection des rapports officiels. V. égal. Pluen O., Constitution de la Ve République, op. cit., p. 304.
-
18.
Coppens Y. (pdt), Commission de préparation de la charte de l’environnement, « Rapport », 2005, ministère de l’Écologie et du Développement durable ; Balladur É. (pdt), Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, Une Ve République plus démocratique, 2008, Fayard-La Documentation française.
-
19.
Projet de loi constitutionnelle n° 911, préc., p. 1.
-
20.
V. concernant la liste des initiatives ayant échoué depuis 2008 : Pluen O., Constitution de la Ve République, op. cit., p. 229-231 et 236-239.
-
21.
CE, avis, Intérieur, 3 mai 2018, n° 394658, préc., p. 3, pt 9.
-
22.
V. sur cette question Geslot C., « Stabilité et révisions constitutionnelles sous la Ve République », RDP 2013, n° 3, p. 641 et s.
-
23.
V. à ce sujet Pluen O., Constitution de la Ve République, op. cit., p. 33-37.
-
24.
CE, avis, Intérieur, 3 mai 2018, n° 394658, préc., p. 13, pt 57.
-
25.
Sur le site Légifrance, dans « constitution du 4 octobre 1958 » en vigueur, l’article 16 fait l’objet du commentaire suivant : « Cet article fut originellement publié avec une faute d’orthographe. Le terme “menacés” devrait en effet s’écrire “menacées” ». La faute apparaît dans la version de la constitution publiée au JO du 5 oct. 1958, p. 9154. D’après les travaux préparatoires, elle semble être apparue dans le projet de constitution joint au décret n° 58-806 du 4 septembre 1958 et figure également dans le texte original de la constitution : DPS, vol. 3, 1991, p. 610.
-
26.
CE, avis, Intérieur, 3 mai 2018, n° 394658, préc., p. 2, pt 6.
-
27.
Ibid., p. 2, pt 8.
-
28.
Ibid., p. 3, pt 12.
-
29.
Projet de loi constitutionnelle n° 911, préc., p. 2.
-
30.
Ibid., pt 15. V. not. sur le sujet de Castries H. et Molfessis N. (pdt), Sécurité juridique et initiative économique, rapport du Club des juristes, 2015, Mare & Martin, p. 97-115, et CE, Simplification et qualité du droit, étude annuelle 2016, La Documentation française, p. 101-102.
-
31.
V. not. Niort J.-F. et Pluen O., « Conclusion générale : synthèses et perspectives », in Niort J.-F. et Pluen O. (dir.), Esclavage, traite et autres formes d’asservissement et d’exploitation, du Code Noir à nos jours, 2018, LGDJ, Thèmes & commentaires, p. 464-475.
-
32.
V. Pluen O., « Les fondements constitutionnels de l’interdiction de l’esclavage en France », RDP 2015, n° 4, p. 994-1020 ; Pluen O., « Constitutionnaliser l’interdiction de l’esclavage et des autres formes d’exploitation des êtres humains : un impératif contemporain », in Niort J.-F. et Pluen O. (dir.), Esclavage, traite et autres formes d’asservissement et d’exploitation, op. cit., 2018, p. 381-422.
-
33.
Ibid., p. 403.
-
34.
CE, avis, Intérieur, 3 mai 2018, n° 394658, préc., p. 2, pt 7.
-
35.
V. Pluen O., Constitution de la Ve République, op. cit., p. 64-65.
-
36.
Projet de loi constitutionnelle n° 911, préc., p. 8.
-
37.
V. sur le sujet Beaud O., « Le cas français : l’obstination de la jurisprudence et de la doctrine à refuser toute idée de limitation au pouvoir de révision constitutionnelle », in Cours constitutionnelles et révisions de la Constitution. Jus Politicum, 2017, n° 18, p. 93-115.
-
38.
Cité Pluen O., Constitution de la Ve République, op. cit., p. 72.
-
39.
CE, avis, Intérieur, 3 mai 2018, n° 394658, préc., p. 2, pt 4.
-
40.
Ibid., p. 1, pt 4.
-
41.
Ibid., p. 15, pt 68 et p. 16, pt 73.
-
42.
Ibid., p. 2, pt 6.
-
43.
Ibid., p. 2, pt 8.
-
44.
Ibid., p. 11, pt 48.
-
45.
V. not. les travaux de Renoux T. S., dont sa thèse Le Conseil constitutionnel et l’Autorité judiciaire : l’élaboration d’un droit constitutionnel juridictionnel, 1984, Economica-PUAM, Droit public positif, t. 8.
-
46.
Ministère de la Justice, « Amovibilité et inamovibilité », in Le système de justice du Canada, www.justice.gc.ca.
-
47.
Cass., avis, 30 avr. 1885, S. 87.1.265.
-
48.
CE, 23 juin 1893, Bariat : Lebon, 506. V. plus larg. Pluen O., L’inamovibilité des magistrats : un modèle ?, 2013, LGDJ-Fondation Varenne, Collection des thèses, n° 66, p. 265-266.