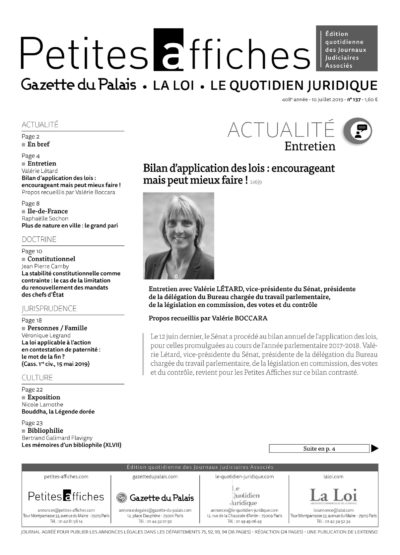La stabilité constitutionnelle comme contrainte : le cas de la limitation du renouvellement des mandats des chefs d’État
Les règles qui limitent le renouvellement des mandats présidentiels dans le temps sont substantielles puisqu’elles obligent à une alternance au pouvoir. Si elles restreignent les possibilités de choix, elles garantissent l’exercice, à intervalles réguliers, d’une expression libre du peuple. C’est donc en méconnaissance de ce caractère démocratique que certains dirigeants tentent de les contourner ou d’en différer l’application, s’affranchissant alors du cadre constitutionnel dans son ensemble : tout report engendre des situations de crises inextricables.
Une constitution détermine avant tout la définition des rapports entre les citoyens et l’État, donc la norme suprême du droit des gouvernés. Si l’on se réfère à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme, elle est à la fois cette « détermination » de la séparation des pouvoirs et l’« assurance » de la garantie des droits. C’est en cela qu’elle est un ordre contraignant. Peut-elle devenir l’instrument d’un homme, d’une idéologie, d’un parti, d’une majorité, sans s’exposer à la critique d’une appropriation du pouvoir ? Un homme peut apparaître à un moment historique donné indispensable à la nation, et vouloir modeler une constitution pour lui permettre d’accéder ou demeurer au pouvoir. Si tel est le cas de l’acte de naissance de l’actuelle constitution française, la loi du 3 juin 1958, qui fixe le cadre de la révision, rappelle que le fondement du nouveau texte est le respect de la séparation des pouvoirs. Outre le fait que ces moments sont rares et correspondent à des phases de reconstruction d’un régime politique, il faut donc toujours distinguer l’objet qu’est l’État de la personne concrète qui gouverne, un temps. Le pouvoir est immanent, la constitution est permanente, par ce qu’elle détermine un ordre qui résiste aux acteurs du jeu politique et les contraint. Elle configure ainsi « une totalité, le résultat d’une série de décisions qui configurent l’unité politique en un certain sens : telle forme de gouvernement et pas telle autre, telle forme d’État et pas telle autre » 1. Les limitations posées au renouvellement des mandats relèvent de cette « totalité », de la structure de l’ordre constitutionnel, condition même de l’adhésion du peuple à ses Institutions.
I – La permanence de l’ordre constitutionnel, condition des adaptations constitutionnelles
Comme l’écrit Ernst Kantorowicz dans Les deux corps du roi : « la valeur d’immortalité ou de continuité, grâce à laquelle les nouveaux gouvernements fondés sur la politia allaient prospérer, était assignée à l’universitas, « qui ne meurt jamais », à la perpétuité d’un peuple (…) dont le roi en tant qu’individu pourrait être séparé mais non la dynastie, la couronne et la dignité royale »2. Il existe ainsi une distinction fondamentale entre le titulaire du pouvoir et la continuité de la nation, qui s’incarne dans l’adhésion du peuple aux institutions. Dans les sociétés contemporaines, la constitution demeure l’instrument qui représente cette continuité, scelle l’unité d’un pays, garantit le fonctionnement des pouvoirs publics et énonce des valeurs, libertés et droits fondamentaux. À l’inverse, la confusion entre le gouvernement, par nature contingent, et sa source constitutionnelle traduit l’incapacité des constitutions à remplir leur but. C’est au nom de la loi commune que les gouvernements sont érigés. Ceux-ci ne sauraient donc la modifier à leur convenance.
Chacun connaît la portée de l’affirmation de Marbury c./ Madison : « Il n’y a pas de milieu entre ces deux alternatives : ou bien la constitution est une loi supérieure et souveraine et il est impossible de la modifier par des procédés ordinaires, ou bien elle est sur le même niveau que les actes législatifs proprement dits, et comme ces actes, elle peut être modifiée quand il plaît à la législature de la changer. Si c’est la première alternative qui est vraie, dans ce cas, un acte législatif contraire à la constitution n’est pas une loi, si c’est au contraire la seconde, alors les constitutions écrites sont d’absurdes tentatives de la part du peuple pour limiter un pouvoir qui est illimité par nature ». John Marshall a raison, en 1803, d’exposer cette logique binaire selon laquelle la constitution est bien la norme suprême, et doit être respectée, ou bien elle n’est « qu’absurde tentative » de la part du peuple pour contraindre les dirigeants. L’histoire constitutionnelle française plaide en faveur de la première affirmation, non pas en dépit de son caractère mouvementé, mais du fait même de ce mouvement dont les soubresauts sont constitutifs d’autant de marques de contournement des règles constitutionnelles : la constitution de 1791 vécue comme une pratique de blocage systématique par le roi usant du veto s’est achevée par la chute de la monarchie à la suite de la journée du 10 août 1792, puis a laissé place à la terreur ; c’est le coup d’État du 18 brumaire an VIII qui met fin au directoire, Napoléon 1er a par la suite supprimé, par sénatus-consulte en 18073, le Tribunat qu’il avait lui-même établi, le texte novateur de 1848, facteur incontournable de blocage du maintien au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte a été aboli par le coup d’État du 2 décembre 18514, le régime de Vichy, le 10 juillet 1940 ne s’est pas accommodé des institutions de la IIIe République, en violant les règles posées pour la révision de la constitution. Elle est avant tout une limite à l’action des pouvoirs publics5, qui se sentent parfois puissants au point de l’abolir.
Ceux-ci ne peuvent en reporter les limites que par une voie démocratique – comme l’a tenté le général de Gaulle, en avril 1969, avec pour conséquence la mise en œuvre volontaire d’une responsabilité politique confirmant ce respect du peuple – ou violente, comme en 1851, ou de façon plus contemporaine dans les coups d’État qui secouent régulièrement, par exemple, le continent africain. Dans ces cas de ruptures brutales, c’est bien parce que la constitution constitue un système contraignant que, par des renversements institutionnels, elle est contournée, donc abolie, ce qui correspond toujours à une régression de l’État de droit et souvent à une progression de la corruption. Toute constitution, source des pouvoirs, est aussi un barrage. L’histoire constitutionnelle française montre d’ailleurs que le pouvoir n’est pas nécessairement légitime à recourir à la révision, même en en respectant les procédures, pour contourner la séparation des pouvoirs et les limites posées à leur exercice, comme en 1807.
La stabilité constitutionnelle, acquise en France sous la IIIe République comme aujourd’hui, mais aussi, à la suite de la chute des dictatures européennes, en Grèce, au Portugal ou en Espagne, est ainsi une marque essentielle du bon fonctionnement des institutions et du respect que lui portent les acteurs politiques. Elle seule garantit un cadre juridique cohérent à la nation et une dévolution régulière du pouvoir politique. Elle fonde la légitimité de l’action des pouvoirs publics. Soustrayant certains éléments au débat, la stabilité constitutionnelle garantit la paix sociale, mais aussi les conditions de la prospérité économique. L’épreuve du temps contribue au respect de la norme, voire à un fort sentiment d’appropriation par le peuple des institutions, comme aux États-Unis.
Pour autant, les constitutions ne sauraient être des textes immuables au risque de devenir inapplicables. Royer-Collard y voyait des « tentes qui ne sont point faites pour le sommeil ». De cette nécessaire adaptation résulte le besoin qu’elles soient modifiables, de deux manières. La première est l’usage des procédures prévues de révision6, mais alors il convient d’insister sur le fait que toute constitution étant l’émanation du peuple souverain, c’est à lui seul qu’il doit incomber d’en entériner les modifications essentielles sans pression des gouvernants en place7. Pour s’attarder à nouveau sur le cas français, c’est bien le peuple et lui seul, qui le 28 octobre 1962, le 27 avril 1969, le 24 septembre 2000, a décidé de l’élection du président de la République, du départ du fondateur de la Ve République – plus d’ailleurs que de la réforme du Sénat et de la régionalisation – ou de l’établissement du quinquennat, d’ailleurs ignoré par près de sept électeurs sur dix.
La seconde modalité de modification des règles constitutionnelles, dans les pays de constitutions écrites, réside plutôt dans l’interprétation des normes, parfois consensuellement par le jeu des acteurs dans les pays où règnent les conventions de la constitution8, ou par le juge constitutionnel dans la plupart des cas. En tout état de cause, l’adhésion du peuple ne peut être usurpée, faute de quoi les constitutions ne sont que d’« absurdes tentatives » pour en garantir le consentement, qui est leur fondement même. La première des constitutions écrites contemporaines, celle de Philadelphie, est un exemple emblématique de l’usage de ces deux modalités : d’une part le socle de 1787 a été complété dès 1789 par les onze amendements formant une déclaration des droits, puis progressivement par 16 autres, dont le plus célèbre reste en 1865 le treizième par l’abolition de l’esclavage, d’autre part l’affirmation progressive du rôle de la Cour suprême pour assurer un équilibre entre les pouvoirs. La stabilité du texte ne doit pas cacher la nécessaire dynamique constitutionnelle. En revanche, il est vrai que les 24 révisions de la constitution de 1958 donnent une impression d’instabilité, même si elles confèrent un caractère plus substantiel à la constitution9 et que les changements du fonctionnement de la Ve République s’expliquent sans doute aujourd’hui davantage par les contingences politiques que par les évolutions institutionnelles. Mais le record est sans doute celui du Mexique qui, en 80 ans, a connu 500 réformes constitutionnelles.
Enfin, Michel Troper a abondamment démontré que l’interprétation de la norme pouvait contribuer à accomplir cette nécessaire dynamique, à la condition que les interprètes tiennent compte les uns des autres et exercent leur pouvoir avec modération : « il faut qu’il existe une justification politique et morale à l’exercice d’un pouvoir »10. Certaines dispositions ne laissent ainsi aucune place à l’appréciation, le texte présentant une « texture fermée »11 tandis que d’autres permettent l’interprétation. Il est évident que les normes organisant la succession des mandats s’inscrivent dans un cadre strict : elles ne laissent pas de place à une interprétation justifiée, même quand une volonté régressive conduit à en différer, contra legem l’application aux mandats en cours. Faute de pouvoir interpréter, ou même « tordre » la règle, on est porté à tenter de l’abolir.
Toute dynamique constitutionnelle est donc subordonnée au respect du cadre fondamental, que représente en particulier la limitation du renouvellement des mandats du chef de l’État.
Peut-on tirer des tendances générales des mutations constitutionnelles, confrontées à autant de particularités qu’il y a de pays membres de l’ONU, soit 193 ? Peut-on se risquer à dessiner des tendances générales, s’agissant de la question de la limitation des mandats successifs ? Dans la plupart des États où le pouvoir décisionnel est concentré au sein de l’exécutif, dans les régimes qualifiés de présidentiels, de « présidentialiste » ou encore pour reprendre ce mot souvent critiqué, à Maurice Duverger12 de « semi présidentiels », mais pas seulement dans ceux-ci, la tendance est de limiter le nombre de mandats du chef de l’État. Dans tous les pays démocratiques, cette règle est incontournable : son respect est la clef du respect du droit du peuple. Ainsi en est-il du cas, historiquement le plus célèbre, du XXIIe amendement à la constitution des États-Unis d’Amérique : en 1947, il convenait, en dépit de l’attachement du peuple au président Roosevelt, qui a été élu quatre fois13, de faire obstacle à la maladie du chef de l’État. Cette révision a modernisé et fait gagner une crédibilité nouvelle aux institutions américaines, déjà fondées sur des mandats courts.
La situation de la Russie paraît plus incertaine. Sans la même justification d’un vieillissement constaté du chef de l’État, l’article 81.3 de la constitution de la fédération de Russie de 1993 comporte une restriction similaire, qui cependant n’exclut pas un retour de l’intéressé au pouvoir : « Une même personne ne peut exercer la fonction de président de la fédération de Russie plus de deux mandats consécutifs ». Ce dispositif a conduit Vladimir Poutine, après ses deux mandats de 2000 et 2004 à céder sa place en soutenant la candidature de Dmitri Medvedev, avant de revenir au pouvoir en 2012, et d’être réélu en 2018. Il est évident que le respect de cette limite, fût-il formel puisque Vladimir Poutine avait conservé des fonctions essentielles de direction de l’exécutif, confère un poids plus grand à sa réélection : le peuple confirme ainsi le choix de ses dirigeants.
Le caractère fondamental de la règle de limitation des mandats dans le temps est donc indéniable. Pour cette raison, il relève, pour les mandats nationaux, de la constitution. Élisabeth Zoller rappelle que l’Arkansas avait voulu rendre inéligible tout représentant ou tout sénateur ayant accompli trois mandats à la chambre des représentants ou deux au Sénat, ce que la Cour suprême déclara contraire à la constitution14 faute d’une délégation constitutionnelle expresse. La règle fait donc bien partie de l’ordre constitutionnel substantiel
Dès lors, les tentatives de révision ou de contournement confirment l’utilité de ces limitations : c’est bien parce que la limitation à deux mandats est une utile contrainte que tant de dirigeants tentent de l’abolir ou d’en différer l’application. Mais la substance de l’ordre constitutionnel n’autorise pas de tels changements au gré des circonstances.
II – Pourquoi limiter le renouvellement des mandats ?
« Le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins » affirme Jefferson. Faut-il entendre le moins longtemps ? La séparation des pouvoirs vaut non seulement dans son acception organique, qui consiste à confier les pouvoirs à des organes séparés, elle vaut aussi dans le temps : assurer la pérennité des institutions en organisant le renouvellement des dirigeants.
Les arguments sont en apparence simple : on pourrait les énoncer selon la logique de Montesquieu : les détenteurs du pouvoir sont portés à en abuser, et cette loi se vérifie d’autant plus que leur présence au pouvoir est longue. Le pouvoir engendre la volonté de s’y maintenir. Il y a donc plusieurs avantages à limiter le renouvellement des mandats : éviter l’assimilation d’un homme, d’une équipe ou parfois d’une famille, avec celle d’un État, confirmer les choix d’une politique qui dépasse les détenteurs du pouvoir, parce que l’excessive personnalisation risque de faire sombrer à la fois cet homme et le régime. La « révolution de jasmin », en Tunisie, en décembre 2010, a entraîné à la fois la chute de Ben Ali et la mise en place d’institutions nouvelles15, et cet exemple n’est pas isolé.
Au-delà de cet argument, cette limitation favorise le renouvellement des équipes, évite une sorte de cristallisation statique du pouvoir. Limiter le renouvellement du mandat de chef de l’État, c’est organiser les conditions d’une alternance des gouvernements, comme aux États-Unis d’Amérique, donc une dynamique dans la gestion des affaires publiques. Enfin, cette règle présente l’avantage de faire naître une opposition responsable, inhérente à la démocratie : si celle-ci a, à échéances régulières, une chance d’arriver au pouvoir, elle ne peut que conforter la règle commune. Le rôle des partis politiques est de ce fait conforté. En revanche, l’élimination de toute possibilité d’alternance cantonne l’opposition en tant que force instituée aux retranchements, à la violence ou à la disparition. Ceci vaut bien entendu pour l’opposition parlementaire, mais cette même règle peut aussi valoir si le passage de relais intervient au profit de la même force politique, puisque tout nouvel élu présentera nécessairement un programme distinct de celui de son prédécesseur, engendrera une nouvelle équipe, renouvellera les dirigeants administratifs, appellera une nouvelle politique et de nouveaux hommes, etc.
Il n’est donc pas étonnant que cette règle s’impose dans le cadre de transitions démocratiques, ce dont témoigne par exemple l’article 123 de la constitution portugaise du 25 avril 1976 : « Le président de la République ne peut être réélu pour un troisième mandat consécutif ni pendant les cinq années suivant le terme du second mandat consécutif », l’article 14 de la constitution brésilienne de 1988 : « le président de la République, les gouverneurs des États et du district fédéral, les maires et ceux qui leur ont succédé ou qui les ont remplacés en cours de mandat peuvent être réélus pour une seule période subséquente »16 ou l’article 57 de la constitution tchèque de 1992 : « Nul ne peut être élu plus de deux fois consécutivement ». La corrélation est donc forte entre de telles limitations et la soif de démocratie.
Les limitations au renouvellement indéfini des mandats relèvent des éléments fondamentaux qui aménagent la séparation des pouvoirs, quel que soit le type de régime. Elles concernent principalement les régimes présidentiels où la séparation des pouvoirs est la base du fonctionnement des institutions, qui concentrent donc le pouvoir décisionnel au profit du chef de l’État. Si l’exemple des États-Unis d’Amérique est le plus souvent cité, on peut y ajouter celui de la République dominicaine, qui a choisi le régime présidentiel. Entre 1844 et 2015, la constitution y a été réformée 39 fois, dont au moins 15 fois afin de permettre la réélection du président de la République. L’apparition contemporaine de la règle y correspond d’ailleurs à la transition démocratique après la dictature de Trujillo, et le rétablissement de la démocratie par Juan Bosch avec la constitution de 1963, rendue inapplicable par un coup d’État et l’intervention américaine17. En 2015, l’article 124 a été révisé et a autorisé la réélection à un deuxième mandat consécutif18, mais interdit une autre élection, même après une interruption19. Aujourd’hui, le débat refait pourtant surface en République dominicaine.
Toutefois, cette règle limitative peut également concerner des régimes de type parlementaire dans lesquels le chef de l’État est élu au suffrage universel, comme le cas du Portugal, déjà cité, de la Pologne, celui de l’Irlande où, depuis 1937, le président est élu par le peuple pour un mandat de sept ans, rééligible une seule fois20, celui de la Finlande21, de l’Autriche dans la constitution de 1920, remise en vigueur depuis 1945, dont l’article 60 dispose : « La durée des fonctions du président fédéral est de six ans. Il ne peut être réélu consécutivement qu’une seule fois » ou encore celui de la France, et même des régimes parlementaires où le chef de l’État est élu par la chambre des députés, comme en Grèce où une seule réélection est possible, ou encore la Suisse où le mandat du président du conseil fédéral est d’un an non renouvelable22. Au soutien de cette limitation drastique, ou plus généralement d’une limitation ou d’une interdiction du renouvellement des mandats, se retrouve l’argument rousseauiste de méfiance à l’égard de la délégation par le peuple du pouvoir et du système représentatif : « le souverain, qui n’est qu’un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même : le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté. En effet, s’il n’est pas impossible qu’une volonté particulière s’accorde sur quelque point avec la volonté générale, il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant »23. Renouveler l’accord par un renouvellement des hommes apparaît donc comme une nécessité démocratique. La concentration du pouvoir exécutif, pour paraître aujourd’hui nécessaire au gouvernement, correspond aussi à l’exigence équilibrante d’un renouvellement des titulaires du pouvoir.
Enfin, il est évident que la transmission du pouvoir est facilitée par le respect de la règle : la situation du président en fin de mandat lui permet de préparer sa succession, ce qui revient à ouvrir un débat qui ne portera pas exclusivement sur son bilan. À l’inverse, le contournement de la règle aboutit à une cristallisation du pouvoir.
On connaît aussi les arguments contre l’introduction de telles règles. Ces arguments ont par exemple été exposés24 lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 en France, où désormais « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs » de président de la République (article 6). Ils tiennent essentiellement à l’atteinte au libre choix du peuple. Mais dans bien des pays dont les élections ne paraissent pas réellement ouvertes, l’abolition de cette limitation aboutit de facto à un choix contraint du peuple. Pour ce qui est de la France, on a débattu de l’inutilité de cette règle – aucun président français n’a accompli plus de deux mandats – ou encore dans d’autres cas de leur dangerosité, conduisant à des contestations, coup de force, ou encore recours provisoire à un prête-nom. Mais ces arguments sont contestables : le peuple est toujours amené à renouveler ses choix, à rappeler au pouvoir, après interruption, une personne à laquelle il est attaché, comme en Russie, et la mise en place de barrières n’est pas inutile parce qu’on les contourne parfois par un coup de force, comme si l’utilité d’une serrure était par elle-même contestable lorsqu’on défonce une porte. Quelle crédibilité peut-on accorder, sur le plan international, comme sur le plan interne, à qui ne respecte pas les bornes que le système qui lui a permis d’accéder au pouvoir a fixées ?
Et pourtant, la tentation existe toujours et partout de contourner ce cadre, l’exemple le plus récent étant celui de la Chine : en 1982, Deng Xiaoping avait introduit la limitation du mandat présidentiel à deux termes, dans le but de prévenir toute dérive autocratique. La réforme de mars 2018, supprime cette limitation du nombre de mandats en tant que chef de l’État. Aux Philippines, l’article VII section 4 de la constitution du 2 février 1987 interdit toute réélection du président, dès lors qu’il a accompli au moins quatre des six ans du mandat. Il n’est pas indifférent de constater que cette limite correspond, comme la constitution elle-même, à la volonté d’en finir avec les vingt années de dictature, de 1965 à 1986, du président Marcos. Le Congrès a entamé au mois de janvier 2019 l’examen d’une réforme constitutionnelle, dont le but affiché serait de passer à un système fédéral, avec des pouvoirs accrus pour le président, mais cette réforme permettrait aussi au président de la République de se représenter et d’enchaîner deux mandats de cinq ans chacun.
Un référendum a été organisé du 20 au 22 avril 2019 en Égypte acceptant la révision constitutionnelle qui autorise l’actuel président de la République à se représenter une nouvelle fois et à rester au pouvoir jusqu’en 2030, alors que son mandat devrait s’achever en 2022. Si une majorité des 44 % de votants a soutenu cette nouvelle constitution, le taux de « non » – 12 % – a été multiplié par six depuis la dernière consultation, prouvant que l’équilibre est plus précaire qu’il n’y paraît. Peut-être le souci d’ordre l’emporte-t-il à court terme, mais 2030 représente un horizon très lointain pour en fixer l’échéance.
Ces mécanismes jettent toujours la suspicion, parfois la révolte et souvent la réprobation internationale sur ceux qui les initient. Ils sont facteurs de trouble, parfois de violence, plus que de stabilité dont ils se prévalent. Ils sortent du cadre constitutionnel, alors que le maintien de la règle de la limitation du nombre de mandats successifs est synonyme de stabilité. Et pourtant, on trouve bien des exemples où les chefs d’État tentent d’abroger ces règles ou d’en différer l’application.
III – Pourquoi ne pas respecter cette règle ?
On ne voit en réponse que de mauvaises raisons. La première réponse qui vient à l’esprit est le maintien du pouvoir en place pour le pouvoir. Les situations abondent où il faut se résoudre à constater que la seule explication réelle de l’abandon de la règle des deux mandats est la volonté de perdurer. Dans ce cas, les départs, différés au gré des révisions constitutionnelles, se font sous la pression populaire, risquant toujours de se transformer en affrontements, parfois sanglants. On ne trouve à cet égard que des exemples convergents. Tel est le cas, le plus récemment constaté, en Algérie : un amendement constitutionnel a été adopté par le Parlement à l’unanimité le 12 novembre 2008, abolissant la limite de deux mandats permettant au président Abdelaziz Bouteflika d’être réélu. Puis, cette absence de limites a débouché, dix ans plus tard, sur le blocage de tout renouvellement au pouvoir, qui n’a cédé que devant la pression populaire, créant une situation de trouble, de report des échéances électorales, et une confusion politique majeure.
Le cas de l’Algérie n’est pas isolé : au Burkina Faso, lorsque le président Blaise Compaoré a achevé ses deux premiers mandats de sept ans en 2005, le Conseil constitutionnel a décidé qu’un amendement à la constitution, adopté en 2000, limitant le mandat présidentiel à deux mandats de cinq ans ne s’appliquait pas à lui, puisque cette règle avait pris effet alors qu’il était en exercice. Cela a ouvert la voie à sa candidature aux élections de 2005, qu’il a remportées. Près de dix ans plus tard, en octobre 2014, Blaise Compaoré a tenté de faire modifier l’article 37 de la loi fondamentale – limitant le nombre de mandats présidentiels – mais la pression populaire a été telle qu’il a été conduit à la démission. Exilé, poursuivi, les conditions de son départ ne peuvent être regardées comme satisfaisantes même si la haute cour de justice n’a pas retenu cette tentative de modification comme un chef de haute trahison.
Au Cameroun, l’Assemblée nationale a modifié, en 2008, la constitution de 1996 afin de supprimer la limite de deux mandats présidentiels, permettant ainsi au président Paul Biya de se présenter pour une réélection en 201125. En Guinée Conakry, une même tentative se dessine. Au Tchad, en 2005, un référendum a approuvé une modification de la constitution qui supprime la limite de deux mandats, ce qui a permis au président Idriss Déby de se présenter pour un troisième mandat en 2006, puis un quatrième et cinquième mandat en avril 2016. Les conséquences sur l’économie du pays, sa situation militaire et politique mais également sur l’état de la démocratie sont aujourd’hui trop connues pour qu’on s’y attarde. On citera seulement le report, depuis 2016, des élections législatives et la promulgation le 4 mai 2018 d’une nouvelle constitution, dont l’article 66 prévoit que le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de six ans, renouvelable une fois : l’attachement symbolique à la règle est tel qu’elle est réaffirmée, dès lors qu’elle ne peut gêner les gouvernants en place.
Au Burundi, à la suite d’un référendum très controversé qui s’est tenu le 17 mai 2018, le texte de la nouvelle constitution permet au chef de l’État, au pouvoir depuis 2005, de briguer deux nouveaux mandats de sept ans à partir de 2020. Le pays est plongé dans une grave crise politique depuis la réélection controversée de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, en avril 2015. Les violences qui ont accompagné cette crise ont fait au moins 1 200 morts et plus de 400 000 réfugiés entre avril 2015 et mai 2017, d’après les estimations de la Cour pénale internationale (CPI), qui a ouvert une enquête. Nombre d’autres exemples : le Togo, où la limite des mandats a été supprimée en 2002, et où l’affichage de l’attachement à la règle s’accompagne, du même mouvement, de son contournement immédiat26 ; l’Ouganda, où elle l’a été en 2005 ; le Gabon, la Turquie, ou encore le Niger viennent confirmer le même schéma. La constitution de 1999 y a limité le mandat du président à deux mandats de cinq ans et a rendu illégale la modification de cette disposition. Le président alors en poste, Mamadou Tandja a convoqué un référendum sur une nouvelle constitution le 4 août 2009, qui lui permettait de rester au pouvoir jusqu’en 2012 et de se présenter ensuite pour un nombre illimité de mandats. Après que le Parlement et la Cour constitutionnelle se sont opposés au référendum, Tandja a dissous les deux et a commencé à statuer par décret, puis a été renversé par l’armée en 2010. Des élections régulières ont eu lieu en 2011. Les actes de suspension des constitutions en Afrique témoignent donc de « l’impuissance du droit constitutionnel africain à réguler ou encadrer véritablement les phénomènes politiques »27.
Enfin, le cas de la Bolivie apparaît comme emblématique du fait que la méconnaissance de la règle de limitation des mandats conduit à sortir du cadre constitutionnel. L’article 168 de la constitution de 2009 dispose : « la période du mandat de la présidente ou du président et de la vice-présidente ou du vice-président de l’État est de cinq ans, et ils peuvent être réélus une seule fois de manière continue ». Après un premier contournement, et une décision de 2013 l’autorisant à se représenter, le président Evo Morales a convoqué un référendum le 21 février 2016 pour une réforme constitutionnelle, afin de lui permettre de briguer un quatrième mandat de cinq ans. Avec 84 % de participation, le « non » l’avait emporté à 53,3 %. À la différence du cas égyptien, la forte mobilisation électorale est donc indéniable. En dépit de ce résultat, le tribunal constitutionnel, acquis au président, a invalidé les résultats du référendum, et admis que la norme constitutionnelle toujours en vigueur était abrogée28. Aucune justification juridique, tenant à l’inconventionnalité de la constitution, ne résiste à l’analyse.
De tels exemples sont emblématiques des « régressions démocratiques en Amérique latine »29. Le contournement de la règle produit donc partout les mêmes effets : il fait sortir le régime d’un cadre constitutionnel et démocratique.
On peut également en tirer la conclusion que lorsque la règle est une première fois reportée, rendue inapplicable aux mandats passés comme au Togo, voire qu’une tentative a échoué comme dans le cas bolivien, les dirigeants se croient autorisés à considérer ce report comme un précédent, comme si le barrage constitutionnel avait définitivement craqué. Or il n’en est rien puisqu’une nouvelle échéance se présente nécessairement, et si l’on peut considérer qu’« une fois ne compte pas », on ne trouve pas un exemple où par la suite l’absence de limites ne conduit pas à l’abandon de tout cadre démocratique en bloquant toute alternance : le premier mouvement de report est une dérogation, avec des motifs conjoncturels qui ne peuvent justifier un second report, lequel apparaît comme un véritable abandon du cadre constitutionnel. Comme le juge la Cour constitutionnelle de Colombie30, l’impossibilité de briguer un troisième mandat relève de « principes structurants prévus originellement par la constitution »31 qui en organisant le lien entre le peuple et les gouvernants, lient irrévocablement l’un aux autres. Y porter atteinte, c’est altérer ce lien qui, seul, explique la citoyenneté et justifie l’obéissance civile.
On peut en conclure que la règle est, quelle que soit la nature des régimes politiques, mais plus encore lorsque le chef de l’État exerce l’essentiel des compétences de l’exécutif, substantielle au regard de l’organisation des pouvoirs et de la démocratie. Son respect est le respect du peuple.
Notes de bas de pages
-
1.
Beaud O., « Le cas français : l’obstination de la jurisprudence et de la doctrine à refuser toute idée de limitation au pouvoir de révision constitutionnelle », Jus Politicum 2017, n° 18.
-
2.
Kantorowicz E., Les deux corps du roi, 1957, traduction française 1989, Gallimard, p. 198.
-
3.
28 floréal an XII.
-
4.
L’article 45 de la constitution de 1848 limitait la durée du mandat du président de la République, élu au suffrage universel à quatre ans, non immédiatement rééligible. Ce fut la cause directe du coup d’État.
-
5.
Camby J.-P., « La constitution de 1958 ou les limites inhérentes à l’action des pouvoirs publics », in Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel, 2008, Montchrestien, p. 61.
-
6.
V. Genevois B., « Les limites d’ordre juridique à l’intervention du pouvoir constituant », RFDA 1998, p. 909.
-
7.
« Il n’existe pas de système constitutionnel clos de nature purement normative, et il est arbitraire de considérer comme unité et ordre systématique une série de dispositions particulières que l’on définit comme lois constitutionnelles, si leur unité ne procède pas d’une volonté unitaire préalable » ; Schmitt C., Théorie de la Constitution, 1928, rééd. 1993, PUF, p. 139 : lignes écrites, qu’on ne s’y trompe pas, sous la constitution de Weimar et au sujet de celle-ci, voir notamment l’introduction par Beaud O.
-
8.
Avril P., Les conventions de la Constitution, 1997, PUF ; Antoine A., Droit constitutionnel britannique, 2016, LGDJ.
-
9.
Guillaume M., Les révisions constitutionnelles : une constitution moins procédurale et plus fondamentale, 2018, Le Seuil, Pouvoirs, n° 166, p. 27 à 39.
-
10.
Hamon F. et Troper M., Droit constitutionnel, 2018, LGDJ, n° 51.
-
11.
V. Hart H., Le concept de droit, 1976, Bruxelles, faculté universitaire Saint-Louis ; Rials S., « Entre artificialisme et idolâtrie », le Débat, mars-avr. 1991, n° 64, p. 171 ; Avril P., Les conventions de la Constitution, 1997, PUF, p. 84.
-
12.
Duverger M., Échec au roi, 1978, Albin Michel ; V. Colliard J.-C., Les régimes parlementaires, Thèse FNSP, 1978.
-
13.
1932 : 22,8 millionsde voix, 1936 : 27,2 millions de voix, 1940 : 27, 2 millions de voix, 1944 : 25,6 millions de voix.
-
14.
Zoller E., Droit constitutionnel, 1998, PUF, n° 272 : Cour suprême US term limits, Inc V. 514us 779, 1995.
-
15.
Après l’arrivée à la présidence de Zine El-Abidine Ben Ali en 1987, la constitution tunisienne a été amendée en 1988 pour permettre aux présidents de ne pas exercer plus de deux mandats. Après les deux premiers mandats de Ben Ali, un nouvel amendement en 1998 a permis un troisième mandat. Enfin, en 2002, la limite d’âge a été abolie et portée à 75 ans. Ben Ali avait alors 73 ans. Plus que la légitimité, c’est la crédibilité du chef de l’État qui est atteinte.
-
16.
Depuis 1994, le mandat du président de la République au Brésil est de quatre ans (article 84). De 1889 à 1937 puis de 1945 à 1997, l’impossibilité valait au terme du premier mandat. Depuis 1997, un président peut effectuer deux mandats consécutifs sans pouvoir se présenter dans les quatre années qui suivent son second mandat. Mais les particularités du fonctionnement de ce régime présidentiel font que les mandats sont interrompus par des procédures pénales, qui s’apparentent à des responsabilités politiques : Dilma Rousseff est destituée en mai 2016 après une réélection en 2014. L’ancien président Lula da Silva, qui a effectué deux mandats de 2003 à 2011 sans pouvoir en briguer un troisième successif, est condamné en 2018, ce qui l’empêche de se représenter. La place du système judiciaire aggrave donc les conséquences de la règle.
-
17.
Manigat L.-F., « La crise dominicaine », RF sc. pol. 1965, p. 1170, https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1965_num_15_6_392905.
-
18.
L’article 124 de la constitution de 2010 faisait obstacle à la réélection suivant un mandat de quatre ans. Le même article, dans la version de la constitution de 2015 fait obstacle à la prolongation au-delà de deux mandats de quatre ans.
-
19.
Les dispositions transitoires (20°) prennent le soin de rendre applicable le dispositif au mandat en cours.
-
20.
En dépit de 30 amendements à la constitution, cette règle y fait preuve d’une grande stabilité.
-
21.
L’article 54 de la constitution de 1999 dispose : « Le président de la République est élu au suffrage direct parmi les citoyens finlandais de naissance, pour un mandat de six ans. Une même personne peut être élue à la présidence pour l’exercice de deux mandats consécutifs au plus ».
-
22.
L’article 176 de la constitution fédérale de 1999 dispose : « La présidence du conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération. L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du conseil fédéral. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence ».
-
23.
Rousseau J.-J., Du contrat social, Livre II, chap. 1.
-
24.
Roussillon H., in La révision de 2008 : une nouvelle Constitution ?, Camby J.-P. (dir.), Fraisseix P. et Gicquel J., 2011, LGDJ, p. 37.
-
25.
L’argument historique de « présomption de continuité » ne vaut évidemment pas au regard de l’évolution récente du pays : la réforme a pour effet de pérenniser l’« hyperpuissance du président de la République » ; v. Owona S.-M., « Les évolutions constitutionnelles en Afrique noire francophone : recherche sur l’idéologie dominante dans l’élaboration des constitutions au Cameroun », RDP 2019, p. 156. Les conditions du déroulement des élections du 7 octobre 2018, l’emprisonnement de Maurice Kamto soulignent, ici encore, que l’abolition de la règle du non-renouvellement des mandats conduit à des altérations profondes du fonctionnement démocratique du régime.
-
26.
En mai 2019, un amendement à la constitution est voté par 90 députés, l’opposition étant désormais largement absente du parlement : « Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Les mandats déjà réalisés et celui en cours à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte ». Le projet initial portait sur un septennat renouvelable. L’actuel président est au pouvoir depuis 2005, il a succédé à son père qui était au pouvoir depuis 1967.
-
27.
Tuekam Tatchum C., « La normativité des actes de suspension de la Constitution dans les États d’Afrique francophone », RDP 2018, p. 573 : le cadre d’analyse plus proche du décisionnisme de Carl Schmitt, s’en éloigne puisque la décision n’est ici plus le fondement absolu du droit.
-
28.
« La sentence constitutionnelle plurinationale n° 0084/2017 du TCP du 28 novembre 2017, longue de 81 pages, a déclaré inconstitutionnels plusieurs articles de la loi sur le régime électoral et supprime plusieurs articles de la constitution politique de l’État de 2009, en particulier l’article 168 (…). Pour ce faire, le TCP s’appuie sur la supposée incompatibilité de la constitution bolivienne avec la convention interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH), ainsi que sur la distinction entre deux types de normes constitutionnelles de rang inégal » ; Audubert V., Jus Politicum : http://blog.juspoliticum.com/2018/09/20/juger-de-linconstitutionnalite-dune-norme-constitutionnelle-le-cas-de-la-decision-du-28-novembre-2017-du-tribunal-constitutionnel-plurinational-bolivien-par-victor-audubert/.
-
29.
Posado T., « les démocraties libérales sont-elles mal-gouvernables ? », Pouvoirs 2018, n° 169, p. 97.
-
30.
Le 26 février 2010, la Cour constitutionnelle rendait publique la sentence n° C-141/10, écartant l’application d’une loi de 2009, et jugeant contraire à la constitution la convocation d’un référendum d’initiative populaire pour réformer une nouvelle fois la constitution et permettre à Álvaro Uribe de briguer un troisième mandat ; v. del Pilar Trujillo Sosa R., « Le pouvoir constituant et la jurisprudence constitutionnelle en Colombie de 1989 à 2012 », Jus Politicum 2015, n° 14 ; Schoettl J-.E., « Exercice franco-colombien de fiction comparative entre jurisprudences constitutionnelles : ou comment le Conseil constitutionnel aurait-il jugé l’affaire dite de la seconde réélection du président Uribe Maison de l’Amérique latine », in Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, 2014, Dalloz, p. 579. La Cour a été critiquée en ce qu’elle bloquait ainsi une initiative populaire, s’en remettant au respect des modes de révision prévus par la constitution, et a été soutenue en ce qu’elle garantissait un principe d’alternance politique et évitait un changement de régime.
-
31.
« Así pues, de los distintos mecanismos contemplados en el artículo 374 constitucional el único que no está sujeto a límites de competencia es una Asamblea Nacional Constituyente, siempre que sea convocada expresamente para proferir una nueva Carta y, por lo tanto, la vía de referendo constitucional no es idónea para transformar los principios estructurantes plasmados originalmente en el texto constitucional » (CC. Decisión C-141 de 2010, p. 129).