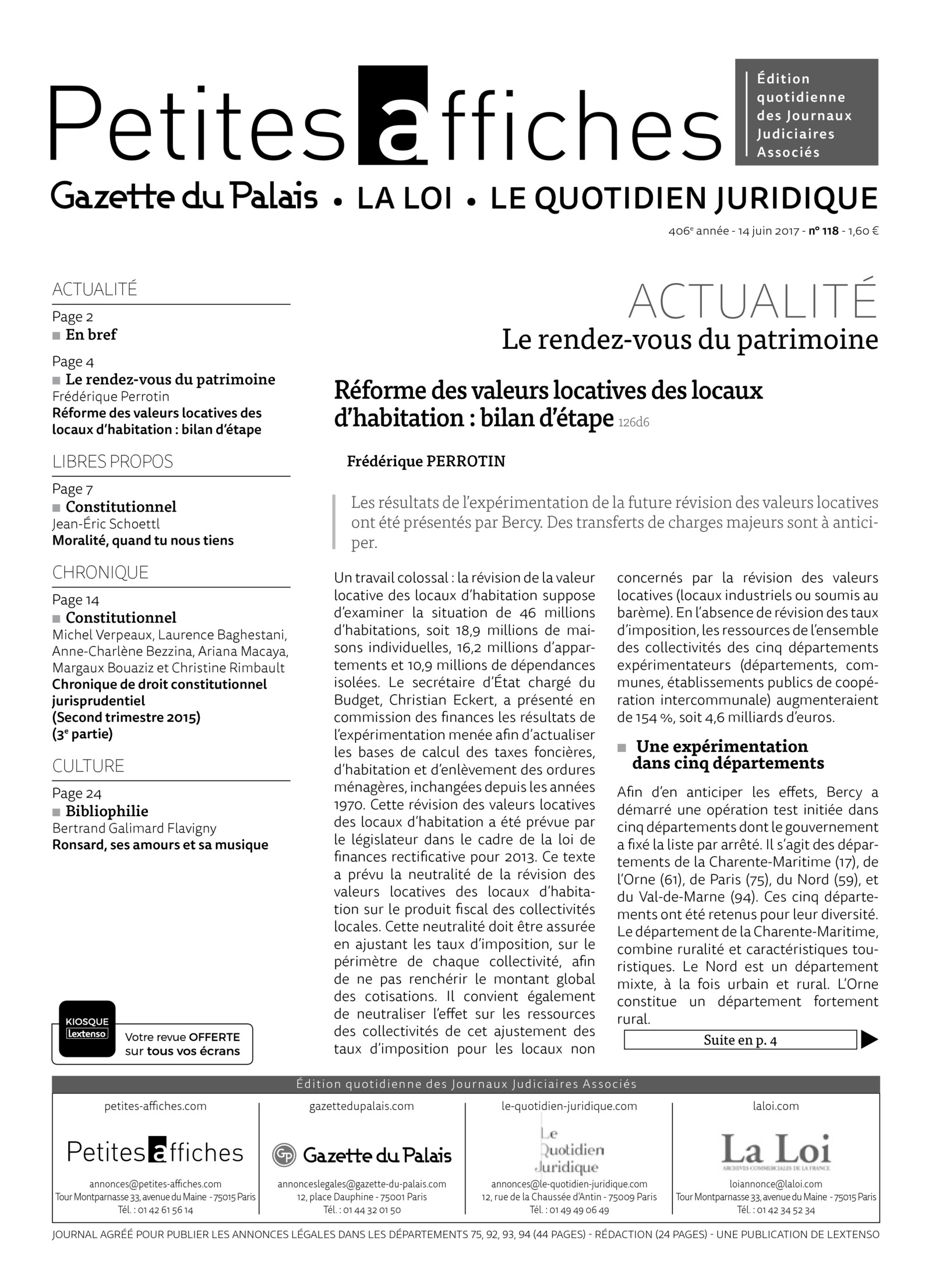Moralité, quand tu nous tiens
La teneur des projets de loi pour le rétablissement de la confiance dans la vie démocratique a été révélée par le garde des Sceaux, mais les textes présentés ne sont pas définitifs. Le projet de loi constitutionnelle n’est pas encore prêt. La réforme est cependant annoncée par le porte-parole du gouvernement avec des accents quasi eschatologiques (« Ce texte doit nous permettre d’entrer dans ce nouveau monde de la transparence totale »). Brr…
Cette surenchère de puritanisme messianique promet bien des embarras dans l’avenir (et dès aujourd’hui avec l’affaire Ferrand). Érigée en norme, la pureté appelle l’épuration. « Un pur trouve toujours plus pur que lui qui l’épure », nous dit justement Guillaume Perrault dans un quotidien du matin…. Comme le montre le théâtre classique, le comportement du vertueux n’est jamais « raccord » avec les exigences qu’il dit s’imposer et même devoir imposer à ses semblables. Or nous sommes dans un pays qui pardonne plus à de petits écarts qu’à une infatuation éthique non corroborée par la conduite personnelle. Aux poses de Tartuffe, nos concitoyens préfèreront toujours les fourberies de Scapin.
Quant à l’histoire, qui juge les dirigeants au vu d’un bilan global et rétrospectif, elle offre l’exemple d’hommes d’État intéressés, mais ayant beaucoup fait pour la nation (de Mazarin au Clémenceau du scandale de Panama, en passant par Talleyrand) comme de ministres intègres, mais ayant pris des décisions catastrophiques (exemples plus nombreux encore hélas !).
Plus profondément, toutes ces législations moralisatrices reposent sur un malentendu. Nos compatriotes réprouvent certes les mauvaises mœurs de la classe politique, mais ce qu’ils lui reprochent le plus, c’est de ne pas prendre à bras le corps les problèmes qui les assaillent au quotidien (chômage, insécurité…). Nos concitoyens veulent que le politique agisse sur le cours des choses, plutôt que légiférer sur la manière de gouverner. Au travers des affaires, ils s’indignent moins de l’affaire elle-même que de l’impuissance ou de la négligence du politique face aux grands défis.
C’est en ce sens que les lois de moralisation de la vie politique sont « à côté de la plaque », voire contre-productives. Des règles trop contraignantes en matière d’exemplarité (comme en matière de représentativité des dirigeants par sexes, origines, etc.) ont toutes les chances d’aboutir à des résultats « sous optimaux » en termes d’efficacité de l’action publique, car elles ne permettront pas de désigner le meilleur homme (ou femme) à la bonne place, ce qui renforcera la défiance de l’opinion au lieu de la dissiper.
De telles règles obligent par ailleurs à immoler tel excellent collaborateur à la première polémique mettant en cause sa probité, sa déontologie, son rapport à l’argent, au sexe, etc. La calomnie se nourrira de l’implacable obligation de transparence, jointe à l’action des lanceurs d’alerte. Héros des temps nouveaux et modernes inquisiteurs, en grande partie protégés des suites professionnelles, civiles et pénales de leurs délations, les accusateurs amateurs clouent au pilori le responsable public en diffusant la rumeur par les canaux appropriés. Et ce n’est pas tout : en édictant des règles pénalement sanctionnées, les lois de moralisation permettent aux accusateurs amateurs de passer le relais aux accusateurs professionnels dont les enquêtes et les instructions alimenteront le bûcher. Tôt ou tard, il faudra s’amputer pour montrer qu’on veut rester exemplaire. Exemplarité, que de dommages collatéraux causés en ton nom !
Les futures lois pour la confiance dans la vie démocratique prendront la suite de toute une série de textes qui, depuis trente ans, après chaque scandale, entendent juguler définitivement les mauvaises tentations. Pas moins de deux textes pour la seule année 2016 : la loi du 20 avril relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; et la loi du 9 décembre relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2 (car il y eut une première loi Sapin en 1993 : celle du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques – qui avait déjà l’ambition d’assainir la vie publique).
Ni nécessaires, ni suffisants, ces corsets font perdre un temps précieux à nos responsables publics (élus et fonctionnaires) et à ceux qui les surveillent, ne serait-ce qu’en remplissage et contrôle de déclarations de patrimoine et de déclarations d’intérêts.
Le public s’est-il seulement aperçu de la superposition de ces ceintures de chasteté qu’on boucle depuis trente ans pour lui rendre confiance dans la chose publique ? D’autant moins, peut-on penser, qu’on lui présente la nouvelle cure comme une désintoxication jamais tentée à ce jour.
La loi peut-elle d’ailleurs faire advenir la morale ? Celle-ci n’est-elle pas question de mœurs plutôt que de normes ? Peut-on mêler sans encombre le pénal et le moral ? Que cherchons-nous à la fin des fins : à humilier les politiques ou à sélectionner les meilleurs gouvernants possibles ?
Pour en revenir aux projets de loi sur la moralisation, le garde des Sceaux en fait le nec plus ultra de son ralliement au chef de l’État et le point d’orgue de sa mission. N’y a-t-il pas pourtant des sujets plus urgents et plus importants dans son champ de compétences ministérielles (surpopulation carcérale, effectivité de la réponse pénale, adaptation et durée des procédures, qualité du droit, décence des moyens, judiciarisation de la société, sérénité de la justice…) ?
Quelle urgence, autre que d’affichage, présente ce bric-à-brac de mesures de circonstance, proches parentes des « y a qu’à » du café du commerce ? Certaines font écho à l’affaire Fillon, soulignant au passage la licéité actuelle des actes qui ont été reprochés à l’ancien Premier ministre (emploi d’un proche comme assistant parlementaire, poursuite d’une activité de conseil pendant le mandat). D’autres (ou les mêmes) soulèvent des questions d’opportunité et de constitutionnalité.
Regardons de plus près.
I. La limitation dans le temps du nombre de mandats consécutifs au Parlement, dans les assemblées délibératives locales ou au Parlement européen, est une règle d’inéligibilité qui, comme toutes les règles d’inéligibilité aux mandats électifs de caractère politique, ne serait justifiée que dans la mesure nécessaire au respect d’exigences constitutionnelles. En effet, aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Qui plus est, selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, la loi ne saurait priver un citoyen du droit d’éligibilité dont il jouit en vertu de l’article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’électeur.
Où serait la nécessité de la limitation en l’espèce ? Au nom de quel impératif supérieur empêcher rétroactivement la carrière parlementaire d’un Mendès-France ? Osera-t-on dire qu’en privant de son droit d’éligibilité l’élu qui, par trois fois, a obtenu la confiance de ses électeurs et en interdisant à ceux-ci de lui renouveler leur confiance une quatrième fois, on assure mieux le respect de l’égalité devant le suffrage ? Ou qu’on préserve mieux la liberté de l’électeur ? Il serait inédit qu’on sanctionne un élu en raison de la confiance que lui maintiennent ses électeurs.
Pour sa part, la limitation dans le temps de mandats exécutifs locaux empêche à la fois le titulaire (parvenu au terme de trois mandats successifs) de se représenter et son conseil (municipal, départemental, régional), de lui renouveler sa confiance.
En quoi les restrictions apportées par le projet de loi au droit d’éligibilité aux fonctions exécutives locales et à la liberté de choix des assemblées locales est-elle nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’électeur ? Quel intérêt la démocratie trouvera-t-elle à interdire à un Alain Juppé de faire un quatrième mandat de maire de Bordeaux ? Invoquera-t-on la nécessité de renouveler les élus ? Ou celle de « déprofessionnaliser » la classe politique ? Ce sont là des notions vagues et journalistiques. Sur le plan constitutionnel, elles sont de peu de poids au regard de l’intérêt général qui s’attache à ce qu’une bonne gestion soit poursuivie, à ce qu’un programme recueillant l’assentiment des citoyens soit mis en œuvre jusqu’au bout, à ce que les équipements commencés soient achevés et à ce que la continuité des services publics soit assurée, toutes finalités qui seraient compromises si la loi empêchait artificiellement le corps électoral de renouveler sa confiance au maire autant de fois qu’il le veut.
Les exemples étrangers devraient inciter à la circonspection. Ainsi, pour conjurer le caudillisme, le Mexique a inscrit dans sa Constitution, au même rang que l’effectivité du suffrage universel, la prohibition de la réélection. Conséquences unanimement déplorées : défaut de perspective, gestion à court terme, frustration d’un électorat qui voudrait voir un bon maire ou un bon gouverneur poursuivre son œuvre. Et comble des combles : incitation aux indélicatesses. Qui veut faire l’ange fait la bête…
Bien sûr, la France n’est pas le Mexique et trois mandats permettent d’achever un équipement. Mais le doigt est dans l’engrenage : déjà René Dosière et l’association ANTICOR demandent qu’on abaisse le nombre maximum de mandats consécutifs de trois à deux dans le projet de loi.
La limitation des mandats dans le temps soulève en outre toutes sortes de questions de cohérence :
-
Vaut-elle seulement pour les mandats de même nature ? (Autrement dit : une suite de 4 mandats de député est-elle interdite, mais une suite de 3 mandats de député puis de 3 mandats de sénateur permise ? Voilà qui serait déprofessionnaliser !)
-
Est-il permis ou interdit d’effectuer trois mandats de maire dans une commune A immédiatement suivis d’un mandat de maire dans la commune B ?
-
Si je démissionne de mon mandat de maire trois mois avant la fin de mon troisième mandat, cette césure me permet-elle de briguer un quatrième mandat ?
Les objections constitutionnelles à la limitation des mandats dans le temps sont si fortes que le gouvernement a décidé, pour les éviter, de placer cette limitation dans la Constitution elle-même.
Les objections n’en demeureraient pas moins du point de vue de la faisabilité (dans les petites communes, la ressource humaine se réduit souvent à une personne), de la rationalité et des fondements philosophiques de la révision.
En supposant l’Assemblée nationale d’avance acquise à la mesure, le Sénat (et, dans son avis, le Conseil d’État) seraient en droit d’estimer que la limitation des mandats dans le temps repose sur des présupposés inacceptables, à savoir : le peuple ne sait pas ce qui lui convient ; livré à lui-même, il s’en remet à la longue aux potentats et aux aigrefins.
La limitation des mandats dans le temps valorise naïvement l’amateurisme, en matière de gestion publique, et tient intrinsèquement pour suspectes l’expérience et la maturité. Pour sa part, l’insistance sur l’ « apport de sang frais » relève, jusque dans le vocabulaire, d’un véritable racisme gérontophobique. Il est heureux que le choix des ministres, le mois dernier, ait procédé d’une autre logique !
II. Subordonner à la virginité du casier judiciaire l’inscription sur la liste des candidats à une élection ?
Là encore une règle d’inéligibilité est de droit strict. Elle ne doit pas permettre d’écarter du suffrage des personnes dont les torts passés ne seraient ni assez récents, ni assez graves, ni assez liés à la gestion publique, pour justifier leur bannissement.
Il n’est donc pas question par exemple d’exclure une personne de la candidature au seul motif que son bulletin n° 1 n’est pas vide (à la différence du bulletin n° 2, le bulletin n° 1 renferme l’ensemble du curriculum pénal, y compris des infractions anciennes, mineures ou amnistiées).
La tentation de revenir aux peines automatiques d’élégibilité censurées par le Conseil constitutionnel en mars 1999 (par un biais tel que l’obligation faite au juge de prononcer l’inéligibilité d’une personne condamnée pour certains types d’infractions) se heurte également à des objections constitutionnelles au regard des principes de nécessité et d’individualisation de la peine. Ces principes impliquent que l’incapacité d’exercer une fonction publique élective ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée et s’il conserve la faculté de ne pas la prononcer au vu des circonstances propres à l’espèce (n° 2010-40 QPC et n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010).
III. Le « quitus fiscal » auquel serait subordonnée l’éligibilité pose le même type de problèmes que la virginité du casier judiciaire. Il en ajoute d’autres : ce « quitus » est plus aisé à brandir sur un plateau de télévision qu’à définir rigoureusement dans une loi organique.
« En règle de ses obligations fiscales » qu’est-ce à dire ? Ces obligations comprennent-elles celles qu’on conteste ? S’agit-il (et pourquoi ?) des seuls impôts d’État ? Couvrent-elles la TVA ? Comment contrôler ? Selon quelle procédure le bureau d’une assemblée sera-t-il averti de l’inaccomplissement de ces obligations ? Le bureau devra-t-il demander à l’intéressé de régulariser sa situation avant de saisir le Conseil constitutionnel ? Comment savoir si cette régularisation est intervenue ? Le Conseil constitutionnel disposera-t-il d’une marge d’appréciation avant de prononcer la déchéance du mandat ? Quid des péchés véniels, des omissions portant sur de faibles montants ?
IV. Seraient attentatoires à l’égalité devant le suffrage des règles qui, directement ou indirectement, excluraient de la représentation les personnes exerçant certaines professions.
Pour représenter authentiquement « la nation tout entière » (comme le répète le Conseil constitutionnel), les assemblées parlementaires doivent être ouvertes à tous les secteurs du corps social. Aussi les incompatibilités doivent-elles se justifier par des raisons précises, objectives et convaincantes (conflits d’intérêt…). Elles ne peuvent revêtir un caractère général, absolu ou définitif. Elles ne sauraient s’autoriser d’un simple principe de précaution.
Les règles d’incompatibilité sont au demeurant de droit strict pour toutes les fonctions publiques électives (la loi organique étant, de plus, nécessaire pour édicter des incompatibilités parlementaires). Tout texte édictant une incompatibilité et qui a donc pour effet de porter une atteinte à l’exercice d’un mandat électif doit être strictement interprété.
Là encore, le Conseil constitutionnel énonce une « sourate » constante : « si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l’exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l’article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou l’indépendance des juridictions contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts ».
Le Conseil constitutionnel censure les restrictions excessives. Ainsi, examinant la loi organique relative à la transparence de la vie publique de 2013, qui, au nouvel article LO 146-1 du Code électoral, interdisait à un parlementaire d’exercer une fonction de conseil, quelle qu’en soit la nature, lorsqu’il ne l’exerçait pas avant le début de son mandat et dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, il juge que le législateur a institué « une interdiction qui, par sa portée, excède manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d’intérêts » (n° 2013-675 DC du 9 oct. 2013, cons. 52 et 53).
Le parti du président est pris en tenaille entre sa volonté affichée d’ouvrir le vivier politique à la société civile et la soumission de la classe politique à des règles beaucoup plus contraignantes qu’aujourd’hui en matière de conflits d’intérêts et d’incompatibilités. Un rigorisme excessif écarterait cependant les bons candidats issus du monde des entreprises et des professions libérales. Parce qu’ils ont eu une vie antérieure, parce qu’ils sont légitimement désireux de ne pas couper les ponts avec leurs activités professionnelles, de ne pas perdre la main, ils renonceraient à un engagement public plutôt que de se plier à de telles règles ou de peur, les enfreignant par mégarde, d’être cloués au pilori. Le même effet pervers se produirait si on obligeait le fonctionnaire élu à quitter l’Administration. À placer trop haut la barre du renoncement, on risque de ne voir candidater aux fonctions publiques électives que des novices, des médiocres ou des aventuriers.
Sur ce point, le projet de loi est limité à la réglementation des activités de conseil. Les dégâts sont donc provisoirement écartés, même si le texte « fait dans la dentelle » pour tenir compte de la jurisprudence de 2013, ce qui conduit à une rédaction alambiquée. Mais le débat parlementaire fera rebondir la question.
V. S’agissant des emplois d’assistants parlementaires, un autre principe constitutionnel doit être respecté par le législateur : celui de la séparation des pouvoirs.
À cet égard, la spécificité de la fonction de l’assistant, inséparable de la fonction parlementaire, doit être reconnue, qu’il s’agisse :
-
du caractère révocable du contrat (comment peut-on songer à en faire un CDI ? Ou penser appliquer sans discernement à sa rupture les règles de droit commun du Code du travail ?) ;
-
des modalités de son exercice (qui doivent être renvoyées au règlement de chaque assemblée, à l’instar de ce que le Conseil constitutionnel a jugé en décembre 2016 pour les contacts du Parlement avec les lobbyistes) ;
-
ou du rôle que doivent jouer les bureaux des assemblées en cas de méconnaissance de ces modalités ou en cas de litige.
Pour les assistants des députés, les règles essentielles sont déjà dans le règlement de l’Assemblée nationale. Le projet de loi ne peut s’y substituer. Il ne peut qu’y renvoyer.
VI. Sur le fond, l’interdiction faite aux élus, voire aux ministres (lorsqu’ils composent leur cabinet), de recruter comme assistants leurs proches ne va pas de soi. On avait cru comprendre, avec le Pénélopegate, que l’accusation portait sur le caractère virtuel du travail fourni. On est passé insensiblement à l’interdiction pure et simple d’employer les membres de la famille. Comment justifier cette restriction ? Les artisans ne font-ils pas travailler (avec de bonnes raisons) les membres de leur famille ? Quid des recrutements croisés ? Que se passe-t-il si j’épouse mon assistante ? Si je recrute mon ex-femme ? Si j’embauche le fils de mon meilleur ami ? Un neveu ? Ma maîtresse ? Et, si la loi interdit le recrutement des « membres de la famille », sans autre précision, où s’arrête exactement le cercle de famille ? Il faut d’autant plus le préciser que la méconnaissance de la prohibition sera pénalement sanctionnée.
En outre, l’intrusion de la loi dans la composition des cabinets ministériels porte atteinte à la séparation des pouvoirs, comme l’a jugé le Conseil constitutionnel à propos des prétentions du législateur à régir la rémunération du président de la République et des membres du gouvernement (déc. n° 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012, cons. 79 à 82).
Les prohibitions édictées posent enfin un problème de cohérence (voire d’égalité devant la loi) : les mêmes raisons qui justifieraient l’interdiction de l’emploi des proches dans les cabinets ministériels et comme assistants parlementaires ne devraient-elles pas également conduire à les interdire :
-
Pour toutes les (nombreuses) nominations à la décision d’un ministre (aux postes de sous-directeurs, dans les établissements publics et les commissions…) ?
-
Pour les permanents des groupes politiques au Parlement et dans les assemblées locales ?
-
Et dans les communes et organismes intercommunaux (CNFPT par exemple), du moins lorsque le recrutement est directement opéré par l’exécutif local (emplois de catégorie C) ?
VII. La réglementation par la loi de l’indemnité parlementaire représentative des frais de mission (IRFM) se heurte au principe de la séparation des pouvoirs.
La loi peut certes prévoir que les règlements des assemblées fixent les conditions dans lesquelles l’utilisation de cette indemnité est vérifiée par les assemblées elles-mêmes et le reliquat inutilisé restitué. C’est assez cosmétique car cela va de soi.
Il serait moins cosmétique que la loi renvoie aux règlements des assemblées le soin de fixer les modalités selon lesquelles les frais de mission sont remboursés par les assemblées, ce qui impliquerait un remboursement ex post et sur justificatifs. Mais un tel changement impliquerait toute une bureaucratie. Le Parlement européen, qui se pose les mêmes questions, a calculé qu’il devrait embaucher 50 personnes pour éplucher les factures des frais professionnels des parlementaires. À raison de 80 factures mensuelles par parlementaire européen, le nombre de factures à éplucher serait de 750 000 par an.
L’étude d’impact qui accompagne le projet de loi français comporte-t-elle des estimations de ce type ? Plus qualitativement : les frais de coiffeur sont-ils des frais professionnels ? Le sont-ils seulement lorsque la coupe de cheveux précède de peu une émission de TV régionale où apparaît le parlementaire ? Y a-t-il lieu à prorata ? Quelle sera l’autorité des services des assemblées pour écarter telle ou telle dépense vis-à-vis du président de groupe majoritaire ?
VIII. La suppression de la réserve parlementaire laisse perplexe. Cette fameuse réserve ne peut être abolie d’une phrase abrogative, car elle n’est prévue par aucun texte. Elle ne résulte que de la pratique d’amendements gouvernementaux à la loi de finances qui organisent indirectement la possibilité, pour les parlementaires, de mettre de l’huile dans les rouages de divers services publics ou d’organismes de l’économie solidaire.
Rien là de scandaleux, bien au contraire. On peut vouloir mieux encadrer la réserve parlementaire, mais pourquoi renoncer à la souplesse qu’elle apporte ?
Supprimer la réserve parlementaire c’est interdire les amendements gouvernementaux qui « émulent » son fonctionnement. Or la loi ne saurait entraver l’exercice du droit d’amendement, qui est de niveau constitutionnel, sans fondement constitutionnel. Certes, la Constitution confie à la loi organique le soin de fixer les conditions dans lesquelles sont votées les lois de finances. Toutefois, si elle permet à la loi organique de poser des règles de procédure budgétaire, elle ne l’habilite pas à interdire au gouvernement, en raison de leur contenu, de déposer des amendements relatifs aux dépenses.
Une réforme de la réserve parlementaire est concevable, mais elle relève des bonnes pratiques en matière de plafonnement des enveloppes ou de traçabilité des engagements. Beaucoup a déjà été fait à ce sujet.
Quant à l’idée de remplacer la réserve parlementaire par un fonds national dans la gestion duquel le Parlement jouerait un rôle directeur, est-ce son rôle d’ordonner la dépense publique autrement qu’en votant les lois financières ? De gérer des crédits publics autres que ses propres crédits de fonctionnement ? Est-il outillé pour ? Ne serait-ce pas excéder ses missions constitutionnelles ?
IX. L’obsession de la transparence conduit certains à vouloir que tout contact entre lobbyistes et responsables publics soit consigné dans un grand registre permettant de traquer les trafics d’influence.
Outre les problèmes de faisabilité que soulèverait cette usine à gaz, ses limites constitutionnelles sont d’ores et déjà atteintes avec la loi Sapin 2.
Ainsi, pour ne pas porter atteinte à la liberté d’entreprendre ou à la liberté d’association, les « représentants d’intérêts » doivent faire l’objet d’une définition stricte qui ne saurait guère aller au-delà de l’actuel périmètre.
En outre, les responsabilités inhérentes à l’action gouvernementale, telles que définies par les articles 20 et 21 de la Constitution, ne permettent pas d’entraver celle-ci par un formalisme trop lourd et s’opposent donc à ce que soient imposées aux membres des cabinets et hauts fonctionnaires des obligations déclaratives au titre des contacts multiformes qu’ils nouent, dans le cadre de leurs fonctions, avec la « société civile ».
Enfin, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ne saurait, sans que soit méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, être investie de la faculté d’imposer des obligations aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs et aux agents de leurs services, dans leurs relations avec ces représentants d’intérêts. C’est aux seules assemblées d’y pourvoir.
Sur cette question, les textes présentés sont silencieux, mais elle aussi peut resurgir au Parlement, tant est insistante la revendication des groupes de pression à ce propos.
X. Dans le domaine du financement des partis politiques, une investigation intrusive (telle qu’une perquisition administrative des locaux), un contrôle trop tatillon ou trop coercitif s’accordent mal avec les dispositions de l’article 4 de la Constitution selon lesquelles « les partis politiques se forment et exercent leur activité librement ».
On peut s’interroger également, au regard de ces dispositions, sur la lourdeur des implications de la transposition aux partis du principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable en vigueur dans les administrations publiques.
Enfin, la certification des comptes des partis par la Cour des comptes interviendra trop tard, alors que, depuis 2016 (art. 7 de la LO 2016-506 du 25 avril 2016), pour les présidentielles, les aides des partis aux candidats en campagne électorale doivent être retracés dans le compte de campagne du candidat. Comment articuler en temps utile le contrôle et la certification des comptes de campagne et des comptes des partis ? Que se passera-t-il en cas de discordance entre l’examen des comptes de campagne des candidats à l’élection présidentielle par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la certification des comptes des partis politiques par la Cour des comptes ? Quel est d’ailleurs l’intérêt de faire certifier par une Cour des comptes déjà bien chargée des comptes déjà certifiés par des commissaires aux comptes ?
La création d’une banque publique censée pallier les refus de prêts des banques aux partis va accentuer la dépendance des partis à l’égard des financements publics. Ne les encourageant pas à développer une action militante, ce financement les éloignera encore un peu plus de la société. Les dons des personnes physiques représentent aujourd’hui 2 % des recettes du PS, ceux du Front national 4 %, ceux des Républicains 22 % et les cotisations des adhérents respectivement 14 %, 21 % et 13 %. Si on additionne le financement public et les cotisations des élus prises sur leurs indemnités, on arrive aujourd’hui à un taux de financement public situé entre 60 et 70 %. Demain, avec le financement public bancaire, ce seuil atteindra selon toute vraisemblance 80 %. À titre de comparaison, les Allemands arrivent à un partage par moitié entre financement public et financement privé, attestant de l’enracinement des partis politiques allemands dans la société.
Sur cette question du financement des partis, comme sur d’autres, les revendications des ligues de vertu doivent être maniées avec des pincettes. Il aurait été plus simple et plus utile de relever le seuil de 1 % du financement public et de supprimer les dons en espèces.
Soit dit en passant, s’il est si urgent de contrôler plus étroitement le financement des partis, quand s’attellera-t-on au contrôle des emplois subventionnés des organisations syndicales et des avantages financiers qu’elles tirent de la gestion paritaire ?
Si on juge indispensable la déprofessionnalisation de la classe politique, pourquoi ne pas aussi tenter, a fortiori, de déprofessionnaliser la direction des centrales, en limitant le cumul et la succession des mandats syndicaux ?
XI. S’agissant de la responsabilité pénale des ministres pour les faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, la bien-pensance exige un traitement de droit commun, ce qui signifie la suppression de la Cour de justice de la République. Celle-ci exige une révision constitutionnelle. Le projet comportera donc un volet constitutionnel, à côté de ses volets organique et ordinaire.
Juridiquement, le Constituant peut faire ce qu’il veut, mais les deux assemblées – et le Parlement réuni en Congrès – devront y réfléchir à deux fois. Accepte-t-on d’exposer l’action ministérielle au harcèlement de plaignants et parties civiles de tous poils, sans un filtre approprié et une composition juridictionnelle équilibrée ? Assume-t-on les inévitables empiètements des juges judiciaires ordinaires sur une gestion administrative qui ne leur est pas familière, alors pourtant qu’il existe un juge administratif qui est fait pour cela et qui a démontré depuis longtemps son indépendance ? Est-on prêt à abandonner les principes républicains fondateurs qui soustrayaient les opérations de l’Éxécutif à la tutelle des anciens parlements ?
Bien sûr, la Constitution pourrait spécialiser une juridiction (la cour d’appel de Paris par exemple) et instaurer une commission de filtrage, ayant le pouvoir de différer une investigation si la plausibilité et la gravité d’une plainte ne justifient pas que soit perturbée une gestion ministérielle. Mais à quoi bon alors supprimer la Cour de justice de la République, qui fournit tous ces garde-fous mieux que ne saurait le faire un organe purement judiciaire ? Pour les besoins de la Cause ou pour les besoins de la Com’ ?
XII. Enfin, il existe certes un consensus pour ne plus faire siéger de droit au Conseil constitutionnel les anciens présidents de la République. Le caractère discutable (dès l’origine) de cette disposition de la Constitution s’accentue en raison du rajeunissement des titulaires et de la réduction de la durée de leur mandat, depuis le début de la Ve République. Matériellement, il n’y aurait pas assez de bureaux au Conseil. Qualitativement, cela déséquilibrerait sa composition, en accentuant sa nature « politique » et en multipliant les hypothèses de « déport ». Les cours supranationales et la doctrine fronceraient le sourcil. La chose aurait dû se faire en 2008.
La mesure doit s’appliquer non seulement aux futurs présidents de la République, mais aussi à l’actuel, ainsi qu’à François Hollande (qui n’a jamais siégé) et à ses deux prédécesseurs qui, pour des raisons très différentes, ne siègent plus.
La courtoisie justifierait cependant qu’on fasse un sort spécial à Valéry Giscard d’Estaing qui siège assez régulièrement, a gardé intactes ses capacités intellectuelles et dont l’âge conduira tôt ou tard au retrait. Comme elle ne saurait être ad hominem, la mesure pourrait s’appliquer à tous les anciens présidents de la République qui, au 1er juillet 2017, n’auront pas siégé au moins une fois au cours des douze mois précédents.
XIII. Last but not least : ces projets sont-ils assortis d’études d’impact dignes de ce nom ? Ou faut-il admettre, au profit des textes emblématiques de début de quinquennat, une atténuation implicite des obligations d’étude d’impact posées par la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ?