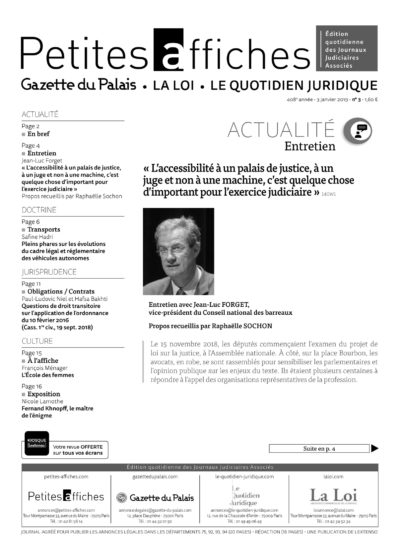L’École des femmes

Simon Gosselin
Comment parvient-il à mener et réussir tant de choses à la fois ? Stéphane Braunschweig est sur tous les fronts : l’administration avec la direction de théâtres prestigieux, l’Odéon après La Colline, les mises en scène de théâtre et d’opéra en France et à l’étranger, la scénographie, l’écriture, les traductions… Comment parvient-il à ne pas se laisser aller à la facilité, à rajeunir les traditions sans les trahir, à promouvoir de nouveaux auteurs, à revisiter les anciens !
Et voici une nouvelle réussite, celle de sa mise en scène très personnelle de L’École des femmes. D’entrée de jeu, on est dans l’insolite, sinon la provocation : Arnold, en short et marcel, pédale pour entretenir sa forme dans une salle de sport, avec son ami Chrisalde. Les valets Alain et Georgette sont en tenue de loubards et Agnès porte un mini short en jean.
On s’habitue très vite, d’autant que les décors sont intemporels et élégants : de grands mobiliers de verre fumé, qui deviendront parfois une cage transparente pour mieux espionner la jeune cloitrée, quelques grands clichés en noir et blanc ajoutant au mystère trouble d’Agnès.
N’est-t-il pas bienvenu de donner à la jeune femme une dimension un peu plus ample que celle d’une ingénue naïve, malmenée par un vieux barbon ridicule, de s’attacher à la complexité des personnages et de faire d’elle une Lolita au caractère trempé qui se joue des hommes et de leur désir au premier degré ? Ici, les sous-entendus des alexandrins, que les comédiens déclament avec une impeccable diction, sont pris au sérieux et mis au service du jeu tragique et comique de la vérité.
Voici ici un Arnold à la fois odieux et touchant, autocrate et soumis, violent et faible, mené par une Agnès irrévérentieuse, provocatrice, déterminée à suivre ses instincts, l’un et l’autre un peu fous, déchirés, promis au même destin de désillusion.
La mise en scène respecte ce que l’on s’attend à trouver : la triste condition d’un sexe « qui n’est là que pour la dépendance », le cruel enfermement d’Agnès par un vieil égoïste qui l’a maintenue dans l’ignorance croyant se préserver du cocufiage, la montée de son délire, celle aussi de son désir un rien libidineux, les ruses apparemment innocentes d’Agnès pour rejoindre un jeune galant passant sous ses fenêtres… Mais tout est traité avec subtilité, inventivité, intelligence, maîtrise, professionalisme, des débuts tirant vers le comique jusqu’à cette fin étrange, cette conclusion sur l’ennui, le pire peut-être des enfermements…
Et puis il y a la performance de deux comédiens, l’un et l’autre fidèles au metteur en scène. Claude Duparfait a été dirigé par Stéphane Braunschweig dès 1992 dans La cerisaie de Tchekhov et s’est vu confier par lui les rôles d’Alceste et de Tartuffe, s’y montrant magistral.
Une fois de plus, il est remarquable, tour à tour – ou plus tôt en même temps ! – ridicule et émouvant, grotesque et tragique, déstructuré comme un pantin, sans personne pour en diriger les fils.
Une vraie performance comme l’est celle de Suzanne Aubert, qui avait été une étonnante Hedvig dans Le canard sauvage d’Ibsen, monté à La Colline en 2014, et qui est ici une étonnante Agnès, aux comportements impévisibles, affranchie et provocatrice, un peu destructurée elle aussi dans les gestes, le ton de la voix ; bien de notre époque, en quelque sorte…