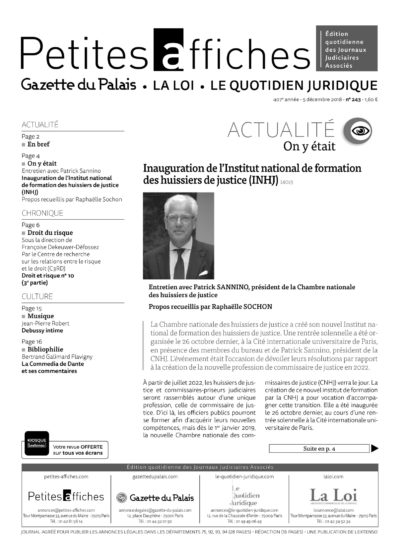Droit et risque n° 10 (3e partie)
Cette dixième chronique des relations entre risque(s) et droit s’organise toujours autour de la distinction entre les risques créés par le droit, au premier rang desquels se situe l’insécurité juridique, et la gestion par le droit des différentes sortes de risques : prévention et/ou réparation.
Mais elle peut aussi être lue au travers des thématiques de recherche qui animent le C3RD : la sécurité, les vulnérabilités, les risques émergents et le préjudice.
La sécurité est un besoin omniprésent qui innerve nombre des demandes sociales et par voie de conséquence, de multiples règles de droit. Les domaines où ce besoin de sécurité se manifeste sont des plus variés. L’un des secteurs où il se fait le plus présent et où sa satisfaction pose de redoutables difficultés juridiques est la détermination de la dangerosité des délinquants et par voie de conséquence de la juste peine à leur appliquer : quatre arrêts de la chambre criminelle (Cass. crim., 9 mai 2018, nos 17-82810, 16-87405, 15-84737, 16-84837) montrent comment la Cour de cassation veille sur la motivation des cours d’appel qui doivent caractériser avec précision la dangerosité criminologique des prévenus afin d’étayer leurs décisions.
Mais le besoin de sécurité se fait aussi sentir dans le domaine économique, tant il est vrai qu’il est présent dans toutes les relations d’affaires. Ainsi, la question de la validité des cautionnements et plus précisément, des critères de l’évaluation de la « disproportion » entre la dette cautionnée et les ressources de la caution (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26182) met en jeu l’intensité du risque couru tant par le créancier que par la caution.
C’est encore la recherche de la sécurité, juridique cette fois, qui anime les règlements européens du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés qui vont entrer en vigueur le 29 janvier 2019.
Un dernier exemple d’insécurité juridique résulte du régime des reconnaissances de complaisance, sources de risques pour l’enfant et sa famille, mais aussi à l’origine d’un très ennuyeux risque d’inconventionnalité du droit français de la filiation (CA Riom, 16 janv. 2018, n° 17/00694).
La protection que le droit offre face aux vulnérabilités est un autre aspect du traitement juridique des risques. Dans cette chronique, l’attention est attirée sur les risques que « l’uberisation du lien social » fait courir au public particulièrement fragile des services sociaux, qui est ainsi détourné des administrations censées les protéger. Une autre contribution s’attache aux missions du médecin du travail, modifiées dans un sens inquiétant par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Les risques émergents sont aussi divers que variés. Dans la chronique de cette année, c’est l’irruption du numérique dans les entreprises et plus précisément l’adoption du programme Watson dans le secteur bancaire qui suscite les craintes des salariés et une demande d’expertise, rejetée avec l’aval de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 16-27866). À raison ? Ou à tort ?
Enfin, la réparation des préjudices résultant de la réalisation des risques fait encore et toujours l’objet d’un contentieux nourri et de réflexions théoriques radicales. Peut-on obtenir réparation du préjudice subi par un parieur sportif lorsqu’un joueur a commis des fautes de jeu inexcusables entraînant l’insuccès de son équipe ? (Cass. 2e civ, 14 juin 2018, n° 17-20046). Le fait de naître sans père est-il constitutif d’un préjudice moral indemnisable (Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26687) ; et enfin, que penser de la proposition de créer une amende civile amenant à dépasser la réparation intégrale du préjudice (article 1266-1 du Code civil tel qu’issu du projet de loi du 13 mars 2017) ?
F.D.-D.
I – Les risques du droit
A – L’insécurité juridique
B – Les autres risques du droit
II – La gestion du risque par le droit
A – Anticipation du risque
L’intelligence artificielle : What’s on ?
Cass. soc., 12 avril 2018, n° 16-27866. En 2012, il était possible de lire dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation que « la fourniture d’ordinateurs portables à des salariés occupant des fonctions de consultant dans des entreprises clientes ne constituait pas un projet important justifiant le recours à l’expertise, cette modification n’entrainant pas de répercussions importantes sur les conditions de travail en termes d’horaires, de taches… »1. 4 années plus tard, la loi Travail, introduisait dans le Code du travail, l’obligation pour les entreprises d’au moins 50 salariés, de négocier un accord organisant le droit à la déconnexion des salariés2.
En 2018, la même chambre est saisie pour se prononcer sur le programme Watson, développé par IBM et, en l’espèce, introduit dans le secteur bancaire. Le CHSCT du Crédit Mutuel du Sud-Est décide, sur le fondement de l’ancien article L. 4614-12, 2°, du Code du travail, de recourir à l’expertise afin d’examiner les modifications des conditions de santé, de sécurité et des conditions de travail liées à l’introduction de ce programme d’intelligence artificielle. Le Crédit Mutuel saisit le tribunal compétent pour obtenir l’annulation du recours à l’expertise. L’ordonnance rendue par le TGI de Lyon annule la délibération du CHSCT, considérant que ce projet n’implique qu’une modification mineure en termes de conditions de travail. Le recours à l’expertise n’est dès lors pas justifié. Cette décision conduit le CHSCT à former un pourvoi en cassation. La haute juridiction doit alors répondre à une question en apparence assez simple : Watson constitue-t-il un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail justifiant la désignation d’un expert ? Après avoir relevé les caractéristiques de l’introduction de Watson auprès des salariés concernés, elle approuve la décision rendue en première instance et confirme ainsi ladite annulation. Plus précisément, le recours à l’expertise n’est pas légitime au regard des conditions légales. Il n’est pas démontré que ce projet constitue un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. La solution est claire pour la Cour de cassation. Elle semble ne faire part d’aucun doute, ne bénéficiant pas de la publication au Bulletin.
Pourtant, même si la décision rendue est un arrêt d’espèce, et donc sa portée limitée, elle appelle néanmoins à quelques remarques. Pour la haute juridiction, l’introduction de Watson, n’apparaît ni perturbante, ni préoccupante, ne légitimant pas l’intervention d’une personne expérimentée capable de fournir une analyse permettant d’identifier l’impact d’un tel outil sur les conditions de travail et donc plus globalement d’en mesurer les risques. Pourquoi ordonner une expertise alors que Watson est intégré comme un facilitateur de travail ? La Cour de cassation privilégie une conception finaliste de l’outil (I) ne laissant pas la place à la réflexion qui pourrait être menée dans l’entreprise, par ses acteurs, sur les implications supposées à terme de l’intégration de l’intelligence artificielle (II).
I. Watson : un facilitateur de travail
Le recours à l’expertise est subordonné à des conditions légales faisant appel à des notions bien connues du droit du travail autorisant une interprétation et une mise en œuvre adaptée aux situations. C’est ainsi de la notion de projet important et celle de conditions de travail. La première renvoie au projet d’une décision ou d’une action dont l’importance repose sur un faisceau d’indices. Parmi eux, on peut citer un nombre important de salariés concernés même si le fait qu’il y en ait peu n’exclut pas à lui seul le projet important3, ou encore des changements imposés aux salariés quant à leurs fonctions, des modifications sur leurs conditions de travail4. Quant à la seconde, elle s’entend des conditions matérielles et techniques de l’exécution du travail mais également des conditions mentales. Les conditions de travail ne se résument pas non plus aux seules données relatives à l’hygiène et à la sécurité. Par son contenu foisonnant, peu d’auteurs se sont essayés à lui donner une définition juridique5. La notion se nourrit inévitablement d’éléments portant sur l’organisation du travail, la gestion du temps, les relations de travail externes comme internes, hiérarchiques et horizontales, liés aussi à l’individu et à ses caractéristiques telles que son âge, sa santé, sa vie personnelle, etc. Si le recours à l’expertise est un outil offert au CHSCT, elle est une prérogative liée à la finalité même de l’institution faisant de lui un acteur dynamique de la prévention des risques professionnels en matière de santé et d’amélioration des conditions de travail.
Appliquées au cas Watson, il est difficile de ne pas qualifier ce dernier de projet important modifiant les conditions de travail. Constituant un programme informatique d’intelligence artificielle, la décision de l’intégrer auprès de postes de chargés de clientèle emporte nécessairement des changements. À ce titre, le rapport Intelligence artificielle et travail émis par France stratégie consacre une partie de ses développements aux impacts de l’intelligence artificielle dans le secteur bancaire énonçant clairement que les changements apportés par l’IA vont « profondément » transformer les métiers des chargés de clientèle6. D’ailleurs, le CHSCT, en l’espèce, tente de faire valoir dans son pourvoi des arguments de même nature : « le projet de technologie cognitive constitué par le logiciel Watson mis en place pour optimiser le travail des chargés de clientèle portait en lui-même la potentialité d’un redécoupage des missions des salariés au sein d’une agence et donc une modification notable des conditions de travail ».
Pour autant, la chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’un tel logiciel n’entraîne que « des conséquences mineures dans les conditions de travail directes des salariés dont les tâches vont se trouver facilitées ». La qualification prévue à l’article L. 4612-12, 2°, n’est donc pas retenue en l’espèce. Approuvant le raisonnement mené par le juge du fond, la Cour de cassation fait primer la finalité du dispositif sur l’impact que celui-ci génère. Même si Watson traite les courriels en tenant compte de mots-clés, ou les classe par ordre de priorité en raison de l’urgence, ou encore propose des réponses, Watson « va aider les chargés de clientèle à traiter les abondants courriels qu’ils reçoivent ». Sa finalité est de faciliter le travail, son impact est alors minimal sur les conditions de travail. Le changement n’est pas jugé significatif, ne donnant pas lieu à des contraintes particulières, ou n’emportant pas d’incidences déterminantes et durables. La mesure de la direction est alors positive. Elle ne modifie pas les conditions de travail, elle semble les améliorer. Le recours à l’expertise dépend donc de la finalité du projet. Une finalité positive, celle d’assister le salarié gomme la possibilité pour le CHSCT de son droit d’expertise. Toutefois, une finalité positive n’est pas synonyme d’absences de risques.
II. Watson : une chance, mais aussi un risque. Des risques…
La présente décision fait écho au débat que suscite de manière plus générale l’intelligence artificielle. Perçue, pour les uns, comme une technologie porteuse de gains de productivité, facilitant le travail, réalisant les tâches fastidieuses, pour d’autres, elle suppose notamment la disparition d’emplois, la diminution de la réflexion. Les rapports rendus par France stratégie7, ou encore celui de Cédric Villani8 s’inscrivent en ce sens. Ils invitent à prendre la mesure des transformations qui s’annoncent. Peut-être, le CHSCT du Crédit Mutuel souhaitait-il le faire en sollicitant une expertise et désirer aussi alerter l’employeur sur les éventuelles conséquences ? En d’autres termes, si Watson est présenté comme un outil facilitateur de travail, voire une chance, n’engendre-t-il pas des risques, en matière de conditions de travail, tels que la perte d’autonomie, l’intensification du travail, dont la réalisation est à moyen ou long terme ?
Sur le fondement de l’ancien article L. 4614-12 2°, le CHSCT soutient, en l’espèce, que l’importance du projet reposait sur des éléments quantitatifs, d’une part, comme notamment le nombre de salariés concernés. D’autre part, s’ajoutaient aussi des éléments d’ordre qualitatif tels que l’appauvrissement intellectuel pour les chargés de clientèle et une intensification de leur travail. Ces derniers n’ont pas convaincu. Le premier semble contradictoire. En effet, Watson apporte un gain de temps en réalisant le travail de tri des mails par priorité. Il propose également un choix de réponse à apporter ce qui permet d’éviter les erreurs. L’instance de représentation du personnel le perçoit comme une forme d’automatisation, limitant ainsi le travail de l’agent à choisir une réponse déjà écrite dont il n’aura plus à en rédiger la formulation. Les juges l’ont quant à eux perçu comme un outil permettant au personnel de gagner du temps et donc de concentrer leur attention sur des mails au contenu plus complexe. De ce point de vue, l’outil ne peut être vu comme une technologie impactant défavorablement le travail. Dès lors, le droit de recourir à l’expertise n’est pas légalement justifié. En revanche, le second élément qualitatif semble mériter plus d’attention. Il paraît « balayé » par le juge considérant que cette « crainte n’est pas objectivée par le gain attendu de seulement 10 minutes par jour et par salarié ». Or l’intégration d’une technologie cognitive présente le risque d’intensification du travail. Dénoncé par les rapports, ce dernier peut se manifester par la nécessité pour les collaborateurs de monter en puissance sur d’autres compétences, de faire part d’une productivité plus importante sur d’autres questions. La direction du Crédit Mutuel ne le nie pas d’ailleurs. Elle en fait même l’éloge9 ! On comprend d’autant mieux la réaction du CHSCT qui a pour mission originelle de contribuer à la protection de la santé des salariés, à l’amélioration de leurs conditions de travail, par leur analyse et celle des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés10. Encore, il doit être associé à la recherche de solutions concernant les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail des salariés.
Dans une autre espèce, dont les faits sont similaires, le président du TGI de Paris a rendu une solution inverse11 de celles décrites précédemment, impliquant une autre banque, le CIC. Le magistrat a procédé à une interprétation différente du même texte aboutissant à l’approbation de la mesure d’expertise. L’analyse n’est absolument pas la même. On serait même tenté d’affirmer qu’elle est menée à travers le prisme de la prévention des risques professionnels, mission essentielle du CHSCT. En effet, il est énoncé dans la décision que « si le chargé de clientèle reste en l’état l’interlocuteur du client, appelé à valider chacune des propositions faites par le logiciel présenté comme une aide, l’outil, qui a la particularité de s’enrichir de manière continue des informations et questions transmises par le salarié et des retours sur expérience pour améliorer la pertinence de ses réponses à des questions récurrentes, va être en mesure, progressivement, de réaliser un certain nombre de tâches plus ou moins simples qui font jusqu’à présent partie du métier de chargé de clientèle (apprécier l’urgence d’un message, proposer une réponse à une demande simple, chercher une information pertinente dans une base de données) ; cela aura donc nécessairement une incidence sur le contenu, l’organisation et la qualification du travail du chargé de clientèle et des fonctions support (…) »12.
La position des juges face à la même question n’est donc pas homogène. L’une confirmée par la Cour de cassation se contente d’une analyse « pragmatique », écartant toute mesure d’expertise dès lors que l’application d’un outil d’intelligence artificielle entraîne des modifications qui ne sont qu’indirectes, et par conséquent entraînant une limitation du rôle du CHSCT dans son action de prévention et d’identification des risques professionnels. L’autre prend davantage les contours d’une analyse prospective tenant compte de la difficulté actuelle d’appréhender les conséquences de l’intégration de l’intelligence artificielle à moyen terme dans une situation de travail.
La Cour de cassation donne sa faveur à la première. Cela est regrettable pour plusieurs raisons. D’une part, sans être alarmiste, la question de l’intelligence artificielle doit être aujourd’hui prise en compte dans les entreprises par ses différents acteurs, tant par la direction que par les représentants du personnel et les salariés eux-mêmes, au premier plan touchés par cette innovation technologique. D’autre part, après les ordonnances Macron, les problématiques touchant à la santé, aux conditions de travail relèvent aujourd’hui de l’instance unique du personnel. Certains s’interrogent sur le devenir des préoccupations de santé, de sécurité dans les entreprises. Le CSE parviendra-t-il à relever le défi ? Ou au contraire comme un auteur a pu l’écrire « faut-il mouiller son mouchoir »13 ? Enfin, les rapports déjà cités insistent sur le rôle que doit jouer le dialogue social. Le rapport Villani propose d’« intégrer pleinement la transformation numérique dans le dialogue social »14, en modifiant le contenu des négociations obligatoires « pour prendre en compte l’introduction de nouvelles technologies et la transformation numérique des entreprises, en termes d’adaptation des compétences et de complémentarité entre l’humain et la machine »15.
Le droit du travail est aujourd’hui à une étape clé de son histoire. Son contenu est bouleversé. Le recours à la négociation collective est considérablement accru. Les innovations techniques comme l’intelligence artificielle impactent le monde du travail. Les entreprises, les salariés, les représentants du personnel sont, dès lors, confrontés à plusieurs mutations sociales. Face à de tels enjeux, il convient de ne pas sous-estimer les risques qu’engendreront de telles mutations sur l’organisation de travail et les conditions de travail de demain.
E. L.
Le risque « défaillance » de la caution personne physique : la disproportion de l’engagement de la caution mariée appréciée plus strictement
Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26182. Lorsque vient le moment de satisfaire à son obligation vis-à-vis du créancier, la caution personne physique qui s’engage à garantir la dette d’un tiers au profit d’un créancier professionnel, use généralement de tous les stratagèmes pour tenter d’y échapper. La disproportion de l’engagement souscrit fait partie de ces armes dont elle dispose contre le créancier. Ce moyen de défense occupe même une place de choix parmi les arguments qu’elle peut avancer, puisqu’il lui permet d’être purement et simplement déchargée de son obligation. En effet, la sanction prévue par l’article L. 341-4 du Code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, prévoit qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Ce texte a suscité bon nombre d’interrogations, parmi lesquelles la question des biens qui doivent être pris en compte pour apprécier cette proportionnalité. Plus précisément, s’agissant d’une caution mariée, commune en biens, les biens communs et les revenus du conjoint doivent-ils être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’engagement souscrit lorsque le conjoint a donné son consentement exprès au cautionnement ? C’est de cette question dont est saisie la chambre commerciale dans la présente espèce.
Une caution, personne physique, s’est engagée à garantir le remboursement d’un prêt consenti à une société qui a été, par la suite, mise en liquidation judiciaire. Au moment où elle est appelée à s’exécuter par le créancier, la caution oppose à celui-ci le caractère manifestement disproportionné de son engagement pour tenter d’obtenir une décharge. Elle obtient gain de cause devant les juges du fond qui considèrent que la disproportion de l’engagement de la caution doit être appréciée uniquement au regard des revenus de la caution ainsi que de sa part dans les biens communs, quand bien même l’époux aurait donné son accord exprès au cautionnement suivant l’article 1415 du Code civil.
Sans surprise, la chambre commerciale de la Cour de cassation va censurer cette décision au visa de l’article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016. La cour d’appel de Toulouse, tout en relevant que l’épouse avait donné son accord au cautionnement, dans les conditions de l’article 1415 du Code civil, permettant ainsi d’étendre le gage du créancier aux biens communs du couple, a décidé, de manière assez surprenante, de limiter l’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement aux seuls revenus de la caution mariée et à sa part dans les biens communs du couple. Cette solution des juges du fond, qui permet à la caution, une fois de plus, de déjouer les prévisions légitimes du créancier, est balayée d’un revers par la chambre commerciale qui saisit l’occasion pour préciser, sans ambiguïté, le principe suivant lequel le consentement exprès donné par l’époux de la caution permettant d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs est sans incidence sur l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement souscrit, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
La chambre commerciale de la Cour de cassation distingue ici soigneusement l’assiette du gage du créancier et les biens qui doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion de l’engagement souscrit, offrant ainsi une lecture plus stricte du principe de proportionnalité.
I. La distinction de l’assiette du gage du créancier et des biens pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de la caution personne physique
Il y a un peu plus d’un an, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirmait que « le consentement exprès donné en application de l’article 1415 du Code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs, c’est à bon droit que la cour d’appel a apprécié la proportionnalité de l’engagement contracté par [l’époux], seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse » dans un arrêt en date du 22 février 201716. Elle venait ainsi tirer comme conséquence de l’accord de l’époux donné au cautionnement, la possibilité, pour le juge, d’apprécier la proportionnalité de l’engagement de la caution au regard des biens constituant l’assiette du gage du créancier. La solution pouvait se comprendre. En effet qui peut le plus peut le moins ! Si les biens communs du couple deviennent, par l’effet de ce consentement au cautionnement, saisissables, alors il paraît assez logique qu’ils doivent également être pris en compte pour l’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement de la caution. Pour autant, fallait-il déduire de cette solution qu’a contrario, en l’absence de consentement du conjoint à l’acte de cautionnement, la disproportion devait n’être appréciée qu’au regard des biens propres et à concurrence de la part de la caution dans les biens communs ? À la lecture de l’arrêt du 22 février 2017 on serait tenté de répondre par l’affirmative tant le lien entre l’assiette du gage du créancier et les biens pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de la caution paraissait évident. Pourtant, quelques semaines auparavant, dans un arrêt en date du 18 janvier 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation semblait suggérer une indépendance de l’assiette du gage du créancier et des biens devant être pris en compte apprécier la disproportion de l’engagement de caution17. L’arrêt du 22 février 2017, qui semblait subordonner la prise en compte des biens communs pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de la caution à ses biens et revenus au consentement du conjoint donné dans les conditions de l’article 1415 du Code civil, alignait l’assiette du gage du créancier sur celle des biens pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’engagement rendant ainsi plus facile le jeu de la disproportion pour la caution qui n’avait pas recueilli l’accord de son conjoint et limitait l’appréciation de la disproportion aux seuls biens propres de la caution et à sa part dans les biens communs alors même que l’article L. 341-4 n’impose pas une telle limite.
Telle n’était vraisemblablement pas la volonté de la chambre commerciale puisque quelques mois après elle démentait cette interprétation dans un arrêt du 15 novembre 2017 très largement diffusé18. Dans cette décision, elle opérait un franc revirement de jurisprudence dissociant très clairement la question de la détermination de l’assiette du gage du créancier de celle de l’appréciation de la disproportion. Elle approuvait les juges du fond d’avoir écarté la disproportion en appréciant celle-ci au regard de l’ensemble des biens de la caution, y compris ceux faisant partie de la communauté, alors même que l’épouse n’avait pas donné son consentement au cautionnement et qu’en conséquence le bien pris en considération pour cette appréciation ne pouvait être engagé pour l’exécution d’une condamnation éventuelle. Ainsi, l’insaisissabilité d’un bien ne s’opposait pas à ce que celui-ci soit pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’engagement souscrit par la caution.
C’est dans cette tendance que s’inscrit l’arrêt du 6 juin 2018 qui entend clairement réaffirmer ce principe. Ainsi, la disproportion de l’engagement souscrit par une caution mariée commune en biens s’apprécie au regard de l’ensemble des biens et revenus qui dépendent de la communauté et cela, peu important que le consentement au cautionnement ait été donné par le conjoint : « la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. X ».
Cette dissociation faite par la chambre commerciale entre les biens pouvant être saisis par le créancier et les biens devant être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution amène à une lecture plus restrictive des conditions d’admission de la décharge pour disproportion, renforçant ainsi la sécurité juridique dans un domaine où elle est bien trop souvent mise à mal19.
II. Une appréciation plus sévère de la disproportion de l’engagement de la caution
Dissocier la question de la détermination de l’assiette du gage du créancier de celle de l’appréciation de la disproportion permettrait d’éviter que la caution mariée commune en bien ne prenne soin d’anticiper sur ce moyen de défense en limitant l’assiette du gage du créancier à ses seuls biens propres. En pareille hypothèse, le créancier courrait à la fois un risque de défaillance de la caution à raison du caractère restreint de l’assiette du gage consentie lequel serait doublé d’un risque lié à ce que la caution invoque le caractère disproportionné de son engagement. On ne peut que se réjouir de cette lecture de l’article L. 341-4 du Code de la consommation qui, d’ailleurs, n’apporte aucune précision quant aux biens qui doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion. En tout état de cause, on observera que si ces biens sont insaisissables en application de l’article 1415 du Code civil à défaut de consentement du conjoint, il reste qu’ils font partie du patrimoine des époux et qu’en tant que tels, ils appartiennent à la caution personne mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts indépendamment du point de savoir si le conjoint a donné son consentement au cautionnement. D’un point de vue économique, la solution se justifie pleinement aussi puisqu’il s’agit de s’interroger sur les capacités financières de la caution mariée à supporter l’engagement qu’elle souscrit. La question de sa capacité à engager seule ces biens est totalement étrangère au point de savoir si ces biens lui procurent des avantages qui peuvent entrer en ligne de compte dans l’appréciation de ses capacités financières.
On comprend alors aisément que la caution mariée sous le régime de la séparation de biens ne puisse pas voir la proportionnalité de son engagement examinée au regard des biens et revenus de son conjoint, ce qu’a rappelé encore très récemment la chambre commerciale dans un arrêt en date du 24 mai 2018 : « la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels »20. Cette solution s’explique par les règles propres au régime de la séparation de biens et en particulier à l’article 1536 du Code civil qui dispose que, « lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 ». D’un point de vue patrimonial, les époux mariés sous le régime de la séparation de biens sont des étrangers l’un pour l’autre et l’appréciation de leur patrimoine doit être individuelle.
La distinction des biens faisant partie de l’assiette du gage du créancier de ceux permettant d’apprécier la capacité de la caution mariée à satisfaire à son engagement restaure ainsi la force obligatoire d’un contrat de cautionnement trop souvent exposé au risque d’une défaillance de la caution. Défaillance, par ailleurs, souvent opposée de mauvaise foi au créancier par une caution qui ne mérite pas toujours la position de faiblesse qu’on lui prête traditionnellement.
La sanction de l’engagement disproportionné est particulièrement lourde pour le créancier et bénéficie aussi bien à la caution profane qu’à la caution avertie. Elle s’apparente ainsi à une véritable sanction pour le créancier alors même que ce dernier n’a aucun intérêt à convaincre une caution personne physique à s’engager au-delà de ses capacités financières. En effet, dans la relation tripartite qu’implique le cautionnement, la seule personne qui trouve un intérêt à l’engagement de la caution reste le débiteur principal. Le créancier n’y trouve un intérêt qu’à la condition que la caution soit fiable et qu’elle ne tente pas, le moment venu, de se défausser. La proportionnalité de l’engagement de la caution est donc l’affaire de tous et une lecture plus stricte des conditions d’appréciation de la disproportion contribue à renforcer la sécurité juridique et la sécurité du crédit tout en protégeant efficacement la caution contre une disproportion appréciée d’un point de vue purement économique.
K. B.-L.
B – Les conséquences des risques réalisés
Pari risqué ?
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-20046. L’occasion était trop belle pour que la Cour de cassation ne la saisisse pas en plein bond. Alors que le 14 juin 2018 la coupe du monde de football s’ouvrait sur son premier match, le jour même, la haute juridiction profitait de l’action d’un parieur déçu pour venir rappeler les limites de la responsabilité des joueurs sportifs et de leur club. Dans cette affaire, il n’était donc pas question d’engager la responsabilité du joueur qui aurait porté atteinte à la sécurité d’un autre pratiquant, comme cela est fréquemment le cas, ou encore qui aurait porté atteinte à l’intégrité d’un tiers tel que l’arbitre de la rencontre21. Le demandeur au pourvoi, qui s’estimait victime de la faute de jeu du joueur de football professionnel, était ici une personne bien éloignée du terrain mais particulièrement attentive au résultat final de la rencontre : un parieur.
Opérons un bref rappel des faits de l’espèce qui éclairera rapidement sur l’originalité de l’action. En septembre 2010, un parieur valide une grille de jeu « loto foot » par laquelle il s’engage sur le pronostic de 14 matchs de football. Son talent divinatoire lui permet d’obtenir 13 résultats pertinents sur 14. Mais il ne faut point se tromper, selon le parieur, son absence de succès dans le pronostic d’un des matchs ne relève pas seulement du hasard mais principalement de la faute inacceptable d’un « joueur professionnel avant-centre international » qui s’était tenu en « positionnement grossièrement hors-jeu de plusieurs mètres » selon les termes du pourvoi. Aussi, fort de cette faute sportive, le parieur assigne le joueur ainsi que son club en raison du gain manqué au titre de 14 bons pronostics. Débouté de ses demandes par la juridiction de Clermont-Ferrand puis par la cour d’appel de Riom22, le parieur décide de former un pourvoi en cassation qui invite ainsi la haute juridiction à s’interroger : toute faute sportive est-elle susceptible de permettre au parieur victime d’un gain manqué d’engager la responsabilité du sportif ainsi que celle de son club ? Avec vigueur, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et restreint le champ de cette faute susceptible de réparation au seul « fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif ».
Si la frappe judiciaire était ici singulière (I), il n’en demeure pas moins que le refus d’indemniser le parieur déçu nous paraît dans une certaine mesure salutaire (II).
I. Une singulière frappe tentée : la recherche de la responsabilité du sportif et de son club par le parieur
Le contrat conclu entre le parieur et l’organisateur de pari est assurément un contrat marqué par son caractère aléatoire. Mais à travers la présente décision, c’est avant tout la nature juridique de la relation unissant le parieur au sportif qui est mise en lumière. À défaut de relation contractuelle entre ces personnes, c’est bien entendu sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle que le parieur était contraint de se placer afin d’engager la responsabilité du sportif mais également de son club. Par conséquent, le triptyque traditionnel de l’article 1240 du Code civil devait être invoqué pour caractériser la responsabilité personnelle du joueur, la responsabilité du club étant également recherchée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
D’autres, avant cet audacieux parieur, se sont risqués à rechercher la responsabilité du sportif considéré comme fautif. C’est sur le terrain des foulées animales et non humaines, plus précisément des courses hippiques, que la Cour de cassation avait eu l’occasion dans les années 1970 d’ouvrir une petite brèche en faveur de la réparation du préjudice du parieur. En effet, elle avait reconnu l’existence d’une perte de chance pour le parieur, causée par la violation de l’article 68 du Code des courses par le jockey, cette faute étant de nature à fausser le résultat de la course23. Dans une autre affaire, toujours dans le domaine hippique, à une époque où la théorie de l’acceptation des risques connaissait un certain succès en matière sportive24, la haute juridiction avait refusé à un jockey fautif de se prévaloir de ladite théorie à l’égard du tiers, en l’espèce un parieur25. Tous les espoirs semblaient alors permis pour les parieurs déchus.
Pourtant, à cette époque déjà, la doctrine était hésitante. Les interrogations d’alors conservent toute leur actualité au regard de l’arrêt commenté. La réalité du préjudice fait à notre sens partie des interrogations majeures : peut-on véritablement considérer qu’il existe un préjudice pour le parieur ? À la lumière de l’analyse du professeur Mouly, ne faut-il pas plutôt considérer que le parieur est simplement victime du caractère aléatoire, inhérent au pari26 ? En l’espèce, le parieur, lui, ne doute nullement de son préjudice, la position de hors-jeu du joueur l’ayant privé de la possibilité de remporter un gain significatif : 1 500 000 €. Et si la question du préjudice n’est pas véritablement reprise par la Cour de cassation, c’est qu’en réalité elle porte toute son attention sur « le fait générateur de responsabilité ».
Car c’est assurément la question de l’appréciation de la faute qui constitue la figure de proue de cette décision. La faute en matière sportive, qu’il s’agisse d’engager la responsabilité personnelle du sportif ou celle de son club, a fait l’objet de multiples évolutions à travers un contentieux riche. On sait notamment que la Cour de cassation refuse de se soumettre aux seules décisions de l’arbitre comme elle a pu le rappeler fermement en 2004 en indiquant que « le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité »27. Par ailleurs, il existe une distinction, qu’on retrouve entre les lignes du pourvoi entre la faute de jeu et la faute contre le jeu. C’est bien parce qu’il existe une transgression de la règle sportive, que le sportif et son club devaient être responsables selon le demandeur au pourvoi.
Finalement, la Cour de cassation balaie une telle appréciation pour cantonner la responsabilité à l’égard du parieur à un champ très restreint. En ce sens, le souhait émis par le professeur Mouly, en 1998, autre année marquante pour le football français, résonne avec une acuité toute particulière. Interrogé sur la possibilité pour le parieur d’engager la responsabilité d’un footballeur, il résumait ainsi sa pensée : « En réalité, que l’on se situe sur le terrain de la faute ou sur celui du préjudice la responsabilité du sportif à l’égard d’un parieur ne devrait être engagée que dans l’hypothèse de fautes intentionnelles ou à tout le moins de comportements lourdement fautifs, créant un risque anormal qui ne peut être considéré comme un aléa du jeu accepté pour le parieur. Cette solution devrait avoir une valeur générale et s’appliquer aussi bien aux footballeurs dont le match a été retenu pour le loto sportif que pour les jockeys dans le cadre du PMU. Sans quoi, la profession de sportifs risquerait de devenir une profession à hauts risques »28. À notre sens, le champ de la responsabilité est au regard de la présente décision plus restrictif encore que celui souhaité par le professeur Mouly, puisqu’il impose la caractérisation d’un « fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif ». L’emploi du terme « sciemment » a inévitablement interpellé les commentateurs29. Il faut sans doute voir se dessiner à travers cette terminologie une faute intentionnelle mais, plus restrictivement encore, une faute commise intentionnellement pour nuire au résultat de la rencontre et donc aux paris sportifs. Or en l’espèce, si tant est que la position de hors-jeu ait pu être considérée comme une faute grave30, il est difficile de reprocher au joueur d’avoir marqué un but pour fausser le résultat de la rencontre, alors que c’est précisément l’objectif de ce sport. Le parieur ne peut donc, à la lumière de cette décision, espérer une réparation que dans l’hypothèse où le pari sportif aurait été truqué grâce à l’aide du joueur. Cette solution, pragmatique, si elle ne satisfera pas les parieurs déçus, semble ainsi éviter certaines difficultés d’appréciation et certaines difficultés judiciaires.
II. Une opportune occasion manquée : les conséquences de l’encadrement strict de la faute susceptible d’entraîner la responsabilité du sportif et de son club
La première difficulté majeure que paraît soulever l’analyse du demandeur au pourvoi est bien celle de l’appréciation d’une faute qui serait susceptible d’entraîner la responsabilité du sportif et de son club. En effet, lorsqu’il est question de préserver la sécurité des participants le degré de gravité de la faute nous semble devoir être moins élevé que lorsqu’il est simplement question d’indemniser un parieur déçu. Si le demandeur semblait insister sur la gravité de cette faute, un hors-jeu majeur selon son argumentation, intolérable pour un joueur professionnel, l’analyse prête à réfléchir. Même aguerri, un sportif n’aurait-il plus droit à l’erreur, a fortiori lorsque la règle du jeu enfreinte ne porte pas atteinte à autrui physiquement mais réduit seulement ses espoirs de gain ? Si la Cour de cassation avait fait le choix de quitter le terrain de la faute qui a « pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif », des difficultés d’appréciation de la faute aurait nécessairement surgies devant les juridictions du fond. Quels gestes pour quels sports pourrait-on considérer comme particulièrement graves, fautifs ? Un geste maladroit ou une main dans la surface, un penalty sifflé conduisant à un but transformé ou non ? Voilà bien des incertitudes qui doivent inviter à la prudence lorsqu’il est question de retenir une faute génératrice de responsabilité. À l’égard des parieurs, qui ne subissent qu’un préjudice économique et non corporel, il faut donc approuver la solution qui consiste à ne pas transformer une simple faute de jeu, commise sans volonté de nuire au résultat de la rencontre, en faute civile génératrice de responsabilité.
D’autant qu’une solution inverse aurait assurément eu des conséquences sur le développement du contentieux. De ce point de vue, tant la date de parution, que les honneurs de publication31 ou encore la formulation retenue contribuent à envoyer un message fort aux parieurs32. Ce message se doit d’autant plus d’être audible que le marché des jeux, et en particulier des paris sportifs, est toujours en expansion. Dans un de ses communiqués récents l’ARJEL33 indiquait ainsi que lors de la dernière coupe du monde, les 48 matchs de groupe ont généré, à eux seuls, un total de 363 millions d’euros de mises répartis entre les points de vente FDJ et les sites des opérateurs sportifs agrées34. Imaginons ainsi qu’une fois déçus des résultats sportifs, tous ces parieurs se prévalent de fautes de jeu devant les juridictions pour obtenir une réparation pour perte de chance. Un tel effet qu’on pourrait qualifier de « boule de neige » serait lourd de conséquence pour les rôles des juridictions françaises. Cette crainte de l’afflux contentieux est très présente en matière de responsabilité civile. Parmi de nombreux exemples, c’est cette même crainte qui a assurément guidé le législateur dans la rédaction de son texte anti-perruche en 2002 afin d’éviter les recours trop nombreux contre les médecins. Dans un tout autre domaine, n’est-ce pas cette inquiétude du contentieux massif qui a conduit la Cour de cassation au refus de reconnaissance d’un lien de causalité entre le défaut d’information du fabricant de cigarettes et la maladie mortelle d’une fumeuse35. Si fumer tue, selon l’affichage accolé sur les paquets de cigarette, cette mort ne peut donc pas être reprochée au fabriquant : volonté de responsabilisation des consommateurs ou souhait de limiter le contentieux, le doute est une fois encore permis.
Ainsi, les parieurs doivent entendre le message. Le pari est un jeu risqué, marqué par l’aléa et pour lequel la responsabilité civile ne doit pas être abusivement mobilisée. Que les parieurs profitent donc des étoiles décrochées par les sportifs mais qu’ils n’espèrent pas les décrocher sous les ors du quai de l’horloge.
A. M.
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. soc., 8 févr. 2012, n° 10-20376.
-
2.
C. trav., art. L. 2242-17, 7°.
-
3.
Cass. soc., 10 févr. 2012, n° 08-42526 : RJS 4/10, n° 449 – CA Versailles, 5 août 2013, n° 13/05861 : RJS 11/13, n° 735.
-
4.
Pour illustration : Cass. soc., 21 juin 2016, n° 14-29745 : RJS 11/16 n° 706. En l’espèce, une réorganisation de l’entreprise entraînait un accroissement du périmètre des déplacements, un nouveau régime des astreintes et une modification du rattachement hiérarchique et des processus RH.
-
5.
Sur la notion de condition de travail : Verkindt P.-Y., « Un nouveau droit des conditions de travail », Dr. soc. 2008, p. 634.
-
6.
Rapport « Intelligence artificielle et travail », France stratégie, mars 2018, p. 46.
-
7.
Rapport « Intelligence artificielle et travail », France stratégie, mars 2018, p. 46.
-
8.
Villani C., « Donner un sens à l’intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne », rapport, mars 2018.
-
9.
« Par rapport au débat très théorique sur l’intelligence artificielle qui remplacerait les emplois, chez nous, au Crédit Mutuel, l’intelligence cognitive est mise au service d’une relation client augmentée et permet de dégager du temps commercial et du temps d’écoute. C’est un outil extrêmement puissant de montée en compétences des salariés, grâce à des assistants (virtuels) efficaces. L’adhésion des utilisateurs est impressionnante, le taux de satisfaction est de l’ordre de 90 % », propos tenus par Nicolas Théry, président du groupe Crédit Mutuel, dans « IA : Watson est un investissement “rentable” au Crédit Mutuel », La tribune.fr, 22 févr. 2018.
-
10.
C. trav., art. L. 4611-1 anc.
-
11.
TGI Paris, réf., 3 nov. 2016, n° 16/58942.
-
12.
TGI Paris, 3 nov. 2016, n° 16/58942.
-
13.
Verkindt P.-Y., « Les conditions de travail et la santé au travail dans les ordonnances du 22 septembre 2017 : faut-il mouiller son mouchoir ? », Dr. soc. 2018, p. 41.
-
14.
Op. cit. p. 113.
-
15.
Op. cit. p. 113.
-
16.
Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-14915 : JCP N 2017, 1201, note Bouchard V. ; Gaz. Pal. 13 juin 2017, n° 297h6, p. 70, obs. Bourassin M. ; D. 2017, p. 2119, obs. Brémond V. ; Defrénois 1er févr. 2018, n° 132s5, p. 28, obs. Champenois G. ; Dalloz actualité, 7 mars 2017, obs. Delpech X. ; RD bancaire et fin. 2017, comm. 72, obs. Legeais D. ; D. 2017, p. 2176, obs. Martin D. R. et Synvet H. ; Banque et droit 2017, n° 172, p. 79, obs. Jacob F. ; Rev. sociétés 2017, p. 586, note Pla Busiris S. ; JCP G 2017, 511, n° 9, obs. Simler P.
-
17.
Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-12723 : D. 2017, p. 212 ; AJCA 2017, p. 122, obs. Houtcieff D. ; Rev. sociétés 2017, p. 282, note Ansault J.-J. ; RTD com. 2017, p. 625, obs. Lecourt A.
-
18.
Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-10504 : Dalloz actualité, 28 nov. 2017, obs. Brémond V. ; RTD civ. 2018, p. 184, note Crocq P. ; D. 2018, p. 392, obs. Dumont-Lefrand M.-P. ; AJCA 2018, p. 93, obs. Houtcieff D. ; RTD civ. 2018, p. 199, obs. Nicod M.
-
19.
V. sur ce point Bourassin M., « Appréciation de la proportionnalité du cautionnement : clair-obscur sur les biens (in)saisissables », Gaz. Pal. 13 juin 2017, n° 297h6, p. 70.
-
20.
Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23036 : AJ fam. 2018, p. 315, note Avena-Robardet V. ; Dalloz actualité, 18 juin 2018, obs. Pellier J.-D. V. en ce sens Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-24800 : D. 2016, p. 1955, obs. Crocq P.
-
21.
Dans une affaire récente, la haute juridiction a ainsi retenu la responsabilité d’une association sportive en raison des violences commises par un de ses joueurs sur l’arbitre alors même que le joueur avait été exclu du terrain mais qu’il se trouvait toutefois encore dans l’enceinte sportive. Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19957.
-
22.
Pour une analyse de l’arrêt d’appel v. Vial J.-P., « Pari sportif perdu pour cause de hors-jeu : pas d’indemnité pour le parieur », Jurisport 2018, n° 185, p. 35.
-
23.
Cass. 2e civ., 4 mai 1972, n° 71-10121, PB.
-
24.
Pour une synthèse de cette évolution v. not. Rép. civ. Dalloz, v° Responsabilité civile des sportifs, Répertoire de droit civil, Responsabilité civile des sportifs, 2018, n° 188 et s., Mouly J.
-
25.
Cass. 2e civ., 25 janv. 1973, n° 71-13363, PB.
-
26.
Mouly J., « Loto sportif et PMU – Responsabilité éventuelle des sportifs », Revue juridique et économique du Sport 1998, n° 47, p. 69.
-
27.
Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-18649, PB.
-
28.
Mouly J., « Loto sportif et PMU – Responsabilité éventuelle des sportifs », Revue juridique et économique du Sport 1998, n° 47, p. 69.
-
29.
Conte H., « Responsabilité et paris sportifs : “La vida es una tombola” », La lettre juridique 19 juill. 2018, n° 750 ; Dupré M., « La peu glorieuse incertitude du parieur », Gaz. Pal. 17 juill. 2018, n° 328w9, p. 14.
-
30.
On rappellera que la position de hors-jeu est définie par la règle 11 édictée par la fédération internationale de football et que s’il s’agit bien d’une faute de jeu elle est simplement sanctionnée par un coup franc et non par un carton.
-
31.
F-PBI.
-
32.
Pour des développements sur la question du dialogue des juges avec les justiciables voir Mâzouz A., « Le cynisme des juges », dans Cynisme et droit, 2016, Lextenso, p. 19.
-
33.
L’autorité de la régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante créée par la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne n° 2010-476 du 12 mai 2010. Parmi ses missions, elle contrôle le marché des paris.
-
34.
Autorité de régulation des jeux en ligne, « Paris sportifs : bilan du marché français des matches de phase de groupes de la coupe du monde de la Fifa, Russie 2018 », en ligne dernière consultation le 16 juill. 2018 : http://www.arjel.fr/IMG/pdf/20180702CP.pdf.
-
35.
Cass. 1re civ., 8 nov. 2007, n° 06-15873, PB.