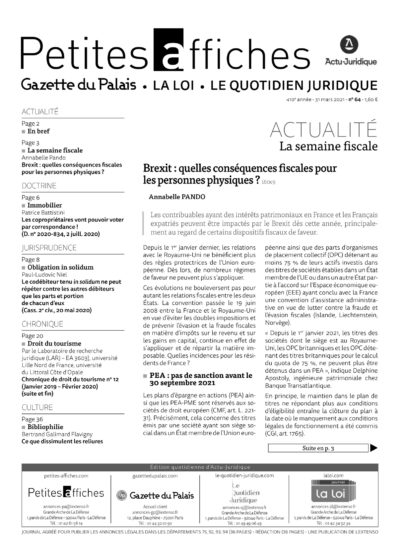Chronique de droit du tourisme n° 12 (Janvier 2019 – Février 2020) (suite et fin)

Attentats, grèves, mouvement des « gilets jaunes », niveau de délinquance, incendie de la cathédrale de Paris, propagation apparemment incontrôlable de l’épidémie liée au Coronavirus (Covid-19), perspective du Brexit… Nombreux sont les événements qui auraient pu cette année encore avoir un impact sur le tourisme en France. L’année 2019 paraît pourtant avoir été de nouveau une bonne année pour le tourisme français, même si les chiffres officiels sur l’année ne sont pas encore disponibles. L’activité touristique semble davantage impactée par son encadrement juridique, lequel continue de nécessiter le recours à de nombreux droits, malgré la promulgation d’un Code du tourisme en 2016.
I – Les acteurs du tourisme
A – Acteurs publics
B – Acteurs privés
II – Activités du tourisme
A – Exercice des activités touristiques
1 – Financement des activités
(…)
2 – Libertés de circulation
(…)
3 – Intermédiaires de voyages
4 – Transports
5 – Hébergements touristiques
(…)
6 – Tourisme collaboratif
(…)
7 – Responsabilités et assurances
(…)
Précisions sur la mise en œuvre du droit à indemnisation (Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, nos 18-20490 et 18-20491 et CJUE, 24 oct. 2019, n° C-756/18). Les modalités de mise en œuvre des droits reconnus aux passagers victimes d’une annulation, d’un retard important de vol ou d’un refus d’embarquement demeurent au cœur d’un contentieux vivant qui donne non seulement à voir le rôle cardinal de la jurisprudence – tant des juridictions internes que de la CJUE – dans la préservation de l’efficacité de la protection organisée par le règlement (CE) n° 261/2004, mais également l’importance des questions de coordination des différents cadres normatifs – international, européen et interne. Les arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 octobre 2019 en fournissent une illustration topique. À l’occasion de précisions fournies en matière de mise en œuvre du droit à indemnisation, ces arrêts mettent en lumière le dialogue nécessaire entre le cadre européen – plus volontiers tourné vers la protection des passagers – et le cadre interne – marqué par une plus grande neutralité.
Dans la première affaire1, était en cause un billet pour un vol Mulhouse-Conakry via Paris, dont l’itinéraire de vol avait été modifié2. La modification de l’itinéraire de vol n’a pas été sans conséquences pour les passagers puisqu’ils sont arrivés à destination avec un retard d’un peu plus de 4 heures3. La seconde affaire4 concernait deux billets sur un vol Mulhouse-Pointe-à-Pitre via Paris. Le premier vol – reliant Mulhouse à Paris – ayant été retardé, les passagers sont parvenus à leur destination finale avec 24 heures de retard.
Dans ces deux affaires, les passagers victimes se sont retournés contre le transporteur aérien en sollicitant une indemnisation d’une part sur le fondement de l’article 75 du règlement (CE) n° 261/20046 et d’autre part, pour défaut de remise d’une notice informative7 relative aux droits que ce règlement reconnaît. À l’occasion de ces deux affaires, la première chambre civile de la Cour de cassation est saisie de deux questions différentes. L’une de ces questions est relative à la détermination du délai de prescription applicable à la demande d’indemnisation fondée sur le défaut de remise d’une notice informative. La seconde a trait aux conditions de reconnaissance du droit à indemnisation énoncées à l’article 3, § 2, sous a) du règlement (CE) n° 261/2004 et plus particulièrement, à l’exigence de preuve de la présence du voyageur victime à l’enregistrement.
S’agissant tout d’abord de la détermination du délai de prescription applicable à la demande d’indemnisation fondée sur l’absence de remise d’une notice informative. De la même manière que dans des affaires précédentes8, la question de la détermination du délai de prescription applicable à l’action en indemnisation fondée sur l’article 14 du règlement (CE) n° 261/2004 se pose sous un angle particulier. Ce n’est pas tant l’absence de délai de prescription qui interroge, que celle de la concurrence de délais pour agir. En d’autres termes, au moins deux délais, dont la durée et la source sont différentes, se trouvent mobilisés. Le premier délai est le délai d’action de deux ans, prévu par la convention de Montréal du 28 mai 19999 et auquel renvoie l’actuel article L. 6421-3 du Code des transports10. Le second est le délai quinquennal prévu à l’article 2224 du Code civil11 – soit le délai de prescription de droit commun prévu en matière civile12.
Conformément à une jurisprudence désormais acquise, la première chambre civile de la Cour de cassation retient l’application du délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil à l’action en indemnisation fondée sur l’article 14 du règlement (CE) n° 261/2004. Pour ce faire, la première chambre civile procède en deux temps.
Le premier temps consiste à identifier la nature de la demande d’indemnisation en cause et, par voie de conséquence, sa source textuelle. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’action en indemnisation fondée sur l’absence de remise d’une notice d’information est une demande d’indemnisation complémentaire au sens de l’article 12 du règlement (CE) n° 261/200413 ou une demande d’indemnisation fondée sur un droit conféré par le règlement (CE) lui-même. La raison en est simple : la détermination de la nature de l’action en cause permet d’identifier son fondement, et plus largement son cadre juridique de rattachement (le règlement (CE) n° 261/2004 ou la convention de Montréal, par exemple). Pour répondre à cette question, la Cour de cassation se réfère à la jurisprudence de la CJUE et rappelle que « les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits qui leur sont conférés par ledit règlement, ne sauraient être considérées comme relevant d’une indemnisation “complémentaire” au sens de l’article 12 de ce texte »14. Et de conclure que la demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du règlement « ne constitue pas une demande d’indemnisation liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal », mais une « demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen qui se situe en dehors du champ d’application de cette convention ». La formulation retenue n’est sans doute pas anodine tant elle souligne l’absence de lien entre la demande d’indemnisation en cause et la convention de Montréal15.
Dans un second temps, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle les solutions retenues en matière de délai applicable à l’action en indemnisation fondée sur les articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004. L’objectif est ici d’étendre la solution à l’action en indemnisation fondée sur l’absence de remise d’une notice informative16. Pour ce faire, la première chambre civile de la Cour de cassation met en exergue une caractéristique commune aux deux actions en cause : elles se situent toutes deux en dehors du champ de la convention de Montréal du 28 mai 199917. Dès lors, ce qui a été retenu pour l’une de ces actions en matière de détermination du délai applicable semble applicable à l’autre. Pour ce faire, la première chambre civile de la Cour de cassation prend appui sur la jurisprudence européenne en ce qu’elle retient que « le délai dans lequel les actions ayant pour objet d’obtenir le versement de l’indemnité prévue aux articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 doivent être intentées, est déterminé par le droit national de chaque État membre »18. Et d’en conclure que la demande d’indemnisation fondée sur la violation de l’article 14 du règlement (CE) n° 261/2004 est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil.
Du point de vue du droit français, cette solution revêt au moins un avantage. Les actions en indemnisation fondées sur le règlement (CE) n° 261/2004 sont soumises à un délai d’action unique19, lequel apparaît d’ailleurs plus favorable aux passagers que les délais spéciaux dont l’application a par ailleurs été envisagée. C’est à tout le moins ce que suggèrent les arrêts ici étudiés. Au-delà, et du point de vue des voyageurs victimes, cette solution a le mérite de la simplicité. Ces derniers n’ont en effet pas à distinguer selon la cause du droit à indemnisation (annulation de vol, non remise de notice informative, par exemple) pour déterminer le délai qui leur est imparti pour agir en justice. Plus largement, les passagers semblent pouvoir échapper aux difficultés traditionnellement attachées en droit français à la diversité des délais de prescription – et plus largement des délais pour agir –. Le maintien d’une telle solution et son élargissement aux actions fondées sur la mise en œuvre des droits reconnus par le règlement (CE) n° 261/2004 serait ainsi de nature à renforcer l’efficacité de ces droits, et avec eux, celle de la protection offerte aux passagers victimes d’une annulation de vol, d’un retard important de vol ou d’un refus d’embarquement. En revanche, à l’échelle des droits des États membres, le risque de traitement différencié des voyageurs selon le droit national applicable, déjà évoqué lors de précédentes affaires, demeure.
S’agissant ensuite de la preuve de la présence des passagers à l’enregistrement, l’article 3, § 2, sous a) du règlement (CE) n° 261/2004 définit le domaine d’application personnel de la protection qu’il organise. À ce titre, le bénéfice de cette protection est subordonné à la réunion de deux conditions : les passagers doivent disposer d’une réservation confirmée pour le vol litigieux et se présenter à l’enregistrement. Tout au plus le texte écarte-t-il la seconde condition en cas d’annulation de vol. De cet article, la première chambre civile de la Cour de cassation a déduit qu’il revenait au passager victime de rapporter la preuve de la réunion de ces deux conditions20 en application du droit – interne – commun de la preuve21. Aussi est-il revenu au passager victime d’un retard important de vol de rapporter la preuve de sa présence à l’enregistrement, alors même que les compagnies aériennes paraissaient bien plus en mesure de rapporter une telle preuve. La rigueur de cette solution a par ailleurs été accentuée par les solutions retenues relativement aux éléments produits par les passagers. Alors qu’il était au fond demandé au passager d’établir sa présence à bord de l’avion dont le vol avait été retardé, la jurisprudence a refusé de retenir qu’une telle preuve soit rapportée par la production d’une réservation électronique et d’une attestation de retard non nominative, signée par le transporteur aérien22. Cette solution a suscité de nombreuses réserves. Les décisions rendues par les juridictions du fond ont d’ailleurs souligné leur souhait d’aménager la solution retenue en répartissant la charge de la preuve entre les parties en présence. Malgré cela, la première chambre civile de la Cour de cassation semble vouloir maintenir son cap. Les arrêts rendus le 10 octobre 2019 en fournissent une illustration topique. Dans la seconde affaire23, la première chambre civile de la Cour de cassation retient en effet que la production de la copie d’un billet électronique ainsi que la carte d’embarquement pour le vol correspondant au vol de réacheminement24 sont des éléments qui ne permettent pas d’établir que les voyageurs victimes « s’étaient présentés dans les délais impartis à l’enregistrement du vol initialement programmé, au départ de Mulhouse le 16 novembre 2012 ». La preuve requise étant celle de la présence à bord du vol retardé, la production d’une carte d’embarquement pour le vol suivant était donc insuffisante. La fermeté de la solution se trouve par ailleurs renforcée par la forme de l’arrêt25 ainsi que par sa diffusion26.
Les difficultés suscitées par la preuve de la présence lors de l’enregistrement – preuve parfois qualifiée de diabolique – peuvent générer chez les plaideurs des stratégies de contournement. L’une d’entre elles consisterait pour le passager victime à privilégier la qualification d’annulation de vol plutôt que celle de retard important. La raison en est simple. L’article 3, § 2, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 écarte la condition de présence du passager à l’enregistrement lorsqu’il est victime d’une annulation au sens de l’article 5 de ce texte. Il n’est cependant pas certain que la Cour de cassation réserve un accueil favorable à une telle démarche. Dans la première affaire27, la haute juridiction a en effet fermement refusé d’assimiler la modification d’un voyage aérien par l’ajout d’une escale à une annulation de vol. Le refus prend appui d’une part sur les dispositions du règlement (CE) n° 261/200428, et d’autre part sur la jurisprudence de la CJUE29. Cette solution interpelle tout d’abord par sa fermeté, d’autant que sur le fond, le refus opposé par la Cour de cassation conduit à appliquer pleinement l’article 3, § 2, sous a) du règlement (CE) n° 261/2004. À défaut des éléments de preuve requis, les passagers ne pourront efficacement faire valoir un droit à indemnisation. Cette solution interroge également tant elle semble difficile à concilier avec la jurisprudence de la CJUE, laquelle jurisprudence retient la possibilité de reconnaître le droit à indemnisation prévu à l’article 5, § 1, sous c) et l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 lorsque l’ajout d’une escale provoque un retard à l’arrivée égal ou supérieur à 3 heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue. En l’espèce, le vol litigieux a en effet accusé un retard d’un peu plus de 4 heures.
La portée de ces deux arrêts doit néanmoins être atténuée depuis l’ordonnance rendue par la CJUE le 24 octobre 201930. Saisie de questions préjudicielles relatives à la charge et aux modes de preuve de la présence des passagers lors de l’enregistrement, la CJUE a choisi de retenir une solution plus protectrice des passagers que celle consacrée par la Cour de cassation. Elle retient en effet que le règlement (CE) n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, sous a) doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de 3 heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. En creux, l’on comprend qu’il revient désormais aux transporteurs aériens de rapporter la preuve de la présence du passager victime d’un retard de vol de 3 heures ou plus.
Valérie DURAND
8 – Tourisme médical et tourisme procréatif
Tourisme procréatif et parenté d’intention : vers un véritable changement de cap ? (Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19053, Mennesson ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-11815 ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-12327 ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, nos 18-14751 et 18-50007). Les derniers arrêts de la Cour de cassation en matière de tourisme procréatif vont-ils enfin mettre un terme à l’insécurité judiciaire découlant du défaut de clarification de la situation légale du parent d’intention ? Alors que le projet de loi relatif à la bioéthique était en cours d’examen au Parlement, plusieurs décisions importantes ont été rendues au cours de l’année 2019 signant des revirements inattendus de la part de la haute juridiction de façon assez surprenante.
Même si le recours à la gestation pour autrui sur le sol français reste un interdit absolu, il convient de le concilier avec la nécessité de protéger l’enfant lorsque des liens affectifs stables sont établis avec le parent d’intention. Mais uniquement dans ce cas, car la Cour de cassation n’hésite pas à rappeler dans toute sa rigueur l’interdit. Ainsi, la première chambre civile s’est prononcée le 12 septembre 201931, sur la recevabilité d’une action en contestation de paternité menée par le père biologique en vue d’établir sa filiation à l’égard d’un enfant issu d’une GPA réalisée sur le territoire français dont la mère porteuse n’avait pas honoré son engagement jusqu’au bout. D’ailleurs, les faits de l’espèce étaient particulièrement illicites puisqu’ils avaient même donné lieu en parallèle à diverses condamnations pénales32. En effet, après avoir conçu l’enfant dans le cadre d’une convention de GPA au profit d’un couple d’homosexuels pacsés, la mère porteuse avait préféré le remettre à un couple marié hétérosexuel avec lequel elle était également en contact durant sa grossesse, faisant croire au père biologique que le bébé était décédé à la naissance. Dans ce conflit de paternité, la réalité biologique ne l’a pas emporté puisque l’action en contestation de la reconnaissance de paternité effectuée par le père d’intention a été déclarée irrecevable, la demande reposant sur un contrat prohibé par la loi33. Aux yeux de la Cour de cassation, il importait peu que la reconnaissance litigieuse soit par ailleurs frauduleuse. L’enfant vivait dans d’excellentes conditions au foyer de ses deux parents depuis sa naissance, son intérêt supérieur devait ainsi prévaloir sur les autres intérêts en présence et primer la vérité biologique.
En matière de GPA internationale, depuis une série d’arrêts rendus en 2017 à la suite d’une évolution jurisprudentielle orchestrée par les condamnations successives de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme34, la Cour de cassation admettait la transcription partielle de l’acte de naissance étranger à l’égard du père biologique mais pas à l’égard de la mère (ou du père) d’intention. Pour établir un lien de filiation à l’égard de l’enfant, le parent d’intention devait obligatoirement passer par la procédure de l’adoption.
Or, l’affaire Mennesson a fini par connaître un rebondissement final lors de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 octobre 201935. Contre toute attente, elle écarte en ce qui les concerne le recours à l’adoption et ordonne la transcription totale des actes de naissance étrangers des jumelles sur les registres de l’état civil, tant à l’égard du père que de la mère d’intention (a). Elle opère ainsi un véritable changement de cap quant aux effets en France des GPA réalisées à l’étranger, changement de cap confirmé 2 mois plus tard dans plusieurs arrêts rendus le même jour par la première chambre civile36 à propos des GPA et des PMA internationales (b). Reste à mesurer l’impact de ces décisions sur la position à adopter par le législateur concernant la parenté d’intention dans la future loi de bioéthique.
a – Le rebondissement dans l’affaire Mennesson
Au terme d’une saga judiciaire qui a duré 19 ans, l’assemblée plénière a finalement reconnu la filiation légale de la mère d’intention qui, en raison d’une malformation congénitale, ne pouvait pas porter un enfant, ni même fournir ses ovocytes. À l’origine du contentieux, une GPA réalisée par le couple en Californie où elle est légalement encadrée. Des jumelles naissent ainsi aux États-Unis au cours de l’année 2000, Fiorella et Valentina. Les parents obtiennent des jugements de la cour supérieure californienne mentionnant dans l’acte de naissance des enfants à la fois le père biologique, Dominique Mennesson, et la mère légale, Sylvie Mennesson, qui n’était pas celle ayant accouché.
Dans un premier temps, les actes de naissance sont retranscrits sur les registres de l’état civil français mais une procédure en annulation est engagée par le ministère public au terme de laquelle la première chambre civile de la Cour de cassation se prononça le 6 avril 2011 et refusa la transcription des actes de naissance. Ayant épuisé les voies de recours interne, les époux saisirent la Cour européenne des droits de l’Homme qui rendit un arrêt le 26 juin 2014 où elle condamna la France pour atteinte au respect de la vie privée des enfants en raison de l’impossibilité pour eux d’établir la filiation à l’égard du père biologique. À la suite de cette condamnation, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence en acceptant à partir de 201537 la transcription sous certaines conditions de l’acte de naissance établi par un pays étranger mentionnant le père biologique d’un enfant issu d’une GPA internationale.
Mais les époux Mennesson s’étaient vu refuser la transcription des actes de naissance étrangers qu’ils réclamaient38. Peu de temps après, ils demandèrent un réexamen de leur affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, conformément à la nouvelle procédure introduite par la loi n° 2016-1547 du 26 novembre 201639. Ils sollicitaient la transcription intégrale des actes de naissance de leurs filles, en ce qui concerne non seulement le père biologique mais aussi la mère d’intention.
Avant de se prononcer sur cette demande de révision, la haute juridiction qui redoutait une condamnation ultérieure préféra saisir la Cour européenne des droits de l’Homme pour avis, selon le mécanisme prévu au protocole additionnel n° 16, lequel était utilisé pour la première fois par la France40. Dans son avis rendu en grande chambre41, la Cour a considéré que le droit au respect de la vie privée de l’enfant au sens de l’article 8 de la CESDH suppose que le lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention puisse être établi mais que c’est aux États de décider du mode le plus adapté.
Dans l’arrêt rendu le 4 octobre 2019, l’assemblée plénière répond aux demandes des époux Mennesson en affirmant tout d’abord que même si les conventions de GPA sont interdites en France, le seul fait qu’une GPA soit réalisée à l’étranger ne peut pas être à lui seul un obstacle à la reconnaissance en France du lien de filiation avec la mère d’intention. D’après elle, cette reconnaissance doit avoir lieu au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère s’est concrétisé.
Par ailleurs, rappelant les cinq voies d’établissement de la filiation en droit français, la haute juridiction estime que dans le cas de la GPA réalisée à l’étranger, la voie de l’adoption est celle qui lui semble être la mieux adaptée afin de permettre au juge français de contrôler la validité de l’acte ou du jugement étranger. Seulement, dans le cas d’espèce, une procédure d’adoption porterait atteinte de façon disproportionnée à la vie privée des enfants, qui sont nées depuis plus de 18 ans. En effet, elles ne peuvent pas prendre l’initiative d’une adoption dont le choix revient aux parents alors que leurs actes de naissance ont été établis à l’étranger dans un cadre légal. La possession d’état n’offrirait pas non plus une sécurité juridique suffisante, à supposer que toutes les conditions légales soient réunies.
La Cour en conclut que, dans ce cas particulier, en absence d’autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée des enfants et en raison du fait que la procédure de réexamen vise à faire cesser les atteintes portées à la CESDH, il ne faut pas annuler la transcription en France des actes de naissance désignant la mère d’intention, le lien avec elle étant depuis longtemps concrétisé.
Cet épilogue dans l’affaire Mennesson était humainement souhaitable, mais qu’en est-il de sa portée exacte ? Il convient de remarquer que l’assemblée plénière utilise pour la première fois dans l’arrêt la formule « mère d’intention ». Sans doute ceci était déjà le signe d’une volonté d’évolution plus profonde de sa jurisprudence, d’un véritable changement de cap, même si ce changement de cap était un peu contraint en raison du standard européen. Or le même jour, lors de la discussion du projet de loi relatif à la bioéthique, un amendement automatisant la reconnaissance en France de la filiation des enfants conçus par GPA dans un pays étranger où elle est autorisée avait été adopté par l’Assemblée nationale. Porté par le député de la République en marche, Jean-Louis Touraine, cet amendement visait à consacrer la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris qui déclarait exécutoire les jugements étrangers par lesquels la filiation d’un enfant né par GPA a été établie en regardant cette filiation comme adoptive. Mais l’Assemblée nationale a fini par faire marche arrière le 10 octobre 2019, lors d’une seconde délibération demandée par le gouvernement par le biais de la garde des Sceaux. L’amendement a été finalement rejeté et le projet de loi relatif à la bioéthique adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 15 octobre 2019, puis par le Sénat le 4 février 2020, après certaines modifications. La seconde lecture du texte par l’Assemblée nationale est attendue après les élections municipales de 2020. Il contient la possibilité pour les couples de femmes ou les femmes seules de recourir à la PMA en France et consacre par la même occasion la notion de parenté d’intention, une reconnaissance plus générale dans laquelle la Cour de cassation s’était déjà engagée dès la fin de l’année 2019.
b – La confirmation du revirement à propos de la filiation du parent d’intention (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, trois arrêts)
Quelques semaines après l’arrêt de l’assemblée plénière, la cour d’appel de Rennes42 avait cru bon de renverser brusquement sa jurisprudence en étendant son raisonnement à des couples qui n’avaient pas le même parcours que la famille Mennesson et qui demandaient la transcription intégrale des actes de naissance sans passer par la voie de l’adoption.
Plus spectaculaire encore est le revirement opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans trois arrêts en date du 18 décembre 201943. En effet, elle étend la solution de l’arrêt Mennesson aux demandes formulées cette fois-ci par des couples de même sexe visant la transcription des actes de naissance d’enfants issus d’une GPA ou d’une PMA internationale. Contre toute attente, la haute juridiction unifie ainsi sa jurisprudence en se fondant sur l’avis de la Cour européenne des droits de l’Homme du 10 avril 2019.
Dans les deux premiers arrêts, il s’agissait de couples d’hommes, mariés ou non mariés, qui avaient eu recours à une GPA aux États-Unis pour constituer leur famille. Dans le troisième arrêt, les deux femmes avaient bénéficié chacune d’une PMA à Londres et avaient accouché toutes deux d’un enfant dont l’autre était « parent ». Les actes de naissance de ces enfants nés en 2014 désignaient, d’une part le père biologique ou la mère ayant accouché et, d’autre part, le parent d’intention conformément au droit étranger en vigueur.
Même si à première vue, la situation ne semblait pas identique, la Cour de cassation devait répondre en réalité à une même question de droit : « faut-il admettre la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant établi à l’étranger qui désigne une personne en qualité de père ou de mère biologique et une autre personne sans aucun lien de type biologique mais qui est indiqué comme étant lui aussi le parent légal de l’enfant ? ».
Pour y répondre la Cour de cassation va rappeler dans les deux types de cas que le fait que l’enfant soit né à l’étranger d’une convention de gestation pour autrui ou d’une assistance médicale à la procréation n’est pas en soi un obstacle à l’action aux fins de transcription. Ensuite, elle va s’affranchir de l’exigence posée à l’article 47 du Code civil quant à la réalité des faits évoqués dans l’acte étranger imposant une transcription. Cette réalité ne doit plus être analysée sous le prisme de la réalité purement biologique et elle revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure44 qui interdisait de reconnaître la maternité d’une femme n’ayant pas accouché.
En admettant la transcription totale des actes de naissance dans ces trois affaires, la Cour de cassation entend ainsi faciliter la filiation du parent d’intention en indiquant que le contrôle exercé par le juge ne doit être qu’un contrôle purement formel. En effet, pour que les actes en question soient probants au sens de l’article 47 du Code civil, il suffit qu’ils soient réguliers, exempts de fraude et conformes à la loi locale et c’est donc une conception purement juridique de la notion de réalité qu’il convient désormais de retenir.
Ce revirement de la part de la Cour de cassation est d’autant plus étonnant que la Cour européenne des droits de l’Homme venait de rendre deux arrêts45 où elle validait expressément en matière de GPA internationale la position médiane adoptée par la jurisprudence française acceptant seulement la transcription partielle de l’acte de naissance en ce qui concerne le père biologique et obligeant la mère d’intention à recourir à la procédure de l’adoption.
Au lendemain de l’arrêt Mennesson, s’est posée la question de savoir si l’assemblée plénière n’avait pas consacré un nouveau mode d’établissement de la filiation qui serait la transcription lorsque d’autres modes d’établissement sont inopérants. Par exemple, lorsque les parents d’intention ne sont pas mariés et que la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint est exclue ou bien lorsque la mère d’intention est également la mère génétique de l’enfant et que la possibilité de reconnaître son enfant ne lui est pas ouverte46.
Dans ces trois arrêts du 18 décembre 2019, la Cour de cassation répond à cette interrogation de façon très claire : l’action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de filiation. Rejeter la transcription intégrale au motif que l’adoption de l’enfant du conjoint était possible aboutissait en fait à exiger le double établissement d’un même lien de filiation. Or, l’objet de l’action aux fins de transcription de l’acte de naissance est de reconnaître une filiation déjà établie à l’étranger et non pas d’établir une nouvelle fois le même lien de filiation.
Cet important revirement de la part de la Cour de cassation résonne aussi comme un puissant appel au législateur pour qu’il clarifie de façon définitive la question de l’établissement de la filiation du parent d’intention. Le changement de cap de la jurisprudence depuis l’épilogue de l’affaire Mennesson pourrait bien ne pas être définitif. En effet, le dernier mot revenant toujours au législateur, les travaux parlementaires actuels liés à la révision de la loi relative à la bioéthique démontrent que la tendance est plutôt à la remise en question des avancées de la fin de l’année 2019, même si elles ont été inspirées par l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le projet de loi initial élargissait l’accès à la PMA aux couples de femmes et prévoyait un mode d’établissement spécifique de la filiation des enfants ainsi conçus sous la forme d’une reconnaissance conjointe anticipée effectuée devant le notaire. Lors de son passage au Sénat, les sénateurs ont réécrit le nouveau mode d’établissement de la filiation de ces enfants en privilégiant le recours à l’adoption par la mère d’intention. À propos de la GPA, les sénateurs ont voté le 7 janvier 2020 un amendement qui exclut la transcription totale à l’état civil des actes de naissance établis à l’étranger qui mentionnent deux pères ou qui mentionnent en tant que mère une femme autre que celle ayant accouché. Seule la transcription du nom du parent génétiquement rattaché à l’enfant serait possible, le texte permettant par ailleurs l’établissement de la filiation à l’égard de la mère ou du père d’intention par le biais de l’adoption.
Autrement dit, si cet amendement est maintenu dans la version définitive de la loi relative à la bioéthique, il marquerait un retour à la jurisprudence antérieure aux arrêts du 18 décembre 2019. Sans oublier que la procédure d’adoption suppose des délais inhérents aux jugements et que sur ce point il n’est pas sûr que chaque cas d’espèce réponde parfaitement aux critères d’effectivité et de célérité posés par la Cour européenne des droits de l’Homme dans son avis du 10 avril 2019. En outre, d’après le droit actuel, l’adoption de l’enfant par le parent d’intention n’est possible qu’à condition que les parents soient mariés et que l’autre parent ait donné son consentement.
En prévoyant le recours à l’adoption à la fois dans le cadre de la PMA au profit d’un couple de femmes et des effets d’une GPA internationale en France, toutes les difficultés ne seraient pas pour autant surmontées, même s’il est vrai que les modalités d’établissement de la filiation à l’égard du parent d’intention tendraient ainsi à être harmonisées.
Un pas en avant, deux pas en arrière… L’aléa judiciaire en matière de reconnaissance de la parenté d’intention est loin d’être aujourd’hui totalement dissipé et le tourisme procréatif a encore de beaux jours devant lui !
Evelyne MONTEIRO
9 – Restauration
L’attente de clarification du statut des travailleurs des plates-formes (Cons. prud’h. Paris, sect. comm., ch. 3, 4 févr. 2020, n° 19/07738, M. C. c/ SAS Deliveroo France ; Cons. const., 20 déc. 2019, n° 2019-794 DC, loi d’orientation des mobilités). Alors qu’elle reste un phénomène marginal47, l’ubérisation, ou l’économie collaborative, continue de produire des dysfonctionnements dans les activités issues du tourisme48. Par exemple, au sein de la restauration, un nouvel intermédiaire a pris place en tant que plate-forme numérique, proposant de mettre en relation les restaurateurs, les clients et les livreurs de repas (notamment la plate-forme britannique Deliveroo, ou la filiale de la célèbre société américaine UberEats).
L’efficacité de ce modèle a eu pour conséquence d’intensifier son attractivité aux yeux des utilisateurs en même temps qu’il a accru l’hégémonie de ses acteurs49. En s’implantant dans des centres urbains particulièrement touristiques, ces plates-formes ont favorisé la création d’emplois, tout en évinçant ce que la réglementation traditionnelle du travail salarié pouvait avoir de protecteur.
En effet, en s’affirmant comme un simple intermédiaire, les plates-formes numériques considèrent que les coursiers qu’elles emploient ne sont plus des travailleurs à salarier mais des partenaires indépendants avec lesquels elles négocient. On retombe alors dans le schéma révolutionnaire des rédacteurs du Code civil, uniquement enclins à admettre la possibilité d’une relation libre et égale, entre des contractants à mêmes de faire valoir leurs intérêts50. Comme au XIXe siècle, cette fiction utilitariste allait bientôt se confronter à la réalité sociale d’un univers déséquilibré entre des personnes dominantes et d’autres dépendantes qui avait naguère justifié l’apparition des protections attachées au statut salarié51.
La répétition des affaires liées à la qualification du statut du travailleur des plates-formes a remis au jour cette conflictualité sociale sans que le législateur ne parvienne encore à l’apaiser. C’est alors au juge d’endosser ce rôle d’ajustement de la paix sociale aux besoins contradictoires d’efficacité économique et de justice sociale. Ces multiples cas ont ainsi révélé ce que l’apparition des plates-formes avait masqué de déséquilibre structurel entre les cocontractants, l’organisation des prestations étant déterminée et contrôlée unilatéralement.
À cet égard, l’arrêt Take Eat Easy52, intervenu après une domination du rejet par les juges du fond de requalifier ces relations en contrats de travail53, semble influencer le sens de la jurisprudence. Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour ne pas avoir caractérisé le lien de subordination entre un coursier et une plate-forme de livraison de repas (en liquidation judiciaire) en s’appuyant sur l’usage du système de géolocalisation ainsi que sur l’exercice d’un pouvoir de sanction.
Cette motivation est reprise par le conseil de prud’hommes dans un jugement du 4 février 2020 qui admet l’existence d’un contrat de travail entre un coursier et la société Deliveroo, une première condamnation d’une plate-forme de livraison de repas encore en activité54.
De façon classique, le travailleur en question avait postulé à l’offre de collaboration diffusée sur des sites internet, effectué les démarches nécessaires pour s’inscrire en qualité d’autoentrepreneur et conclu avec la société un « contrat de prestations de service » en septembre 2015. 6 mois plus tard, la société a mis fin au contrat. Contestant cette rupture, le livreur a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail et le paiement de diverses sommes, dont une indemnité pour travail dissimulé. Afin d’accueillir ces demandes, le conseil de prud’hommes a relevé l’exercice des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction par la société Deliveroo, conduisant à la caractérisation d’un contrat de travail en l’espèce (a), ainsi qu’à l’amplification des débats sur l’avenir du modèle en général (b).
a – La reconnaissance judiciaire d’un contrat de travail entre le livreur et la plate-forme
Sans originalité, le conseil de prud’hommes expose d’abord les fondements juridiques qui régissent le contentieux de qualification du contrat de travail.
Après avoir évoqué l’article L. 8221-6 du Code du travail qui institue une présomption de non-salariat au profit des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, le juge prud’homal précise que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes exercent leur activité dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre. Il rappelle la définition de ce lien caractérisé par l’exercice par l’employeur d’un pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements55. La preuve de ces éléments renverse alors la présomption légale de non-salariat au nom des principes de réalité et d’indisponibilité de la qualification du contrat de travail, également rappelés par le juge. D’ordre public, ces principes subordonnent l’existence d’une relation de travail aux seules conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, indépendamment de la volonté exprimée par les parties et de la dénomination donnée à leur convention56.
De manière plus intéressante, avant d’examiner les conditions d’exercice de l’activité, le conseil de prud’hommes reprend la formule de la Cour de cassation dans l’arrêt Take Eat Easy, l’érigeant au rang de principe en ce qui concerne les personnes travaillant avec les plates-formes en ligne57.
La juridiction prud’homale procède ensuite à la caractérisation de ces éléments en l’espèce. D’une part, elle s’appuie sur l’obligation d’installer l’application dotée d’un système de géolocalisation pour en déduire l’exercice des pouvoirs de direction et de contrôle. À l’instar de l’arrêt Take Eat Easy, ce n’est pas l’existence du système de géolocalisation en soi qui est problématique, mais son usage « de sorte que le rôle de la plate-forme ne se limitait pas à la mise en relation du restaurateur, du client et du coursier »58. En permettant le suivi en temps réel par la société de la position du travailleur et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus, ce système constitue un outil de contrôle du déroulement de la prestation. Cet usage est confirmé par des messages personnellement adressés au coursier par la société dans la messagerie de l’application afin de lui rappeler de le réactiver, ou de vérifier sa position par rapport au client59.
D’autre part, le juge considère que l’exercice d’un pouvoir de sanction est également établi par les courriers adressés au livreur l’informant des mesures imposées en cas d’une mauvaise exécution de ses prestations. Par exemple, à partir de deux désassignements au cours d’un shift60 de l’après-midi sur une période d’1 mois, le coursier est automatiquement enlevé d’un shift. De même, en cas d’absence non validée une semaine en avance, une retenue tarifaire est appliquée, voire une rupture de contrat si l’absentéisme est considéré trop élevé. Enfin, une obligation d’accepter les courses envoyées au livreur lui est également rappelée, sous peine de rupture du contrat. Cette méthode d’incitation rappelle le système de strikes de la plate-forme Take Eat Easy61.
Enfin, sans avoir recours à la notion de service organisé62, le conseil de prud’hommes souligne la fixation unilatérale de la rémunération par la société, ainsi que son droit de modifier les zones de travail du livreur sans solliciter son accord.
La combinaison de ces indices conduit les juges à relever que l’activité du livreur était exercée dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente, et, par conséquent, à constater l’existence d’un contrat de travail entre les parties, dont découle l’obligation de paiement de diverses sommes.
b – L’inconcevable maintien du modèle des plates-formes numériques
Outre la requalification, le conseil de prud’hommes a accordé au livreur une indemnité pour travail dissimulé, jugeant que Deliveroo s’était « intentionnellement soustrait à l’accomplissement des formalités relatives aux déclarations » exigées pour l’embauche de salariés63.
Cette condamnation consolide les critiques adressées au modèle des plates-formes numériques et accroît les interrogations quant à sa viabilité. Ceci d’autant plus qu’elle s’ajoute à la censure partielle par le Conseil constitutionnel de certaines dispositions de la loi d’orientation des mobilités (LOM) relatives à l’adoption de chartes facultatives déterminant les modalités d’exercice de la responsabilité sociale des plates-formes envers les travailleurs. Il était initialement prévu qu’en cas d’homologation, le respect de la charte ferait obstacle à la caractérisation d’un lien de subordination juridique entre la plate-forme et les travailleurs64. Cette faculté, particulièrement favorable aux plates-formes, fut déclarée inconstitutionnelle pour sa tentative de faire échec à la compétence du juge prud’homal de relever l’existence d’un contrat de travail, dont la qualification est indisponible et d’ordre public.
Le jugement du conseil de prud’hommes s’inscrit également dans un mouvement de requalification international intensifié. Il s’agit en effet de la quatrième décision européenne de requalification de travailleurs de plates-formes de livraison de repas en salariés, en ce début d’année seulement65. Il est surtout suivi par l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 4 mars, qui couronne le bouleversement du modèle en confirmant définitivement le caractère « fictif » du statut indépendant et l’existence d’un contrat de travail liant un chauffeur à la société Uber66.
La mise au jour de ces demandes, et la consécration de leur légitimité dans l’ordre juridictionnel, démontrent le caractère fallacieux des promesses de liberté et d’indépendance via le travail sur les plates-formes numériques, la réalité mettant en lumière des travailleurs qui exercent leur activité dans des conditions similaires à celles des salariés sans pour autant bénéficier de leurs protections (congés payés, salaire minimum, durée maximale de travail, assurances contre les maladies professionnelles et les accidents de travail, application des conventions collectives, etc.).
Ainsi, devant de telles concessions judiciaires, la question de la solution salariale demeure en suspens, puisqu’elle mettrait en péril, selon les partisans du modèle, l’existence même du modèle, et par conséquence le vivier d’emplois qui en émane67.
Une chose est certaine : la multiplication des solutions judiciaires, suppléant aux lacunes de la loi Travail et ses suites68, n’est plus tenable car elle disconvient aux attentes légitimes des justiciables à connaître le droit applicable, dans un pays qui se targue d’appartenir à la tradition continentale de règles prospectives supposées dissiper de telles incertitudes.
Miriam ELDAYA
B – Aménagement des espaces à vocation touristique
1 – Tourisme durable
L’obligation de respecter la procédure d’évaluation environnementale pour les unités touristiques nouvelles autorisées hors SCOT ou PLU (CE, 6e et 5e ch. réunies, 26 juin 2019, n° 414931). La conciliation entre exploitation touristique et préservation de l’environnement pose souvent question. Pour marier les deux, des procédures sont prévues. Le Conseil d’État a dû se prononcer sur l’application de l’une d’entre elles.
L’association France Nature Environnement s’oppose à des dispositions réglementaires (notamment le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles) en ce qu’elles ne prévoient pas d’évaluation environnementale pour les unités touristiques nouvelles (UTN) et en ce que les systèmes d’enneigement artificiel puissent être faits hors de la procédure d’autorisation d’UTN. Le ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire n’a pas répondu à ses demandes ; formulant ainsi une décision implicite de rejet. L’association saisit alors le Conseil d’État. Il lui donne raison le 26 juin 2019, mais seulement en ce qui concerne la procédure d’évaluation environnementale pour les UTN.
Celle-ci est prévue par une directive européenne. L’article 3 de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement oblige à effectuer une évaluation environnementale pour les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Les unités touristiques nouvelles inscrites dans un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou un plan local d’urbanisme (PLU) sont soumises à une telle évaluation par ce biais. Mais ce n’est pas le cas lorsqu’elles sont autorisées dans les communes non couvertes par ces documents par l’autorité administrative compétente (le préfet coordonnateur de massif ou celui de département). Le Conseil d’État précise à leur sujet qu’il leur faut donc justifier d’une procédure d’évaluation environnementale, notamment une consultation de l’autorité environnementale.
En ce qui concerne le système d’enneigement artificiel, il n’est pas une opération de développement touristique comme l’entend l’article sur les UTN. Il n’a donc pas à être soumis à la procédure d’autorisation d’UTN.
Les unités touristiques nouvelles (UTN) trouvent une première consécration législative avec la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (dite loi Montagne). La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (dite loi Montagne II) et le décret d’application n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles les modernisent.
La question de la compatibilité des nouvelles procédures de la loi Montagne II avec les exigences européennes d’évaluation environnementale avait déjà été soulevée69. Mais c’est la première fois que le juge administratif exige une étude environnementale pour les UTN70.
Les UTN sont prévues par les articles L. 122-15 et suivants du Code de l’urbanisme. Il s’agit de « toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard »71. Cette définition de 2016 élargit la précédente pour s’appliquer à d’autres cas que les aménagements initialement prévus et liés au ski72.
Les textes de 2016 et 2017 distinguent deux types d’UTN : les structurantes dont l’impact s’étend sur tout un bassin de vie et planifiées dans un SCOT ; et les locales dont l’impact est local et la planification dans un PLU. Les UTN structurantes remplacent celles de massif et celles locales se substituent à celles départementales73. L’autorité administrative compétente peut aussi définir des UTN structurantes ou locales, en l’absence de SCOT ou de PLU. Les conditions et surtout les seuils départageant les UTN structurantes des locales sont fixés par décret en Conseil d’État74.
Les nouvelles UTN de 2016 décentralisent leur mise en œuvre tout en prévoyant leur inclusion dans des documents d’urbanisme75. L’arrêt du Conseil d’État du 26 juin 2019 les conforte en sanctionnant les UTN définies par l’État mais pas celles définies dans les documents d’urbanisme décentralisés. Ce sont alors celles définies de manière décentralisée qui sont les plus respectueuses des procédures, alors même que les UTN avaient des origines centralisées et technocratiques76.
Nicolas DEMONTROND
2 – Tourisme et patrimoine
(…)
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20490 : RTD com. 2019, p. 973, obs. Bouloc B. ; JT 2019, p. 10, obs. Delpech X. ; D. 2020, p. 262, note Dupont P. et Poissonnier G. ; Dalloz actualité, 24 oct. 2019, obs. Delpech X. ; Gaz. Pal. 25 févr. 2020, n° 370p6, p. 33, obs. Carayol R.
-
2.
Dans cette affaire, la modification a consisté en l’ajout d’une escale à Dakar.
-
3.
Alors que l’arrivée à destination était initialement prévue à 15 h 55, l’avion a atterri à Conakry à 20 h 30.
-
4.
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20491 : RTD com. 2019, p. 974, obs. Bouloc B ; Dalloz actualité, 24 oct. 2019, obs. Delpech X ; Gaz. Pal. 25 février 2020, n° 08, p. 34, obs. Carayol R ; LEDC déc. 2019, n° 112u1, p. 6, obs. Sabard O ; JCP E 2019, act. 697
-
5.
Cet article organise le droit à indemnisation forfaitaire dont le montant est déterminé en fonction de la distance du vol ainsi que des modalités d’un éventuel réacheminement du passager vers sa destination finale.
-
6.
Étant précisé que dans la première affaire (Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20491), la passagère invoquait un droit à indemnisation fondé sur l’annulation du vol sur lequel elle devait initialement voyager, l’annulation résultant de l’ajout d’une escale à Dakar.
-
7.
V. règl. (CE) n° 261/2004, art. 14
-
8.
V. Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-15378 : RTD com. 2018, p. 454, obs. Bouloc B. ; Énergie - Env. - Infrastr., comm. 48, obs. Degert-Ribeiro C. ; Resp. civ. et assur. 2018, comm. 179 ; LPA 11 déc. 2019, n° 149z1, p. 10-11, obs. Durand V. V. égal. ant. Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 16-13352 : RTD com. 2017, p. 680, obs. Bouloc B. ; D. 2018, p. 1412 et s., obs. Kenfack H. ; Énergie - Env. - Infrastr. 2017, comm. 56, obs. Ktorza R. ; Resp. civ. et assur. 2017, comm. 236, note Bloch L. ; Contrats, conc. concur. 2017, comm.° 189, obs. Bernheim-Desvaux S. ; Gaz. Pal 18 juill. 2017, n° 298x6, p. 24, obs. Dupont P. et Poissonnier G. – Cass. 1re civ., 15 juill. 2017, n° 16-19375 : RTD com. 2017, p. 680, obs. Bouloc B. ; JCP G 2019, 1273, note Heymann J. ; JCP E 2019, act. 697 ; Contrats, conc. consom. 2019, comm. 210, obs. Berheim-Desvaux S.
-
9.
Conv. Montréal, 28 mai 1999, art. 35 : délai de recours. « 1. L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de 2 ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
-
10.
2. Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi ».
-
11.
L’article L. 6421-3 du Code des transports détermine les règles applicables à la responsabilité du transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Cet article est inséré dans la section II intitulée « Responsabilité du transporteur aérien concernant le transport aérien de personnes et de bagages ». Pour cette raison, il constitue un fondement sans doute moins discutable que l’article L. 6422-5 du même code, également sollicité lorsque la question de la détermination du délai pour exercer l’action en paiement de l’indemnisation due par le transporteur aérien à la suite d’une annulation de vol s’est posée.
-
12.
C. civ., art. 2224 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
-
13.
A tout le moins, en matière d’actions personnelles ou mobilières.
-
14.
Règl. (CE) n° 261/2004, art. 12 : Indemnisation complémentaire. « 1. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
-
15.
2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l’article 4, paragraphe 1 ».
-
16.
L’arrêt fait référence à la décision, CJUE, 13 oct. 2011, n° C-83/10, Aurora Sousa Rodríguez e.a. c/ Air France SA.
-
17.
Cette absence de lien est affirmée à au moins trois égards. Tout d’abord à l’égard de l’action en cause, laquelle est qualifiée d’autonome. Ensuite à l’égard de son fondement textuel, dont l’identification permet dans le même temps la distinction de la convention de Montréal. Enfin, à l’égard du lien existant entre le règlement (CE) n° 261/2004 et la convention de Montréal lequel est cette fois exclu. Le règlement se situe en dehors du champ d’application de la convention.
-
18.
Règl. (CE) n° 261/2004, du PE et du Cons., 11 févr. 2004, art. 14.
-
19.
D’autres points communs pourraient également être évoqués comme par exemple la nature de l’action (action en indemnisation) ou encore le fondement de l’action (règl. (CE) n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 7).
-
20.
La première chambre civile fait ici référence à l’arrêt rendu par la CJUE (CJUE, 22 nov. 2012, n° C-139/11, Joan Cuadrench Moré c/ Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV).
-
21.
Cela permet d’unifier d’une part la durée du délai pour agir et d’autre part le régime juridique applicable à ce délai. En effet, le choix de l’article 2224 du Code civil est également un choix de nature de délai. Le délai quinquennal est un délai de prescription et non un délai de forclusion. Partant, le régime juridique qui lui est applicable résulte en principe des dispositions de l’actuel titre XX du Code civil, à défaut de dispositions spéciales.
-
22.
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23205 : Énergie - Env. - Infrastr. 2018, comm. 26, obs. Charles J.-B. ; Gaz. Pal. 4 sept. 2018, n° 329v5, p. 28, obs. Carayol R., Dalloz actualité, 20 mars 2018, obs. Delpech X. ; D. 2018, p. 461 ; RTD com. 2018, p. 453, obs. Bouloc B. ; JT 2018, p. 45, obs. Lachieze X. ; D. 2018, p. 1214, obs. Kenfack H. ; JCP E 2018, 1281, note Dupont P. et Poissonnier G. ; JCP E 2018, 1240, note Siguoirt L. – Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-25926 : Énergie - Env. - Infrastr. 2018, comm. 63, note Ktorza R. ; Gaz. Pal. 26 févr. 2019, n° 342h1, p. 39, obs. Carayol R. ; LPA 11 déc. 2019, n° 149z1, p. 8, obs. Durand V.
-
23.
C. civ., art. 1353, art. 1315 anc.
-
24.
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23205 : Énergie - Env. - Infrastr. 2018, comm. 26, obs. Charles J.-B. ; Gaz. Pal. 4 sept. 2018, n° 329v5, p. 28, obs. Carayol R., Dalloz actualité, 20 mars 2018, obs. Delpech X. ; D. 2018, p. 461 ; RTD com. 2018, p. 453, obs. Bouloc B. ; JT 2018, p. 45, obs. Lachieze X. ; D. 2018, p. 1214, obs. Kenfack H. ; JCP E 2018, 1281, note Dupont P. et Poissonnier G. ; JCP E 2018, 1240, note Siguoirt L.
-
25.
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20491.
-
26.
Vol Paris–Pointe-à-Pitre réalisé le 17 novembre 2012.
-
27.
L’arrêt est rendu au visa de l’article 3, § 2, sous a) et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, auquel est associée la formule suivante : « attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le règlement s’applique à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement ».
-
28.
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20491, FS-PBRI.
-
29.
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20490.
-
30.
L’arrêt est en effet rendu au visa de l’article 3, § 2, sous a) et l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
-
31.
Dans ce cadre, il est rappelé que la jurisprudence européenne s’articule en quelque sorte autour d’un principe et d’une atténuation. La CJUE dit pour droit « que l’article 2, sous 1, du règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un vol dont les lieux de départ et d’arrivée ont été conformes à la programmation prévue, mais qui a donné lieu à une escale non programmée, ne peut être considéré comme annulé » (CJUE, ord., 5 oct. 2016, n° C-32/16, Ute Wunderlich c/ Bulgarian Air Charter Limited). L’atténuation concerne l’hypothèse dans laquelle l’escale provoque un retard à l’arrivée (destination finale) égal ou supérieur à 3 heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue. Dans ce cas, la situation ouvre droit à l’indemnisation prévue à l’article 5, § 1, sous c) et à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
-
32.
LEDA déc. 2019, n° 112g6, p. 2, obs. Douville T. ; JCP G 2019, 1273, note Heymann J. ; D. 2019, p. 2133, obs. Poissonnier G. ; Énergie - Env. - Infrastr. 2019, alerte 189.
-
33.
Cass. 1re civ., 12 sept. 2019, n° 18-20472 : D. 2019, p. 1758 ; Defrénois 19 sept. 2019, n° 152a6, p. 5.
-
34.
C’est lors du procès pénal que la paternité biologique de l’enfant fut démontrée de façon certaine, les cinq protagonistes ayant été condamnés pénalement pour provocation à l’abandon d’enfant né ou à naître.
-
35.
La Cour s’est fondée sur l’article 16-7 du Code civil selon lequel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle, cette disposition étant d’ordre public d’après l’article 16-9 dudit code.
-
36.
V. « Nouveaux éclaircissements à propos de effets en France des GPA réalisées à l’étranger (CEDH 21 juillet 2016, Foulon et Bouvet c/ France, n° 9063/14 et n° 10410/14, CE 3 août 2016, n° 401924) », LPA 16 nov. 2017, n° 131f6, p. 5, obs. Monteiro E.
-
37.
Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19053 : AJ fam. 2019, p. 592, obs. Houssier J., obs.Kessler G ; AJ fam. 2019, p. 481, point de vue Brunet L. ; AJ fam. 2019, p. 487, obs. Dionisi-Peyrusse A. ; D. 2019, p. 2228, note Fulchiron H. et Bidaud C. ; D. 2019, p. 2000, point de vue Guillaumé J. ; RTD civ. 2019, p. 817, obs. Margénaud J.-P. ; RTD civ. 2019, p. 841, obs. Leroyer A.-M. ;Gaz. Pal. 7 janv. 2020, n° 367h5, p. 86, obs. Rein-Lescastéreyres I. et Niboyet M.-L.
-
38.
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-11815 ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-12327(GPA) ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, nos 18-14751 et 18-50007 (PMA).
-
39.
V. Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 14-21323 ; Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 15-50002 : « Chronique Droit du Tourisme » :LPA 7 oct. 2016, n° 120x5, p. 11, obs. Monteiro E.
-
40.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-20052.
-
41.
Sur le fondement du nouvel article L. 452-1 du Code de l’organisation judiciaire qui prévoit désormais un mécanisme de révision à la suite d’une condamnation par la CEDH des décisions civiles devenues définitives, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2017.
-
42.
V. Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 10-19053 ;Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 12-30138 : D. 2019, p. 1819, note Fulchiron H. et Deumier P. Cette consultation pour avis visait à l’éclairer sur la possibilité de reconnaître l’existence du lien de filiation avec la mère d’intention en dehors de toute réalité biologique. Par ailleurs, la première chambre civile a estimé que la question de la transcription de la filiation à l’égard de la mère d’intention dans le cadre d’une GPA internationale au profit d’un couple hétérosexuel était liée à celle plus générale du parent d’intention dans le cadre des GPA ou des PMA réalisées à l’étranger au profit de couples homosexuels. Elle a donc prononcé dans plusieurs affaires pendantes devant elle des sursis à statuer le 20 mars 2019 dans l’attente de l’avis de la CEDH. Cf. Gaz. Pal. 2 juill. 2019, n° 355g3, p. 41, obs. Ni Ghairbhia N.
-
43.
CEDH, avis, gde ch., 10 avr. 2019, n° P16-2018-001, relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger et la mère d’intention.
-
44.
V. CA Rennes, 18 nov. 2019, nos 18/03965 et 18/04404 ; CA Rennes, 25 nov. 2019, nos 18/01155, 18/01497 et 18/01936 : AJ fam. 2020, p. 9 ; AJ fam. 2020, p. 71, obs. Dionisi-Peyrusse A ; AJ fam. 2020, p. 615.
-
45.
Viganotti E., « GPA et PMA internationale : le standard européen prime sur la notion de “réalité” ! » :Gaz. Pal. 11 févr. 2020, n° 368y0, p. 12.
-
46.
V. Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, nos 15-28597, 16-16901 et 16-50025 : D. 2017, p. 1737, note Fulchiron H. –Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-50021.
-
47.
CEDH, 12 déc. 2019, n° 1462/18, C. c/France ; CEDH, 12 déc. 2019, n° 17348/18, E. c/France : AJ fam. 2020, p. 131, obs. Berdeaux F. Dans les deux arrêts, les enfants étaient nés à la suite d’une convention de GPA au profit de couples hétérosexuels réalisée aux États-Unis ou au Ghana. Leur acte de naissance mentionnant que les enfants étaient nés des deux parents, les couples avaient sollicité leur transcription intégrale sur les registres de l’état civil français mais cette dernière avait été limitée au seul parent biologique. À l’unanimité, la CEDH a rejeté les requêtes en estimant qu’il n’y avait pas de violation des articles 8 et 14 de la CESDH dans la mesure où le droit français offre la possibilité de reconnaître le lien de filiation de la mère d’intention par le biais de l’adoption de l’enfant du conjoint. La cour reconnaît explicitement dans cet arrêt que le choix des moyens à mettre œuvre pour permettre la reconnaissance du lien entre l’enfant et les parents d’intention tombe dans la marge nationale d’appréciation des États.
-
48.
V. TGI Nantes, 1re ch., 23 mai 2019, n° 18/00222 : Gaz. Pal. 1er oct. 2019, n° 360f3, p. 72. Dans cette espèce, le tribunal a admis la transcription intégrale de l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA aux États-Unis dont le père était non français et dont la mère d’intention était également la mère génétique, en raison de l’absence d’autres modes de reconnaissance possibles.
-
49.
Institut Montaigne, Rapp. 2019, « Travailleurs des plates-formes : liberté oui, protection aussi », avr. 2019, p. 28.
-
50.
Not. l’hôtellerie (ex : Airbnb), le transport (ex : Uber) ou la restauration.
-
51.
En tant que marchés multi-faces, les plates-formes ont des effets de réseau cumulatifs : le consommateur aura tendance à utiliser une plate-forme où le délai d’attente est plus court en raison du nombre plus élevé des travailleurs connectés, de même, le travailleur aura intérêt à s’inscrire sur une plate-forme où la demande des consommateurs est plus élevée. Cet effet peut favoriser la montée d’entreprises dominantes qui continueront à conquérir plus de marchés.
-
52.
Supiot A., Critique du droit de travail, 3e éd., 2015, PUF, Quadrige, p. 48 : en 1804, la relation de travail fut positivement définie par le libre engagement contractuel des parties, et négativement par la prohibition de toute immixtion, de la part de la puissance publique ou de la profession (suppression des corporations et interdiction des corps intermédiaires par le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier de 1791).
-
53.
Verkindt P.-Y., Le droit du travail, 2005, Dalloz, Connaissance du droit, p. 9-14 : à partir des années 1880, les doctrines socialistes (notamment Duguit, Hauriou, Saleilles, etc.) se prennent à une âpre critique de l’individualisme juridique et proposent d’autres méthodes d’interprétation du droit afin de tenir compte de la réalité sociale (ex : adaptation des règles de responsabilité civile aux accidents industriels).
-
54.
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20079 : JCP S 2018, p. 1398, note Loiseau G. ; SSL 2018, n° 1841, p. 10, note Lokiec P. ; JCP G 2019, 46, note Roche V.
-
55.
Par exemple, Voxtur : CA Paris, pôle 6, ch. 2, 7 janv. 2016, n° 15/06489 ; Take Eat Easy : CA Paris, pôle 6, ch. 2, 20 avr. 2017, n° 17/03088 ; Deliveroo : CA Paris, pôle 6, ch. 2, 9 nov. 2017, n° 16/12875 ; Uber : Cons. prud’h. Paris, 29 janv. 2018, n° 16-11460
-
56.
Une première décision après l’arrêt Take Eat Easy a admis l’existence d’un contrat de travail entre un chauffeur et la plate-forme de transport Uber (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 10 janv. 2019, n° 18/08357).
-
57.
Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Société générale c/ URSSAF de Haute-Garonne : D. 1996, p. 268 ; Dr. soc., 1996, p. 1067, note Dupeyroux J.-J.
-
58.
Cass. ass. plén., 4 mars 1983, n° 81-11647 ; Cass. ass. plén., 4 mars 1983, n° 81-15290, Barrat ; Cass. soc., 19 déc. 2000, n° 98-40572, Labbane : Dr. soc. 2001, p. 227, note Jeammaud A.
-
59.
« S’agissant des personnes travaillant avec les plates-formes en ligne, lorsque l’application est dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du travailleur et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus d’une part, et que la société dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard du travailleur, il en résulte l’existence d’un (…) lien de subordination ».
-
60.
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20079, note explicative de la Cour de cassation.
-
61.
Parmi les messages produits : « Tu es bien en bas de chez le client ? », « Tu dois avoir un souci de GPS alors. Je te vois super loin de chez le client ».
-
62.
Plage horaire.
-
63.
Même si le système de Take Eat Easy paraît plus construit, car établi en avance par des documents non-contractuels (un guide et des réponses dans la foire aux questions) et prévoyant une échelle de strikes (des malus par type de faute) et des sanctions selon le nombre de strikes cumulés sur un mois.
-
64.
Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Société générale c/ URSSAF de Haute-Garonne : D. 1996, p. 268 ; Dr. soc., 1996, p. 1067, note Dupeyroux J.-J.
-
65.
La procédure pénale pour travail dissimulé en cours n’a pas empêché le conseil de prud’hommes de rejeter la demande de sursis à statuer, en application de l’article 4 du Code de procédure pénale.
-
66.
Cons. const., 20 déc. 2019, n° 2019-794 DC.
-
67.
En Espagne, ont été requalifiés en salariés par la cour d’appel madrilène 532 livreurs de Deliveroo (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, 17 janv. 2020), et un livreur de Glovo (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, 3 févr. 2020, n° 68/2020). En Italie, la Cour de cassation a confirmé l’application de la protection des travailleurs subordonnés (qui exercent une activité organisée par le client) à cinq coursiers de Foodora (Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, 24 janv. 2020, n° 1663/2020).
-
68.
Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13316.
-
69.
Institut Montaigne, Rapp. 2019, « Travailleurs des plates-formes : liberté oui, protection aussi », avr. 2019, p. 145 (qui est financé par des entreprises privées, dont certaines ont des liens avec l’économie collaborative, et présidé par l’ex-PDG du groupe Axa, qui a conclu des partenariats avec Uber et Deliveroo pour l’assurance des accidents de travail de leurs prestataires).
-
70.
L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : JO n° 184, 9 août 2016, art. 60 (mettant en place la notion de responsabilité sociale à l’égard des travailleurs des plates-formes de mise en relation par voie électronique) – L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019 d’orientation des mobilités : JO n° 299, 26 déc. 2019, art. 44.
-
71.
Joye J.-F., « L’unité touristique nouvelle après la loi Montagne 2 : mode d’emploi d’une espèce juridique endémique », Constr.-Urb. 2017, étude 7, p. 9-16.
-
72.
Joye J.-F., « Impact sur l’environnement des aménagements touristiques en montagne : l’impératif d’améliorer la procédure UTN après l’annulation partielle du décret du 10 mai 2017 », Constr.-Urb. 2019, étude 25, p. 9-13.
-
73.
C. urb., art. L 122-16.
-
74.
Mollion G., « La refonte des unités touristiques nouvelles », JCP N 2017, n° 29, act. 726.
-
75.
Mollion G., « La refonte des unités touristiques nouvelles », JCP N 2017, n° 29, act. 726.
-
76.
C. urb., art. R 122-4 et s.
-
77.
Joye J.-F., « L’unité touristique nouvelle après la loi Montagne 2 : mode d’emploi d’une espèce juridique endémique », Constr.-Urb. 2017, étude 7, p. 9-16.
-
78.
Joye J.-F., « L’unité touristique nouvelle après la loi Montagne 2 : mode d’emploi d’une espèce juridique endémique », Constr.-Urb. 2017, étude 7, p. 12.