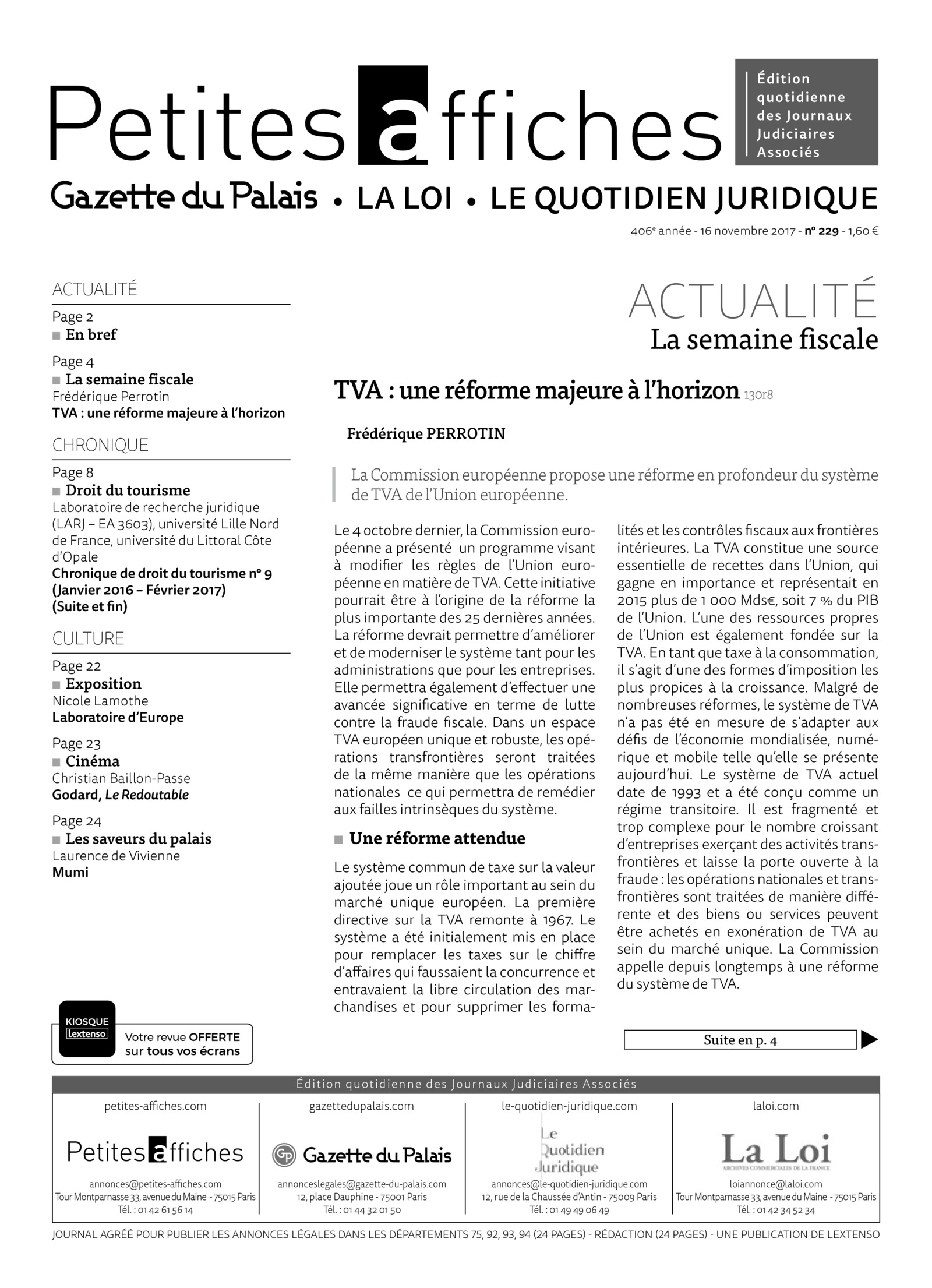Chronique de droit du tourisme n° 9 (Janvier 2016 – Février 2017) (Suite et fin)
51,9 % des Britanniques ont choisi de quitter l’Union européenne le 23 juin 2016 lors d’un référendum organisé par l’ancien Premier ministre David Cameron. Donald Trump, 70 ans, a remporté les primaires républicaines puis l’élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. Le monde change et le tourisme aussi.
Après les dramatiques attentats de 2015 et 2016 en France qui ont eu un impact négatif sur la fréquence touristique, un « fort » rebond au quatrième trimestre 2016 permet à la France de dépasser son niveau de l’automne 2014. Elle devrait ainsi garder sa place de première destination touristique mondiale en 2016. Un nouveau plan pour le tourisme de 42,7 millions d’euros a d’ailleurs été présenté lors du Comité interministériel du tourisme du 7 novembre 2016 qui devrait l’y aider. Cette chronique annuelle est de nouveau l’occasion d’analyser l’actualité juridique concernant ce secteur essentiel à l’économie française.
I – Les acteurs du tourisme
A – Acteurs publics (…)
B – Acteurs privés
1 – Organisations professionnelles (…)
2 – Réglementation des professions
II – Activités du tourisme
A – Exercice des activités touristiques
1 – Financement des activités (…)
2 – Liberté de circulation
3 – Intermédiaires de voyages
4 – Transports
5 – Hébergements touristiques
6 – Tourisme collaboratif
7 – Responsabilités et assurances
Pas de responsabilité pour violation de l’obligation contractuelle de sécurité de l’agence de voyages au profit des victimes par ricochet (Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, nos 15-17033 et 15-17516, PB, SA Axa France IARD et a. c/ Cts P.)
Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 septembre 20161 est l’occasion de préciser les conditions de l’indemnisation des victimes par ricochet.
En l’espèce, un médecin avait « acheté » un voyage en Équateur. Il décède d’un œdème pulmonaire au cours d’une excursion de haute altitude réalisée durant ce voyage. Sa veuve et ses filles exercent une action en indemnisation de leurs préjudices personnels contre l’organisateur du voyage et son assureur. Elles tentent pour cela de se prévaloir de l’article L. 211-16 du Code du tourisme. Ce texte rend en effet l’agence de voyages qui « vend » un forfait touristique « responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat », et ce, « que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services ». Et la jurisprudence en fait une lecture extrêmement protectrice des « acheteurs » de voyages à forfait : elle considère qu’il leur permet d’engager la responsabilité de l’agence de voyages toutes les fois que l’une des obligations liées à l’exécution du voyage vendu a été mal exécutée, et ce, que l’agence ait été chargée de leur exécution ou qu’elle ait eu recours à un autre prestataire, et que, dans ce dernier cas, la responsabilité de l’agence est engagée de plein droit y compris lorsque la responsabilité du prestataire sollicité n’aurait, quant à elle, pu être engagée à l’égard de « l’acheteur » que sur le fondement de la faute. C’est ainsi qu’une agence de voyages peut voir sa responsabilité engagée à l’égard d’un client qui se blesse en tombant dans les escaliers de l’hôtel où il séjourne sur le fondement de cette disposition2 alors même que l’obligation de sécurité de l’hôtelier n’est que de moyens3, de sorte que la responsabilité de l’hôtelier ne peut être recherchée que sur le fondement de la faute prouvée. De ce fait, si les ayants-cause de la victime directe avaient agi au nom et pour le compte de leur auteur, elles auraient pu obtenir réparation de son dommage sans avoir à établir d’autre preuve que celle que son décès est survenu au cours d’une excursion.
Mais, en l’espèce, elles agissaient en leur qualité de victimes par ricochet. Et la Cour de cassation s’appuie sur la lettre de l’article L. 211-16 du Code du tourisme pour refuser d’en faire application. Elle considère en effet que, puisque cet article instaure une responsabilité légale de plein droit, dont il précise expressément qu’elle joue « au seul profit de l’acheteur du voyage », les victimes par ricochet ne peuvent pas fonder leur action sur cette disposition : les ayants-droit de la victime directe ne peuvent agir contre l’agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, ce qui, selon elle, suppose la preuve d’une faute du voyagiste.
La solution étonne au premier abord : la jurisprudence décide aujourd’hui que les victimes par ricochet qui agissent en réparation du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait du décès d’un de leur proche doivent le faire sur le fondement extracontractuel4. Et le principe de l’effet relatif des contrats5 interdit de considérer que les tiers sont liés ou profitent des dispositions d’un contrat auquel elles sont étrangères. Mais la Cour de cassation admettait depuis un arrêt Myr’Ho du 6 octobre 2006, rendu en assemblée plénière, que toute inexécution contractuelle constituait nécessairement une faute extracontractuelle vis-à-vis des tiers6, ce qui permettait aux tiers qui subissaient un dommage du fait de cette inexécution de se contenter d’établir la preuve de l’inexécution pour en obtenir réparation. Et l’on aurait pu croire que cette jurisprudence, qui n’avait pas été remise en cause par l’ordonnance n° 2010-131 du 10 février 2016, aurait permis de dispenser les victimes par ricochet de la preuve d’une faute de l’agence de voyages.
Mais tel n’a pas été le cas : sans revenir sur cette jurisprudence – l’arrêt se fonde sur le seul article L. 211-16 du Code du tourisme – la Cour de cassation y a posé une limite : lorsque la victime directe a subi son préjudice du fait de la mauvaise exécution d’un contrat de voyages à forfait, les victimes par ricochet qui réclament réparation de leur propre préjudice ne pourront engager la responsabilité de l’agence de voyages que si elles parviennent à établir que cette agence a commis une faute à l’origine de leur dommage, étant entendu que tout portait à croire que cette faute pouvait consister en une inexécution du contrat la liant à la victime directe.
Simplement, les victimes par ricochet étaient placées dans une situation moins favorable que la victime directe : elles devaient prouver que le contrat de voyages à forfait avait été mal exécuté et que cette mauvaise exécution était due à un fait de l’agence de voyages, c’est-à-dire que l’agence avait commis une faute dans l’exécution des obligations qui lui incombaient7, par exemple qu’elle avait commis une imprudence dans le choix des personnes à qui elle avait confié l’exécution des différentes prestations comprises dans le forfait ou, comme cela aurait pu être le cas en l’espèce, qu’elle avait méconnu son devoir d’information et de conseil.
Il n’est toutefois pas certain que cette solution ait vocation à être maintenue : anticipant sur l’abandon attendu de la jurisprudence Myr’ho par une future réforme du droit de la responsabilité civile, la Cour de cassation vient, dans un arrêt qui aura les honneurs de la publication au Bulletin, de refuser d’admettre que la violation d’une obligation contractuelle de résultat puisse automatiquement constituer une faute délictuelle à l’égard des tiers8, ce qui semble signifier que, désormais, une telle faute ne pourra être invoquée par des tiers agissant sur le fondement délictuel contre son auteur que si cette faute constitue en même temps une faute d’imprudence au sens des nouveaux articles 1240 et 1241 du Code civil.
Quoi qu’il en soit, en l’espèce, c’est la violation de l’obligation d’information du voyageur qui aurait pu être retenue. En effet, c’est le deuxième intérêt de l’arrêt, les juges du fond avaient accueilli l’argument des ayants-cause de la victime directe qui se prévalaient d’un manquement, par l’agence de voyages, à l’obligation contractuelle « de conseil » qu’elle aurait eue envers son « acheteur », dès lors que cette violation n’était pas établie.
La Cour de cassation considère en effet que l’agence de voyages était tenue d’une obligation, qu’elle qualifie « d’information » vis-à-vis de son client : selon elle, « les compétences professionnelles ou personnelles du voyageur ne dispensent pas l’agence de voyages de son obligation d’information envers lui », de sorte que même médecin, la victime devait, comme tout autre voyageur, être prévenue par le voyagiste du danger que présentaient ce voyage et cette excursion en haute altitude.
Ainsi, l’« obligation d’information » de l’agence de voyages ne se limite pas à une obligation d’informer sur le contenu des prestations proposées, comme le suggère la lettre de l’article L. 211-8 du Code du tourisme. Elle porte sur tout ce que le voyageur a besoin de savoir pour que son voyage se passe bien, notamment sur ce qui permet d’assurer qu’il revienne sain et sauf. À ce titre, même si la Cour de cassation refuse d’employer ce terme, l’obligation de l’agence consiste ici davantage en une obligation de conseil, ou à tout le moins de mise en garde qu’en une obligation de transmettre des renseignements bruts.
Par ailleurs, alors que l’obligation d’information et de conseil, découverte progressivement par la jurisprudence à la charge de tout contractant ayant connaissance d’une information utile à son cocontractant, est généralement considérée comme ne profitant qu’à celui qui l’ignore légitimement9, la Cour de cassation décide que celle due par l’agence de voyages profite à chaque « acheteur » de la même manière, que ses compétences le rendent ou non susceptible de la connaître, ce qui revient à imposer cette obligation dans des hypothèses où elle apparaît pourtant inutile. Cela s’explique sans doute par l’objet de cette obligation, assurer la sécurité de l’« acheteur », en l’avertissant des dangers présentés par les prestations incluses dans le forfait « vendu » et les précautions à prendre pour se protéger.
Quoi qu’il en soit, en l’espèce, des informations avaient été transmises : l’agence avait remis aux voyageurs une documentation qui contenait une rubrique relative au mal des montagnes et donnait pour conseil de faire un bilan médical. L’agence ne pouvait voir sa responsabilité engagée, sauf à ce que les victimes par ricochet ne parviennent à établir que l’information ainsi diffusée était insuffisante.
On notera pour finir que les faits sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, et que le fondement de l’obligation mise en l’espèce à la charge de l’agence de voyages est ambigu : est-ce l’obligation spéciale d’information prévue par l’article L. 211-8 du Code du tourisme, dont la jurisprudence a une lecture extensive, mais auquel il n’est pas fait référence dans l’arrêt ; ou celle de droit commun progressivement dégagée par la jurisprudence avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, comme pourrait le suggérer la référence aux anciens articles 1147 et 1382 du Code civil ? Quelle que soit la réponse à cette question, on peut supposer que la solution serait la même si la décision était rendue à propos d’un contrat conclu après l’entrée en vigueur de l’ordonnance. En effet, même si c’est à l’obligation d’information de droit commun qu’il est fait référence, et si l’ordonnance n’a qu’imparfaitement consacré cette obligation à l’article 1112-1 du Code civil en tant qu’obligation précontractuelle ne profitant qu’à celui qui « légitimement, (…) ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », il ne s’est pas agi, pour ses auteurs, de réduire la portée de l’obligation telle qu’elle existait avant l’entrée en vigueur du texte, de sorte que les magistrats pourraient certainement s’appuyer sur le fait que le voyageur « fait confiance à son cocontractant » pour continuer à faire profiter le médecin d’une obligation d’information sur des éléments que, de par sa profession, il ne peut ignorer10.
Sophie MOREIL
L’obligation d’assurer l’ordre public dans les communes touristiques : le rappel d’une norme légale et… d’une évidence sociétale ! (CE, 4 nov. 2016, n° 386694, A. c/ Sté « L’auberge provençale » et Cne de La Garde)
Le touriste aime festoyer ! Après avoir travaillé toute l’année, la fourmi se fait cigale et entend profiter de vacances bien méritées, agrémentées de sorties nocturnes, dans des établissements proposant danses, repas et autres boissons souvent alcoolisées. Les communes ont évidemment conscience de ce besoin festif estival. Elles ont grand intérêt à favoriser toutes les offres touristiques locales pour rendre leur territoire le plus attractif possible. Retombées financières, commerciales et commerçantes voire électorales en dépendent… Mais il faut raison garder : une commune risquerait gros à organiser un spring break dont les complications contentieuses seraient contre productives ! Sans aller jusqu’à cet extrême festif made in USA, le maire de la commune de la Garde a autorisé un établissement, l’Auberge provençale de la Pauline, d’ouvrir ses portes, en période estivale (i.e. de début mai à fin septembre), jusqu’à 3 heures du matin. Des voisins, probablement gênés par l’exploitation tardive de cette auberge proposant notamment une piste de danse et des possibilités d’accueil de convives fort conséquentes (jusqu’à 250 !), ont tenté d’obtenir l’annulation de deux arrêtés municipaux autorisant cette ouverture dérogatoire pour les années 2011 et 2012. Le tribunal administratif de Toulon, saisi de cette affaire, rendit un jugement fort équilibré… mais qui ne satisfit personne ! Il prononça l’annulation d’un des deux arrêtés11. Appel fut interjeté ! La cour administrative d’appel de Marseille, en octobre 2014, fit pleinement droit à la commune et aux exploitants et rejeta la requête des époux A12. Probablement désireux de protéger leur tranquillité et conscients que cette préservation signifiait obstination, les époux formèrent un pourvoi en cassation et l’affaire échoua donc au Palais Royal ! La haute juridiction censura l’arrêt phocéen en rappelant l’obligation légale pesant sur le maire d’assurer le maintien de l’ordre public, fût-il à la tête d’une commune dite touristique. Cet arrêt intéresse donc le droit du tourisme de deux manières : par l’évocation des facilités administratives dont peuvent bénéficier les communes dites touristiques ou riveraines de la mer (I) mais qui ne les exonèrent pas de leurs obligations ordinaires en matière de maintien de l’ordre public (II).
I. De quelques particularismes touristiques fort opportuns
L’obtention de labels mais également certaines données factuelles, à l’instar de la situation géographique littorale de certaines collectivités par exemple, se traduisent par une présence touristique forte. L’arrêt commenté évoque ces atouts touristiques à travers le statut de commune touristique13, de station classée de tourisme14 ou de « commune riveraine de la mer »15. Ces statuts ont été, en l’espèce, utilisés par la préfecture du Var : elle les a intégrés dans un arrêté préfectoral du 8 avril 2010 pour autoriser les maires des communes concernées à octroyer, sous condition, à certains exploitants de débits de boisson, des dérogations à l’heure légale de fermeture, sans toutefois pouvoir dépasser une heure limite, 3 heures du matin. Ces choix préfectoraux sont ordinaires et sont déjà passés sous les fourches caudines de la juridiction administrative16, qu’ils concernent les débits de boissons ou les discothèques17.
Ce statut, provisoire18, des communes touristiques offre certains avantages normatifs19 : institution d’une taxe de séjour20 spécifique, modulation du versement destiné aux politiques de transports21, dérogations à l’interdiction de vente de boissons alcoolisées au bénéfice d’organisateurs de manifestations à caractère touristique22, possibilité de maintenir des offices de tourisme distincts dans le cadre pourtant dissolvant d’un EPCI23, participation possible au comité régional24 ou départemental25 du tourisme… des avantages certains, même s’ils sont parfois synonymes de contraintes supplémentaires comme l’obligation de conclure avec l’État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers26.
II. Une collectivité heureusement soumise à la loi commune de la prévalence de l’ordre public
Ce statut de commune touristique offre même la possibilité d’associer à la police municipale des agents communaux habituellement affectés à d’autres emplois27. Il est établi qu’une population plus importante crée mécaniquement plus d’interactions sociales, ce qui inclut plus de désagréments, de frictions… et donc de troubles à l’ordre public. Une commune touristique ne saurait évidemment négliger ces problématiques, ne serait-ce que pour préserver son attrait touristique ! Quel gâchis en termes d’image et de retombées touristiques futures si une commune venait à laisser se multiplier effluves nauséabondes, situations accidentogènes, rixes autour des lieux de consommation d’alcool ou gênes sonores ! C’est sur ce dernier point que la commune de La Garde fut prise en défaut par la haute juridiction.
Estimant que les faits établis par les requérants avaient été dénaturés par la cour de Marseille, le Palais Royal annule et statue, faisant application de l’article L. 821-2 du CJA. Il estime que l’arrêté du maire de La Garde autorisant l’ouverture de l’établissement L’auberge provençale jusqu’à 3 heures du matin est illégal car cette situation « créait à la date de l’arrêté (…) des nuisances sonores nocturnes qu’il appartenait au maire (…) de prévenir » par le biais de ses pouvoirs de police administrative générale issus de l’article L. 2212-2 du CGCT28. Le Conseil d’État délivre une analyse factuelle et juridique du plus grand classicisme. Il reconnaît la constitution des troubles à l’ordre public en remarquant l’existence d’une pétition et le dépôt de nombreuses plaintes ainsi que la rédaction d’un rapport d’expertise faisant état de relevés acoustiques aussi nocturnes qu’estivaux très significatifs en ce que les bruits émanant de l’établissement excédaient les maxima réglementaires. Que les futurs requérants s’en souviennent : sans preuve du trouble, pas de trouble !29 Idem est non esse et non probari enseigne l’adage romain30… Si, en matière de libertés fondamentales, le contrôle du juge est maximal depuis plusieurs décennies, l’arrêt commenté ne signifie pas nécessairement l’interdiction définitive de toute autorisation d’ouverture dérogatoire. En effet, le Conseil n’a fait que sanctionner l’octroi d’une autorisation créant un trouble. Rien ne l’empêche de reformuler un tel arrêté pourvu qu’il l’accompagne de conditions ou de mesures réduisant les troubles subis par les voisins de l’établissement, comme, par exemple, la mise en place de cloisons ou de palissades antibruit, l’interdiction de matériels sonores trop puissants31… Mais que l’édile prenne garde ! Si d’aventure le mécontentement perdurait, le juge appliquera un contrôle très exigeant et la responsabilité de la commune finirait assurément par être recherchée – et probablement engagée – devant des juridictions de premier et de second degré déjà échaudées par l’affaire. Ah, qu’il n’est pas simple de développer une politique touristique efficace et respectueuse des droits des riverains !
Olivier CARTON
III – Tourisme médical et tourisme procréatif
Nouveaux éclaircissements à propos des effets en France des GPA réalisées à l’étranger (CEDH, 21 juill. 2016, Foulon et Bouvet c/ France, nos 9063/14 et 10410/14 et CE, 3 août 2016, n° 401924)
Les dernières décisions rendues au sujet des effets en France des gestations pour autrui pratiquées à l’étranger permettent de constater que le phénomène du tourisme procréatif est devenu de plus en plus difficile à endiguer. En effet, même s’il est reconnu à la France le pouvoir de prendre sur son territoire des mesures d’interdiction de telles pratiques, les condamnations de l’État français par la Cour européenne des droits de l’Homme pour refus de transcription des actes de naissance des enfants nés d’une GPA hors frontières se succèdent et se ressemblent32.
Le Conseil d’État, quant à lui, avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette délicate question en concluant à la légalité de la circulaire de la ministre de la Justice qui prescrivait la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants ainsi conçus malgré les soupçons d’un recours à la GPA par les parents33. La haute juridiction administrative a rendu une nouvelle décision en référé qui ordonne au ministre des Affaires étrangères de délivrer un laissez-passer à un enfant né en Arménie quand bien même sa naissance résulterait d’une GPA34.
Le débat national parfois très virulent entre partisans et opposants à la GPA s’est prolongé sur le plan européen puisque l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est prononcée le 11 octobre 2016 contre l’adoption d’une recommandation portant sur les « droits de l’enfant liés à la maternité de substitution »35. Il est vrai qu’il existe de nombreuses divergences entre les législations des 47 États membres du Conseil de l’Europe, même si une majorité d’entre eux interdit le recours aux mères porteuses. Or, c’est dans ce contexte extrêmement houleux que le Portugal a réussi à adopter la loi n° 25/2016 du 22 août 201636 autorisant la GPA « altruiste », en tant que technique de procréation médicalement assistée, lorsque la mère d’intention est dans l’impossibilité absolue et définitive de mener une grossesse en raison de l’absence ou du dysfonctionnement de son utérus.
À défaut d’une évolution législative clairement favorable à la maternité de substitution, l’arrêt de la CEDH en date du 21 juillet 2016 Foulon et Bouvet c/ France ainsi que l’ordonnance du Conseil d’État du 3 août 2016 apportent de nouveaux éclaircissements sur les effets en France de ces pratiques, contribuant à la sécurisation juridique du statut des enfants dont il convient de préserver les droits.
I. CEDH, 21 juillet 2016, nos 9063/14 et 10410/14, Foulon et Bouvet c/ France
Même si la CEDH conclut de façon similaire à la violation du droit au respect de la vie privée des enfants concernés, telle qu’elle est protégée par l’article 8 de la CESDH, et non pas à la violation du droit au respect de la vie familiale des requérants, les faits n’étaient pas exactement les mêmes que dans les arrêts Mennesson et Labassée. Par ailleurs, l’arrêt Foulon et Bouvet répond implicitement à un autre point de droit, à savoir l’obstacle à l’exécution des condamnations prononcées par la CEDH que constitue l’autorité de la chose jugée.
Il s’agissait de deux pères français qui avaient chacun eu recours à des mères porteuses en Inde ayant donné naissance respectivement à une petite fille en 2009 et à des jumeaux en 2010. Par conséquent, contrairement aux affaires Mennesson et Labassée, aucune mère d’intention n’était mentionnée, ni même tout autre parent, puisque seuls les pères biologiques étaient requérants aux côtés de leurs enfants. Le 13 septembre 2013, les deux affaires avaient connu une issue identique devant la Cour de cassation37 fondée sur le motif de la fraude à la loi française. Le pourvoi formé par M. F. et sa fille contre l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Rennes annulant sa reconnaissance prénatale de paternité en France avait été ainsi rejeté. De même, alors qu’il était pourtant favorable à la transcription des actes de naissance des enfants de M. B. sans que sa reconnaissance de paternité ne soit remise en cause, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes avait été cassé.
Les deux pères et leurs enfants s’étaient ensuite adressés à la Cour de Strasbourg qui a décidé de joindre leurs requêtes. Constatant que la situation des intéressés est similaire à celle des requérants dans les affaires Mennesson et Labassée, la Cour rappelle la solution à laquelle elle était parvenue et affirme qu’il n’y a aucune raison de conclure autrement. Ainsi, le refus de transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance d’enfants nés d’une GPA à l’étranger constitue une violation de leur droit au respect de leur vie privée38.
Cependant, l’enjeu principal de l’arrêt Foulon et Bouvet est ailleurs. Il est lié à la question de l’autorité de la chose jugée qui figeait la situation des requérants en empêchant l’établissement de la filiation des enfants à leur égard39. En effet, le problème de la filiation des enfants nés d’une GPA à l’étranger ayant fait l’objet d’une décision définitive qui refuse la transcription de leur acte de naissance avait été laissé en suspens dans les affaires Mennesson et Labassée. Le gouvernement, qui demandait la radiation des affaires Foulon et Bouvet du rôle, invoquait les évolutions du droit français, notamment le revirement opéré par l’assemblée plénière le 3 juillet 201540. Il déclarait également réfléchir à l’adoption d’un mécanisme de révision en matière civile suite à une condamnation par la CEDH.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, a doté la France d’une telle procédure de révision41. Désormais, rien ne semble s’opposer à la possibilité pour les enfants nés d’une GPA à l’étranger de voir leur filiation établie à l’égard de leur géniteur, même si une décision antérieure frappée de l’autorité de la chose jugée a annulé la reconnaissance de paternité comme pour M. F.
II. CE, 3 août 2016, n° 401924
L’affaire concernait une ressortissante française qui avait eu recours à une GPA en Arménie. Elle s’était présentée à l’ambassade de France avec un acte d’état civil arménien établi le 28 juin 2016 sur lequel elle figurait comme mère de l’enfant, demandant son enregistrement ainsi qu’un laissez-passer consulaire afin de pouvoir rentrer en France avec le nourrisson. Le procureur de la République de Nantes lui ayant refusé l’enregistrement de l’acte sur le fondement de l’article 47 du Code civil et l’ambassade de France ne lui ayant pas délivré le document de voyage, la requérante avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Le Conseil d’État42 confirme l’ordonnance du juge des référés du 26 juillet 2016 qui avait enjoint le ministre des Affaires étrangères de délivrer le document de voyage. S’appuyant sur l’intérêt supérieur de l’enfant et les circonstances de l’espèce, il estime dans sa décision qu’il convenait « de ne pas séparer l’enfant de la requérante ». En effet, la mère d’intention n’avait aucun proche à ses côtés pour assumer la charge de l’enfant après son départ d’Arménie.
La décision est humainement compréhensible. Toutefois, on peut se questionner sur la position qu’aurait adoptée le juge administratif s’il avait dû connaître de l’affaire une fois que l’arrêt de grande chambre Paradisio et Campanelli c/ Italie fut rendu43. De façon assez inattendue et controversée, la grande chambre a invalidé l’arrêt de chambre ayant considéré que le retrait à ses parents d’intention d’un enfant né de GPA en Russie violait l’article 8 de la CESDH. Il ressort de cette décision que lorsqu’il n’y a pas de lien biologique entre l’enfant et ses parents d’intention, l’intérêt de l’enfant ne prime pas systématiquement. Dans la pesée des intérêts en présence, le principe de subsidiarité ne doit pas non plus être perdu de vue car les États membres ont parfaitement le droit ne pas reconnaître d’effet à la GPA.
La portée de ces dernières évolutions jurisprudentielles et législatives est notable car la situation du parent d’intention demeurait bien incertaine en droit français. Ainsi, après avoir été opposée à la transcription intégrale, la cour d’appel de Rennes a finalement ordonné dans un arrêt en date du 12 décembre 201644 la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance ukrainien établissant la filiation à l’égard des parents d’intention. En revanche, la cour d’appel de Dijon45 a refusé de prononcer l’adoption simple par l’époux du père d’un enfant né aux États-Unis dans le cadre d’une GPA. Ce dernier avait pourtant sa filiation établie à l’égard de son père biologique et de la mère porteuse et son acte de naissance n’était pas contesté.
Mais le « mariage pour tous » doit-il forcément conduire à « l’adoption pour tous » ? Faute de clarification par le législateur, face aux propositions visant à abroger la loi du 17 mai 2013, face aux velléités des partisans du mouvement « No maternity traffic » désireux d’éradiquer le tourisme procréatif à travers le monde, la piste à suivre par les juges est désormais mieux tracée en ce qui concerne le parent d’intention depuis les arrêts rendus le 5 juillet 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation. À suivre.
Evelyne MONTEIRO
A – Aménagement des espaces à vocation touristique
1 – Tourisme durable
La maîtrise des flux touristiques et la légalité du décret approuvant la charte du parc national de La Réunion (CE, 27 juill. 2016, n° 378327, B)
La consécration, par décret, d’un nouveau parc national ne doit pas seulement satisfaire les amoureux de la nature soucieux de biodiversité. Elle doit également réjouir les élus locaux qui verront arriver, sur site, ces mêmes amoureux drapés dans leurs habits de touristes. Tourisme ordinaire, vert ou scientifique, national ou international… un parc national mêle, en théorie, des intérêts écologiques et touristiques. Pour gérer cet outil idéal, il convient néanmoins de le doter d’une gouvernance efficace et équilibrée46. Les dix parcs nationaux français sont ainsi dotés d’une charte, elle aussi consacrée par un décret. Le parc national de La Réunion fut juridiquement doté d’une telle charte par un décret du 21 janvier 2014… contre lequel M. B. forma un recours devant le Conseil d’État. Le Palais Royal rendit son arrêt en juillet 2016 – parfois le temps de la réflexion juridictionnelle s’écoule plus lentement – par lequel il débouta le requérant. En quoi cet arrêt relatif aux parcs nationaux intéresse-t-il le droit du tourisme ? De deux manières, une très générale (I) et une beaucoup plus spécifique, relative à la gestion des flux touristiques comme éléments de la complétude et donc de la légalité de ladite charte (II).
I. Un effet juridique fort sur les collectivités territoriales et les particuliers situés dans le territoire du parc national
La charte d’un parc national définit, pour 15 ans, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de son territoire. Deux zones principales sont d’ailleurs à distinguer : le « cœur » et l’« aire d’adhésion » du parc. La charte apparaît comme définissant un « projet de territoire »47 évidemment et essentiellement axé sur la préservation écologique des sites et se développant en une myriade de conventions intéressant les communes associées et des acteurs privés. Le parc est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministère de l’Environnement et dirigé par un conseil d’administration. Certains de ses objectifs sont d’essence touristique comme concourir à la politique d’éducation du public, à la connaissance et au respect de l’environnement48 ou, de manière plus directe, conduire des activités « de surveillance et de police, d’assistance (…) aux usagers de l’espace »49. Ces parcs n’ont pas qu’une vocation environnementale ; ils ont bien une vocation touristique en sus de leur dimension urbanistique50 ou économique51. Dans le cadre d’une QPC récemment posée, le Conseil d’État a rappelé l’« intérêt spécial » que la loi porte à ces parcs, tout en reconnaissant que ce statut de parc affectait le principe de libre administration des collectivités territoriales concernées mais de manière non disproportionnée52. La haute juridiction a déjà eu à connaître ce contentieux singulier53. Qu’apporte aujourd’hui cette décision de juillet 2016 ?
II. Une charte devant intégrer « la connaissance et la maîtrise des flux touristiques »…
Les données touristiques publiques relatives au parc national de La Réunion sont très significatives de la qualité exceptionnelle de ces lieux et de la pression qu’exercent (in)consciemment les amoureux de la nature sur, par exemple, les sites de Cilaos ou de Mafate : 800 km d’itinéraires pédestres, un million de visiteurs annuels, espèces endémiques ou flore invasive, une centaine d’événements sportifs annuels liés au parc… L’article 15 de la charte du parc de La Réunion dispose que « les activités artisanales et commerciales existantes à la date de la création du parc et régulièrement exercées sont autorisées ». Ont ensuite été listées lesdites activités d’essence touristique : hébergement, restauration, « prestations de services touristiques » comme le guidage, les activités de loisirs de nature ; la commercialisation de produits artisanaux ou issus des filières agropastorales locales54… Un des arguments contentieux soulevés par les requérants était l’incomplétude de ladite charte, en l’occurrence une insuffisance qualitative des développements relatifs à la description matérielle du parc, à son économie ou à ses enjeux. Le Palais Royal, soucieux de ces éléments comme le démontre sa jurisprudence55, rejette l’ensemble de ses arguties en portant une attention particulière au volet touristique de la charte. Il se montre en effet très clair : « la charte comprend des développements suffisants concernant la fréquentation du cœur du parc et, notamment, la connaissance et la maîtrise des flux touristiques »56. La charte comprend effectivement des développements substantiels décrivant les sites et pratiques touristiques « incontournables » de l’île et du parc, la recherche d’un développement touristique réunionnais ainsi que la mise en œuvre de politiques publiques adéquates ou la nécessité d’en instituer de nouvelles57. L’analyse du Conseil d’État est à la fois textuelle58 et très pragmatique, collant au plus près des « caractéristiques du site en cause », même s’il n’usa pas, en l’espèce, de cette formule très opportune tirée d’un arrêt plus ancien59.
Olivier CARTON
2 – Tourisme et patrimoine
Le tourisme culturel : les apports de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (L. 2016-925, 7 juill. 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine)
La notion de tourisme culturel60 est apparue dans le discours à travers la « charte du tourisme culturel » adoptée en novembre 197661 par l’Icomos62. Selon le texte, le tourisme culturel est celui qui a pour objet, entre autres objectifs, la découverte des sites et monuments. Le Conseil de l’Europe, de son côté, a retenu une définition plus précise en ajoutant que le tourisme culturel « mise sur la mosaïque des lieux, des traditions, des manifestations artistiques, des célébrations et des expériences qui représentent une région et ses habitants »63. C’est ainsi une conception élargie du patrimoine qui est mise en avant.
L’offre culturelle constitue aujourd’hui un des principaux moteurs du tourisme. Conscients de son potentiel économique, les pouvoirs publics ont initié à partir des années soixante-dix une revalorisation de l’ensemble patrimonial français par d’importantes campagnes de restauration qui ont touché, notamment, les monuments, les musées, les lieux de spectacle et les ensembles urbains64. Toutefois, la relation entre tourisme et patrimoine est ambivalente. Si la promotion du second constitue un moteur du premier, inversement, le premier est parfois perçu comme une menace pour le second65. L’Icomos s’était d’ailleurs interrogée sur la question de savoir « comment faire en sorte que le tourisme ne constitue pas un danger pour le patrimoine »66. Le tourisme culturel implique donc à la fois une démarche de valorisation et de protection du patrimoine.
La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine comporte plusieurs dispositions qui permettent de répondre à cet enjeu67. Le texte prévoit, d’une part, un encadrement juridique des éléments patrimoniaux permettant leur promotion et, d’autre part, une série de mesures protectrices du patrimoine culturel
I. La promotion du patrimoine
Les protections, labels et appellations sont autant d’éléments qui offrent une meilleure visibilité du patrimoine. Ils constituent un élément important de promotion touristique. Dans ce cadre, Fleur Pellerin a initié une consécration juridique de plusieurs éléments ou dispositifs patrimoniaux dans le but de valoriser le patrimoine urbain et rural68. La loi consacre ainsi la politique de labellisation du patrimoine architectural récent69 initiée par le Conseil de l’Europe70. À ce dernier titre, l’article L. 650-1-I du Code du patrimoine prévoit que les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de 100 ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique peuvent recevoir un label par décision motivée de l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
À cette consécration du patrimoine protégé par le droit de l’Union européenne, s’ajoute une consécration des éléments patrimoniaux inscrits au « patrimoine mondial de l’Unesco »71. Ce label, créé pour les sites considérés comme ayant une valeur universelle exceptionnelle, représente le meilleur aiguillon du développement de la fréquentation touristique72. Réglementé par la Convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, il apparaît désormais directement dans le Code du patrimoine73.
Le texte consacre enfin une servitude d’utilité publique unique, le « site patrimonial remarquable »74, qui fusionne les secteurs sauvegardés, Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Sont classés à ce titre les villes, villages ou quartiers « dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ». Au même titre, peuvent être classés les espaces ruraux et les paysages « qui forment avec ces villes, villages ou quartiers, un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur ». La loi prévoit également qu’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable.
Ces différentes mesures de valorisation participent sans conteste au mouvement de structuration et de promotion de l’offre touristique autour du patrimoine. Ce dernier, cependant, afin de garder son caractère attractif doit être protégé de la main de l’homme.
II. La protection du patrimoine
Les dispositifs les plus importants concernent en premier lieu les monuments historiques. Pour rappel, les monuments historiques sont protégés par le biais de la servitude d’utilité publique des abords75. À l’intérieur du périmètre de cette servitude, les travaux se trouvent soumis à autorisation préalable de la part de l’architecte des bâtiments de France (ABF)76.
La loi a modifié le périmètre de délimitation de la servitude d’utilité publique des abords. L’article 75 de la loi du 7 juillet 2016 prévoit que « les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords ». Sont visés par cette protection les immeubles, bâtis ou non bâtis, situés dans un périmètre désormais délimité par l’autorité administrative77. Ce nouveau périmètre remplace le périmètre automatique de 500 mètres. Toutefois, l’ancien régime trouve encore à s’appliquer par exception. En effet, l’article L. 621-30 du Code du patrimoine prévoit toujours « qu’en l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ».
Le texte consacre, en second lieu, un régime spécifique au profit des domaines nationaux visant à protéger ces derniers contre les risques de démembrement. Elle prévoit ainsi l’inaliénabilité des domaines nationaux, tels que la liste en sera fixée par décret en Conseil d’État, après avis du ministre chargé du Domaine et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, et tels qu’ils seront délimités dans les mêmes conditions.
Il convient enfin de noter que la loi prévoit également des mesures de protection du patrimoine archéologique78 ainsi que du patrimoine culturel immatériel79, facteurs certains d’attractivité touristique.
Ces différentes dispositions profiteront sans aucun doute au « tourisme culturel ». À cet égard, il aurait été souhaitable que le texte se préoccupe davantage de la préservation du « petit patrimoine », encore appelé « patrimoine rural non protégé »80. Espérons que les suites données au rapport rédigé par Martin Malvy sur la promotion de l’offre touristique dans le domaine du patrimoine81 et préconisant la promotion du patrimoine éloigné dans les circuits touristiques actuels permettront de pallier ce manque.
Camille CARBONNAUX
Du nécessaire soin juridique à apporter aux conventions confiant la gestion d’un site touristique à un exploitant (CE, 9 déc. 2016, n° 396352, Cne de Fontvieille)
La valorisation du patrimoine notamment touristique des collectivités territoriales est devenue plus qu’une marotte doctrinale : elle est, en ces temps de contrainte budgétaire paroxystique, un enjeu public local majeur. En effet, la France restant encore aujourd’hui la première destination touristique du monde, les communes françaises ont grand intérêt à mobiliser leurs moyens matériels, humains ou financiers pour choyer les touristes s’aventurant sur leur territoire. Cette mobilisation peut également être juridique et, en l’occurrence, contractuelle : à défaut de régie, confier, par convention, la gestion d’un site touristique à un acteur privé, personne physique ou morale, en échange d’une compensation financière. Motivé par une activité touristique dont dépend sa rémunération, ce cocontractant offre des services que les communes ne peuvent (ou ne veulent) assurer, ces dernières voyant rentrer dans leurs finances publiques une rente pécuniaire fort appréciable. Candide n’y aurait rien trouvé à redire ! Las ! Les rapports idylliques se transforment parfois en matière contentieuse à l’occasion de la survenue de difficultés financières affectant ledit cocontractant. C’est ce qui a amené la commune de Fontvieille devant le Conseil d’État.
La gloire nationale de cette commune provençale se nommait Alphonse Daudet. La gestion d’un musée et du moulin ayant inspiré l’auteur, propriétés privées, a été confiée, par une lointaine convention, à la commune. Celle-ci, également par contrat, en confia l’exploitation à une personne privée. Durant les années 2000, les conventions se multiplièrent : l’animation culturelle des lieux lui était attribuée ; les lieux pouvaient être utilisés à des fins commerciales – vente de souvenirs – en contrepartie du versement d’un loyer modique. La dernière convention, conclue le 1er février 2010, est la plus contraignante pour cet exploitant : l’exploitation des sites touristiques communaux est élargie au château de Montauban mais le cocontractant doit désormais verser une « redevance » (sic) mensuelle de 7 500 €. Faute de voir honorer ces engagements, la commune émet six titres exécutoires que la requérante attaque, dont elle n’obtient pas l’annulation devant le tribunal administratif marseillais82 mais qu’elle parviendra à faire annuler devant la cour administrative phocéenne en février 201583, obtenant même de cette juridiction la condamnation de la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. La commune fontvieilloise forme alors un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Il faudra attendre le 9 décembre 2016 pour que la haute juridiction casse l’arrêt marseillais et renvoie à cette même cour l’affaire. Quelles leçons de droit du tourisme peut-on retirer de ces décisions ?
Cet arrêt intéresse tout d’abord le droit administratif des contrats. La haute assemblée sanctionne la cour marseillaise pour avoir estimé que le cocontractant participait à l’exécution d’un service public culturel communal et qu’ainsi le contrat pouvait être qualifié de délégation de service public alors que la commune de Fontvieille avait fait preuve d’une remarquable « absence d’implication dans l’exploitation touristique des sites en cause ». Le Palais Royal exige en effet, pour pouvoir qualifier, au sens de l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, une telle convention de délégation de service public, que soient réunis différents indices de l’indispensable attention que doit porter la puissance publique à la gestion d’une activité fondamentale car d’intérêt général. Or, sans utiliser le mot de carence, le Conseil, selon « les pièces du dossier », énumère – et finalement donne autant de pistes de réflexion – les comportements administratifs susceptibles de caractériser une telle délégation : un contrôle global sur les prix d’entrée ou de vente des brimborions touristiques habituels, les horaires d’ouverture du site, une volonté de promouvoir une politique culturelle dynamique sur site et/ou à destination de « publics particuliers »84 85. Le Conseil d’État se montre ici sensible, comme dans de nombreux pans de ses jurisprudences, à l’intention de l’Administration. Et, en matière touristique, un service public culturel ne se présume pas et ne se déduit pas non plus d’un simple contrat, fût-il parsemé d’affirmations juridiques approximatives, ce que marque l’usage plutôt rare dans la jurisprudence administrative de guillemets enserrant redevance86 !
L’arrêt souligne par ailleurs l’importance de l’écrit contractuel dans la résolution du litige. La convention prévoit quelques interdits commerciaux comme l’interdiction de vente d’aliments ou de biens de « nature dévalorisante ou anachronique pour l’image et la qualité des lieux ». Si la vente d’aliments se conçoit aisément, qu’entendre par nature dévalorisante ? Des exemples peuvent naître de la plume de l’observateur mais point de liste exhaustive ! Le juge adoptera une analyse casuelle. Ces précisions textuelles, même si elles n’interfèrent pas avec l’illégalité constatée en l’espèce, doivent toutefois attirer l’attention de l’administrateur soucieux de prévenir tout contentieux : plus il prendra de soin à rédiger de telles conventions (et il ne faut pas oublier la liberté contractuelle dont jouit la puissance publique, ainsi que sa position forte dans la formulation du contenu conventionnel), plus une éventuelle démarche contentieuse aura de chances de succès. La redevance de 7 500 € semble être l’élément déclencheur du différend. Il convient, dans l’intérêt communal, de fixer, par écrit et au plus haut possible, un tel montant, notamment au regard d’éléments objectifs : fréquentation touristique ou chiffre d’affaires de la société cocontractante. Il ne s’agit certes pas de saigner à blanc un partenaire dont la vitalité économique conditionne le versement de cette redevance mais il ne faut pas renoncer, par inertie ou par négligence, à des sommes importantes en les laissant choir dans une escarcelle exclusivement privée. La commune de Fontvieille aurait-elle été trop gourmande ? L’avenir le révélera. Si son actuel partenaire ne peut supporter une telle ponction, il faudra trouver d’autres conditions contractuelles et financières… voire un autre partenaire ?
Enfin, l’usage de l’article L. 761-1 du CJA pose question. Alors que la cour avait condamné la commune à 2 000 € à ce titre, le Conseil d’État inverse la condamnation et alourdit le bât de Mme B. d’un versement de 1 500 €. La haute juridiction a-t-elle voulu sanctionner la mauvaise foi de l’intéressée ? Y a-t-il eu, de sa part, une intention dilatoire ? Sans autre précision jurisprudentielle, la pilule semble doublement amère : n’est-il pas légitime de recourir au juge afin de se défaire de décisions financières potentiellement illégales ? De surcroît, ce n’est pas Mme B. qui avait saisi la cour suprême. Le décret Jade, récemment rentré en vigueur, permet désormais de sanctionner plus lourdement les recours abusifs. Le Conseil devrait se montrer plus pédagogue vis-à-vis de sa politique jurisprudentielle des frais non compris dans les dépens.
Olivier CARTON
Le tourisme dans l’acte II de la loi Montagne (L. 2016-1888, 28 déc. 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne)
Les députés ont adopté le 28 décembre 2016 la loi n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Suite logique du rapport rédigé par les députées Bernadette Laclais et Annie Genevard87, elle a pour objectif premier de renforcer l’attractivité et le dynamisme des territoires de montagne. Dans cette optique, le tourisme est un thème majeur du texte88. Ce dernier prévoit en effet de nombreuses mesures tendant, d’une part, à soutenir le développement touristique et, d’autre part, à réhabiliter l’immobilier de loisir.
I. Le soutien au développement touristique
Le titre II intitulé : « Soutenir l’emploi et le dynamisme économique » consacre deux chapitres au tourisme : le premier est relatif au développement des activités touristiques tandis que le second porte sur l’organisation de la promotion des activités touristiques.
A. Le développement des activités touristiques
La première mesure prise au soutien du développement des activités touristiques vise à renforcer les garanties offertes aux voyageurs. L’article 64 de la loi habilite en effet le gouvernement à prendre par ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2017, toute mesure visant à transposer la directive (UE) n° 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, dite directive Travel89. Cette transposition aura pour mérite de moderniser le régime applicable aux activités d’organisation et de vente de voyages en offrant aux voyageurs une meilleure lisibilité de leurs droits. La confiance ainsi retrouvée permettra sans aucun doute de favoriser le développement touristique des stations de ski.
Autre mesure essentielle, l’article 68 de la loi étend à tout le domaine skiable le champ d’application des servitudes de passage sur les propriétés privées en dehors des périodes d’enneigement. L’article 342-20 du Code du tourisme prévoit désormais qu’« après avis consultatif de la chambre d’agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ». Le but est de développer un tourisme multi-saisonnier, dit encore tourisme quatre saisons, par la promotion des activités autres que le ski (randonnée pédestre, VTT, trail, parapente etc.). Les activités économiques liées à l’enneigement ne sont donc plus appréhendées comme l’unique source d’exploitation touristique des territoires de montagne.
B. La promotion des activités touristiques
Pour rappel, l’article 68 de la loi NOTRe90 prévoyait le transfert obligatoire des communes vers les intercommunalités de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme »91. Par dérogation, la loi Montagne permet aux communes touristiques érigées en stations classées de tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme de conserver leurs offices de tourisme92. La maîtrise de la promotion du tourisme constituant un atout majeur pour les stations dont les marques jouissent d’une certaine notoriété, il a été jugé fondamental de leur octroyer cette possibilité afin de ne pas les « noyer » dans de vastes intercommunalités93.
II. Les soutiens à l’immobilier de loisir
L’immobilier de loisir occupe une place centrale au sein de l’acte II de la loi Montagne. Le titre III du texte lui est en effet entièrement consacré94. Ce dernier prévoit à la fois la rénovation de la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) et la réhabilitation de l’immobilier de loisir.
A. La rénovation de la procédure des unités touristiques nouvelles
Première innovation, la loi procède à un élargissement de la notion d’UTN. Sous l’empire de la loi Montagne de 1985, l’UTN était définie comme « toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :
1° Soit de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État »95.
L’article 71-5° de la loi évoque désormais « toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard »96. La définition abandonne donc les différentes catégories présentes dans l’ancien article L. 122-16 du Code de l’urbanisme. La notion repose désormais sur deux critères : le développement touristique et la contribution du projet à la performance socio-économique.
Deuxième innovation, la loi introduit une nouvelle procédure de création d’UTN97. Le texte opère désormais une distinction entre deux catégories d’UTN : les UTN dites « structurantes » et les UTN dites « locales ». S’agissant des premières, sont considérées comme telles celles dont la liste est définie par décret d’une part, mais également celles identifiées par le document d’orientation et d’objectifs du SCoT98. S’agissant ensuite des secondes, seront identifiées comme telles celles dont la liste est définie par décret d’une part, mais également celles identifiées par le PLU99.
Cette nouvelle procédure présente une caractéristique majeure. En plus de permettre la réalisation de l’UTN à l’échelon local pertinent, elle en adoucit les conditions de création. Il s’agit sans contexte d’un encouragement au développement des équipements touristiques, lesquels constituent un fort enjeu économique100.
B. La réhabilitation de l’immobilier de loisir
Le renouvellement de l’immobilier de loisir représente un enjeu majeur du développement touristique des stations de ski. En effet, les immeubles construits dans les années 1960-1970 ne correspondent plus à la demande actuelle. Vieillissants, ils sont boudés par les touristes. Ce désamour se traduit par une multiplication de « lits froids » ou « volets clos » dont l’impact est très négatif pour l’économie des stations101.
Pour contrer ce déficit de fréquentation, le législateur a créé en 2000 un nouveau dispositif visant à favoriser la réhabilitation de l’immobilier de loisir. Il s’agit de l’Oril (opération de réhabilitation de l’immobilier de de loisirs) issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU)102. La procédure permet aux collectivités d’octroyer des aides financières au professionnel ou propriétaire effectuant des travaux de rénovation. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la loi, peu de logements ont été réhabilités. De ce fait, un groupe de travail interministériel a été mis en place en 2015 dans le but de trouver des solutions opérationnelles. Dans cette optique, l’acte II de la loi Montagne prévoit plusieurs mécanismes.
En premier lieu, le texte élargit les bénéficiaires des aides. L’article L. 318-5 du Code de l’urbanisme prévoit désormais que pourront profiter également du dispositif « les personnes physiques ou morales qui s’engagent à acquérir des lots de copropriété et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location des logements définies par la délibération [de la collectivité créant l’Oril] ».
En second lieu, le texte laisse une plus grande liberté aux communes et groupements de communes pour déterminer les obligations contractuelles à la charge des propriétaires. Ces derniers, souvent frileux en raison des contraintes imposées, seront ainsi susceptibles de bénéficier de conditions plus souples. À cet égard, la loi a diminué la durée minimale de location qui est passée de 9 ans à 5 ans. Aussi, les organismes locaux de tourisme agréés ne seront plus nécessairement un passage obligé pour les propriétaires désireux de louer leur bien.
Enfin, l’article 81 de la loi prévoit que les copropriétaires devront être informés par le syndicat de toute vente d’appartement. Il s’agit d’une mesure visant à faciliter l’achat de lots contigus afin de développer la taille des logements loués.
Camille CARBONNAUX
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, nos 15-17033 et 15-17516 : D. 2017, p. 341, note Lachièze C. ; D. 2017, p. 24, obs. Quézel-Ambrunaz C. ; AJ Contrat 2017, 41, obs. Dagorne-Labbe Y. ; RDC 2017, n° 113z5, p. 39, note Deshaye O. ; Gaz. Pal. 10 janv. 2017, n° 283c6, p. 26, obs. Gerry-Vernières S. ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 342, note Bloch L. ; Contrats, conc. consom. 2016, comm. 247, note Leveneur L. ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 342
-
2.
Cass. 1re civ., 16 févr. 1999, n° 96-21883 ; Cass. 1re civ., 2 nov. 2005, n° 03-14862 : Bull. civ. I, n° 401 ; ; Gaz. Pal. 4 avr. 2006, n° G0663, p. 31 ; D. 2006, p. 1016, note Maréchal J.-Y. ; RTD civ. 2006, p. 329, obs. Jourdain P. ; JCP G 2006, II 10018, note Poumarède M.
-
3.
Cass. 1re civ., 22 mai 1991, n° 89-21791 : Bull. civ. I, n° 163.
-
4.
Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 01-15391. V. aussi, Cass. 1re civ., 10 avr. 2008, n° 07-13520.
-
5.
C. civ., art. 1165 anc., devenu le nouveau C. civ., art. 1199.
-
6.
Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255, Myr’ho : Bull. ass. plén., n° 9 ; Resp. civ. et assur. 2006, étude 17, Bloch L. ; D. 2006, p. 2825, obs. Gallmeister I., note Viney G. ; D. 2007, p. 1827, obs. Rozès L. ; D. 2007, p. 2897, obs. Brun P. et Jourdain P. ; D. 2007, p. 2966, obs. Amrani-Mekki S. et Fauvarque-Cosson B. ; AJDI 2007, p. 295, obs. Damas N. ; RDI 2006, p. 504, obs. Malinvaud P. ; RTD civ. 2007, p. 61, obs. Deumier P. ; RTD civ. 2007, p. 115, obs. Mestre J. et Fages B. ; RTD civ. 2007, p. 123, obs. Jourdain P.
-
7.
V. Leveneur L., note ss Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, in Contrats, conc. consom. 2016, comm. 247, selon lequel il faut qu’elles établissent non seulement une mauvaise exécution du contrat conclu par l’agence de voyages, mais également que cette mauvaise exécution est de son fait.
-
8.
Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11203. V. déjà, mais isolés, Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-17691 ; Cass. com., 18 janv. 2017, nos 14-16442 et 14-18832.
-
9.
V. not. Fabre-Magnan M., Droit des obligations, 1 – Contrat et engagement unilatéral, 4e éd., 2016, Puf, Thémis droit, nos 235 et s. s’agissant de l’obligation précontractuelle d’information, et n° 492 pour l’obligation de nature contractuelle.
-
10.
V. Deshaye O., note ss. Cass. civ. 28 sept. 2016, in RDC 2017, n° 113z5, p. 39.
-
11.
TA Toulon, 29 nov. 2012, nos 1101683 et 1201463.
-
12.
Arrêt du 24 oct. 2014, n° 12MA04945.
-
13.
C. tourisme, art. L. 133-11 et s. et C. tourisme, art. R. 133-32 à 36.
-
14.
Ibid., C. tourisme, art. L. 133-13 et s. et C. tourisme, art. R. 133-37 à 41.
-
15.
§ 3 de l’arrêt du Conseil d’État.
-
16.
CAA Bordeaux, 19 mars 2013, n° 11BX00684, SARL Le Boléro c/ préfet de l’Ariège.
-
17.
CAA Marseille, 1er déc. 2011, n° 10MA00787, SARL Rodip Discothèque.
-
18.
C. tourisme, art. R. 133-35 : 5 ans de dénomination sur le fondement d’un arrêté préfectoral.
-
19.
Pour une approche doctrinale, v. Breton J.-M., Droit et politique du tourisme, 2016, Dalloz, p. 394 s.
-
20.
CGCT, art. L2333-26.
-
21.
CGCT, art. L2333-64.
-
22.
CSP, art. L. 3335-4.
-
23.
C. tourisme, art. L. 134-2.
-
24.
C. tourisme, art. L. 131-4.
-
25.
C. tourisme, art. L. 132-3.
-
26.
CCH, art. L. 301-4-1.
-
27.
CSI, art. L. 511-3.
-
28.
§ 6.
-
29.
Pour un exemple de référé débouchant sur la suspension d’un arrêté municipal de 2016 ordonnant la fermeture d’un bar en s’appuyant sur une pétition de… 2006, v. CE, ord., 28 juill. 2016, n° 401689, C. c/ Cne du Mont-doré. V. égal. CAA Douai, 9 mars 2017, n° 15DA01560, Union des métiers de l’hôtellerie et syndicat SNEG et Co c/ Ville de Lille à propos d’un arrêté municipal limitant les autorisations de prolongation d’ouverture des débits de boissons.
-
30.
Roland H., Lexique juridique. Expressions latines, 4e éd., 2006, Litec, p. 126.
-
31.
V., mutatis mutandis, CE, 6 avr. 2016, n° 377184, B. c/ Ville de Cannes à propos d’une interdiction municipale d’usage d’une cale de mise à l’eau portuaire pour des raisons de sécurité et de tranquillité publiques.
-
32.
Cinq condamnations ont déjà été rendues contre la France à ce sujet : CEDH, 24 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France et n° 65941/11, Labassée c/ France ; CEDH, 21 juill. 2016, Foulon et Bouvet c/ France, nos 9063/14 et 10410/14 et CEDH, 19 janv. 2017, n° 44024/13, Laborie c/ France.
-
33.
CE, 12 déc. 2014, n° 367324, Assoc. juristes pour l’enfance et a. : D. 2015, p. 352, concl. Domino X. et p. 355.
-
34.
CE, 3 août 2016, n° 401924 : D. 2016, p. 1700, obs. Le Maigat P.
-
35.
Le projet a été rejeté par 83 voix contre, 77 voix pour et 7 abstentions. Pour de plus amples détails sur les positions au sein du Conseil de l’Europe, v. Chaltiel F., « La gestation pour autrui et le droit français. Développement récents », LPA 19 déc. 2016, n° 122v2, p. 8.
-
36.
Lei n° 25/2016 de 22 de Agosto, Diário da República, 1.ª serie, n° 160, p. 2775.
-
37.
Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, nos 12-18315 et 12-30138, 2 arrêts.
-
38.
Cette position a été de nouveau confirmée dans un arrêt de la CEDH du 19 janv. 2017, Laborie c/ France, v. Lexbase Hebdo n° 685, 26 janv. 2017, éd. privée, Brèves, Lonné-Clément A.-L.
-
39.
V. Caire A.-B., « Vers un réexamen des décisions civiles définitives rendues en matière d’état des personnes après une condamnation de la CEDH ? », D. 2016, p. 2152.
-
40.
V. Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, nos 14-21323 et 15-50002 : « Chronique Droit du Tourisme », LPA 7 oct. 2016, n° 120x5, p. 3, obs. Monteiro E.
-
41.
V. l’art. L. 452-1 nouveau du Code de l’organisation judiciaire.
-
42.
CE, 3 août 2016, préc.
-
43.
CEDH, gde ch., 24 janv. 2017, n° 25358/12, Paradisio et Campanelli c/ Italie. V. not. les explications de Chénédé F., « Petite leçon de “réalisme juridique”. À propos de l’affaire Paradisio et Campanelli contre Italie », D. 2017, p. 663.
-
44.
CA Rennes, 12 déc. 2016, n° 15/08549, Lexbase Hebdo n° 684, 19 janv. 2017, éd. privée, Brèves, Lonné-Clément A.-L.
-
45.
CA Dijon, 3e ch. civ., 24 mars 2016, n° 15/00057 : D. 2016, p. 783, obs. Gallmeister I. ; JCP G 2016, 423, obs. Mirkovic A. ; RTD civ. 2016, p. 335, obs. Hauser J.
-
46.
Il convient de noter le récent rattachement de l’établissement public Parcs nationaux de France à l’Agence française de la biodiversité. V. www.parcsnationaux.fr.
-
47.
C. envir., art. L. 331-3 et § 13 de l’arrêt commenté.
-
48.
C. envir., art. L. 331-9.
-
49.
V. également CE, 16 juill. 2012, n° 351846, Union des amis du parc naturel régional du Gâtinais français, 2e consid.
-
50.
C. envir., art. L. 331-3 III.
-
51.
Selon l’art. L. 331-4-1 dudit code, la réglementation du parc et la charte peuvent « fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ». V. égal. l’arrêt du CE, 25 juin 2014, n° 366007, Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction Midi-Pyrénées et autres à propos d’éventuelles réglementations extractives « qui ne seraient pas nécessaires à l’objectif de protection de l’environnement » quant au parc régional du Haut Languedoc.
-
52.
CE, 10 févr. 2017, n° 402690, Cne de Busseaut et autres.
-
53.
CE, 29 oct. 2013, n° 360085, Assoc. Les amis de la rade et des calanques et autres ; CE, sect., 23 mars 2012, n° 328866, Cne de Lourdios-Ichere et a.
-
54.
Modalité 21 relative aux activités commerciales et artisanales, v. www.reunion-parcnational.fr.
-
55.
CE, 8 juin 2016, n° 389062, Assoc. « Baronnies libres sans parc » à propos du classement du parc régional des Baronnies provençales, 11e consid.
-
56.
14e consid.
-
57.
La charte du parc national de La Réunion, « Les pitons, cirques et remparts au centre d’un projet de territoire », p. 56 et s.
-
58.
Une approche ancienne : v. CE, 29 avr. 2009, n° 293896, Cne de Manzat.
-
59.
CE, 26 avr. 2013, n° 343957, Assoc. pour le développement durable de la Brenne Tourangelle.
-
60.
Sur cette notion, v. not., Goliard F., « Tourisme culturel : un concept protéiforme », JT 2010, p. 18.
-
61.
Les pétitions de principe du texte seront reprises et complétées par l’association à travers l’adoption de la « charte internationale du tourisme culturel » en octobre 1999 : https://www.icomos.org/charters/tourism_f.pdf
-
62.
Organisation internationale non-gouvernementale de professionnels qui œuvre à la conservation des monuments et des sites historiques dans le monde.
-
63.
Conseil de l’Europe, « Promotion du tourisme culturel en tant que facteur de développement des régions », Strasbourg, 2005, éditions du Conseil de l’Europe, p. 8.
-
64.
Malvy M., Rapp. « 54 suggestions pour améliorer la fréquentation touristique de la France à partir de nos patrimoines », 14 mars 2017, p. 19.
-
65.
Noppen L., Morisset K., « Le patrimoine est-il soluble dans le tourisme ? », Téoros 2012, 22-3.
-
66.
Forum UNESCO – Université et patrimoine, Beyrouth et Byblos, 12 déc. 2000.
-
67.
Également, sur le rapport entre la loi et le tourisme, v. Pontier J.-M., « Loi LCAP : quels enjeux pour le tourisme ? », JT 2017, p. 21.
-
68.
V. Leroux M., « La volet « patrimoine » de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine », Droit administratif Mars 2017, n° 3 ; Touzelin D., « Une loi qui valorise les patrimoines sous leurs différentes formes », JT 2017, n° 193, p. 37.
-
69.
LCAP, art. 78.
-
70.
Recomm. du Conseil de l’Europe R-(91) 13 relative à la protection du patrimoine architectural du XXe s.
-
71.
Leroux M., « Le volet “patrimoine” de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine », préc.
-
72.
Malvy M., Rapp. préc., p. 45.
-
73.
La loi introduit en effet dans le Code du patrimoine un nouvel article L. 612-1 qui prévoit que L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972.
-
74.
De Lajartre A., « Les sites patrimoniaux remarquables : une vraie-fausse simplification du droit des espaces protégés », JT 2017, p. 26.
-
75.
Proust A. , « Les abords des monuments historiques », JT 2017, p. 31.
-
76.
Touzeau-Mouflard L., « Les travaux sur les immeubles protégés après la loi du 7 juillet 2016 », RDI 2017, p. 64.
-
77.
C. patr., art. L. 621-30, II.
-
78.
V. chap. 2, titre 1 de la loi.
-
79.
La loi complète la définition du patrimoine en y ajoutant le patrimoine immatériel entendu au sens de l’article 2 de la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris, le 17 oct. 2003.
-
80.
Goliard F., « Tourisme et territoire – Patrimoine culturel – La préservation du “petit” patrimoine », JT 2015, n° 178, p. 36.
-
81.
Malvy M., Rapp. préc., p. 19.
-
82.
TA Marseille, 18 mars 2013, n° 1105215.
-
83.
CAA Marseille, 13 févr. 2015, n° 13MA02242.
-
84.
Il est probable que le Conseil envisage là les visites scolaires ou de groupe, l’accueil de personnes handicapées…
-
85.
Notons que le Conseil d’État s’appuie également sur le caractère quasi précaire de la convention, révocable à tout moment et dont le préavis est très bref. Un caractère incompatible, pour le juge, avec la durée minimale à envisager pour rendre possible une délégation et les investissements parfois lourds qu’elle nécessite. Ce que l’article L. 1411-1 précité suggère à travers la formule « Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service ».
-
86.
Arrêt de la cour administrative d’appel préc., 1er cons.
-
87.
Genevard A. et Laclais B., « Un acte II de la loi Montagne pour un pacte renouvelé de la nation avec les territoires de montagne », 27 juill. 2015.
-
88.
Sur ce sujet, v. not. Courrèges M., « Les attentions portées au secteur du tourisme : des avancées en demi-teinte », AJDA 2017, p. 795.
-
89.
JOUE L 326, 11 déc. 2015, p. 1.
-
90.
L. n° 2015-991, 7 août 2015 : JO, 8 août 2015, n° 182, p. 13705.
-
91.
Sur cette question, v. Carbonnaux C., « L’organisation territoriale du tourisme dans la loi NOTRe », in « chronique de droit du tourisme », LPA 3 oct. 2016, n° 119w9, p. 14.
-
92.
Sur ce sujet, v. not. Benech F., « Activités touristiques – offices de tourisme – entrée en vigueur in extremis de la dérogation à la loi NOTRe », JT 2017, p. 45.
-
93.
Ginésy C.-A., « Notre objectif : refaire de la France la première destination mondiale du ski », JT 2017, p. 15.
-
94.
Sur une étude détaillée du titre III de la loi, Devès C., « L’aménagement de la montagne après la loi du 28 décembre de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne », AJCT 2017, p. 202 ; Joye J.-F., « Les ajustements du droit de l’urbanisme en montagne », AJDA 2017, p. 800.
-
95.
C. urb., art. L. 122-16.
-
96.
Ibid.
-
97.
Rappelons que cette procédure permet de déroger au principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante.
-
98.
C. urb., art. L.122-17.
-
99.
C. urb., art. L. 122-18.
-
100.
Juen P., « L’acte II de la loi Montagne en matière d’urbanisation : de l’érosion du principe d’équilibre à la hiérarchisation des priorités », RDI 2017, p. 176
-
101.
Delpech X., « Immobilier – Remédier à la dégradation de l’immobilier de loisir dans les stations de montagne et du littoral », JT 2016, p. 8.
-
102.
JO, 16 déc. 2000, n° 289, p. 19777.