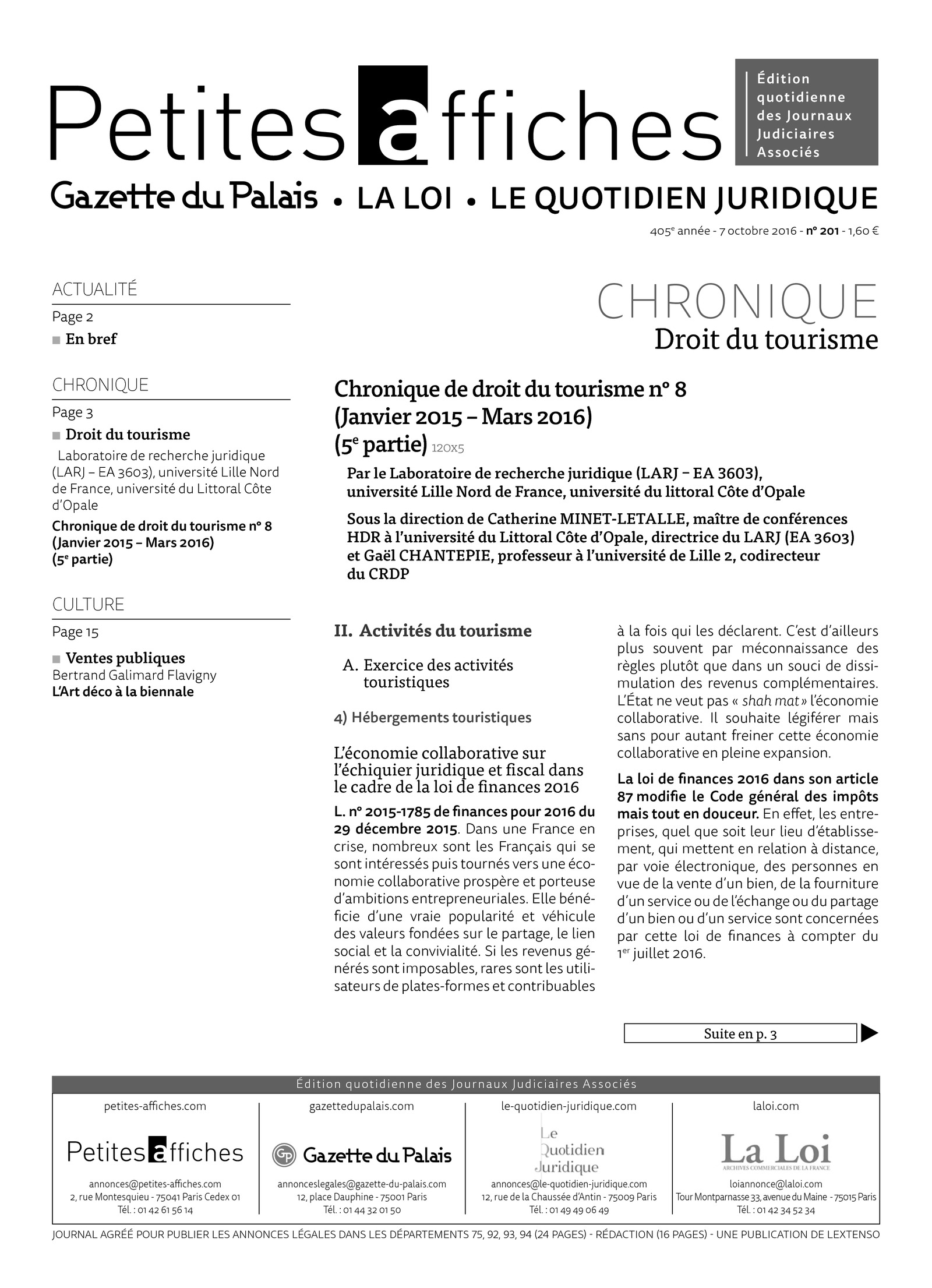Chronique de droit du tourisme n° 8 (Janvier 2015 – Mars 2016) (5e partie)
CE, 9 oct. 2015, no 384804, Cne de Lauzet-sur-Ubaye c/ Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement
Cass. soc., 25 mars 2015, no 13-27695
Cass. soc., 24 juin 2015, no 13-25761
Cass. soc., 7 juill. 2015, no 13-17195
Cass. soc., 8 juill. 2015, no 14-16330
CJUE, 1er oct. 2015, no 432/14, O. c/ Bio Philippe Auguste SARL
CE, 24 févr. 2015, nos 374726, 374905, 376267 et 376411, Féd. des employés et cadres CGT-FO et a. ; Féd. CGT personnels du commerce, de la distribution et des services et a.
Cass. crim., 22 sept. 2015, no 13-82284
Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, nos 14-15720 et 14-18014
CJUE, 14 janv. 2015, The Queen à la demande d’Eventech
Cons. const., 22 mai 2015, no 2015-468/469/472 QPC
Cons. const., 22 sept. 2015, no 2015-484 QPC
Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, no 14-16731
Cass. crim., 15 déc. 2015, no 13-81581
Cass. 1re civ., 25 mars 2015, no 13-24431
Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, no 14-22223
CE, 9 nov. 2015, no 383791, A. c/ Cne d’Allos et Office national des forêts
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, no 14-20533
Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, nos 14-21323 et 15-50002
CAA Douai, 26 nov. 2015, no 14DA01125, Ministre du Logement et de l’Égalité des territoires c/ Sté Innovent
L. n° 2015-994, 17 août 2015, relative au dialogue social et à l’emploi, art. 49
L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, Titre III, Chapitre 1, art. 241 à 257
Ord. n° 2015-333, 26 mars 2015, portant diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur touristique, art. 3
L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015, loi de finances pour 2016
I – Les acteurs du tourisme
A – Acteurs publics
B – Acteurs privés
1 – Organisations professionnelles (…)
2 – Réglementation des professions
a – Contrats saisonniers
b – Travail dominical et en soirée
II – Activités du tourisme
A – Exercice des activités touristiques
1 – Financement des activités
2 – Intermédiaires de voyages
3 – Transports
4 – Hébergements touristiques
L’économie collaborative sur l’échiquier juridique et fiscal dans le cadre de la loi de finances 2016
L. n° 2015-1785 de finances pour 2016 du 29 décembre 2015. Dans une France en crise, nombreux sont les Français qui se sont intéressés puis tournés vers une économie collaborative prospère et porteuse d’ambitions entrepreneuriales. Elle bénéficie d’une vraie popularité et véhicule des valeurs fondées sur le partage, le lien social et la convivialité. Si les revenus générés sont imposables, rares sont les utilisateurs de plates-formes et contribuables à la fois qui les déclarent. C’est d’ailleurs plus souvent par méconnaissance des règles plutôt que dans un souci de dissimulation des revenus complémentaires. L’État ne veut pas « shah mat1 » l’économie collaborative. Il souhaite légiférer mais sans pour autant freiner cette économie collaborative en pleine expansion.
La loi de finances 2016 dans son article 872 modifie le Code général des impôts mais tout en douceur. En effet, les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service sont concernées par cette loi de finances à compter du 1er juillet 2016.
Le Sénat avait proposé la mise en place d’une franchise fiscale de 5 000 euros pour les revenus déclarés mais cette proposition a été rejetée lors du passage à l’Assemblée nationale le 11 décembre 2015 au matin dans le cadre d’un amendement3.
L’Assemblée nationale a validé un second amendement4 au projet de loi de finances pour 2016 qui oblige dorénavant les plates-formes collaboratives à envoyer un récapitulatif des revenus bruts générés à leurs utilisateurs et à les informer de leurs obligations en matière fiscale. Cet amendement introduit également une amende de 10 000 euros en cas de non-respect de ces exigences.
Les plates-formes, qui ont connaissance des revenus dégagés par leurs utilisateurs, pourraient donc à court terme en communiquer les montants aux administrations sociales et fiscales en vue de fiabiliser les déclarations des contribuables. Cela va dans le sens de la modernisation de l’économie5 qui se fonde sur la télétransmission. Les employeurs le font déjà pour les salaires, tout comme les banques pour les revenus mobiliers. Nous n’en sommes plus très loin. Les plates-formes comme Airbnb sont mises à contribution depuis le 1er octobre 2015 pour collecter la taxe de séjour à Paris pour le compte de leurs hôtes. Cette possibilité a été ouverte pour toutes les plates-formes de location de logements entre particuliers dans le cadre de la loi de finances 20156 suivi du décret7 n° 2015-970 du 31 juillet 2015. À l’international, Airbnb centralise déjà la taxe de séjour auprès des touristes et l’envoie aux services fiscaux au nom de chaque hôte dans certaines grandes villes comme Amsterdam, Portland et San Francisco8. Le législateur devra convaincre les dirigeants des plates-formes présentes sur le marché français mais dont le siège social est à l’étranger.
Toute l’économie collaborative n’est pas fiscalement taxable. Dans cet article 87 de la loi de finances 2016, il est à noter que les obligations fiscales et sociales incombent aux utilisateurs/contribuables qui réalisent des transactions commerciales. Seules donc, les activités commerciales sont concernées par l’impôt. Les ventes ou les locations de biens ainsi que les prestations de services proposées en ligne sont actuellement les seules retenues.
Les activités relevant du partage de frais (comme le covoiturage) ne sont donc pas concernées puisqu’elles ne génèrent pas plus de revenus que de frais. Voici donc une distinction importante au cœur de l’économie collaborative. En effet, les revenus provenant par exemple du covoiturage sont considérés comme ne couvrant pas les frais générés par un déplacement et donc n’ont pas un caractère lucratif.
Cela revient-il à conclure que ce principe doit s’appliquer à toutes les plates-formes dans la même situation ? La chose demande à être clarifiée au travers d’un « statut » des plates-formes en fonction de la prestation proposée. Le législateur devra fournir une définition précise des domaines de l’économie solidaire taxables.
Les obligations fiscales. Les sommes perçues par les utilisateurs/contribuables, que l’activité soit exercée à titre professionnel et lucratif ou non, sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Il se pose dès lors la question des déductions des charges et de l’amortissement des biens correspondant aux recettes brutes.
En matière de TVA, toute prestation de services9 est taxable dès lors qu’elle est réalisée par un assujetti et qu’elle n’est pas exonérée. L’application ou non de la TVA suppose que l’utilisateur de la plate-forme agisse en tant qu’assujetti (cela suppose la réalisation répétée de prestations de services). Mais à partir de combien d’opérations est-on assujetti ? La franchise de TVA10 peut également s’appliquer dès que le chiffre d’affaires généré est inférieur à un seuil de chiffre d’affaires. Les utilisateurs auront tout intérêt à se déclarer assujettis et à bénéficier de la franchise.
Les obligations sociales. Les plates-formes collaboratives doivent s’interroger sur le risque de requalification en travail déguisé. Si le service rendu est répétitif, l’utilisateur devra alors se doter d’un statut juridique11. Le moins contraignant étant celui du micro entrepreneur12.
Les utilisateurs des plates-formes attendent à cet égard d’abord des clarifications sur la notion de revenu imposable ainsi que sur la notion d’activité professionnelle. Pour qu’ils puissent respecter leurs obligations, l’Administration devra expliquer que certaines activités ne créent pas de revenu imposable (le covoiturage qui se limite à du partage de frais) et que, quand elles dépassent la pratique occasionnelle, ces activités exigent que l’utilisateur s’enregistre en tant que professionnel, pour accumuler des droits sociaux.
Le rapport Terrasse13. Le député Pascal Terrasse, à la demande du premier ministre Manuel Valls, a conclu la mission qui lui avait été confiée en remettant le 8 février 2016 un rapport qui propose de mieux encadrer l’économie collaborative, et qui rappelle qu’elle ne se limite pas aux très polémiques Uber et Airbnb. Ce sont en effet près de 300 plates-formes qui sont concernées et la très grande majorité d’entre elles ont leur siège en France. Ce rapport souhaite que le législateur repense l’intervention des pouvoirs publics afin d’accompagner ce développement dans le cadre de règles de droit. Il appelle aussi les entreprises du secteur à prendre leurs responsabilités.
Aucun dispositif nouveau n’est cependant proposé. Le rapport porte son analyse sur l’intégration des travailleurs indépendants. La question de l’encadrement des relations de travail entre les plates-formes de services et leurs utilisateurs, dont elles tirent leurs revenus, doit être débattue entre les partenaires sociaux. Ils ont inscrit à leur agenda social un volet « dialogue économique », incluant le numérique.
Il est temps de faire évoluer la fiscalité pour tenir compte des spécificités de l’économie collaborative. Les règles au contour imprécis ne permettent pas actuellement de contrôles. Les utilisateurs ne déclarent pas leur revenu tout en évoluant dans un flou juridique et fiscal. L’État perd ainsi de nombreuses recettes fiscales. Les entreprises de l’économie capitaliste se sentent victimes d’une concurrence déloyale. Personne n’est satisfait de la situation actuelle.
Une nouvelle législation doit permettre d’assurer un encadrement de l’économie collaborative sans la « shah mat ». Une juste imposition des revenus professionnels ou quasi-professionnels, tout en exonérant les compléments de revenu modestes et occasionnels, est attendue de tous en complément des domaines taxables.
Thierry RIGAUX
5 – Responsabilités et assurances
La détermination de la juridiction compétente à l’épreuve de l’articulation des normes
Cass. 1re civ., 25 mars 2015, n° 13-24431. La responsabilité des acteurs intervenant dans le cadre de transports aériens internationaux est le siège d’un contentieux particulier, nécessitant de coordonner différentes normes supra-nationales. Si, classiquement, ce contentieux se concentre sur l’indemnisation des passagers victimes, il ne s’y cantonne pas, comme en témoigne l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 mars 201514. Était en cause un retard de vol affectant le trajet retour d’un voyage reliant Cancún à Paris.
Afin d’obtenir réparation de leur préjudice, les passagers victimes du retard de vol ont assigné en justice l’agence de voyages ainsi que le transporteur afin d’obtenir réparation. À cet effet, ils choisissent de fonder l’action en responsabilité sur les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou retard important de vol15. En réponse, le transporteur aérien soulève l’exception d’incompétence de la juridiction saisie – tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois – en application de l’article 33 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international16. L’exception d’incompétence ayant été écartée sur le fondement de l’article 42 du Code de procédure civile17, l’affaire est portée devant la Cour de cassation.
De prime abord relatif à la détermination de la juridiction compétente, ce contentieux conduit la Cour de cassation à se prononcer sur l’articulation des deux normes invoquées. En invoquant tour à tour le champ d’application de la convention de Montréal18, la nature de la règle invoquée19, l’identité de nature des droits à indemnisation consacrés par ces deux instruments20 et le caractère impératif des dispositions relatives à la compétence juridictionnelle instituée par la convention de Montréal, le moyen au pourvoi tend à créer une hiérarchie entre cette dernière et le règlement (CE) n° 261/2004 et ce, au bénéfice de la première. L’argumentation est néanmoins rejetée. Ce faisant la Cour de cassation précise les modalités de coordination de ces deux instruments. Pour y parvenir, la Cour de cassation se fonde sur la nature des droits à indemnisation qu’ils consacrent. Ces droits sont résolument différents. Là où la convention de Montréal définit les conditions dans lesquelles peuvent être engagées les actions exercées par les passagers leur permettant d’obtenir une réparation individualisée, le règlement (CE) n° 261/2004 instaure des « mesures réparatrices standardisées ». Ce faisant, les juges du fond en ont exactement déduit que l’action en réparation formée par les victimes du retard de vol sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 n’était pas soumise aux règles de compétences énoncées à l’article 33 de la convention de Montréal. Et de conclure que ces dernières dispositions ne pouvaient donc faire obstacle à l’application de l’article 42 du Code de procédure civile.
À la différence des règles matérielles régissant le droit à réparation, marquées par la complémentarité21, les règles déterminant la compétence juridictionnelle soulignent l’indépendance de ces deux instruments normatifs.
Valérie DURAND
Des limites de l’obligation d’information de la compagnie aérienne
Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-22223. Le transporteur aérien qui vend un vol sec n’est pas tenu des obligations d’information pesant sur le vendeur de voyages à forfait. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 septembre 201522.
En l’espèce, une famille a acheté un vol sec pour Phnom Penh auprès d’une compagnie aérienne. Elle n’est pas autorisée à embarquer en raison de ce qu’elle n’a pas réservé de vol retour, que les parents ne disposent pas de visa et que le passeport du père n’est pas valable. La famille assigne dès lors la compagnie aérienne qui lui a vendu les billets d’avion en réparation de son préjudice. Le juge de proximité accueille sa demande. Il considère que cette compagnie, en sa qualité de vendeur de billets d’avion, était tenue, comme tout vendeur professionnel, d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients et qu’il lui revenait, à ce titre, de les informer des formalités multiples d’entrée et de séjour dans la ville de destination, obligation à laquelle elle avait manqué.
Le pourvoi formé contre son jugement invitait dès lors la Cour de cassation à préciser si la compagnie aérienne qui vend un vol sec est tenue d’informer ses clients sur les conditions d’entrée dans le pays de destination. La Cour ne le croit pas : elle casse le jugement au visa des articles 1147 du Code civil et L. 211-3 du Code du tourisme et remarque que les billets d’avion litigieux avaient été délivrés par un transporteur aérien, de sorte que n’était applicable à la société ni l’obligation d’information incombant au vendeur, ni celle incombant aux opérateurs de la vente de voyages et de séjours, au sens des articles L. 211-1 et suivants du Code du tourisme, relative aux conditions de franchissement des frontières.
La solution repose sur une application stricte des dispositions du Code du tourisme. En effet, l’article L. 211-8 de ce code impose au vendeur de voyages à forfait d’informer ses clients par écrit préalablement à la conclusion du contrat, notamment des conditions de franchissement des frontières23. Mais l’article L. 211-3 écarte expressément l’application de cette disposition aux « transporteurs aériens qui n’effectuent (…) que la délivrance de titres de transport aérien (…) », ce qui était le cas de la compagnie aérienne en l’espèce. Il était dès lors logique que la Cour de cassation décide que l’obligation d’information prévue par l’article L. 211-8 ne puisse pas, en tant que telle, être invoquée en l’espèce.
Le juge de proximité avait d’ailleurs certainement conscience de la difficulté. Il n’avait en effet pas fondé sa décision sur l’article L. 211-8, mais retenu que la compagnie aérienne qui commercialise directement des billets d’avion auprès de ses passagers aurait eu la qualité de « vendeur » de ces billets et qu’elle aurait dès lors été tenue de l’obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel. On sait en effet que, si l’article 1602 du Code civil ne fait bien obligation au vendeur que d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, la jurisprudence n’a eu de cesse, en s’appuyant sur le droit commun des contrats, d’étendre l’obligation d’information qui pèse sur le vendeur professionnel : ce dernier a aujourd’hui l’obligation de prendre l’initiative de communiquer à son cocontractant tout ce qu’il sait et qui est, soit susceptible d’influencer sa décision d’acheter, soit utile à l’usage de la chose vendue et, plus largement, tout ce qui est nécessaire à la jouissance du bien ou relatif aux précautions à prendre lors de son utilisation24. En l’espèce, cette obligation aurait permis d’imputer à faute à la compagnie aérienne l’absence de renseignement quant aux conditions d’entrée sur le territoire cambodgien.
Mais c’était jouer sur les mots et qualifier de « vente » ce qui n’en est pas une25 : la vente est un contrat translatif de la propriété d’un bien moyennant une contrepartie monétaire26. Le transporteur qui « vend » des billets d’avion ne transmet la propriété d’aucun bien. Il se contente de s’engager à procéder à un déplacement, et conclut dès lors un contrat de transport aérien de passagers, qui constitue une variété de contrat d’entreprise27. Il était donc impossible de qualifier la compagnie aérienne de vendeur professionnel. Et l’on comprend que la Cour de cassation ait décidé que « l’obligation d’information incombant au vendeur » n’était pas applicable à la compagnie aérienne.
Cette solution paraît toutefois rigoureuse pour « l’acheteur » des billets d’avion, qui est privé du bénéfice d’une obligation dont il aurait profité s’il avait acheté un forfait touristique auprès d’une agence de voyages sans avoir nécessairement conscience de la différence28. Il semble même qu’il aurait pu en bénéficier s’il avait « acquis » ses billets d’avion auprès d’une telle agence puisque, si les agences de voyages ne sont elles-mêmes tenues des obligations découlant des articles L. 211-7 et suivants que lorsqu’elles « vendent » des forfaits touristiques29 et y échappent lorsqu’elle se contente de « vendre » un vol sec30, la Cour de cassation a pu admettre qu’une agence de voyages commettait une faute à ne pas informer son client de façon claire et précise sur les conditions d’utilisation du billet, parmi lesquelles figuraient les formalités d’entrée sur le territoire des États de destination, notamment au regard des justifications requises de vaccinations en cours de validité31.
La solution paraît d’autant plus sévère que l’heure est à la généralisation de l’obligation d’information, tant en droit de la consommation32, qu’en droit commun des contrats. On sait en effet que ce dernier reconnaît une obligation d’information à la charge de tout contractant qui dispose d’une information33 que l’autre partie ignore légitimement34 et qui est pertinente35, c’est-à-dire qui lui est utile soit pour prendre la décision de conclure le contrat, soit pour tirer le meilleur parti du contrat une fois celui-ci conclu36, obligation qui, après avoir été dégagée par la jurisprudence sur le fondement de l’article 1135, voire de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, va être consacrée dans le Code civil à compter du 1er octobre 201637.
La Cour de cassation semble pourtant hostile à toute idée d’imposer une obligation d’information relative aux conditions de franchissement des frontières à la charge du professionnel qu’elle qualifie expressément de « transporteur aérien » lorsque celui-ci se contente de vendre des billets d’avions à ses passagers. Et il est vrai que cette obligation n’est prévue que dans une seule disposition, l’article L. 211-8, dont on a vu que le législateur exclut expressément l’application au transporteur aérien « vendant » des billets d’avions à ses clients38. Il faut sans doute en déduire que la seule obligation du transporteur aérien à cet égard est de vérifier la situation des passagers lors de l’embarquement pour s’assurer qu’ils pourront atterrir sur le lieu de destination de l’avion39, ce qui intervient certainement un peu tard dans la vie du contrat.
On remarquera que la Cour de cassation n’a expressément refusé de mettre à la charge du transporteur aérien que les obligations d’information pesant respectivement sur le vendeur de voyages à forfait et sur le vendeur. Admettrait-elle qu’un « acheteur » se plaigne du silence d’une compagnie aérienne en invoquant le droit commun des obligations ? Cela est peu probable, même si la lettre de l’arrêt ne l’exclut pas. Quoi qu’il en soit, accepterait-elle de l’envisager que l’on risquerait de se heurter à une autre difficulté : on risque d’avoir du mal à considérer que l’« acheteur » des billets d’avion ignore légitimement les conditions d’entrée dans un pays, lesquelles sont aisément accessibles, puisqu’elles sont diffusées sur le site internet du ministère des Affaires étrangères.
Sophie MOREIL
Du dommage subi par le touriste sur un chemin de grande randonnée : peur sur l’édile ?
CE, 9 nov. 2015, n° 383791, A. c/ Cne d’Allos et Office national des forêts. Les touristes, ça ose tout… C’est même à ça qu’on les reconnaît ! Que Michel Audiard nous pardonne et nous permette cet emprunt cinématographique mais il est vrai que, parfois, certains touristes se mettent inconsidérément dans des situations d’évident péril pour ensuite, une fois les chairs meurtries, chercher à obtenir réparation, auprès du juge administratif, d’une soi-disant faute de la puissance publique ! L’arrêt A. c/ Commune d’Allos et ONF offre l’occasion au Conseil d’État de rappeler quelques règles contentieuses protectrices des intérêts de collectivités locales fort soucieuses de leurs deniers publics.
Les faits sont d’une banalité touristique absolue. Une mère et sa fille participent, au sein d’un petit groupe, à une randonnée dans le parc du Mercantour. Ce groupe décide, dans un élan collectif d’intelligence panurgique, de quitter le chemin de grande randonnée pour gravir une pente sur laquelle sont stockées des grumes abattues à la demande de l’ONF – opération par ailleurs financée par la commune d’Allos – afin de trouver un endroit agréable pour déjeuner. L’observateur avisé du droit administratif français a, dès à présent, noué le scénario qui mène au Palais-Royal. Une fois assis sur ces morceaux de tronc, deux membres du groupe provoquent la chute d’une grume qui roule et heurte malheureusement Mme A. et sa fille restées en contrebas. La victime se transforme alors en requérante. Le tribunal administratif de Marseille restera insensible à leurs demandes de condamnation solidaire de l’ONF et de la commune allossarde40. Appel sera interjeté par les justiciables mais sans plus de succès41. Un pourvoi en cassation sera alors formé devant le Conseil d’État qui, par sa décision ici commentée42, ne désavouera pas les juridictions phocéennes. Deux problématiques successives ont été tranchées par le Palais-Royal : d’une part, la compétence même de la juridiction administrative quant à la responsabilité de l’ONF pour avoir laissé sur site ces grumes et, d’autre part, l’irresponsabilité de la commune quant à une faute alléguée du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative.
I. Le touriste et l’ONF : de l’affirmation de la compétence du juge judiciaire
Établissement public qualifié par la loi d’industriel et commercial, et commodément affublé par la doctrine d’une « double casquette », l’ONF se retrouve très régulièrement devant les juridictions françaises pour obtenir réparation d’un préjudice subi par l’Office ou pour se défendre contre une attaque contentieuse. La compétence juridictionnelle ne relève pas, pour l’ONF, d’un bloc de compétence unifiée ; il doit se rendre par principe devant le juge de droit commun43 et, par exception, devant le juge administratif si l’activité litigieuse révèle une dimension de prérogative de puissance publique44. Dans l’arrêt Commune d’Allos, le Conseil d’État se montre pédagogue puisqu’il prend la peine de donner des exemples d’activités de nature administrative : « telles la réglementation, la police ou le contrôle » (cons. 6), rappelant la jurisprudence traditionnelle du tribunal des conflits45.
Le Palais-Royal précise qu’en l’espèce, l’opération menée était de nature touristique : il s’agissait d’abattre des arbres pour ouvrir une perspective paysagère favorable à la venue de touristes. Le raisonnement eût été le même s’il s’était agi d’un abattage menant à une vente commerciale dans le cadre d’une valorisation économique de la forêt. L’incompétence validée par le Conseil d’État ne signifie heureusement pas, pour les requérants, la fin de leurs espoirs contentieux. Ils peuvent toujours porter leur litige devant le juge judiciaire compétent.
II. Le touriste et le maire : entre risque à assumer et précautions administratives a minima…
Le maintien de l’ordre public est une obligation légale très commentée par la doctrine. Matière vivante, circonstanciée, passionnelle en ce qu’elle touche au droit des libertés fondamentales, polémique parfois46, les communes – et surtout leurs maires ! – doivent prendre garde à toute forme de trouble à l’ordre public, avéré comme probable, si elles ne veulent pas voir leur responsabilité engagée par le premier requérant venu en cas de réalisation d’un dommage. Qu’en fut-il en l’espèce ? L’entreposage des grumes constituait-il un danger pour la sécurité publique ? Le maire aurait-il dû prendre des mesures de prévention ? Et si oui, lesquelles ?
Au-delà des preuves matérielles à apporter pour caractériser le trouble et emporter la conviction du juge47, l’inaction communale en matière de police est souvent préjudiciable aux intérêts pécuniaires locaux. Agir pour préserver ou rétablir l’ordre public constitue une obligation pour tout maire. En l’espèce, le maire avait pris soin d’informer les randonneurs des risques d’avalanche encourus en s’engageant dans ce chemin de randonnée. Cette obligation d’informer peut n’être pas suffisante48. Dans son huitième considérant, le Conseil d’État insiste particulièrement sur cette obligation spécifique : « il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par prudence, se prémunir ». Deux remarques importantes : d’une part, le maire n’a pas à signaler tous les dangers. Uniquement les plus importants et ceux dont il a connaissance49 ! Heureuse position juridictionnelle qui évite la multiplication des panneaux aussi inutiles qu’inesthétiques ! Et, d’autre part, le juge administratif attend de l’administré un comportement rationnel, avisé, de raisonnable prudence qui, s’il n’est pas observé, fera peser sur l’imprudent(e)50 les conséquences contentieuses de l’adage latin Nemo auditur propriam turpitudinem allegans51…
Aussi, le Conseil appuie-t-il sa démonstration sur une analyse factuelle poussée, mettant en exergue la « forte déclivité » du lieu, implicitement la plus grande probabilité de chutes de choses comme de personnes, et sur la notion de risque pris par la victime, cause fort classique d’exonération de responsabilité publique52. La haute assemblée valide alors le raisonnement de la cour marseillaise qui avait conclu à l’absence de faute locale dans l’exercice des pouvoirs de police administrative.
Olivier CARTON
L’application de la responsabilité de plein droit de l’article L. 211-16 du Code du tourisme à l’organisateur d’une croisière
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-20533. Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 décembre 2015 clarifie le régime de la responsabilité de l’organisateur de croisière53.
Les faits étaient les suivants : une cliente qui avait « acheté » une croisière chute sur le pont du navire le deuxième jour de la croisière à l’occasion d’un exercice de sécurité. Elle intente alors une action en responsabilité contre l’agence de voyages qui lui avait vendu la croisière et contre l’organisateur de la croisière et son assureur. Elle obtient la nomination d’un expert et la condamnation in solidum de l’agence de voyages, de l’organisateur de la croisière et de son assureur à lui verser une provision en attendant que l’expert rende ses conclusions. Devant la Cour de cassation, se posait dès lors la question de savoir si l’obligation de l’organisateur de la croisière et de l’agence de voyages d’indemniser leur cliente n’était pas sérieusement contestable.
La Cour y trouve l’occasion de préciser que la responsabilité de l’organisateur de croisières relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l’article L. 211-16 du Code du tourisme lorsque la croisière présente les caractères d’un forfait touristique. En l’espèce, l’organisateur de croisière avait organisé la totalité des opérations composant la croisière, y compris l’ensemble des services touristiques complémentaires offerts à ce titre. La croisière pouvait donc être qualifiée de forfait touristique. L’organisateur était responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu par la victime, et ce, peu important qu’il ne soit pas lié contractuellement avec cette victime, puisque l’article L. 211-16 s’applique à toute personne physique ou morale se livrant à une opération consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs. Celle-ci avait fait une chute sur le pont du bateau. Aucune des causes d’exonération spécifiquement prévues par le Code du tourisme n’était établie. La responsabilité de l’organisateur de croisière n’était pas sérieusement contestable. La Cour de cassation décide que celle de l’agence de voyage, qui, en sa qualité de « vendeur », était soumise au même régime de responsabilité de plein droit, ne l’était pas davantage dès lors que le dommage était survenu au cours de l’exécution d’une opération composant le forfait touristique.
La solution n’était pas évidente. Elle imposait de résoudre un épineux conflit de qualifications54. En effet, les articles 48 et 49 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes prévoient un régime de responsabilité spécifique des organisateurs de croisières. Ils distinguent l’inexécution du contrat de croisière, qui donne lieu à un régime de responsabilité de plein droit (art. 48), de l’inexécution du contrat de transport maritime, pour laquelle la responsabilité de l’organisateur est engagée dans les conditions et les limites des articles 37 et 38, devenus les articles L. 5421-3 et L. 5421-4 du Code des transports. Il faut alors à nouveau discriminer : l’accident survenu à l’occasion d’un sinistre majeur engage la responsabilité de l’organisateur de croisière, à moins que celui-ci ne parvienne à prouver que l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés55. Celui ayant une autre cause conduit à ne retenir sa responsabilité que « s’il est établi qu’il a contrevenu aux obligations prescrites par l’article L. 5421-2 ou qu’une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés »56.
Mais la croisière maritime répond en principe également aux caractéristiques du forfait touristique, entendu, selon l’article L. 211-2 du Code du tourisme, comme la prestation résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; et vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. La croisière maritime consiste en effet le plus souvent en un ensemble de prestations mêlant transport, logement, restauration, et d’autres prestations, qui dure plus de vingt-quatre heures, et est vendu à un prix tout compris. Or, la responsabilité de celui qui se livre à l’organisation ou à la vente d’un forfait touristique57 est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que celle prévue par la loi de 1966 : ce dernier est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, et ce, y compris lorsque ces obligations sont à exécuter par d’autres prestataires (C. tourisme, art. L. 211-16, al. 1er). Il ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure (C. tourisme, art. L. 211-16, al. 2).
L’issue du litige dépendait donc du point de savoir si la Cour de cassation entendait faire prévaloir le droit maritime ou le droit du tourisme. C’est le deuxième qui l’emporte : relevant que la croisière remplissait les critères de qualification du forfait touristique, la Cour décide qu’il convenait d’appliquer le régime issu du Code du tourisme – et donc un régime de responsabilité de plein droit – à l’égard de l’organisateur de la croisière.
La solution se révèle très protectrice de la croisiériste : le dommage était survenu à l’occasion de l’exécution du contrat de transport et ce, en dehors de tout sinistre majeur. Appliquer le régime issu de la loi de 1966 aurait conduit à retenir un régime de responsabilité pour faute qui aurait rendu la mise en cause de la responsabilité de l’organisateur de la croisière extrêmement complexe, tant sa faute aurait pu sembler difficile à établir. Cela n’aurait d’ailleurs été possible que si on avait pu identifier un lien contractuel entre l’organisateur et la croisiériste. En retenant l’application de l’article L. 211-16, la Cour évite d’avoir à s’interroger sur l’existence de ce lien contractuel et permet à la croisiériste de bénéficier d’un régime de responsabilité de plein droit, l’organisateur de croisière ne pouvant s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve de ce que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat était imputable à l’une des causes d’exonération énumérées à l’alinéa 2 de l’article L. 211-16, ce qui est délicat et qu’il n’était pas parvenu à faire en l’espèce.
La décision n’est pas parfaitement inédite. La Cour de cassation a déjà pu admettre la qualification d’une croisière maritime en forfait touristique58 et accepter de lui appliquer les dispositions du droit du tourisme en lieu et place de celles issues du droit maritime59. Mais des doutes subsistaient, la jurisprudence ne semblant pas exclure l’application de la loi de 1966 en ce domaine60. L’arrêt du 9 décembre 2015, en ce qu’il fait découler l’application de l’article L. 211-16 de la qualification de la croisière en forfait touristique, ne semble plus laisser de place à l’application de la loi de 1966 lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité de l’organisateur d’une croisière qui remplit effectivement les conditions pour être qualifiée comme telle61.
On notera que la qualification de forfait touristique retenue à propos de la croisière a aussi permis d’approuver les juges du fond d’avoir également appliqué le régime issu de l’article L. 211-16 à l’agence de voyages. Celle-ci engageait logiquement sa responsabilité de plein droit à l’égard de la croisiériste dont le dommage était survenu durant l’exécution du forfait touristique.
Sophie MOREIL
6 – Tourisme médical et tourisme procréatif
L’assemblée plénière face au tourisme procréatif : le timide revirement de jurisprudence à propos des effets en France d’une GPA internationale
Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, nos 14-21323 et 15-50002. Répondant aux injonctions de la CEDH dans les arrêts Mennesson et Labassée du 24 juin 201462 qui avaient condamné la France en raison de la non-transcription en droit français des actes de naissance des enfants issus d’une GPA internationale à l’égard de leur père biologique, l’assemblée plénière s’est prononcée le 3 juillet 2015 par un timide revirement de jurisprudence63. En effet, dans ces deux arrêts, elle estime que le fait que l’enfant ait été conçu dans le cadre d’une GPA en fraude à la loi française n’est pas un obstacle à la reconnaissance en France de l’acte de naissance étranger. Cependant, les circonstances de fait n’étaient pas les mêmes puisqu’il s’agissait de GPA exécutées en Russie au profit de pères célibataires. Dans chacune des affaires, l’acte de naissance russe mentionnait comme père de l’enfant son géniteur français et comme mère la femme qui avait accouché puis abandonné l’enfant, autrement dit sa mère porteuse. La filiation de l’enfant était donc établie à l’égard des parents comme si celui-ci était issu d’une procréation charnelle, les autorités russes n’ayant pas fait jouer à la convention de GPA un quelconque effet sur la filiation. Le cas de figure était donc semblable à celui de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 février 201264 où la transcription de l’acte de naissance avait été ordonnée, faute pour le ministère public d’avoir pu rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de GPA conclu et exécuté en Inde.
Dans les espèces ayant donné lieu aux arrêts de l’assemblée plénière, la demande concernait la transcription directe de l’acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français sur le fondement de l’article 47 du Code civil. Or, dans ce cas, les juges doivent seulement vérifier que l’acte en question est régulier, exempt de falsification et conforme à la réalité, sans qu’il soit besoin de se prononcer au fond sur l’établissement du lien de filiation. Par ailleurs, chacun des pères avait reconnu son enfant en France.
La Cour de cassation, dans deux précédentes décisions en date du 13 septembre 201365 et du 19 mars 201466, avait refusé la transcription des actes de naissance des enfants en appliquant la théorie de la fraude à la loi, dès lors que les éléments de preuve d’un processus d’ensemble dans lequel une convention de gestation pour autrui était impliquée avaient été rapportés par le ministère public. L’assemblée plénière affirme désormais l’inverse dans les arrêts du 3 juillet 2015 et il s’agit bien d’un revirement de jurisprudence. Seulement, sa portée apparaît comme étant limitée car il n’y avait pas d’atteinte manifeste aux dogmes qui fondent l’interdiction des mères porteuses en France, à savoir l’adage Mater semper certa et le principe de l’indisponibilité de l’état.
La technicité et l’austérité des décisions67 semblent confirmer que l’assemblée plénière a sans doute voulu privilégier l’interprétation stricte des arrêts Mennesson et Labassée de la CEDH selon laquelle seul le refus d’établir la filiation des enfants à l’égard du père biologique aurait été condamné. Le communiqué de presse tend à le confirmer68. Or, le conseiller-rapporteur et le Défenseur des droits suggéraient une décision ayant une toute autre portée en ce qui concerne les parents d’intention. La question des effets à l’égard de la mère d’intention n’étant pas encore tranchée, plusieurs pistes peuvent être envisagées.
La première d’entre elles est la transcription généralisée des actes de naissance étrangers au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce fut la solution adoptée par le tribunal de grande instance de Nantes dans trois décisions du 13 mai 201569 : « le fait que la naissance de l’enfant puisse être la suite de la conclusion par ses parents d’une convention prohibée au sens de l’article 16-7 du Code civil ne saurait faire obstacle à la reconnaissance en France du lien de filiation qui en résulte et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant qui ne saurait se voir opposer les conditions de sa naissance ». Ainsi, il admet la transcription d’un acte de naissance ukrainien qui indiquait comme étant mère de l’enfant la mère d’intention, conformément à la loi ukrainienne70. Ce fut également la position du groupe de travail présidé par Irène Théry dans son rapport remis à la ministre déléguée chargée de la Famille71.
Une seconde piste, celle de la reconstruction de la filiation, nous est suggérée par le Tribunal Supremo espagnol dans sa décision du 2 février 201572. La maternité de substitution étant interdite par le droit espagnol, l’ordre public international espagnol s’opposait comme en France à l’inscription de la filiation d’un enfant né à l’étranger d’une GPA. Mais pour les hauts magistrats espagnols, le refus d’inscription sur les registres de l’état civil ne portait pas atteinte aux droits de l’enfant, son intérêt étant préservé par le fait que la filiation était établie à l’égard de son père biologique et que la voie de l’adoption par le parent d’intention lui serait ultérieurement ouverte afin de lui permettre une intégration de facto dans sa famille.
Cette seconde piste s’avère être en parfaite cohérence avec les avis du 22 septembre 2014 dans lesquels la Cour de cassation avait également abandonné le raisonnement sur le terrain de la fraude à la loi à propos des effets en France d’une IAD pratiquée à l’étranger au profit d’un couple de femmes. Elle y affirmait que le recours à l’assistance médicale à la procréation à l’étranger dans des conditions autres que celles admises en France n’était pas en soi un obstacle à l’adoption par l’épouse de la mère de l’enfant.
À travers l’appréciation in concreto de l’intérêt de l’enfant à être adopté par le conjoint de celui ou de celle qui l’a procréé, le droit au respect de la vie privée serait ainsi préservé. Mais encore faut-il que cette appréciation in concreto de la part du juge soit effective, ce qui ne semble pas être le cas dans les arrêts rendus par les cours d’appel à l’issue de cet avis de la Cour de cassation73. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry est assez significatif. En effet, après avoir relevé que l’identité du géniteur des deux enfants était connue, des adoptions plénières furent prononcées par la Cour74.
De portée encore incertaine, le revirement de jurisprudence opéré par l’assemblée plénière ne remet pas en cause la prohibition de la maternité de substitution en France qui est par ailleurs assortie de sanctions pénales75. Ainsi, le 1er juillet 2015, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné pour provocation à l’abandon d’enfant un couple d’hommes mariés ayant eu recours à une mère porteuse à Chypre, laquelle avait été accompagnée durant sa grossesse par les deux hommes en France où elle avait finalement accouché76.
Evelyne MONTEIRO
B – Aménagement des espaces à vocation touristique
1 – Tourisme durable (…)
2 – Tourisme et patrimoine
Du refus préfectoral de délivrance d’un permis de construire d’éoliennes : intérêts touristiques vs développement économique et écologique ?
CAA Douai, 26 nov. 2015, n° 14DA01125, Ministre du Logement et de l’Égalité des territoires c/ Sté Innovent. Les voies de production d’énergie verte sont multiples : solaire, marine, naturelle – la méthanisation par exemple – ou aérienne. L’expansion, en France, de l’éolien est régulière. Ce développement ne se fait pas sans heurts. En effet, l’implantation d’un parc éolien provoque des actions contentieuses de la part de riverains, d’associations et même de collectivités déçues de ne pas recevoir sur leur territoire ces « aérogénérateurs » – et les ressources fiscales y étant associées ! – et mécontentes de n’en subir que les nuisances visuelles voire auditives…
La société Innovent subit ces difficultés contentieuses devant les juridictions administratives de la région Nord-Pas-de-Calais. Ayant demandé la délivrance d’un permis de construire de six éoliennes et d’un poste de livraison77 sur le territoire de deux communes proches du littoral de la Côte d’Opale, dans le Pas-de-Calais, elle se voit opposer un refus préfectoral en novembre 2010. Sûre de son bon droit, notamment en ce que ce projet « Parc éolien Mer et Terres d’Opale » entendait rajouter ces éoliennes à des éoliennes déjà implantées aux abords de l’autoroute A16, la société saisit le tribunal administratif de Lille pour faire annuler ces refus. Elle obtient gain de cause, par un jugement du 4 mars 201478, le tribunal lillois enjoignant l’Administration de réexaminer la demande dans un délai de deux mois. Le ministre du Logement et de l’Égalité des territoires interjette appel, une action à laquelle s’associe une association écologiste très active sur la Côte d’Opale, le GDEAM. Par un arrêt très dense du 26 novembre 2015, la cour administrative d’appel de Douai infirme le jugement et confirme les arrêtés de refus de novembre 2010. Certains arguments intéressent directement l’activité touristique d’un département et d’une région qui, contrairement aux poncifs médiatiquement relayés, disposent d’atouts touristiques remarquables : ses stations balnéaires, Wimereux, Hardelot-plage, Le Touquet, mais également la baie de Somme, les marais de l’Audomarois, la beauté de ses beffrois, la richesse de ses musées…
I. De quelques arguments éprouvés en droit administratif
Le juge administratif a toujours eu un rapport singulier à la loi. Acte républicain par excellence, la loi a été longtemps mise au pinacle par une juridiction soucieuse de quiétude politique. Même si le Palais-Royal a, depuis plus d’une génération, fait passer la loi derrière les traités internationaux et européens, il garde toujours une certaine réserve quant à l’examen de la constitutionnalité de la loi. Il n’est ici pas question ni de lister les raisons de cette pudeur normative ni de regretter ou de louer une telle attitude juridictionnelle. La société requérante en fit les frais contentieux. Elle tenta d’alléguer l’inconstitutionnalité de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme79 qui permet le rejet d’un projet dès que celui-ci porte « atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Malheureusement pour elle, l’argument n’est pas recevable, l’article incriminé étant pris pour l’application d’un article à valeur légale de ce même code. La théorie de la loi-écran fait son œuvre : le juge n’est pas le censeur de la loi au regard de la Constitution. 80 ans séparent la jurisprudence Arrighi de l’arrêt du 9 mars dernier, Stés Uber France et Uber BV80, et le juge se montre tout aussi intraitable81 avec un moyen, en l’espèce, fondé sur la violation de la Charte de l’environnement.
Un autre argument tenait au constat que le préfet n’avait formulé qu’une seule motivation pour ces deux arrêtés de refus, le projet éolien ayant été scindé en deux par la société Innovent. La cour a ici fait preuve de pragmatisme. Nul besoin de deux appréciations administratives dès lors que la cohérence et même l’unicité du projet est avérée ! Les termes employés par la cour douaisienne sont significatifs : « même ensemble d’éoliennes », « projet global » ou « demandes concomitantes »… Le juge administratif sanctionne la puissance publique qui ne se livrerait pas à l’examen d’un cas particulier avant de prendre sa décision82. Ici, l’appréciation était certes globale, i.e. valable pour les deux dossiers, mais bel et bien circonstanciée. Cette mise en balance assurée par la cour mérite d’être approfondie.
II. Une vision dynamique de la préservation de l’environnement et du tourisme ?
L’implantation de structures industrielles provoque immanquablement son lot de protestations contentieuses. « Not in my backyard », prévient la sagesse populaire anglaise. Déchetterie, décharge ou usine d’incinération, industrie polluante, hypermarchés… Les autorisations d’ouverture sont vouées au prétoire. Sauf à envisager une implantation au milieu d’un désert démographique, le juge sera effectivement saisi à terme par un requérant soucieux de sa tranquillité, un concurrent chafouin de voir sa zone de chalandise commercialement contestée, une association de défense de l’environnement… Las ! Ces structures doivent physiquement trouver un lieu d’implantation. L’arrêt formulé à Douai est par ailleurs également intéressant en ce que l’intérêt général du projet est suggéré par la juridiction elle-même : « l’intérêt général éventuellement rattaché à la réalisation du projet » ou « intérêt du projet au regard d’intérêts publics tels que le développement des énergies renouvelables »83. Le jugement annulant les refus préfectoraux sera pourtant annulé par la cour administrative d’appel. Pourquoi ? Les nouvelles éoliennes en auraient côtoyé d’autres. La représentation que se fait le juge des lieux concernés semble pondérée : « représentatif de l’arrière-pays littoral du département », n’étant pas « dépourvu d’agrément et d’intérêt », la cour conclut à l’absence de caractère remarquable du site immédiat.
Le raisonnement poursuivi par le juge tient essentiellement aux qualités naturelles et touristiques de l’estuaire de la Canche et de la commune du Touquet, visibles du lieu d’installation envisagé. Les atouts de ce lieu privilégié sont listés par le juge dans le droit-fil de la jurisprudence du Conseil d’État84 : présence d’un parc naturel régional et d’une réserve naturelle, valeur architecturale et patrimoniale de la « commune touristique » du Touquet, notamment soulignée par la présence d’un hippodrome inscrit85 et d’une base nautique. La conclusion intervient ensuite : le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet, en créant « une barrière visuelle longue d’environ 3 kilomètres » partiellement visible « notamment de la pointe du Touquet et, d’une manière générale, de la rive opposée », aurait appauvri et dénaturé « les paysages côtiers et d’estuaire de la Côte d’Opale ». Mélange de données écologiques et factuelles, la décision d’appel fait finalement primer un intérêt public local à forte dimension touristique sur des intérêts privés surfant sur la double exigence de production énergétique et de respect de l’environnement86. Juger n’est pas une tâche simple. L’équilibre ici trouvé sera-t-il remis en cause par le juge de cassation ? La société Innovent est une société très présente dans les prétoires87. Nul doute qu’elle saisira, un jour, le Conseil d’État et peut-être ce dernier profitera-t-il de l’occasion pour, par un arrêt de section ou d’assemblée88, clarifier l’état de ce droit de l’urbanisme mâtiné de droit de l’environnement89 et susceptible d’affecter un (droit du) tourisme français ô combien précieux90…
Olivier CARTON
Notes de bas de pages
-
1.
Les Échecs. Roi des jeux, jeu des rois de Jean-Michel Péchiné dans la collection Découvertes Gallimard (n° 335), Série Culture et société. Aux échecs, vous devez vaincre le roi en l’attaquant et en le rendant incapable de bouger. C’est ce qu’on appelle « échec et mat ». Cette expression vient de « Shah Mat » qui signifie « Le roi est vaincu ». Mat est un mot persan pour dire « vaincu », « impuissant », ou « paralysé ». C’est ce dernier synonyme qu’il convient de retenir dans ce titre.
-
2.
L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 de finances pour 2016, art. 87.
-
3.
Assemblée nationale : séance ordinaire 2015-2016, 1re séance de travail du 11 décembre, article 2 septies, amendement n° 164 sous la présidence de M. David Habib.
-
4.
Assemblée nationale : séance ordinaire 2015-2016, 2e séance de travail du 11 décembre, article 37 bis, amendement n° 334 sous la présidence de Mme Laurence Dumont.
-
5.
BOI – référence : BOI-BIC-DECLA-30-60-40-20140716 BIC – Régimes d’imposition et obligations – Téléprocédures – Obligation de télétransmission des déclarations de TVA, de CVAE et de résultats, et des règlements de TVA, d’IS, de TS et de CVAE.
-
6.
L. n° 2014-1654, 29 déc. 2014 de finances pour 2015.
-
7.
D. n° 2015-970, 31 juill. 2015.
-
8.
https://www.airbnb.fr/help/article/654/what-is-occupancy-tax--do-i-need-to-collect-or-pay-it.
-
9.
BOI-TVA-BASE-20-20-20141016.
-
10.
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup ?espId=2&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_457.
-
11.
C. com., art. R210-1 à R210-8, Livre II : des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique.
-
12.
Delpech X., Auto-entrepreneur. Micro-entrepreneur, 3e éd., 2016, Delmas.
-
13.
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/6421/master/index.htm.
-
14.
V. not. JCP E 2015, 1491, obs. Peru-Pirotte L. ; Gaz. Pal. 10 sept. 2015, n° 238s0, p. 19, obs. Carayol R.
-
15.
En cas de retard de vol, le Règlement (CE) n° 261/2004 reconnaît aux passagers victimes le droit à une prise en charge variable en fonction de l’importance du retard et de la distance de vol (art. 9 et 6) ainsi que le droit au réacheminement ou au remboursement des billets en cas de retard d’au moins 5 heures (art. 8, § 1, a et art. 6). V. not. sur l’application de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 prévoyant un droit à indemnisation aux retards de vol, CJUE, 19 nov. 2009, nos C-402/07 et C-432/07, Sturgeon ; CJUE, 23 oct. 2012, nos C-581/10 et C-629/10, Nelson ; Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-25351.
-
16.
Art. 33 « 1. L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ».
-
17.
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ». Or, il est relevé en l’espèce que l’agence de voyages avait son siège dans le ressort de la juridiction de proximité.
-
18.
« La Convention de Montréal du 28 mai 1999 s’applique à toutes les actions en responsabilité nées d’un contrat de transport international de personnes, de bagages ou de marchandises, effectué par aéronef contre rémunération ».
-
19.
Il s’agit de règles de compétence qui s’appliquent, selon le moyen au pourvoi, « indépendamment des règles de droit matériel qui auront vocation, le cas échéant, à permettre le traitement des questions de droit substantiel qui seront soumis au juge ».
-
20.
Consacrés par la convention de Montréal et le Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.
-
21.
Cass. 1re civ., 2 avr. 2014, n° 13-16038, PB : JCP G 2014, 1345, spéc. n° 793, obs. Delebecque P. ; RD transp. 2014, comm. n° 28, obs. Delebecque P. ; D. 2014, p. 1755, note Paulin C. ; D. 2014, p. 2272, obs. Kenfack H. ; Gaz. Pal. 18 sept. 2014, n° 191x0, p. 24, note Tosi-Dupriet I. ; Gaz. Pal. 11 sept. 2014, n° 190j4, p. 23, note Carayol R. ; RLDC juin 2014, n° 116, p. 17, obs. Le Gallou C. ; LPA 14 août 2015, « Chronique de droit du tourisme n° 7 ».
-
22.
Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-22223 : RCA déc. 2015, comm. n° 321, note Bloch L. ; RLDC nov. 2015, n° 131, p. 12, obs. Le Gallou C. ; Gaz. Pal. 8 mars 2016, n° 259s5, p. 36, obs. Carayol R. ; Gaz. Pal. 4 nov. 2015, n° 245w2, p. 8, obs. Paulin C. ; LEDC 6 oct. 2015, p. 7, obs. Latina M.
-
23.
Pour un exemple d’application de cette disposition, v. not. Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 10-26328.
-
24.
Sur cette obligation, v. not. Collart-Dutilleul F. et Delebecque P., Les contrats civils et commerciaux, 10e éd., 2015, Dalloz, Précis, nos 212 et s., spéc. nos 212 et 217.
-
25.
V., proposant de retenir la qualification de « vente de service », Savatier R., « La vente de services », D. 1971, p. 223 ; et, montrant à l’inverse l’inadaptation du régime de la vente aux contrats portant sur une prestation de services, Planque J.-C., « La vente de prestations de services », Contrats, conc. consom. févr. 2003, chron. n° 2.
-
26.
Collart-Dutilleul F. et Delebecque P., op. cit., n° 35.
-
27.
Collart-Dutilleul F. et Delebecque P., op. cit., n° 771.
-
28.
Bloch L., « Billets d’avion délivrés par un transporteur aérien », note sous. Cass. 1re civ., 10 sept. 2015 : RCA déc. 2015, comm. n° 321.
-
29.
Dans ce cas, sa responsabilité sera d’ailleurs engagée si l’agence établit que son manquement n’est pas de son fait. V. not. Cass. 1re civ., 8 avr. 2010, n° 09-14437 : JT 2010, n° 123, p. 11, note X. D.
-
30.
V. not. C. tourisme., art. L. 211-7, qui réserve notamment l’application de l’article L. 211-8 à « la réservation et la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur ligne régulière » « lorsque celles-ci entrent dans le cadre d’un forfait touristique », sans égard pour la qualité de celui qui « vend » ces titres de transport.
-
31.
V. Cass. 1re civ., 19 mars 2009, n° 08-11617. V. toutefois, Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 10-26328.
-
32.
C. consom., art. L. 111-1.
-
33.
Fabre-Magnan M., De l’obligation d’information dans les contrats, 1992, LGDJ, Bibl. droit privé, n° 221, nos 244 et s.
-
34.
Fabre-Magnan M., op. cit., nos 253 et s.
-
35.
Fabre-Magnan M., op. cit., nos 169 et s.
-
36.
Lequette Y., Terré F., Simler P., Droit civil – Les obligations, 11e éd., 2013, Dalloz, Précis, nos 258 et s.
-
37.
Futur art. 1112-1 du Code civil. Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016.
-
38.
C. tourisme., art. L. 211-3.
-
39.
C. transp., art. L. 6421-2 : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ».
-
40.
TA Marseille, 16 juill. 2012, n° 1104053, A. c/ Cne d’Allos et ONF.
-
41.
CAA Marseille, 19 juin 2014, n° 12MA03846, A. c/ Cne d’Allos et ONF.
-
42.
V. AJDA 2016, p. 526.
-
43.
T. com., 23 avr. 2007, n° C3590, Cne de Bourges pour une construction de canalisation qualifiée d’emprise irrégulière sur une propriété privée.
-
44.
CE, 4 mai 2016, n° 393470, ONF c/ Cne de Tostes quant à l’institution d’une servitude d’utilité publique (3 espèces).
-
45.
T. com., 28 mars 2011, n° C3787, Groupement forestier de Beaume-Haie c/ ONF.
-
46.
Il faut se rappeler les controverses politiques et médiatiques relatives à l’affaire Dieudonné de janvier 2014.
-
47.
V. CAA Paris, 12 avr. 2016, n° 15PA01728, Franco c/ Cne de Punaauia pour le rejet d’une requête notamment provoqué par l’absence de preuve du trouble allégué (des aboiements de chiens troublant l’ordre public).
-
48.
CE, 7 janv. 2016, n° 382634, Dejardin c/ Cne de Cilaos.
-
49.
Pour une chute de pierres inattendue dans les calanques, v. CAA Marseille, 23 avr. 2015, n° 14MA04657, D. c/ Cne de Marseille.
-
50.
CAA Marseille, 17 oct. 2013, n° 11MA02887, Cne de Montagnac-Montpezat pour le rejet d’une requête relative à un accident de vélo « entièrement imputable à son imprudence » ou CE, 18 nov. 2011, n° 342711, Cne de Gruissan quant à un accident de vélo « entièrement imputable à l’imprudence commise par la victime (…) se détournant délibérément de son trajet afin de franchir, à pleine vitesse, des bosses visibles et qu’il lui était loisible d’éviter ».
-
51.
Pour un cas particulièrement dramatique mais illustrant parfaitement l’inconscience menant parfois à la mort et à l’irresponsabilité administrative, v. CAA Marseille, 19 sept. 2013, n° 12MA00839, D. et a. c/ SNCF.
-
52.
CAA Bordeaux, 21 juin 2012, n° 11BX02406, Parmantier c/ Cne de Lourdes.
-
53.
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-20533 : D. 2016, p. 633, note Delebecque P. et Arié Lévy J. ; LEDC févr. 2016, p. 6, obs. O. Sabard ; Gaz. Pal. 8 mars 2016, n° 259s8, p. 38, obs. Carayol R. ; RLDC janv. 2016, n° 134, p. 26, obs. Latil C. ; Juristourisme janv. 2016, p. 12, obs. Delpech X.
-
54.
Sur lequel, V. not. Scalpel C., « Le droit positif de la croisière maritime en France », DMF avr. 2012, p. 306.
-
55.
C. transp., art. 38, devenu C. transp., art. L. 5421-3.
-
56.
C. transp., art. 37, devenu C. transp., art. L. 5421-4.
-
57.
L’article L. 211-1 du Code du tourisme assimile l’organisateur et le vendeur de forfait touristique, de sorte qu’ils sont soumis au même régime.
-
58.
Cass. 1re civ., 18 oct. 2005, n° 02-15487 : Bull. civ. I, n° 376 ; D. 2007, p. 111, obs. Kenfack H. ; DMF 2006, p. 243, note Tassy H.
-
59.
Cass. 1re civ., 18 oct. 2005, préc. ; Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-10585 : Bull. civ. I, n° 221 ; D. 2012, p. 93, obs. Delpech X. ; RD transp. 2012, n° 5, obs. Ndendé M. ; RCA 2012, n° 68, obs. Bloch L. ; DMF 2012, p. 356, obs. Le Bihan-Guenole M. ; LPA 13 nov. 2012, p. 4, obs. Chantepie G., qui s’appuie toutefois sur le fait que les parties avaient expressément choisi d’appliquer les dispositions du droit du tourisme.
-
60.
Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, préc.
-
61.
V. sur ce point, Delebecque P. et Arié Levy J., note sous Cass. 1re civ., 9 déc. 2015 : D. 2016, p. 633, spéc. nos 13 et s.
-
62.
CEDH, 24 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France et CEDH, 24 juin 2014, n° 65941/11, Labassée c/ France.
-
63.
Cass. ass. plén., 3 juill.2015, nos 14-21323 et 15-50002 : JCP G 2015, 1614, note Gouttenoire A. ; D. 2015, p. 1819, note Fulchiron H. et Bidaud-Garon C. ; AJ famille 2015, p. 364, obs. Dionisi-Peyrusse A. ; AJ famille 2015, p. 496, obs. Chénedé F.
-
64.
V. « Chronique de droit du tourisme n° 4 », LPA 13 nov. 2012, p. 12, obs. Monteiro E.
-
65.
Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, nos 12-18315 et 12-30138.
-
66.
Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-50005.
-
67.
Surtout dans le second arrêt de rejet (n° 15-50002) où aucune motivation axée sur les droits fondamentaux n’apparaît.
-
68.
Le communiqué semble clair : « Les espèces soumises à la Cour de cassation ne soulevaient pas la question de la transcription de la filiation établie à l’étranger à l’égard de parents d’intention : la Cour ne s’est donc pas prononcée sur ce cas de figure ». Pourtant à l’audience, il n’avait été question que de cela : v. Frison-Roche M.-A., « Maternités de substitution (Gestation pour autrui-GPA) – III. La compréhension des arrêts du 3 juillet 2015 par le souvenir du jeu de l’audience », LPA 8 oct. 2015, p. 14.
-
69.
TGI Nantes, 1re ch., 13 mai 2015, nos 14/07497, 14/07499 et 14/07503 : AJ famille 2015, p. 307, édito Avena-Robardet V. ; AJ famille 2015, p. 313, obs. Dionisi-Peyrusse A.
-
70.
V. jugement TGI Nantes, 1re ch., 13 mai 2015, n° 14/07497.
-
71.
Thery I. et Leroyer A.-M., Filiation, origines, parentalité. Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, 2014, Odile Jacob, p. 226.
-
72.
Fulchiron H., « Gestation pour autrui (statut des enfants) : position du Tribunal Supremo espagnol », D. 2015, p. 626.
-
73.
Neirinck C., « L’adoption plénière par l’épouse de la mère : la marée noire de l’appel », Dr. famille 2015, n° 7-8, étude n° 12.
-
74.
CA Chambéry, 28 avr. 2015. Il s’agissait de deux adoptions croisées où chacune des épouses demandait à adopter la fille de l’autre. Les enfants avaient été conçues grâce à un même donneur de sperme rencontré sur internet.
-
75.
V. C. pén., art. 227-12, al. 1er (provocation à l’abandon d’enfant) ; C. pén., art. 227-12, al. 3 (délit d’entremise en vue d’une GPA) et C. pén., art. 227-13.
-
76.
TGI Bordeaux, ch. 5, 1er juill. 2015, n° 14 322 000 193 : Lexbase Hebdo n° 621, 16 juill. 2015, obs. Gouttenoire A.
-
77.
Bâtiment servant à la connexion des éoliennes avec le réseau public d’électricité et assurant l’injection de l’énergie produite dans ledit réseau.
-
78.
TA Lille, 4 mars 2014, n° 1100025, Sté Innovent c/ Préfet du Pas-de-Calais.
-
79.
Aujourd’hui, C. urb., art. R. 111-27, depuis le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015.
-
80.
CE, 9 mars 2016, n° 388213.
-
81.
Les cours administratives d’appel s’inscrivant évidemment dans cette rigueur : par ex., v. CAA Bordeaux, 19 janv. 2016, n° 15BX02378, A. c/ Préfet de la Haute-Vienne.
-
82.
L’ensemble de l’action administrative est heureusement soumise à cette contrainte : CE, 25 févr. 2015, n° 385471, B. quant au refus d’octroi de la nationalité (contra) : CE, 26 sept. 2014, n° 372863, B. quant à une extradition…
-
83.
Cons. 16.
-
84.
CE, 9 oct. 2015, n° 374008, Ministre de l’Égalité des territoires et du Logement c/ Sté Eco Delta à propos de la visibilité d’éoliennes depuis des « perspectives donnant sur la cathédrale de Chartres ».
-
85.
Construit en 1925 dans un style pittoresque, travées à grandes arcades brisées et étage de comble à baies ornées de faux pans de bois ; classé monument historique en 1997.
-
86.
V. également CAA Douai, 25 févr. 2016, n° 14DA00856, Sté Centrale éolienne de la traverse de Ponthieu et a.
-
87.
CAA Nantes, 10 mai 2016, n° 14NT03372, Sté Innovent c/ Préfet de la Sarthe pour un refus annulé par la Cour ; CAA Douai, 10 déc. 2015, n° 14DA00374, Sté Innovent c/ Préfet de la région Picardie ; CAA Douai, 23 déc. 2011, n° 10DA00382, Sté Innovent c/ Préfet du Pas-de-Calais…
-
88.
CE, 19 sept. 2014, n° 357327, Association Protégeons nos espaces et a. pour une autorisation confirmée dans un département démographiquement peu important mais extrêmement riche sur les plans historiques et touristiques.
-
89.
CE, 26 févr. 2014, n° 345011, Association Forum des Monts d’Orb.
-
90.
Comp. avec CAA Bordeaux, 3 mars 2016, n° 14BX02096, Association pour la préservation de l’identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique pour la validation d’un parc éolien visible depuis plusieurs monuments historiques aveyronnais et CAA Nantes, 5 févr. 2016, n° 14NT02311, Sté Centrale éolienne Chanteraine c/ Préfet de la région Centre pour une annulation de permis compte tenu de la proximité du seul château de Billeron, classé monument historique.