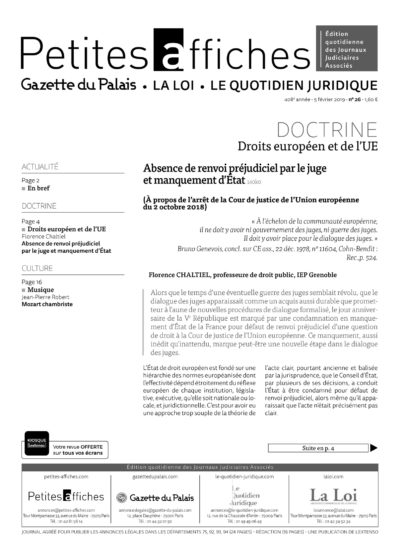Absence de renvoi préjudiciel par le juge et manquement d’État
Alors que le temps d’une éventuelle guerre des juges semblait révolu, que le dialogue des juges apparaissait comme un acquis aussi durable que prometteur à l’aune de nouvelles procédures de dialogue formalisé, le jour anniversaire de la Ve République est marqué par une condamnation en manquement d’État de la France pour défaut de renvoi préjudiciel d’une question de droit à la Cour de justice de l’Union européenne. Ce manquement, aussi inédit qu’inattendu, marque peut-être une nouvelle étape dans le dialogue des juges.
L’État de droit européen est fondé sur une hiérarchie des normes européanisée dont l’effectivité dépend étroitement du réflexe européen de chaque institution, législative, exécutive, qu’elle soit nationale ou locale, et juridictionnelle. C’est pour avoir eu une approche trop souple de la théorie de l’acte clair, pourtant ancienne et balisée par la jurisprudence, que le Conseil d’État, par plusieurs de ses décisions, a conduit l’État à être condamné pour défaut de renvoi préjudiciel, alors même qu’il apparaissait que l’acte n’était précisément pas clair. Complexité du droit de l’Union européenne ou interprétation volontairement divergente en raison d’une position juridique assumée, la raison de ce manquement ne ressort ni des arrêts du Conseil d’État ayant soigneusement évité le renvoi préjudiciel ni des conclusions de l’avocat général ni encore de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 octobre 2018 qui décide que : « Le Conseil d’État (France) ayant omis de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, selon la procédure prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, afin de déterminer s’il y avait lieu de refuser de prendre en compte pour le calcul du remboursement du précompte mobilier acquitté par une société résidente au titre de la distribution de dividendes versés par une société non-résidente par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente, l’imposition subie par cette seconde société sur les bénéfices sous-jacents à ces dividendes, alors même que l’interprétation qu’il a retenue des dispositions du droit de l’Union dans les arrêts du 10 décembre 2012, Rhodia1, et du 10 décembre 2012, Accor2, ne s’imposait pas avec une telle évidence qu’elle ne laissait place à aucun doute raisonnable, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE»3. Ce deuxième point du dispositif de l’arrêt de la Cour fait suite au premier selon lequel « en refusant de prendre en compte, pour le calcul du remboursement du précompte mobilier acquitté par une société résidente au titre de la distribution de dividendes versés par une société non-résidente par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente, l’imposition subie par cette seconde société sur les bénéfices sous-jacents à ces dividendes, alors même que le mécanisme national de prévention de la double imposition économique permet, dans le cas d’une chaîne de participation purement interne, de neutraliser l’imposition qu’ont subi les dividendes distribués par une société à chaque échelon de cette chaîne de participation, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 et 63TFUE ».
Les articles 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étaient-ils alors si complexes qu’ils conduisent à une double condamnation corrélée de la France en manquement ou s’agit-il de divergences d’appréciation du droit qui justifie d’autant que la Cour, non satisfaite du traditionnel recours en manquement pour mauvaise application des traités, innove, en faisant droit à la demande de la Commission de condamner la France à raison de la conception de l’acte clair retenue par sa juridiction administrative suprême ?
Citons les articles litigieux. Selon l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. Selon l’article 63, 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
En condamnant la France en manquement à raison de l’abus d’acte clair par le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne entend-elle faire un sévère rappel à la loi ponctuel, ou ouvre-t-elle l’ère d’une approche plus restrictive de l’acte clair ? Seule la postérité de l’arrêt le dira.
La théorie de l’acte clair avait été d’emblée utilisée par le juge administratif suprême, alors même qu’il était réticent vis-à-vis du renvoi préjudiciel que les traités de Rome avaient institués dès les premiers textes. Ainsi, selon l’article 177 initial, aujourd’hui article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)précise que : « la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ».
Ce texte distingue deux cas de figure que sont d’une part, l’appréciation de légalité d’un acte de droit européen dérivé et d’autre part, l’interprétation du droit européen originaire ou dérivé. Le traité distingue aussi entre les juridictions dont les décisions sont susceptibles de recours et les juridictions de dernière instance, dont les décisions sont, par définition, insusceptibles de recours. Ces dernières, en cas de question quant à l’interprétation du droit européen, sont tenues de saisir le juge européen d’une question préjudicielle.
Sur cette base juridique, il a été précisé par la jurisprudence que la cour a le monopole d’appréciation de validité du droit européen, le juge national n’étant dès lors pas compétent pour écarter une mesure européenne. S’agissant des questions d’interprétation, la Cour a, depuis le début des années 1980, accepté la théorie dite de l’acte clair. Celle-ci permet au juge national, dans un souci de gain de temps et d’efficacité, de ne pas saisir la Cour d’une question d’interprétation, si l’acte semble suffisamment clair.
Dans son arrêt Cilfit de 19824, la Cour apporte ainsi les précisions suivantes. Si l’article 177, alinéa 3, du traité oblige sans aucune restriction les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne à soumettre à la Cour toute question d’interprétation soulevée devant elles, l’autorité de l’interprétation donnée par celle-ci peut cependant priver cette obligation de sa cause et la vider ainsi de son contenu ; il en est notamment ainsi quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou que le point de droit en cause a été résolu par une jurisprudence établie de la Cour, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence, même à défaut d’une stricte identité des questions en litige. Il reste cependant entendu que, dans toutes ces hypothèses, les juridictions nationales, y compris celles visées à l’alinéa 3 de l’article 177, conservent l’entière liberté de saisir la Cour si elles l’estiment opportun.
L’article 177, alinéa 3, du traité doit être interprété en ce sens qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu’une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu’elle n’ait constaté que l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ; l’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit communautaire, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de la communauté5.
C’est donc l’« évidence » qui ne laisse « place à aucun doute » qui sert de critère premier. Ce dernier doit être apprécié en fonction des caractéristiques propres du droit européen, des difficultés particulières d’interprétation et des risques de divergences de jurisprudence au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne.
C’est cette évidence qui a continué à jalonner la jurisprudence européenne. Un arrêt de 20156 vient apporter des précisions en restant dans la même philosophie. L’article 267 TFUE attribue compétence à la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, tant sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union que sur la validité de ces actes. Cet article dispose, à son deuxième alinéa, qu’une juridiction nationale peut soumettre de telles questions à la Cour, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement et, à son troisième alinéa, qu’elle est tenue de le faire si ses décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne7.
La Cour rappelle, en particulier, que l’obligation de saisir la Cour d’une question préjudicielle que prévoit l’article 267, troisième alinéa, TFUE à l’égard des juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours s’inscrit dans le cadre de la coopération, instituée en vue d’assurer la bonne application et l’interprétation uniforme du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres, entre les juridictions nationales, en leur qualité de juges chargés de l’application du droit de l’Union, et la Cour8.
La Cour a précisé qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu’une question de droit de l’Union se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu’elle n’ait constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. La Cour a ajouté que l’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de l’Union9.
Une juridiction nationale de rang inférieur à la juridiction de renvoi ayant saisi la Cour pour l’interroger sur une question de droit de l’Union semblable à celle qui a été soulevée devant la juridiction de renvoi et qui porte exactement sur la même problématique, se pose la question de savoir si une telle circonstance fait obstacle à ce que les critères qui ressortent de l’arrêt Cilfit et a.10, pour fonder l’existence d’un acte clair et, notamment, celui selon lequel l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse place a aucun doute raisonnable, soient remplis.
Sur ce point, la Cour rappelle qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour11.
Par ailleurs, la Cour souligne que la jurisprudence découlant de l’arrêt Cilfit et a.12 laisse à la seule juridiction nationale le soin d’apprécier si l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable et, en conséquence, de décider de s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union qui a été soulevée devant elle13 et de la résoudre sous sa propre responsabilité14.
Il en découle qu’il appartient aux seules juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne d’apprécier, sous leur propre responsabilité et de manière indépendante, si elles sont en présence d’un acte clair15.
Les notions d’évidence et d’absence de doute sont ainsi une constante dans l’appréciation de l’acte clair par la cour de justice de l’Union européenne. Cependant, si de nombreux arrêts préjudiciels ont été rendus, conduisant à estimer que telle législation, règlementation ou jurisprudence n’est pas conforme à telle interprétation du droit de l’Union européenne, la Cour crée aujourd’hui un précédent en condamnant la France en manquement pour défaut de renvoi préjudiciel par une juridiction suprême, en l’occurrence, le Conseil d’État. C’est la succession de jurisprudences ayant noué un dialogue implicite entre les deux juridictions (I) qui conduit la Cour à dessiner un nouveau cas de manquement d’État pour excès de clarté (II).
I – Succession de décisions juridictionnelles et dialogue des juges
S’il est une matière aux contours difficiles, c’est bien le droit fiscal, dont les méandres nationaux comme européens sont souvent complexes, pour le profane comme pour le spécialiste. La matière peut appeler aussi des politiques jurisprudentielles fondées sur des conceptions qui divergent selon les ordres et traditions juridiques. Le juge administratif est traditionnellement inscrit dans un dialogue avec le juge européen (A), dialogue qui avait cependant, en l’espèce, conduit le Conseil d’État à estimer ne pas avoir à saisir la Cour (B).
A – Le dialogue et les jurisprudences
Il faut en premier lieu souligner que le Conseil d’État était d’emblée inscrit dans une logique de dialogue, par la saisine initiale qu’il avait effectuée, précisément sur la question fiscale en cause dans l’arrêt du 4 octobre 2018. En effet,saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’État, la Cour, dans son arrêt du 15 septembre 2011, Accor16, a indiqué, tout d’abord, au point 49, que, contrairement aux dividendes provenant de filiales résidentes, la législation française ne permettait pas de prévenir l’imposition intervenue au niveau de la filiale distributrice non-résidente, alors que les dividendes perçus tant des filiales résidentes que des filiales non-résidentes étaient, lors de leur redistribution, soumis à précompte.
La Cour en a conclu, au point 69 de cet arrêt, qu’une telle différence de traitement entre les dividendes distribués par une filiale résidente et ceux distribués par une filiale non-résidente était contraire aux articles 49 et 63TFUE. La Cour avait aussi affirmé, au point 92 de ce même arrêt, qu’un État membre devait pouvoir être en mesure de déterminer le montant de l’impôt sur les sociétés acquitté dans l’État membre d’établissement de la société distributrice et devant faire l’objet de l’avoir fiscal accordé à la société mère bénéficiaire, et que, partant, il n’était pas suffisant d’apporter la preuve que la société distributrice avait été imposée, dans son État membre d’établissement, sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués, sans fournir les informations relatives à la nature et au taux de l’impôt ayant effectivement frappé les bénéfices précités.
La Cour a encore précisé, aux points 99 et 101 de ce même arrêt, que les justificatifs requis doivent permettre aux autorités fiscales de l’État membre d’imposition de vérifier, de façon claire et précise, si les conditions d’obtention d’un avantage fiscal sont réunies et que la demande de production de ces éléments doit intervenir pendant la période de conservation légale des documents administratifs et comptables, telle que prévue par le droit de l’État membre d’établissement de la filiale, sans qu’il puisse être demandé de fournir des documents qui couvrent une période excédant de manière conséquente cette période.
La Cour avait lors répondu au renvoi préjudiciel de la manière suivante. Selon elle, les articles 49 TFUE et 63 TFUE s’opposent à une législation d’un État membre ayant pour objet d’éliminer la double imposition économique des dividendes telle que celle en cause en l’espèce qui permet à une société mère d’imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l’avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s’ils proviennent d’une filiale établie dans cet État membre, mais n’offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d’une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n’ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l’octroi d’un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale.
Elle avait encore affirmé que les principes d’équivalence et d’effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société-mère des sommes de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d’autres États membres, donnant lieu à redistribution par ladite société-mère, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu’il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres, alors même que, à l’égard des filiales installées en France, ces mêmes éléments, connus de l’Administration, ne sont pas exigés. La production de ces éléments ne peut cependant, toujours selon la position de la Cour,être requise que sous réserve qu’il ne s’avère pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d’apporter la preuve du paiement de l’impôt par les filiales établies dans les autres États membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation desdits États membres se rapportant à la prévention de la double imposition et à l’enregistrement de l’impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu’à la conservation des documents administratifs. Il appartenait donc à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont satisfaites dans l’affaire en cause. Il revenait dès lors au Conseil d’État de faire application de cette interprétation donnée par la Cour de justice européenne, voix autorisée de l’interprétation du droit européen originaire et dérivé.
B – L’interprétation retenue par le Conseil d’État
À la suite du prononcé de l’arrêt du 15 septembre 2011, Accor17, le Conseil d’État a, dans ses arrêts du 10 décembre 2012, Rhodia, et du 10 décembre 2012, Accor18, fixé les conditions auxquelles est subordonnée la restitution des précomptes mobiliers perçus en violation du droit de l’Union.
Ainsi, s’agissant, en premier lieu, de l’étendue du remboursement des précomptes mobiliers, le Conseil d’État a jugé que dans le cas où le dividende redistribué à une société-mère française par l’une de ses filiales établie dans un autre État membre n’a pas été imposé au niveau de cette dernière société, l’impôt acquitté par la sous-filiale ayant réalisé les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués n’a pas à être pris en compte pour la détermination du précompte à restituer à la société-mère19 ; lorsqu’une société distributrice a supporté dans l’État membre un impôt effectif à un taux supérieur au taux normal de l’impôt français, soit 33,33 %, le montant du crédit d’impôt auquel elle peut prétendre doit être limité au tiers des dividendes qu’elle a reçus et redistribués20. Le juge administratif avait ainsi affirmé, qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêt précité de la Cour de justice de l’Union européenne que, lorsque les bénéfices sous-jacents aux dividendes versés par la filiale établie dans un autre État membre sont soumis, dans l’État de la société distributrice, à un impôt supérieur à l’impôt prélevé par l’État membre de la société bénéficiaire, ce dernier n’est contraint d’accorder un crédit d’impôt que dans la limite du montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société bénéficiaire et n’est pas tenu de rembourser la différence, c’est-à-dire le montant acquitté dans l’État de la société distributrice qui excède le montant de l’impôt dû dans l’État membre de la société bénéficiaire ; que, par suite et ainsi que le soutient le ministre, lorsqu’une société distributrice a supporté dans l’État membre un impôt effectif à un taux supérieur au taux normal de l’impôt français, soit 33,33 %, le montant du crédit d’impôt auquel elle peut prétendre doit être limité au tiers des dividendes qu’elle a reçus et redistribués.
S’agissant, en second lieu, des preuves à fournir au soutien de demandes de remboursement, le Conseil d’État a constaté l’opposabilité des déclarations de précompte en vue de la détermination du montant des dividendes perçus des filiales établies dans un autre État membre21 ; a nécessité de disposer de tous les éléments de nature à justifier le bien-fondé de la demande de remboursement pendant toute la durée de la procédure, sans que l’expiration du délai légal de conservation n’entraîne dispense de cette obligation22. Le Conseil d’État avait alors jugé qu’il appartient à une société ayant présenté une réclamation tendant à la restitution du précompte de disposer de tous les éléments de nature à justifier le bien-fondé de sa demande pendant toute la durée de la procédure ; que l’expiration du délai légal de conservation de tels documents ne peut la dispenser de cette obligation ; qu’il en va notamment ainsi pour la conservation des documents fiscaux dans les pays concernés par cette demande.
C’est à la suite de ces arrêts que plusieurs plaintes ont été déposées en tant que les décisions nationales ne respectent pas le droit européen en général et les interprétations juridictionnelles en particulier.
II – Un nouveau cas de manquement d’État pour « excès de clarté »
Le Conseil d’État est le créateur du traditionnel recours pour excès de pouvoir. Il est désormais à l’origine de ce que l’on pourrait appeler le manquement « pour excès de clarté », sous-entendu, excès d’usage de la théorie de l’acte clair.
À la suite des plaintes déposées, une procédure précontentieuse puis contentieuse s’est engagée. Le gouvernement français ayant maintenu ses positions, la commission a saisi la Cour de justice de l’Union européenne23 ; quatre griefs étaient reprochés à la France.
Deux ont été retenus, conduisant à condamner l’État en manquement (A), dessinant alors les contours de ce nouveau manquement d’État (B).
A – La France condamnée en manquement
La commission invoquait quatre griefs devant la Cour, les trois premiers étant tirés de la violation des articles 49 et 63 TFUE, tels qu’interprétés par la Cour dans l’arrêt du 15 septembre 2011, Accor, ainsi que des principes d’équivalence et d’effectivité, le quatrième grief étant tiré de la violation de l’article 267, troisièmealinéa, TFUE.
Si la Cour écarte quelques-uns des arguments développés par la commission, elle juge que la France a violé plusieurs dispositions des traités en se conformant insuffisamment aux arrêts précédemment rendus par la Cour.
En effet, dans l’arrêt Accor du 15 septembre 201124, la Cour de justice avait indiqué que la différence de traitement entre les dividendes distribués par une filiale résidente et ceux distribués par une filiale non-résidente était contraire au droit de l’Union et que le mécanisme français de prévention de la double imposition n’était pas compatible avec les dispositions du traité.
Plus précisément, les articles 49 TFUE et 63 TFUE s’opposent à une législation d’un État membre ayant pour objet d’éliminer la double imposition économique des dividendes telle que celle en cause au principal, qui permet à une société-mère d’imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l’avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s’ils proviennent d’une filiale établie dans cet État membre, mais n’offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d’une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n’ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l’octroi d’un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale.
Le droit de l’Union s’oppose à ce que, lorsqu’un régime fiscal national tel que celui en cause ne se traduit pas en lui-même par la répercussion sur un tiers de la taxe indûment acquittée par le redevable de celle-ci, un État membre refuse le remboursement des sommes payées par la société-mère, au motif soit que ce remboursement entraînerait pour celle-ci un enrichissement sans cause, soit que la somme acquittée par la société-mère ne constitue pas pour celle-ci une charge comptable ou fiscale, mais s’impute sur la masse des sommes susceptibles d’être redistribuées à ses actionnaires.
Les principes d’équivalence et d’effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société-mère des sommes de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d’autres États membres, donnant lieu à redistribution par ladite société-mère, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu’il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres, alors même que, à l’égard des filiales installées en France, ces mêmes éléments, connus de l’Administration, ne sont pas exigés. La production de ces éléments ne peut cependant être requise que sous réserve qu’il ne s’avère pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d’apporter la preuve du paiement de l’impôt par les filiales établies dans les autres États membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation desdits États membres se rapportant à la prévention de la double imposition et à l’enregistrement de l’impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu’à la conservation des documents administratifs. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont satisfaites dans l’affaire dont la Cour était alors saisie par le juge administratif français suprême.
Le Conseil d’État a rendu, à la suite de l’arrêt Accor, plusieurs arrêts qui ont provoqué des plaintes adressées à la commission. Celle-ci a relevé que certaines conditions relatives au remboursement du précompte mobilier prévues par ces arrêts étaient susceptibles de constituer des violations du droit de l’Union. La France ayant refusé d’accéder à l’avis de la commission lui enjoignant d’adopter certaines mesures, la commission a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice.
Dans son arrêt du 4 octobre 2018, la Cour rappelle que, à l’égard d’une réglementation fiscale visant à prévenir la double imposition économique des bénéfices distribués, la situation d’une société actionnaire percevant des dividendes d’origine étrangère est comparable à celle d’une société actionnaire percevant des dividendes d’origine nationale dans la mesure où, dans les deux cas, les bénéfices réalisés sont, en principe, susceptibles de faire l’objet d’une imposition en chaîne. Or le droit de l’Union impose à un État membre qui connaît un système de prévention de la double imposition économique dans le cas de dividendes versés à des résidents par des sociétés résidentes d’accorder un traitement équivalent aux dividendes versés à des résidents par des sociétés non-résidentes.
La Cour constate ainsi que la France était tenue, pour mettre fin au traitement discriminatoire dans l’application du mécanisme fiscal visant à la prévention de la double imposition économique des dividendes distribués, de prendre en compte l’imposition subie antérieurement par les bénéfices distribués résultant de l’exercice des compétences fiscales de l’État membre d’origine des dividendes, dans les limites de sa propre compétence d’imposition, indépendamment de l’échelon de la chaîne de participation auquel cette imposition a été subie, à savoir par une filiale ou une sous-filiale. La France a donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.
En réalité les deux griefs retenus par la Cour sont étroitement liés. C’est parce que le Conseil d’État a persisté dans une application jugée erronée du droit européen et qu’il a insuffisamment tiré les conséquences des arrêts précédemment rendus par la Cour et donc implicitement, insuffisamment participé au dialogue qu’induit le jeu du renvoi préjudiciel que le grief tiré de la violation des articles 49 et 63, et des principes d’équivalence et d’effectivité a été retenu. Ce faisant, au lieu d’en rester à un simple constat de manquement aux dispositions matérielles, la Cour dessine les contours d’un manquement procédural.
B – Les contours du nouveau cas de manquement
La nouveauté du manquement ainsi retenu peut s’analyser à plusieurs niveaux. En premier lieu, la nouveauté peut être jugée relative, voire de nature redondante. En effet, de deux choses l’une en cas d’absence de renvoi préjudiciel comme en l’espèce : soit le juge national qui n’utilise pas cette voie procédurale commet une erreur et conduit alors son État à une condamnation en manquement en raison de la mauvaise interprétation et application du droit originaire ou dérivé applicable à l’espèce ; soit l’absence d’utilisation de la procédure en raison d’une estimation de la clarté de l’acte ne conduit pas à une violation du droit européen et dans ce cas, aucun manquement ne sera avéré.
L’avocat général25 expose très précisément la philosophie de la condamnation qu’il proposait et que la Cour a suivie sur le principe de violation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE. Selon lui, ce grief ne peut s’envisager que dans l’hypothèse où l’un (ou plusieurs) des autres griefs est fondé. Comme la commission le précise elle-même, ce dernier grief est limité au fait que le Conseil d’État a manqué à son obligation « dans les circonstances de l’espèce » c’est-à-dire les suites de l’arrêt du 15 septembre 2011, Accor. Il ne vise donc pas un manquement structurel à l’obligation de renvoi préjudiciel qui pèse sur le Conseil d’État en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE.
L’avocat général met d’emblée en évidence la circonstance que c’est la première fois que la Cour est amenée à se prononcer sur un grief de cette nature dans le cadre d’un recours en manquement. Cependant, la possibilité théorique d’un manquement étatique fondé sur une violation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE apparaît « certaine » sous la plume de l’avocat général.
Il est de jurisprudence constante que « la responsabilité d’un État membre au regard de l’article 258 TFUE est engagée, quel que soit l’organe de l’État dont l’action ou l’inaction est à l’origine du manquement, même s’il s’agit d’une institution constitutionnellement indépendante ». D’autre part, la Cour a rejeté l’argument selon lequel il serait difficile de remédier à un manquement au motif qu’il trouverait son origine dans un arrêt d’une juridiction suprême.
Cette possibilité est, selon l’avocat général, non seulement cohérente avec le but poursuivi par l’obligation de saisine prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, mais également avec les conditions du régime de responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l’Union.
L’obligation de saisine prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE a notamment pour but de prévenir que s’établisse, dans un État membre, une jurisprudence nationale qui ne concorde pas avec les règles du droit de l’Union26. Comme l’a souligné l’avocat général Bot, le non-respect par les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne de leur obligation de renvoi conduit à priver la Cour de la mission fondamentale qui lui est assignée à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, qui est d’assurer « le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités »27.
Il ressort d’une jurisprudence constante que l’inexécution de l’obligation de renvoi préjudiciel imposée à l’article 267, troisième alinéa, TFUE est un des éléments qui doit être pris en compte dans l’examen de la responsabilité d’un État membre en raison d’une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort.
La possibilité de reconnaître un manquement dans le chef d’un État membre en raison d’une violation de l’obligation de renvoi préjudiciel est d’autant plus justifiée lorsque celle-ci fait suite à un premier arrêt de la Cour. En effet, selon la Cour, l’obligation qui pèse sur un État membre aux termes de l’article 260, paragraphe 1, TFUE signifie que « tous les organes de l’État membre concerné ont l’obligation d’assurer, dans les domaines de leurs pouvoirs respectifs, l’exécution de l’arrêt de la Cour. [C’est ainsi que les juridictions de l’État membre concerné ont de leur côté l’obligation d’assurer le respect de l’arrêt dans l’exercice de leur mission] »28. Affirmée à propos de l’exécution d’un arrêt en constatation de manquement, la même conclusion s’impose à l’égard des juridictions ayant interrogé la Cour à titre préjudiciel puisque les arrêts en interprétation de la Cour ont un effet « généralisé » dans l’ordre juridique de l’Union : une fois qu’une disposition de droit de l’Union a été interprétée par la Cour de justice, cette interprétation s’impose à toutes les juridictions. Cette interprétation précise la signification et la portée de la règle du droit de l’Union en cause telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur.
Par conséquent, selon l’avocat général, si la juridiction à l’origine de la question préjudicielle éprouve encore des doutes sur le sens de la règle et qu’elle est une juridiction de dernier ressort, elle a alors l’obligation de réinterroger la Cour. En effet, dans ces circonstances, la réponse de la Cour apparaît nécessaire pour la solution du litige de telle sorte que, conformément à l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit et a.29, l’obligation de renvoi est « constituée »30.
En effet, l’avocat général rappelle, s’agissant de la portée de cette obligation, que la Cour a confirmé qu’il résultait désormais « d’une jurisprudence consolidée depuis le prononcé de l’arrêt Cilfit et a.31 qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu’une question de droit de l’Union se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu’elle n’ait constaté que la question soulevée n’est pas pertinente [c’est-à-dire “dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige”]ou que la disposition du droit de l’Union concernée a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable »3233.
En deuxième lieu, et au regard de l’analyse de l’avocat général présentée plus haut, il y a donc surtout une haute portée symbolique à la décision de la Cour de retenir le manquement d’État à raison de l’absence de renvoi préjudiciel. Car sur le fond du droit, la mise en évidence de la matière du manquement pouvait suffire. C’était d’ailleurs le cas jusqu’à présent.
En troisième lieu et en conséquence des deux précédents, le manquement d’État devrait désormais, même si tout dépendra de la postérité de l’arrêt du 4 octobre 2018, pouvoir s’étudier en deux temps que sont d’une part, le manquement matériel et d’autre part, le manquement procédural – en l’occurrence, pour défaut de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne.
Ainsi, selon la commission, le Conseil d’État aurait dû procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour avant de fixer les modalités de remboursement du précompte mobilier dont la perception avait été jugée incompatible avec les articles 49 et 63 TFUE par l’arrêt du 15 septembre 2011, Accor34.
La Cour rappelle que le Conseil d’État est une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, et à laquelle il incombe de procéder à un renvoi préjudiciel lorsqu’elle est saisie d’un litige soulevant une question d’interprétation du droit de l’Union.
La Cour estime que le Conseil d’État a eu tort de ne pas la saisir alors même que les éléments juridiques en présence n’étaient pas d’une clarté telle qui pouvait justifier l’absence de renvoi. Elle indique en effet que la compatibilité avec le droit de l’Union des restrictions résultant des arrêts du Conseil d’État apparaît, selon ses termes, « à tout le moins, douteuse », au regard notamment de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation35. Selon cet arrêt, rendu en grande chambre, sur renvoi préjudiciel d’un juge britannique, sur des questions comparables, Les articles 49 TFUE et 63 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui applique la méthode d’exonération aux dividendes d’origine nationale et la méthode d’imputation aux dividendes d’origine étrangère, s’il est établi, d’une part, que le crédit d’impôt dont bénéficie la société bénéficiaire des dividendes dans le cadre de la méthode d’imputation est équivalent au montant de l’impôt effectivement payé sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués et, d’autre part, que le niveau d’imposition effectif des bénéfices des sociétés dans l’État membre concerné est généralement inférieur au taux d’imposition nominal prévu
Répondant à un argument du gouvernement français dans sa défense, la Cour estime que la simple circonstance que la commission retient une acception différente des principes dégagés dans l’arrêt du 15 septembre 2011, Accor36, de celle mise en avant par le Conseil d’État témoignerait de ce que les solutions qui se dégagent de ces arrêts ne pourraient bénéficier d’une « présomption de compatibilité avec le droit de l’Union ».
Face aux arguments selon lesquels la commission est restée en défaut de préciser les difficultés auxquelles le Conseil d’État aurait été confronté dans les espèces qui ont abouti aux arrêts visés par cette institution et qui auraient justifié un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE et selon lesquels les seules difficultés auxquelles le Conseil d’État a été confronté auraient été, en réalité, des difficultés d’ordre factuel, et non des difficultés d’interprétation du droit de l’Union, la Cour apporte une réponse de confirmation du caractère essentiel à l’uniformité d’interprétation du droit européen du renvoi préjudiciel.
Ainsi la Cour retient la thèse soutenue par la commission en tant que le Conseil d’État, en tant que juridiction statuant en dernier ressort, ne pouvait procéder à l’interprétation du droit de l’Union, telle qu’elle découle de ses arrêts du 10 décembre 2012, Rhodia37, et du 10 décembre 2012, Accor38, sans avoir, au préalable, interrogé la Cour au moyen d’un renvoi préjudiciel.
La Cour rappelle alors une série de principes qui, eux, ne sont pas constitutifs d’une nouveauté jurisprudentielle. Elle insiste ainsi sur l’obligation des États membres de respecter les dispositions du TFUE, qui s’impose à toutes leurs autorités, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles. La Cour a en effet déjà eu l’occasion, à maintes reprises, de préciser que toutes les autorités, qu’elles soient locales, exécutives, législatives ou juridictionnelles, doivent respecter le droit européen. S’agissant de la violation du droit européen à raison d’une décision juridictionnelle, un des arrêts essentiels de la Cour est l’arrêt Köbler de 200339. En vertu de ce dernier, le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables est également applicable lorsque la violation en cause découle d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort, dès lors que la règle de droit communautaire violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées. Afin de déterminer si la violation est suffisamment caractérisée lorsque la violation en cause découle d’une telle décision, le juge national compétent doit, en tenant compte de la spécificité de la fonction juridictionnelle, rechercher si cette violation présente un caractère manifeste. C’est à l’ordre juridique de chaque État membre qu’il appartient de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à ladite réparation40.
Ainsi, selon la Cour, un manquement d’un État membre peut être, en principe, constaté au titre de l’article 258 TFUE quel que soit l’organe de cet État dont l’action ou l’inaction est à l’origine du manquement, même s’il s’agit d’une institution constitutionnellement indépendante41.
La Cour insiste sur la circonstance que, dans la mesure où il n’existe aucun recours juridictionnel contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la Cour au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE dès lors qu’une question relative à l’interprétation du TFUE est soulevée devant elle42. La Cour a en effet déjà jugé que l’obligation de saisine prévue à cette disposition a notamment pour but de prévenir que s’établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit de l’Union43. Il faut noter qu’une telle obligation n’incombe pas à cette juridiction lorsque celle-ci constate que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, l’existence d’une telle éventualité devant être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de l’Union44.
En l’espèce, la Cour suit l’avocat général qui avait indiqué, dans ses conclusions, que dans le silence de l’arrêt du 15 septembre 2011, Accor, le Conseil d’État a choisi de s’écarter de l’arrêt du 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation45 au motif que le régime britannique en cause était différent du régime français de l’avoir fiscal et du précompte, alors qu’il ne pouvait être certain que son raisonnement s’imposerait avec la même évidence à la Cour.
La Cour ajoute que l’absence d’un renvoi préjudiciel de la part du Conseil d’État dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 10 décembre 2012, Rhodia46, et du 10 décembre 2012, Accor47, a amené celui-ci à adopter, dans lesdits arrêts, une solution fondée sur une interprétation des dispositions des articles 49 et 63 TFUE qui est en contradiction avec celle retenue par le juge européen, ce qui implique que l’existence d’un doute raisonnable quant à cette interprétation ne pouvait être exclue au moment où le Conseil d’État a statué. Pourtant, on soulignera que les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne faisaient bel et bien partie des visas dans les arrêts litigieux du Conseil d’État de 2012. Ce dernier avait en effet indiqué que « considérant que, par l’arrêt précité du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la liberté d’établissement et l’article 63 de ce traité relatif à la liberté de circulation des capitaux s’opposaient à la législation d’un État membre, telle que la législation française, ayant pour objet d’éliminer la double imposition économique des dividendes et qui permet à une société-mère d’imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l’avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s’ils proviennent d’une filiale établie dans cet État membre, mais n’offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d’une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n’ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l’octroi d’un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale ; et que, par suite, les dispositions régissant l’avoir fiscal et le précompte alors en vigueur, en tant qu’elles n’avaient pas autorisé une société-mère française à imputer, sur le précompte dont elle était redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales établies dans un autre État membre de la communauté européenne, un crédit d’impôt ouvert sur le Trésor public français à raison de l’impôt effectivement acquitté par les filiales au titre des bénéfices réalisés et qu’elles ont distribués, méconnaissaient la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux garanties par le traité ; que, dès lors, une telle société est, sur le principe, fondée à se prévaloir d’un droit à la restitution du précompte calculée de telle sorte que ces dispositions soient neutres au regard de ces libertés ; qu’une atteinte à ces libertés existe lorsque les sommes versées par la société au titre du précompte sont supérieures à celles qu’elle aurait dû verser si un tel crédit d’impôt lui avait été octroyé ; qu’il y est remédié par la restitution des sommes de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de la société-mère établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d’autres États membres, lorsque ces dividendes ont donné lieu à redistribution par cette société-mère »48.
L’ensemble de l’interprétation retenue par le juge français n’est cependant pas celle que la Cour attendait. En conséquence, la cour juge que dès lors que le Conseil d’État a omis de saisir la Cour, selon la procédure prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, afin de déterminer s’il y avait lieu de refuser de prendre en compte, pour le calcul du remboursement du précompte mobilier acquitté par une société résidente au titre de la distribution de dividendes versés par une société non-résidente par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente, l’imposition subie par cette seconde société sur les bénéfices sous-jacents à ces dividendes, alors même que l’interprétation qu’il a retenue des dispositions du droit de l’Union dans les arrêts du 10 décembre 2012, Rhodia, et du 10 décembre 2012, Accor, ne s’imposait pas avec une telle évidence qu’elle ne laissait place à aucun doute raisonnable, la France a manqué à ses obligations européennes.
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne est au moins un rappel à l’ordre juridique européen. Peut-on pour autant esquisser une théorie d’un nouveau cas d’ouverture du recours en manquement : l’excès d’acte clair ? Cela n’est pas certain, tant s’en faut. La question s’inscrit plus largement dans la réflexion sur le dialogue des juges que l’actualité du droit européen, et plus précisément, du droit de la Convention européenne des droits de l’Homme renforcera nécessairement.
Alors que le protocole n° 16 de la Convention européenne des droits de l’Homme est invoqué, que la Cour de cassation a utilisé ce nouveau recours pour la première fois et que le Conseil d’État devrait également saisir la Cour49, le dialogue des juges est appelé à s’intensifier. La Cour de cassation a ainsi interrogé la Cour européenne des droits de l’Homme sur des questions sensibles de gestation pour autrui et de transcription des actes d’État civil en droit français pour des enfants nés de GPA. Rappelons le contexte pour présenter l’ouverture de ce nouveau dialogue. La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales50. Elle a considéré que le refus de transcription de l’acte de naissance de ces enfants nés d’un processus de GPA affectait significativement le droit au respect de leur vie privée et posait une question grave de compatibilité de cette situation avec l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour a estimé que cette analyse prenait un relief particulier lorsque l’un des parents d’intention était également le géniteur de l’enfant. Elle en a déduit qu’en faisant obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne de leur lien de filiation à l’égard de leur père biologique, l’État était allé au-delà de ce que lui permettait sa marge d’appréciation.
Selon la Cour de cassation, l’existence d’une convention de GPA ne fait pas nécessairement obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi à l’étranger dès lors qu’il n’est ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité biologique.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation confirme donc l’évolution de sa jurisprudence, tirant les conséquences de la position de la Cour européenne, marquée par les arrêts rendus en assemblée plénière le 3 juillet 201551 en outre, sur la nécessité, au regard de l’article 8 de la convention d’une transcription des actes de naissance en ce qu’ils désignent la « mère d’intention », indépendamment de toute réalité biologique, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé que l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les États parties à cet égard demeure incertaine au regard de la jurisprudence de la Cour européenne. Elle a décidé de surseoir à statuer sur les mérites du pourvoi et d’adresser, au terme d’une motivation développée, à la Cour européenne des droits de l’Homme, une demande d’avis consultatif.
En effet, le protocole 16, prévoit la possibilité pour les plus hautes juridictions des États parties, d’adresser des demandes d’avis consultatif à la Cour sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la convention ou ses protocoles. Le protocole n° 16 est entré en vigueur le 1er août 2018 à l’égard des États l’ayant signé et ratifié. La France fait partie de ces États et la Cour de cassation, puis le Conseil. Il faut néanmoins noter plusieurs différences entre ces nouvelles demandes d’avis et le traditionnel renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne. En premier lieu, dans ce nouveau cas de figure, les avis sont consultatifs, ce qui fait que les États membres peuvent ensuite se les réapproprier. En deuxième lieu, il existe, dans ce cas d’avis consultatif, la possibilité pour les juges n’ayant pas voté dans le sens de l’avis rendu, d’émettre des opinions dissidentes. Ainsi selon l’article 5 du protocole, les avis consultatifs ne sont pas contraignants. Selon son article 4, alinéa 2, « si l’avis consultatif n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée », tandis que son dernier alinéa précise que les avis sont publiés.
Si ce caractère consultatif peut a priori contraster avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il n’est pas improbable que les États suivent les avis, que leurs juridictions auront-elles-mêmes sollicités, et ce, d’autant plus dans les cas d’absence d’opinion divergente,
En somme, ces données témoignent d’une intensification du dialogue des juges, doublement classique et renouvelé. Classique et renouvelé, le dialogue l’est par le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union qui, par son arrêt du 4 octobre 2018.
Au regard des enjeux financiers de l’affaire rendue publique le 4 octobre 2018, il semble nécessaire de préconiser des renvois préjudiciels plus fréquents, quand bien même cela ralentirait la procédure juridictionnelle globale. Tout dépendra de la postérité de l’arrêt du 4 octobre 2018. Arrêt isolé, constitutif d’un rappel à la loi ou amorce d’une approche restrictive de l’acte clair ? Quelles que soient les raisons de l’erreur du juge national, la portée de l’arrêt de la cour supranationale, les enjeux du nouveau dialogue devant le juge supranational des droits de l’Homme, raison garder devrait être le maître mot. Un dialogue ne saurait se mener sans heurts ; la justice supranationale ne saurait non plus se voir engorgée de trop de renvois préjudiciels.
Il est à noter enfin, que le président de la section du contentieux, qui se trouve être aussi ancien référendaire à la Cour de justice des communautés européennes, 10 jours après que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ait été rendue publique, a choisi de publier une tribune dans une revue juridique52. Avant même d’apporter quelques réflexions sur le fond des propos tenus par le président dans sa tribune, on notera que cette réponse s’inscrit dans une tendance du Conseil d’État, adoptée depuis plusieurs mois déjà, à prendre position dans la presse ou, comme en l’espèce, dans des revues juridiques. Une certaine médiatisation, matérialisée d’ailleurs par la mise en place d’un poste de porte-parole du Conseil d’État depuis 201653, se voit ainsi confirmée.
Les termes, qui s’inscrivent à n’en pas douter dans un dialogue – que l’on souhaite non conflictuel – ne sont pas dénués d’ambiguïtés comme en témoignent les quelques mots suivants : après avoir débuté son propos en forme de nostalgie sur le temps, révolu, dans lequel l’Union européenne était une forme d’évidence. Cette appréciation, que l’on ne saurait à proprement parler qualifier de « juridique » est suivie d’une réflexion sur le dialogue des juges, dont la paternité revient à l’illustre prédécesseur, le président Genevois.
Ce dialogue des juges implique, selon le président actuel, un rôle fondamental des juges nationaux, qui ont « besoin d’être entendus et écoutés par Luxembourg ». Soulignant que, par les jurisprudences nationales, plusieurs pans de la vie économique et sociale sont pris en charge, il estime, en fin de tribune que la « sagesse commande (…) de ne pas cantonner le rôle des cours suprêmes à celui de l’interprétation de l’évidence ». Ces propos, en forme de réponse à l’arrêt de condamnation en manquement, à raison de ce que nous avons appelé l’abus de clarté, posent en réalité la question de la marge de manœuvre des États et des juges nationaux. Il est possible de lire, dans cette réponse, en creux, une demande de plus grande latitude laissée au juge national, au-delà même de l’acte clair. Sans doute la question mérite-t-elle d’être posée, mais en ayant à l’esprit l’importance de l’uniformité d’interprétation et du droit de l’Union qui ont fait la réussite de l’État de droit européen.
Gageons alors que chaque juge, dans ses prérogatives, fort de son expérience, saura, pour l’un, renvoyer à bon escient chaque fois que nécessaire, pour l’autre, dire le droit dans les limites des exigences et de la philosophie de la construction européenne.
Notes de bas de pages
-
1.
CE, 10 déc. 2012, n° 317074, Rhodia.
-
2.
CE, 10 déc. 2012, n° 317075, Accor.
-
3.
CJUE,4 oct. 2018, n° C 416/17.
-
4.
CJCE, 6 oct. 1982, n° 283/81, Cilfit.
-
5.
Ibid.
-
6.
CJCE, 9 sept. 2015, nos C-72/2014 et C-194/2014, X.
-
7.
CJUE, date, nos C-188/10 et C-189/10, Melki et Abdeli, pt 40.
-
8.
CJCE, 6 oct. 1982, n° 283/81, Cilfit et a., pt 7.
-
9.
CJCE, 6 oct. 1982, n° 283/81, Cilfit et a., pt 21.
-
10.
CJCE, 6 oct. 1982, n° 283/81, Cilfit et a.
-
11.
CJUE, n° C-111/11, Eon Aset Menidjmunt, pt 76.
-
12.
CJCE, 6 oct. 1982, n° 283/81, Cilfit et a.
-
13.
CJUE, 15 septembre 2005, n° C-495/03, Intermodal Transports, pt 37.
-
14.
CJCE, 6 oct. 1982, n° 283/81, Cilfit et a., pt 16.
-
15.
CJCE, 9 sept. 2015, nos C-72/2014 et C 194-2014, X., pts 54 à 59.
-
16.
CJCE, 15 septembre 2011, n° C-310/09.
-
17.
CJCE, 15 septembre 2011, n° C-310/09.
-
18.
CE, 10 déc. 2012, n° 317075.
-
19.
CE, 10 déc. 2012, n° 317074, Rhodia, pt 29 ; CE, 10 déc. 2012, n° 317075, Accor, pts 10 et s., spéc. pt 24.
-
20.
CE, 10 déc. 2012, n° 317074, Rhodia, pt 44 ; CE, 10 déc. 2012, n° 317075, Accor, pt 40.
-
21.
CE, 10 déc. 2012, n° 317074, Rhodia, pts 24 et 25 ; CE, 10 déc. 2012, n° 317075, Accor, pts 19 et 20.
-
22.
CE, 10 déc. 2012, n° 317074, Rhodia, pt 35 ; CE, 10 déc. 2012, n° 317075, Accor, pt 31.
-
23.
À la suite des arrêts du Conseil d’État, la commission a reçu plusieurs plaintes relatives aux conditions de remboursement des précomptes mobiliers acquittés par des sociétés françaises ayant reçu des dividendes d’origine étrangère. Les échanges d’informations entre la commission et la République française n’ayant pas satisfait cette institution, celle-ci a adressé aux autorités françaises, le 27 novembre 2014, une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle relevait que certaines conditions relatives au remboursement du précompte mobilier prévues par les arrêts du Conseil d’État étaient susceptibles de constituer des violations du droit de l’Union. La République française ayant contesté, dans sa réponse du 26 janvier 2015, les griefs qui lui étaient reprochés, la commission lui a notifié, le 29 avril 2016, un avis motivé lui enjoignant d’adopter les mesures pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis. La République française ayant maintenu sa position dans sa réponse du 28 juin 2016, la commission a introduit un recours en manquement sur le fondement de l’article 258TFUE.
-
24.
CJUE, 15 septembre 2011, n° C-310/09, rendu sur renvoi préjudiciel du CE.
-
25.
Conclusions de l’avocat général M. Melchior Wathelet présentées le 25 juillet 2018.
-
26.
CJUE, 15 mars 2017, n° C-3/16, Aquino, pt 33, cité par l’avocat général sur l’affaire du 4 oct. 2018 ici commentée.
-
27.
Conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Ferreira da Silva e Brito et a. (CJUE, 9 sept. 2015, n° C-160/14, pt 102).
-
28.
CJCE, 14 déc. 1982, nos 314/81 à 316/81 et 83/82, Waterkeyn et a., pt 14.
-
29.
CJCE, 6 oct. 1982, n° 283/81, Cilfit et a., pt 16.
-
30.
Lekkou E., comm. nº 24, in Karpenschif M. et Nourissat C. (dir.), Les grands arrêts de la jurisprudence de l’Union européenne, 3e éd., 2016, PUF, p. 131 à 136. Cité par l’avocat général dans ses concl. note 50.
-
31.
CJCE, 6 oct. 1982, n° 283/81, Cilfit et a.
-
32.
CJUE, 9 sept. 2015, n° C-160/14, Ferreira da Silva e Brito et a., pt 38. V. égal., en ce sens, CJUE, 15 sept. 2005, n° C-495/03, Intermodal Transports, pt 33 ; CJUE, 9 sept. 2015, nos C-72/14 et C-197/14, X et van Dijk, pt 55, CJUE, 1er oct. 2015, n° C-452/14, Doc Generici, pt 43.
-
33.
Pts 86 à 92 des conclusions de l’avocat général sur l’affaire ici commentée.
-
34.
CJUE, 15 sept. 2011, n° C-310/09, Accor.
-
35.
CJUE,13 nov. 2012, n° C-35/11.
-
36.
CJUE,15 sept. 2011, n° C-310/09.
-
37.
CE, 10 déc. 2012, n° 317074.
-
38.
CE, 10 déc. 2012, n° 317075.
-
39.
CJCE, 30 sept. 2003, n° C-224/01.
-
40.
Dispositif de CJCE, 30 sept. 2003, n° C-224/01.
-
41.
CJUE, 9 déc. 2003, n° C-129/00, Commission/Italie, pt 29 ; CJUE, 12 nov. 2009, n° C-154/08, Commission/Espagne, pt 125.
-
42.
CJUE, 15 mars 2017, n° C-3/16, Aquino, pt 42.
-
43.
CJUE, 15 mars 2017, n° C-3/16, Aquino, pt 33.
-
44.
Sur ce point, v. CJUE, 6 oct.1982, n° 283/81, Cilfit et a., pt 21 ; CJUE, 9 sept. 2015, n° C-160/14, Ferreira da Silva e Brito et a., pts 38 et 39 ; CJUE, 28 juill. 2016, n° C-379/15, Assoc. France Nature Environnement, pt 50.
-
45.
CJUE, 13 nov. 2012, n° C-35/11.
-
46.
CE, 10 déc. 2012, n° 317074, Rhodia,
-
47.
CE, 10 déc. 2012, n° 317075, Accor.
-
48.
CE, 10 déc. 2012, n° 317075, Accor.
-
49.
Audience d’assemblée du 5 octobre 2018 :par un pourvoi, la SARL Super Coiffeur demande au Conseil d’État : (…) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel subsidiairement, de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme, sur le fondement de l’article 1er du protocole n° 16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, d’une demande d’avis portant sur les conditions d’application de l’article 4 du protocole n° 7 à cette convention et sur le caractère opposable de la réserve d’interprétation formulée par la République française à propos de cette stipulation. Question justifiant l’examen de l’affaire par l’assemblée du contentieux : le juge administratif est-il compétent pour se prononcer sur la validité d’une réserve formulée par la France lors de la ratification d’un traité international et, plus particulièrement, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou de l’un de ses protocoles (en l’espèce, réserve à l’article 4 du protocole n° 7 sur le non bis in idem).
-
50.
CEDH, 5e sect., 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/France ; CEDH, 21 juill. 2016, nos 9063/14 et 10410/14, Foulon et Bouvet c/ France.
-
51.
Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, nos 14-21323 et 15-50002.
-
52.
Combrexelle J.-D., « Sur l’actualité du dialogue des juges », AJDA 2018, p. 1929.
-
53.
V. Chaltiel F., Le Conseil d’État, acteur et censeur de l’action publique, 2017, Lextenso.