« On parle de la dématérialisation de la justice, mais la réalité est qu’on travaille sur Word perfect, un logiciel créé en 1996 ! »
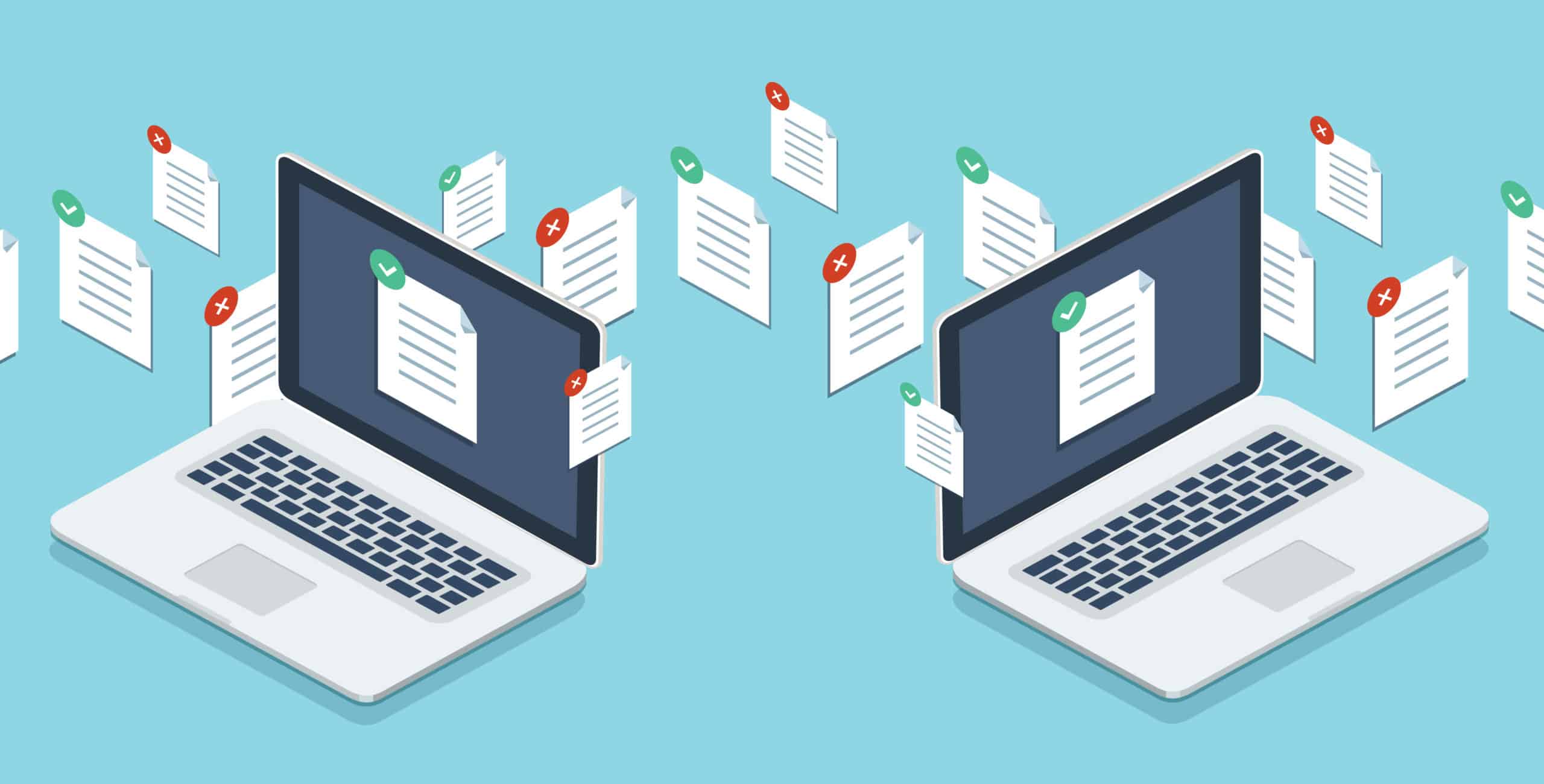
« Depuis la parution de l’appel des 3 000, on sent que ça bouge, les médias réagissent », se réjouit Cyril Jeanningros, magistrat au tribunal judiciaire de Créteil, membre de l’Union syndicale des magistrats (USM). Une lueur d’espoir dans un constat bien sombre. Sorti de l’ENM en 2017, il était un camarade de promotion de Charlotte Guichard, juge placée à Douai qui a mis fin à ses jours en août dernier. Pour lui, les jeunes magistrats ne peuvent plus se projeter dans leur métier sur le long terme. Pour le magistrat, le constat à tirer des contestations actuelles est celui d’une génération sacrifiée.
Actu-juridique : Que représente pour vous l’appel des 3 000 ?
Cyril Jeanningros : L’appel des 3 000 c’est le cri du cœur des jeunes magistrats. Le texte a été rédigé par des juges de moins de 30 ans, de manière spontanée. On s’est tous reconnus dans leur texte, qui parle du dilemme auquel nous sommes confrontés : juger vite et mal ou de manière juste mais dans des délais inacceptables. J’ai 31 ans et je suis magistrat depuis un peu plus de deux ans. Je m’occupe de la responsabilité contractuelle, qui recouvre les contentieux des baux commerciaux et du droit bancaire. C’est une procédure écrite, qui n’implique pas de recevoir les justicables. J’ai pris mes fonctions en septembre 2019. Quelques mois plus tard, nous avons été confrontés à la grève des avocats puis à la crise du Covid-19. Nous n’étions évidemment pas préparés à cela et avons dû nous adapter. Rien que depuis 2019, j’ai vu mes conditions de travail se dégrader à vue d’oeil.
AJ : Vous attendiez-vous à cela en devenant magistrat ?
C.J. : Contrairement à nos aînés, ma génération sait dès son entrée à l’École nationale de la magistrature (ENM) que l’institution est dégradée. On rentre en connaissance de cause. On sait qu’on part au front quand on s’engage dans la justice. Je crois qu’on est malgré tout loin d’imaginer l’ampleur des dégâts. Moi, en tout cas, je ne l’imaginais pas. Je pensais que ce que j’entendais était exagéré, que les anecdotes rapportées ici et là relevaient un peu de la légende.
En fait, tout est vrai. J’ai vu des greffiers dévisser des imprimantes dans des bureaux isolés pour récupérer des cartouches d’encre, parce qu’il n’y avait plus de budget pour en commander de nouvelles. Regardez le papier sur lequel , pour faire des économies, on imprime les jugements : il est gris, tout fin. On parle sans cesse de la dématérialisation de la justice, mais la réalité est qu’on travaille sur Word perfect, un logiciel créé en 1996. Certaines communications se font encore par fax. On est dans une situation similaire à celle de l’hôpital et de l’école.
AJ : Qu’est-ce qui fait que la magistrature continue d’attirer ?
C.J. : Personnellement, j’ai un parcours un peu atypique. Je ne rêve pas de la magistrature depuis mes 15 ans. En revanche, j’ai toujours eu l’envie de travailler dans le service public. Je suis normalien, je devais passer un concours de la catégorie A et je ne voulais pas passer l’agrégation. J’ai donc dû proposer un concours alternatif. À 25 ans, j’ai assisté au procès de Dominique Cottrez, jugée par la cour d’assises de Douai en 2015 pour le meurtre de huit de ses enfants. Cela m’a passionné et donné envie d’être magistrat.
Les assises sont à mon avis le dernier endroit où une justice de qualité existe, même si les jurés, qui viennent en transports en commun, repartent en taxi à minuit, sans que personne n’envisage de leur rembourser ces frais.
AJ : Que pensez-vous de la formation que vous avez reçue à l’ENM ?
C.J. : L’ENM est à mon sens une des dernières choses qui fonctionne bien dans la magistrature. On y reçoit une formation de grande qualité. On vous montre l’audience parfaite, l’instruction parfaite. C’est d’autant plus une déception de ne pas pouvoir mettre en pratique ce qu’on a appris. C’est violent de se retrouver obligé de faire un travail bâclé faute de temps et de moyens. Ce décalage est très dur à vivre. Charlotte Guichard, qui s’est suicidée au mois d’août, était une de mes camarades de promotion. Je la connaissais très bien. C’était une idéaliste, rêveuse, pleine d’ambition pour la justice. Elle s’est heurtée brutalement aux réalités du métier. D’autres anciens camarades ont été en détresse peu après leur prise de fonction. Par le bouche-à-oreille, je sais que plus de 25 de mes anciens camarades, sur une promotion de 350, ont fait un burn-out quelques mois seulement après avoir commencé à exercer leur métier.
AJ : Comment tenez-vous ?
C.J. : On fait un métier qu’on aime et on tient pour l’idéal qu’il représente. Dans les fonctions que j’exerce aujourd’hui, je me dis que je permets aux gens de récupérer une dette. De manière générale, on a l’impression d’être utile à la société.
En ce qui me concerne, je n’ai pas été immédiatement dans une situation d’épuisement. Mais les responsabilités viennent au fur et à mesure quand on exerce ses fonctions. Il faut se construire une protection mentale, accepter que la justice est dans un état piteux et qu’on n’en est pas responsable. C’était la seule manière de tenir. Le métier est déjà assez dur, il ne devrait pas y avoir de dimension sacrificielle. On travaille même en arrêt maladie car on n’est pas remplacés et on pense aux collègues qui devront faire le travail à notre place, ou aux dossiers qui vont s’être empilés en notre absence…
AJ : Avez-vous espoir que cela bouge ?
C.J. : L’appel des 3 000 tourne, et cela nous réconforte. Nous avons également reçu le soutien du barreau de Paris. J’espère que l’opinion prendra, elle aussi, conscience du problème. Les citoyens ne se sentent pas toujours concernés par les affaires pénales ou les conditions d’incarcération. Mais la justice, c’est aussi beaucoup le quotidien : 55 % des décisions de justice rendues concernent les affaires familiales. Nous avons, malheureusement, peu de leviers pour nous faire entendre. Nous ne pouvons pas faire grève. Les procédures disciplinaires ont été multipliées par 10 depuis qu’Éric Dupond-Moretti est garde des Sceaux. Cela ne pousse pas à la révolte.
AJ : Quelle est la situation dans le Val-de-Marne ?
C.J. : Créteil est dans le top trois des tribunaux les plus sinistrés, avec Marseille et Bobigny. Les délais d’audiencement permettent de mesurer objectivement la dégradation du tribunal. À Créteil, vous allez attendre 14 mois avant de rencontrer un juge aux affaires familiales si vous avez un désaccord autour de la pension ou du droit de garde de votre enfant. La décision sera rendue encore plusieurs semaines après cette rencontre. Cela dit, toutes les juridictions françaises sont en souffrance aujourd’hui, à des degrés variables. Nous sommes beaucoup trop peu pour rendre une justice digne de ce nom.
AJ : Quels sont les domaines les plus impactés ?
C.J. : À Créteil, les audiences correctionnelles sont complètement surchargées. Il y a une seule audience de comparution immédiate par jour, en dépit de l’accroissement de la délinquance. Cela veut dire qu’il faut juger 20 personnes par jour. L’audience commence à 13h. Soit on « juge » les gens en 20 minutes et on fait de ces audiences une autoroute vers la prison, soit on renvoie les dossiers sur d’autres audiences déjà surchargées, soit on termine à des heures indues. Cela arrive très souvent : une audience sur deux de comparution immédiate finit après minuit. Hier soir, l’audience s’est terminée à 3h15 du matin. C’est le cas une quinzaine de fois par an. On se retrouve aussi à tenir des audiences à juge unique pour des faits qui devraient être jugés en collégialité. C’est par exemple le cas des violences conjugales.
AJ : Quelle serait la solution ?
C.J. : La solution est connue de tous et depuis longtemps déjà : il faut former massivement de nouveaux juges. Les pouvoirs politiques, quels qu’ils soient, s’accordent pour ne pas donner à la justice les moyens d’exister. Je ne me l’explique pas. Nous venons de passer le cap des 9 000 magistrats. C’est à peine plus qu’au temps de Balzac : on dénombrait en effet 8 500 magistrats en 1830. Le Conseil de l’Europe, qui réunit 47 pays, a fait le calcul du nombre de juges et de procureur par habitant. La moyenne est de 21,4 juges et de 12 procureurs pour 100 000 habitants.
En France, avec 10,9 juges pour 100 000 habitants, nous avons moitié moins d’effectifs que cette moyenne. En ce qui concerne les procureurs, nous en avons 3 pour 100 000 habitants, le quart seulement de la moyenne des pays du Conseil de l’Europe. Cela nous place derrière la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Moldavie ou le Kosovo. Dans le Val-de-Marne, nous avons 94 juges et 34 procureurs pour une population de 1,4 million de personnes. Il nous faudrait 299 juges et 168 procureurs pour être dans la moyenne.
AJ : Le budget de la justice a pourtant augmenté…
C.J. : Le budget alloué à la justice a augmenté, mais tout est allé au renouvellement du parc des prisons – ce qui était nécessaire. Le budget de la justice judiciaire en réalité n’a augmenté que de 3 % et cet argent est parti dans ce que le garde des Sceaux appelle les « sucres rapides » : des assistants de justice, qui sont des contractuels titulaires d’un master. Ils ne prennent aucune décision mais doivent nous aider à les préparer, pour que l’on double notre production. Seulement, former ces assistants nous prend beaucoup de temps, et ils ne restent jamais longtemps. Sous François Hollande, il y avait eu quelques promotions importantes à l’ENM mais elles ont surtout compensé les nombreux départs des baby-boomers. On réclame que l’ENM tourne à plein régime pendant les prochaines années. Ce n’est malheureusement pas ce qui s’annonce : pour les deux prochaines années, les postes offerts à l’ENM vont être réduits. Il faudrait pourtant passer à 12 000 juges si l’on veut se situer dans la moyenne des pays du Conseil de l’Europe.
AJ : Comment vous projetez-vous dans ce métier ?
C.J. : Dans les années 80, les magistrats se projetaient dans ce métier pour toute une vie. Ils ont vu la situation se dégrader peu à peu, jusqu’à ce que le malaise devienne chronique au début des années 2000, alors qu’émergeait dans la société une forte demande de justice. Nous, on manque de perspectives.
Personnellement, je fais de mon mieux dans mon service mais je ne sais pas où je serai dans 10 ans. La mort de Charlotte a été un déclic. Je ne me mettrai pas en danger pour ce métier.
Référence : AJU003b0





