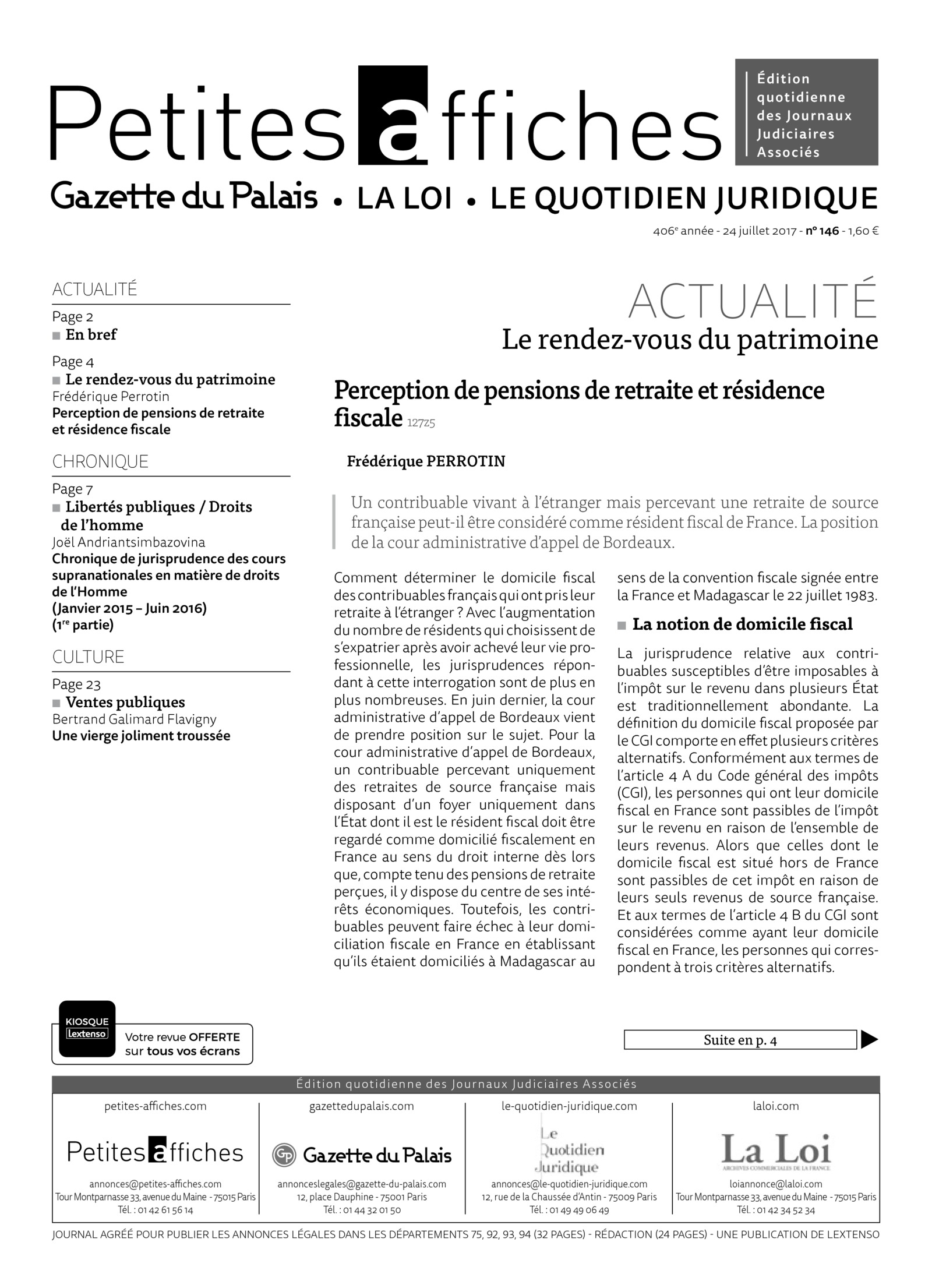Chronique de jurisprudence des cours supranationales en matière de droits de l’Homme (Janvier 2015 – Juin 2016) (1re partie)
Introduction
Les cours supranationales dérangent en ces périodes de repli de certains États sur eux-mêmes et de réaffirmation tapageuse de la souveraineté étatique. Elles font l’objet de contestations qui se manifestent sous différentes formes : soit politiquement par le gouvernement ou par des personnalités politiques soit juridiquement par des juridictions1.
Si l’on doit être attentif aux raisons de ces méfiances et de ces critiques des juridictions supranationales, l’on ne doit pas cependant oublier que ces cours sont les gardiennes de l’équilibre entre le pouvoir des États et les droits et libertés des individus. Cette fonction n’est pas seulement une fonction défensive, elle est aussi offensive et dynamique en ce que les cours supranationales assurent également l’adaptation de la démocratie politique aux évolutions de la société y compris par la promotion et le développement des libertés.
À travers quelques arrêts saillants, la présente livraison démontre combien les cours supranationales assurent un travail délicat de conciliation de différents droits et des libertés dans la prise en compte d’intérêts parfois divergents.
Elles doivent ainsi chercher à harmoniser les exigences du droit des Nations unies avec les droits de l’Homme au niveau régional, à protéger les droits de l’Homme en période de conflits armés, à apporter des réponses à des questions sociétales notamment concernant les minorités, l’orientation sexuelle ou la violence envers les femmes. Elles doivent également garantir au mieux le bon fonctionnement de la coopération pénale entre les États tant dans le cadre de l’extradition classique que dans le cadre du mandat d’arrêt européen. Elles sont aussi amenées à se prononcer sur les grands principes de la loi pénale comme le non bis in idem et la présomption d’innocence, à utiliser la technique de la « procéduralisation » afin de rendre effectif un droit substantiel comme le droit au logement, à maintenir le niveau de protection des libertés politiques à travers la liberté d’expression et le droit à des élections libres.
En ces périodes de tentation de limitation des droits de l’Homme, la jurisprudence des cours supranationales constitue un repère indispensable pour faire face à l’accroissement de la durée des enfermements, à l’augmentation des risques d’exploitation des données personnelles, à la permanence des attentats terroristes.
À travers ces exemples hétérogènes, le lecteur trouvera dans cette livraison, matière à réflexion.
I – Cours supranationales et rapports entre systèmes juridiques
Sur un pont aux ânes ? La Cour européenne des droits de l’Homme et l’exécution nationale des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies
Et de deux. La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la Cour) vient de condamner une nouvelle fois à travers la Suisse, le mécanisme onusien dit des « sanctions ciblées ». Dans l’arrêt Al-Dulimi et Montana Management Inc.2, la position de la Cour est restée invariable sur la désormais récurrente question de la compatibilité à la Convention de ce mécanisme tant décrié3. Étaient ici en cause deux résolutions du Conseil de sécurité mettant en place un embargo contre l’Irak après l’invasion du Koweït en 1990. Sur la base de ces résolutions, M. Al-Dulimi et la société Montana dont il était le dirigeant furent inscrits sur une liste de personnes dont les avoirs financiers ont été confisqués et transférés vers un Fonds de développement pour l’Irak. N’ayant pas obtenu leur radiation devant les autorités suisses, ils décidèrent de saisir la Cour en invoquant la violation de leur droit à un procès équitable.
Pour sa défense, le gouvernement suisse soutenu par les gouvernements français et britannique invoquait la primauté du droit onusien ne lui ayant laissé que le seul choix d’ignorer en l’espèce l’application de la Convention.
Sur le fond, la Cour apporte sans surprise satisfaction aux requérants et confirme l’absence d’immunité juridictionnelle de l’application nationale des résolutions du Conseil de sécurité (I). C’est en revanche le cheminement méthodologique ayant conduit à cette fin qui laisse subsister des incertitudes sur la régulation par la Cour des rapports entre les engagements onusiens et conventionnels incombant aux États (II).
I. La confirmation de l’absence d’immunité juridictionnelle des actes nationaux d’application des résolutions du Conseil de sécurité
Dans ce type d’affaire, la première étape du raisonnement de la Cour conduisant à une condamnation de l’État défendeur est désormais classique : la reconnaissance de la juridiction de la Suisse même en ayant agi sous impulsion onusienne (A). La seconde étape du raisonnement est quelque peu inédite. La Cour consacre une obligation de contrôle de l’absence d’arbitraire comme nouveau critère de la justiciabilité des actes nationaux d’application des résolutions du Conseil de sécurité (B).
A. La reconnaissance de la juridiction de l’État défendeur, fondement classique de la justiciabilité des actes nationaux d’application des résolutions du Conseil de sécurité
D’entrée de jeu, la Cour devait déterminer l’origine des violations alléguées par les requérants. Les mesures litigieuses étaient-elles « directement imputable[s] à la Suisse » ou au Conseil de sécurité ? Dans la première hypothèse soutenue par le requérant, l’adoption « d’actes propres de droit interne » par la Suisse afin de mettre en œuvre la résolution devrait suffire à engager sa responsabilité personnelle. Dans la seconde hypothèse, l’imputabilité des mesures litigieuses au Conseil de sécurité, comme l’ont défendu la Suisse et les gouvernements tiers-intervenants, repose sur la nature impérative des résolutions du Conseil de sécurité par l’effet combiné des articles 25 et 103 de la Charte de l’ONU et des précédents Behrami et Saramati. Dans ces deux décisions, la Cour avait en effet jugé que les actes accomplis par les États sous mandat de l’ONU et dans le cadre du chapitre VII de la Charte ne relevaient pas de sa compétence ratione personae4.
En deux mouvements successifs la Cour écarte cette argumentation pour reconnaître sa compétence ratione personae et ratione materiae, partant la juridiction de la Suisse. Tout d’abord, la Cour confirme une solution de principe par laquelle elle réduisait, dans les arrêts Al-Jedda et Al-Skeini, les hypothèses d’irresponsabilité conventionnelle des États agissant sous mandat de l’ONU. Elle y affirmait déjà – comme elle le rappelle fort opportunément en l’espèce – que « les parties contractantes sont responsables au titre de l’article 1 de la Convention de tous les actes de la Convention de tous les actes et omissions de leurs organes, qu’ils découlent du droit interne ou d’obligations juridiques internationales. L’article 1 ne fait aucune distinction à cet égard quant au type de normes ou de mesures et ne soustrait aucune partie de la “juridiction” des parties contractantes à l’empire de la Convention » (§ 95). Par conséquent, elle souscrit à l’analyse de la chambre pour qui « les actes nationaux d’application d’une résolution du Conseil de sécurité » (§ 94) suffisent à engager la responsabilité de la Suisse au titre de l’article 1 de la Convention. Sa compétence personnelle clairement établie, la Cour n’a pas eu de mal à reconnaître ensuite sa compétence matérielle. Les mesures nationales d’application de la résolution du Conseil de sécurité constituent une entrave à l’exercice du droit d’accès à un tribunal des requérants. À ce titre, la compétence matérielle de la Cour est donc clairement établie.
B. « L’obligation de s’assurer de l’absence d’arbitraire », nouveau critère de justiciabilité des actes nationaux d’application des résolutions du Conseil de sécurité
Consciente du juste équilibre à rechercher entre la nécessité de respecter les droits de l’Homme et les impératifs de la protection de la paix et de la sécurité internationales, la Cour souhaite néanmoins éviter tout arbitraire dans l’exécution par les États des résolutions du Conseil de sécurité. Là encore, la condamnation de la Suisse était prévisible. Mais c’est surtout sur le fondement de la condamnation que la Cour apporte, par un raisonnement aux relents constitutionnels, une innovation dans le contentieux européen des sanctions ciblées. En convoquant la nature constitutionnelle de l’ordre public européen institué par la Convention, la Cour rappelle aux États leur obligation d’en préserver les fondements parmi lesquels elle compte l’État de droit dont l’arbitraire est la négation (§ 145). Tirant les conséquences de cette affirmation, la Cour, dans ce qui apparaît vraisemblablement comme un avertissement de portée générale, juge que « l’État partie dont les autorités donneraient suite à l’inscription d’une personne – physique ou morale – sur une liste de sanctions sans s’être au préalable assuré – ou avoir pu s’assurer – de l’absence d’arbitraire dans cette inscription, engagerait sa responsabilité sur le terrain de l’article 6 de la Convention » (§ 147). La solennité de l’affirmation mérite qu’on s’y attarde pour en dégager quelques conséquences.
En premier lieu, l’arrêt Al-Dulimi et Montana s’inscrit incontestablement dans une perspective plus générale d’extension des fondements et des critères d’examen par la Cour de l’application par les États des résolutions du Conseil de sécurité mettant en place des sanctions ciblées. Après avoir reconnu la dimension procédurale et substantielle5 du contentieux des sanctions ciblées, la Cour élève ici le niveau de contrôle en cas de conflit entre les obligations issues de la Convention et celles découlant des résolutions du Conseil de sécurité. Même si elle s’en défend, la portée d’un tel contrôle est en réalité beaucoup plus large : le contrôle de l’arbitraire s’étend ici non seulement à une contestation de la décision d’inscription des personnes physiques ou morales sur les listes litigieuses mais aussi à tout refus de radiation (§ 147).
En second lieu, un tel degré d’exigence dans la protection de l’ordre public européen des droits de l’Homme ne manquera pas de rappeler l’approche de la CJCE dans l’arrêt Kadi6. Comme son homologue de Luxembourg en son temps, on peut voir dans la condamnation par la Cour de la violation des valeurs fondamentales de son ordre juridique, la défense de sa spécificité. À la seule différence que la lecture dualiste des relations entre l’ordre juridique de l’Union et l’ordre juridique onusien était assumé par la Cour de justice. Ce qui n’est pas le cas ici pour la Cour qui a manqué, dans son raisonnement, l’occasion de « prendre la Convention au sérieux »7 et laisse ainsi subsister des incertitudes d’ordre méthodologique sur la question des rapports de systèmes.
II. Les apories méthodologiques de la Cour sur la question de l’articulation entre les systèmes conventionnel et onusien
Au-delà de la condamnation de la Suisse, le véritable enjeu de l’arrêt commenté était surtout d’ordre méthodologique. En effet pour parvenir à ce résultat, la Cour a esquivé la question de la hiérarchie entre le droit onusien et le droit conventionnel en adoptant une interprétation extensive de la résolution litigieuse pour n’y déceler aucun conflit normatif (A). Ce faisant, la Cour semble renoncer au test de Bosphorus qui a été jusque-là considéré comme sa technique de gestion contentieuse des rapports de systèmes8 (B).
A. La négation d’un conflit entre les obligations onusiennes et conventionelles
Après avoir constaté l’existence et apprécié la légitimité de la limitation par l’État défendeur du droit d’accès au tribunal des requérants, la Cour devait ensuite se livrer au contrôle de proportionnalité d’une telle limitation. Un tel examen impliquait logiquement un positionnement de la Cour sur les relations entre la Convention et le droit onusien étant donné que la Suisse invoquait la nécessité d’appliquer la résolution 1483 pour justifier la limitation en question. Mais au prix d’un raisonnement passablement confus, la Cour réussit à se dispenser de « trancher la question de la hiérarchie entre les obligations des États parties à la Convention en vertu de cet instrument d’une part, et celles découlant de la Charte des Nations unies, d’autre part » (§ 141).
Les ressources argumentatives de la Cour menant à une telle issue sont désormais bien connues. Elle commence d’abord par rappeler la supériorité formelle et matérielle9 du droit onusien pour inférer ensuite, « dans un esprit d’harmonisation systémique », une présomption de compatibilité aux droits de l’Homme des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité. Cette présomption ne pouvant être renversée que dans l’hypothèse où la résolution contient une formule claire et explicite excluant ou limitant le respect des droits de l’Homme (§ 140). Niant l’évidence même10, la Cour, suivant une interprétation littérale juge qu’« aucune disposition [des résolutions 1483 ou 1518] n’interdisai[t] aux tribunaux suisses de vérifier, sous l’angle du respect des droits de l’Homme, les mesures prises au niveau national en application de ces résolutions » (§ 143). En effet, pour la Cour, le § 23 de la résolution 1483 prescrivant aux États de geler « sans retard » et de transférer « immédiatement » les avoirs et fonds des personnes visées ne peut être interprété comme excluant la possibilité d’un contrôle judiciaire des mesures prises pour son exécution (§ 148).
Une fois ce préalable posé, la Cour déclare sans objet la question de l’application du critère de la protection équivalente, une position fort contestable.
B. Le refus contestable d’appliquer le critère de la protection équivalente
Le critère de la protection équivalente a été mis en place par la Cour dans son arrêt Bosphorus Airways c/ Irlande du 30 juin 2005 et lui a servi depuis comme outil interprétatif d’articulation des « engagements parallèles et contradictoires »11 avec la Convention. La Cour consacrait une présomption de conventionalité des mesures prises par les États pour honorer les obligations découlant de leur participation à une autre organisation internationale à la seule condition que cette dernière garantisse une protection matérielle et procédurale équivalente à celle de la Convention. Mais contrairement à la chambre qui n’avait pas hésité à appliquer le critère de la protection équivalente, la Grande chambre a fait le choix contraire. Par une phrase laconique, elle juge sans objet la question de l’application de la protection équivalente couronnant un raisonnement par lequel elle niait l’existence d’un conflit entre les obligations onusiennes et conventionnelles ici en jeu. Un tel positionnement ne peut que laisser l’esprit mal satisfait et troublé d’autant plus qu’au fil de jurisprudences, la Cour a étendu l’application de ce critère à d’autres organisations internationales en dehors du seul contexte des rapports entre le droit de l’UE et la Convention. C’est donc fort à propos que plusieurs juges ont critiqué le choix de la Cour de ne pas retenir en l’espèce l’application du critère de la protection équivalente12.
Au final, les artifices du raisonnement de la Cour l’ayant conduit à écarter en l’espèce l’application du test de la protection équivalente présagent une sclérose au sein de la Cour du débat sur l’articulation entre le droit conventionnel et le droit onusien. Une situation qui rappelle certainement le débat sur la question des rapports entre le droit international et les droits internes, un débat qu’on a pu qualifier, à raison, d’un véritable pont aux ânes13.
Wenceslas Monzala
II – Cours supranationales et conflits armés
La protection des droits fondamentaux garantie dans des territoires sujets à conflits entre États parties à la Convention européenne
« La grandeur et la particularité d’une société démocratique se manifestent dans l’attention qu’elle accorde aux valeurs des droits de l’Homme, y compris en temps de troubles »14. Dans les arrêts Chiragov et autres c/ Arménie et Sargsyan c/ Azerbaïdjan du 15 juin 201515, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) confirme sa compétence dans un territoire sujet à des conflits entre des États parties à la Convention européenne, tel celui du Haut-Karabakh (« HK »), situé en Azerbaïdjan mais majoritairement habité par des Arméniens. En 1988, des manifestations y éclatent pour demander son rattachement à l’Arménie. En 1991, période de l’effondrement de l’Union soviétique, la République du « HK » (« RHK ») proclame son indépendance. Cependant elle n’est reconnue par aucun État ni aucune organisation internationale. Depuis, le conflit perdure. Dans l’affaire Chiragov et autres c/ Arménie, les requérants sont azerbaïdjanais. Dans Sargsyan c/ Azerbaïdjan, le requérant est arménien. Tous ont fui leur domicile et leurs biens, situés dans des zones de conflit, respectivement dans le corridor de Latchin et à Golestan. Ils se plaignent de griefs similaires : atteinte au droit au respect de leurs biens, au droit d’usage de ces derniers, au droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile et au droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. Avant de conclure à la violation continue, par l’Azerbaïdjan et l’Arménie, de ces droits reconnus par les articles 1 des protocoles nos 1, 8 et 13 de la Convention, la Cour détermine si les faits relèvent d’une « juridiction » d’un État partie au sens de l’article 1 de la Convention, cette condition étant indispensable pour engager la responsabilité de ce dernier et pour appliquer la Convention. À cet effet, la Cour adopte une position constante pour protéger la plénitude de la juridiction territoriale (I), et veille à éviter tout défaut de protection des droits fondamentaux au sein de l’espace d’applicabilité de la Convention (II).
I. La préservation de la juridiction territoriale
En refusant les déclarations à caractère trop général restreignant l’exercice de la juridiction sur une partie du territoire (A) et en présumant l’exercice de cette dernière sur l’ensemble du territoire (B), la Cour garantit l’essence de la juridiction territoriale.
A. Le refus des déclarations à caractère trop général restreignant la juridiction territoriale
Dans la décision de recevabilité de l’affaire Sargsyan c/ Azerbaïdjan16, la Cour rejette l’exception qui repose sur la déclaration ainsi libellée : « La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir l’application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d’Arménie jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation » (§ 59-71). La doctrine avait souligné avec étonnement que cette déclaration contenue dans l’instrument de ratification n’avait soulevé aucune observation ni objection de la part des autres parties à la Convention, voire du secrétaire général du Conseil de l’Europe17. Pour l’heure, la Cour reste conforme à sa jurisprudence18 en rappelant que l’article 56 de la Convention ne saurait exclure de la « juridiction » d’un État partie une portion de son territoire. Et, bien que l’Azerbaïdjan explicite que cette déclaration ne se fonde pas sur l’article 57 (§ 52), elle tient à démontrer que la déclaration ne constitue pas une réserve valide aux fins de ce même article à cause de son caractère trop général (§ 71). La Cour, constante, continue de préserver le caractère complet de la juridiction territoriale.
B. La présomption de l’exercice de la juridiction sur l’ensemble du territoire
Toujours dans l’affaire Sargsyan c/ Azerbaïdjan, la Cour refuse d’admettre l’existence de circonstances exceptionnelles permettant à l’Azerbaïdjan de limiter sa responsabilité. Pour commencer, elle souligne que Golestan est un territoire internationalement reconnu de l’Azerbaïdjan (§ 139). Ce dernier approuve, mais en s’appuyant sur l’affaire Ilasçu et autres c/ Moldova du 8 juillet 2004, il tente de renverser le principe selon lequel la juridiction est présumée s’appliquer normalement sur l’ensemble du territoire. Après avoir précisé les circonstances exceptionnelles qui l’amènent à limiter cette présomption, soit : l’occupation militaire par les forces armées d’un autre État qui contrôle effectivement ce territoire, les actes de guerre ou de rébellion, ou encore les actes d’un État étranger soutenant la mise en place d’un régime séparatiste, la Cour refuse d’y inclure les zones qu’elle qualifie de « contestées » (§ 146) car « faute de troupes étrangères présentes sur place, Golestan n’est ni occupé par des forces étrangères ni sous le contrôle effectif de telles forces » (§ 144). Dès lors, elle maintient la présomption de l’exercice de la juridiction de l’Azerbaïdjan.
II. La volonté d’éviter un défaut de protection des droits fondamentaux dans l’espace juridique de la Convention
La Cour rappelle son objectif : garantir la protection des droits individuels dans l’espace juridique de la Convention19. Ainsi, elle opère un « transfert »20 de responsabilité entre États parties en jugeant de l’exercice extraterritorial de l’un des États (A). En outre, elle confirme le caractère non absolu de la règle de l’épuisement des voies de recours internes (B).
A. La reconnaissance de l’exercice extraterritorial de la juridiction
Lors de l’arrêt Chiragov et autres c/ Arménie, la Cour établit la juridiction dont relève le district de Lachin afin de savoir, cette fois, si la responsabilité de l’Arménie est engagée. Or, la juridiction d’un État partie est présumée et se limite principalement à son territoire. Toutefois, elle se déploie exceptionnellement, si l’État partie exerce « un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire »21. Aussi, la Cour réunit différentes conditions pour fixer l’existence de ce contrôle : « l’ampleur de la présence militaire de l’État sur place, mais d’autres indicateurs, tels que le soutien économique et politique » (§ 169). Elle constate que la présence militaire de l’Arménie dans le « HK » a été à plusieurs égards officialisée (§ 175). De plus, elle note que la « RHK » bénéficie d’appuis politiques et financiers substantiels de l’Arménie. Partant, elle juge que cet État exerce un contrôle effectif car il manifeste : « une influence importante et déterminante » dans le « HK », et « que les deux entités sont hautement intégrées » (§ 186). Ainsi, la Cour conclut à l’exercice extraterritorial de la juridiction d’un État partie sur un territoire conflictuel situé dans un autre État partie.
B. La dispense de l’épuisement des voies de recours internes
La Cour rappelle qu’il ne lui est pas nécessaire de trancher les questions de juridiction pour se prononcer sur le respect de la règle de l’épuisement des voies de recours internes. Dans les deux affaires, pour insister sur le caractère subsidiaire de sa fonction, elle met l’accent sur le fondement de cette règle, expression de la souveraineté étatique22. Néanmoins, ici, elle reconnaît que « des difficultés considérables peuvent se poser en pratique pour une personne originaire de l’un quelconque des deux pays qui cherche à intenter et poursuivre une procédure judiciaire dans l’autre »23. Réaliste, la Cour admet la valeur non absolue de la règle car le recours ne présente pas de perspectives raisonnables de succès24.
Dans ces deux arrêts, l’interprétation de la notion de « juridiction » aboutit à une répartition des responsabilités étatiques25 qui est critiquée par certains26. Pour autant, la Cour a le mérite de garantir l’applicabilité de la Convention dans des territoires sujets à conflit entre États parties.
Nadège Carme
III – Cours supranationales et questions sociétales
A – Lutte contre la discrimination
D’une discrimination à l’autre, le courant ne passe pas (CJUE, 16 juill. 2015, n° C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD)
À l’heure où la grogne monte en France au sujet de l’installation de nouveaux compteurs électriques intelligents à domicile, qui collectent automatiquement des informations plusieurs fois par jour, la question du suivi approprié de la consommation d’électricité ainsi que la sécurité du réseau de transport d’électricité s’est posée, dans d’autres circonstances, devant la Cour de justice de l’Union européenne27. Une plaignante, qui n’est pas d’origine rom, a déposé plainte pour discrimination subie devant la Komisia za zashtita ot dikriminatsia (Commission de défense contre la discrimination), en raison du fait que le distributeur d’électricité installait les compteurs électriques sur des piliers en béton, à 6 ou 7 mètres de hauteur, et non à 1,70 m ou directement sur la façade comme dans d’autres quartiers. La commission de défense contre la discrimination (ci-après « KZD »), a reconnu que la plaignante subissait une discrimination directe fondée au regard de sa « situation personnelle ». Saisie de la décision, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer pour effectuer un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne. Aux termes de dix questions posées à la Cour, la problématique majeure que soulève la situation est de déterminer si la directive n° 2000/43/CE28, en ce qu’elle condamne toute forme de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, peut s’appliquer à cette situation et dans quelles circonstances. L’arrêt du 16 juillet 2015 CHEZ est ainsi l’occasion pour la Cour de justice de préciser la notion de discrimination au sens de la directive (I) et d’en rappeler le régime applicable (II).
I. Les contours précisés de la notion de discrimination
L’arrêt du 16 juillet 2015 relatif à l’application de la directive n° 2000/43/CE à une personne ne souffrant pas de discrimination en raison de son origine ethnique mais en subissant les effets permet d’interpréter le texte précité de façon extensive (A) et nécessairement casuistique (B).
A. Une interprétation extensive de la personne discriminée
La directive n° 2000/43/CE prévoit que des personnes peuvent être discriminées de deux façons, directement ou indirectement. Une personne peut être considérée comme directement discriminée si, en raison de sa race ou de son origine ethnique, elle est traitée de façon défavorable par rapport à une autre personne placée dans la même situation. Elle subit en revanche une discrimination indirecte dès lors qu’« un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes »29. En l’espèce, la requérante n’était pas d’origine rom. La Cour de justice opère alors une interprétation téléologique de la directive au regard de la finalité visée. Cela lui permet ainsi d’affirmer que si la directive s’applique aux personnes qui ont une origine ethnique discriminée, elle peut également s’appliquer aux personnes « qui, sans posséder ladite origine, subissent, conjointement avec les premières, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier résultant de cette mesure »30. Si la directive trouve à s’appliquer ratione personae à la plaignante, encore faut-il que la situation incriminée entre dans son champ d’application.
B. Une interprétation nécessairement casuistique de l’agissement discriminatoire
La question du caractère discriminatoire de la mesure se pose également. Sans véritablement y répondre, la Cour rappelle aux juridictions nationales qui seront amenées à en décider, que les agissements litigieux s’observent de façon casuistique. Il faut en effet que le traitement discriminatoire porte atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes. Cela nécessite alors de prendre en compte la finalité de la pratique31. Afin de répondre d’une façon la plus exhaustive possible, la Cour suggère différents critères d’identification du caractère discriminatoire ou non de la mesure. Elle propose notamment d’examiner si la pratique a eu lieu dans d’autres quartiers de la ville, si elle n’est limitée qu’aux personnes ayant pu avoir des agissements illicites dans le passé et si elle est toujours justifiée dans le temps32. La Cour de justice suggère ainsi que l’évaluation doit s’opérer en prenant en compte l’ensemble des éléments qui les caractérisent33, par rapport à d’autres personnes, pouvant être placées dans une situation comparable. Elle en déduit que ces mesures touchant l’ensemble du quartier, indépendamment de l’origine rom des habitants, la situation peut être comparée avec d’autres quartiers où des personnes d’origine rom et non rom, habitent. À cet égard, les habitants d’autres quartiers ayant accès à leur compteur d’électricité, la Cour de justice estime que la mesure pourrait ainsi constituer un traitement défavorable indirect, contraire au principe d’égalité.34 Elle précise également, en lien avec sa jurisprudence établie sur la charge de la preuve, que c’est au défendeur de démontrer que la mesure ne repose pas sur une discrimination et qu’elle est justifiée35. Sur ce dernier point, le distributeur d’électricité explique que la différence de traitement poursuit un intérêt légitime, justifiant un régime différent.
II. La délimitation variable du régime de la discrimination
Les juges de Luxembourg considèrent en l’espèce qu’une discrimination pourrait être avérée (A) au regard des éléments dont ils disposent. Leur raisonnement, pourtant habituel, pourrait surprendre au regard de la discrimination « indirecte » qu’eux-mêmes opèrent (B).
A. Une discrimination avérée
Le défendeur oppose à la Cour le fait qu’il est de « notoriété publique » que des dégradations et manipulations de compteurs ont davantage lieu dans les quartiers roms36. Se fondant sur cette réputation, l’entreprise n’a pas fourni de preuves matérielles attestant de la véracité des agissements incriminés qui auraient pu fonder le traitement inégal et défavorable. La Cour de justice note cette absence de preuves et procède, en raison de la dixième question préjudicielle posée, à un examen de la légitimité de la mesure, indépendamment de toute preuve de dégradation mais sur le fondement de la protection de la sécurité du réseau électrique37. Si elle reconnaît que la mise en hauteur des compteurs permet de garantir la sécurité et la santé des utilisateurs, elle évalue toutefois l’importance des moyens mis en œuvre par rapport au but poursuivi. Ainsi, la Cour de justice opère un contrôle de proportionnalité de la mesure. Si l’avocat général estime pour sa part que la mesure est proportionnée à l’intérêt de protection de la santé et de sécurité des individus38, la Cour, quant à elle, prend note des remarques de la KZD qui précise que d’autres distributeurs ont trouvé des techniques différentes qui permettent de concilier la prévention de comportements litigieux et l’accès à un compteur d’électricité à une hauteur accessible39. En conséquence, la Cour estime que le défendeur, même poursuivant un intérêt légitime, a mis en place une mesure disproportionnée quant au but à atteindre dans la mesure où, d’une part, il existait d’autres moyens pour prévenir les fraudes et d’autre part, la mesure dite de protection ne concerne qu’un quartier majoritairement peuplé de personnes d’origine rom40. Cet examen du traitement égal des personnes situées dans une même situation pourrait être étendu à la Cour de justice elle-même.
B. Une discrimination implicite
Par le principe de proportionnalité, les magistrats ont vérifié que les mesures de protection ne trahissent pas un traitement discriminatoire pour certaines personnes. En somme, de façon assez classique, la Cour de justice de l’Union européenne continue sa jurisprudence en faveur d’une protection contre la discrimination et d’une égalité de traitement de tous dans l’Union européenne. Ces questions préjudicielles auraient néanmoins pu être l’occasion pour la Cour de prendre en compte la jurisprudence – au sujet d’une discrimination des roms41 ! – et les textes issus du Conseil de l’Europe. À l’heure d’une adhésion inévitable et d’une complémentarité avérée entre les deux ordres juridiques dans la protection des droits fondamentaux, une telle absence relèverait presque d’une discrimination…
Aude Bernard
La protection des droits fondamentaux au-delà de toute prudence
La discrimination subie par les personnes composant des couples de même sexe est structurelle en Amérique latine42. Toutefois, quasiment tous les États américains ont opéré des modifications normatives récentes afin d’y remédier. L’arrêt Duque c/ Colombie de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (Cour IDH) en est un exemple marquant43.
Angel Alberto Duque, atteint du VIH, demande une pension de réversion suite au décès de son concubin, le 15 septembre 2001, dû au même virus. Toutefois, selon le droit en vigueur, la pension ne pouvait alors qu’être accordée au survivant d’un couple de sexe différent. Le 26 avril 2002, suite au refus de la part de la compagnie de lui attribuer la pension, M. Duque dépose un recours en protection des droits fondamentaux (acción de tutela). La justice colombienne ne fera pas droit aux prétentions de M. Duque car sa situation n’est pas prévue par la loi. Le 26 août 2002, la Cour constitutionnelle colombienne ne sélectionne pas ce cas qui lui a été envoyé44.
Le 8 février 2005, M. Duque envoie une pétition devant la Commission interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH) qui l’accepte le 2 novembre 2011 et émet un rapport sur le fond le 2 avril 2014. Elle conclut que l’État est responsable pour la violation du droit à l’intégrité personnelle (art. 5.1), des droits aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire (art. 8.1 et 25) et du droit à l’égalité et à la non-discrimination (art. 24 en relation avec l’art. 2), tous en relation avec l’article 1.1 de la Convention américaine. La CIDH soumet le cas à la Cour IDH le 21 octobre 2014.
Durant la procédure supranationale, la Cour constitutionnelle colombienne reconnaît, en 2007, des bénéfices patrimoniaux aux couples de même sexe45 et, par son arrêt n° C-336 du 16 avril 2008, elle leur reconnaît le bénéfice de la pension de réversion. Dans les arrêts nos T-05/10 du 2 février 2010 et T860/11 du 15 novembre 2011, elle indique que la pension ne doit pas être refusée si le concubin est décédé avant l’arrêt de 2008.
La Cour IDH rejette les exceptions préliminaires présentées par l’État et déclare la responsabilité de celui-ci pour avoir violé le droit à l’égalité devant la loi (art. 24) en relation à l’article 1.1 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (CADH). Elle déclare, contrairement à la CIDH, que l’État n’est pas responsable de la violation de l’article 2 en relation avec les articles 24 et 1.1, de la violation des articles 8.1 et 25 et de la violation des articles 4.1 et 5.1 de la Convention.
La question posée à la Cour est de savoir à partir de quand la responsabilité internationale de l’État est-elle susceptible d’être engagée.
Cette question pose au moins deux problèmes à la Cour : d’abord, la Cour doit déterminer l’existence d’un fait illicite (I) et ensuite s’il y a effectivement une obligation internationale exigeant de l’État un comportement différent de celui qu’il a adopté (II).
I. Une réfutation fragile de l’évolution normative interne
La Cour tente par tous les moyens d’établir une obligation internationale (A) sans valoriser suffisamment les changements internes (B).
A. La difficile détermination du fait illicite
Il est assez étonnant de voir que pour justifier l’existence d’une discrimination, la Cour cite des instruments internationaux et des règles nationales qui sont tous postérieurs à 2002.
Elle cite les observations générales nos 19 et 20 du Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies qui datent de 2008 et de 2009 ; les principes de Yogyakarta de 2007 émis par un groupe de personnes physiques ; des évolutions normatives dans la ville de Mexico qui ont eu lieu en 2006 et en 2009, en Uruguay depuis 2007 ; le cas de la ville de Buenos Aires et de la situation de l’Argentine en général, le cas du Brésil, du Chili et même des États-Unis, État non partie à la CADH. Aucune de ces références n’est ni pertinente dans le temps ni, pour certains cas, en droit ; la Cour ne citant pas que des sources de droit international public. C’est notamment le reproche que lui fait le juge Eduardo Vio Grossi dans son opinion séparée46.
Par conséquent, le consensus international qui existe aujourd’hui en la matière n’existait pas à l’époque des faits. La Cour IDH prend malgré tout le même chemin que la CEDH dans son arrêt P.B et J.S c/ Autriche du 22 juillet 2010, dans lequel elle déclare que cette distinction est une discrimination au sens de la Convention EDH (Conv. EDH), mais avec une plus grande prudence.
B. La difficile prise en compte du changement normatif interne
À ces éléments se rajoute un changement dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle colombienne à partir de 2008 qui reconnaît une discrimination et inclut dans les bénéfices de la loi les survivants de couples homosexuels de manière rétroactive.
Le moment opportun pour étudier l’épuisement des recours internes est lors de l’adoption du rapport de recevabilité de la CIDH. Celle-ci n’avait pas connaissance de ces changements à ce moment-là mais l’a acquise a posteriori. Ces modifications qui auraient pu permettre de résoudre l’affaire au niveau interne n’ont cependant pas empêché la CIDH de déclarer la responsabilité de la Colombie et d’envoyer le cas à la Cour.
Cet envoi a été très critiqué de la part des juges Manuel Ventura Robles et Eduardo Vio Grossi dans leurs opinions séparées. Le premier invitant notamment la Commission à ne plus transmettre ce genre de cas à la Cour afin de respecter le principe de complémentarité du système. En effet, « la juridiction [de la Cour], n’a pas été établie pour que tous les cas lui soient soumis, ou pour que les victimes présumées gagnent tous les cas en toutes circonstances »47.
II. Une détermination imprudente d’une responsabilité internationale rétroactive
Si la Cour retient la stricte responsabilité internationale de l’État en faisant abstraction des particularités du cas (A), les conséquences de l’arrêt se veulent assez imprévisibles (B).
A. La détermination d’une responsabilité apparemment évidente
La Cour IDH n’a pas retenu la position de la CEDH dans l’arrêt cité de 2010 dans lequel, avec prudence, elle déclare une responsabilité internationale modulable de l’État en distinguant la période durant laquelle l’État avait une législation discriminatoire et la période postérieure à des modifications législatives durant laquelle le fait illicite a cessé et pour laquelle l’État n’est pas responsable.
Peu après l’arrêt Duque, la position de la CEDH a changé. Dans l’arrêt Aldeguer Tomás c/ Espagne du 14 juin 2016, très similaire à l’affaire Duque, la CEDH n’a pas retenu la responsabilité internationale car selon elle « les États jouissent d’une marge d’appréciation au regard du rythme de l’introduction des changements législatifs dans le domaine de la reconnaissance légale des couples de même sexe… ». Elle continue en expliquant que le droit espagnol n’est pas contestable « pour ne pas avoir introduit les législations de 2005 ou de 2007 à un moment antérieur qui aurait permis au requérant de bénéficier de la pension de survivant »48.
Au contraire pour la Cour IDH, en interprétant la Convention, l’obligation de non-discrimination qu’elle dégage prend effet à partir de la date du texte conventionnel (1969) et non pas de celle de l’arrêt. Il en découle qu’en suivant cette réflexion, la Cour retient la responsabilité internationale de la Colombie. Si dans le cas d’espèce, l’arrêt renforce la jurisprudence nationale, ces conséquences pour les autres États ayant accepté la compétence de la Cour laissent de nombreuses questions en suspens.
B. Les conséquences hasardeuses d’une telle responsabilité
En reconnaissant la Colombie responsable pour une discrimination qui ne fut reconnue par le droit positif qu’après les faits, la Cour interaméricaine met en difficulté les autres États.
D’abord, cet arrêt signifie que tous les États, même ceux qui ont modifié leur droit national, ont commis un fait illicite international susceptible d’engager leur responsabilité internationale. Cette conséquence, même si elle est importante, n’induira pas forcément de difficulté pour les États qui ont déjà modifié leur droit national étant donné que, au regard du principe de subsidiarité, la réparation du fait illicite se trouve dans le droit national. À moins que la Cour ne juge que ces réparations ne soient pas satisfaisantes comme dans l’arrêt Duque.
Ensuite, cet arrêt ébranle la sécurité juridique du système. En effet, la Cour peut reconnaître l’existence d’un fait illicite à une date antérieure à l’apparition de l’obligation et alors même que le droit interne a été modifié. Ainsi, la question se pose de savoir si la conduite actuelle des États est susceptible d’engager leur responsabilité demain pour des obligations qui n’existent pas encore dans l’ordre juridique international. Il paraît donc impossible pour les États de prévenir les violations à la Convention et d’empêcher la Cour de les condamner, ce qui porte un coup au principe de subsidiarité.
Thomas Manrique
L’arrêt Oliari et a. c/ Italie du 21 juillet 2015 ou l’obligation conventionnelle de mise en œuvre d’un cadre juridique pour les couples LGBTI
L’arrêt Oliari49, rendu par la CEDH, condamne l’Italie pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale. Les juges de Strasbourg considèrent qu’il est nécessaire de créer un cadre permettant aux couples homosexuels de voir leur union juridiquement reconnue.
La Cour, s’appuyant sur la tendance à la reconnaissance juridique des couples homosexuels au sein des États parties à la Convention mais aussi plus généralement au niveau international50, juge que la protection que prévoit la loi italienne ne répond pas aux besoins fondamentaux d’un couple engagé dans une relation stable, et qu’un partenariat civil constituerait le moyen juridique le plus approprié pour une telle reconnaissance. En revanche, elle considère qu’il n’y a pas de violation du droit au mariage et que l’on ne peut reconnaître une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Afin de comprendre la portée de cet arrêt, qui s’inscrit dans une politique des petits pas adoptée par la Cour, il est nécessaire de le replacer dans le contexte actuel d’une évolution du droit de la famille (I) et du droit au mariage (II).
I. L’évolution de la notion de « vie familiale », fondement de la reconnaissance d’un droit à un partenariat civil pour les couples homosexuels
Le caractère de « vie familiale » des couples homosexuels (A) ne fait désormais plus l’objet de contestation en droit international et en droit européen. La mise en œuvre d’une obligation positive visant à la reconnaissance et à la protection juridique de ces couples en est la principale illustration (B).
A. Le caractère incontesté de « vie familiale » des couples homosexuels
La mutation progressive de la notion de « famille » constitue l’élément déclencheur d’une reconnaissance juridique progressive des couples LGBTI51. Si les divers instruments du droit international classique ont toujours reconnu sa conception traditionnelle comme un droit fondamental qui doit être juridiquement protégé52, on constate, depuis le début du XXIe siècle, que des déclarations internationales nouvelles font la part belle à un concept élargi de famille, dépassant celle composée d’un homme et d’une femme53.
Les jurisprudences des cours régionales s’inscrivent également dans ce mouvement. Dans l’affaire Átala, la CIADH a affirmé que « le concept de vie familiale n’est pas réduit uniquement au mariage et doit comprendre d’autres liens familiaux de fait où les parties ont une vie commune »54.
Dans le système européen, le développement de la notion l’a vue progressivement se délier de l’institution du mariage55. La distinction d’une famille nucléaire fondée sur l’orientation sexuelle est d’ailleurs devenue inconventionnelle56, tout comme le fait de protéger la famille dans son sens traditionnel, considéré comme un argument abstrait qui manque de base juridique57.
Dans l’affaire Schalk et Kopf, les juges ont considéré que la relation entre un couple de même sexe était protégée par la notion de vie familiale de la même manière que celle d’un couple hétérosexuel58. Cette conception a été réaffirmée sans discontinuité depuis59. L’arrêt Oliari rend pleinement compte de cette évolution et créé une nouvelle obligation positive visant à s’assurer du respect effectif de ce droit.
B. L’arrêt Oliari, consécration d’une obligation positive de reconnaissance et de protection juridiques en droit interne des relations des couples homosexuels
La Cour avait reconnu dans l’affaire Schalk et Kopf que les couples homosexuels se trouvent dans une situation comparable à celle des couples hétérosexuels pour ce qui est de leur besoin de reconnaissance juridique et de protection de leur relation.
Elle rappelle que 24 des 47 États membres ont adopté une législation permettant une telle reconnaissance juridique et que les plus hautes juridictions italiennes avaient déjà argumenté sur la nécessité de modifier la loi en ce sens. Elle ajoute que la possibilité de faire enregistrer ces unions auprès de certaines municipalités ou de former un « accord de cohabitation » ne revêt qu’une valeur symbolique. C’est ici l’absence d’une règlementation assurant certains besoins fondamentaux indispensables à un couple uni de manière stable, comme le soutien matériel mutuel, l’obligation alimentaire ou encore les droits de succession, qui est condamnée.
Les juges de Strasbourg estiment qu’en dehors du mariage, la mise en place d’une union civile constituerait le moyen le plus approprié pour permettre cette reconnaissance juridique et ne ferait pas peser sur l’État une charge démesurée. Tirant les conséquences de ses conclusions rendues dans l’arrêt Vallianatos60, elle constate l’absence d’un intérêt général à mettre en balance avec l’intérêt des requérants.
La théorie de l’instrument vivant, évolutif et dynamique qui veut que la Convention se lise à la lumière des conditions de vie actuelles prend ici tout son sens. Ceci explique peut-être pourquoi, en dépit de l’obligation positive créée, la Cour se refuse toujours de consacrer le droit au mariage des couples homosexuels.
II. La lente évolution jurisprudentielle vers un droit au mariage des personnes LGBTI
À l’heure actuelle, on constate une ouverture progressive du droit au mariage à de nouvelles catégories de personnes (A). Néanmoins, le juge européen, en raison d’une politique jurisprudentielle déterminée en partie par l’existence d’un consensus entre États membres, se refuse toujours à consacrer le droit au « mariage égalitaire » (B).
A. Une évolution progressive du droit au mariage pour les personnes LGBTI
Les principaux textes internationaux ont toujours reconnu le mariage, entendu dans un sens traditionnel, c’est-à-dire l’union entre deux personnes de sexe biologiquement différent, comme un élément fondamental de la société61. Depuis une décennie, plusieurs déclarations non-contraignantes viennent toutefois plaider en faveur de la reconnaissance d’un mariage égalitaire62.
Pour fixer sa jurisprudence, la CEDH s’est fondée, dans un premier temps, sur le concept traditionnel du mariage63. Elle a cependant, dès 1998, affirmé que la matière devait être « surveillée de manière constante par les États parties » en raison du contexte « d’acceptation sociale du phénomène »64. Dans l’affaire Christine Goodwin, la Cour en a tiré toutes les conséquences et a considéré que les critères biologiques n’étant plus déterminants, elle « ne trouve aucune raison qui justifie que les transsexuels soient privés en toute circonstance du droit de se marier »65.
Toutefois, dans l’affaire Schalk et Kopf, qui fait désormais jurisprudence, elle a considéré que la Convention n’oblige pas l’État à garantir l’accès au mariage pour les couples homosexuels, celui-ci jouissant d’une marge d’appréciation en la matière66. Cette conception a été reprise dans le présent arrêt. Elle peut s’expliquer par la rédaction même de l’article 12 de la Convention, lequel ne consacre pas de manière expresse une protection additionnelle basée sur le principe de non-discrimination. Elle s’explique surtout par l’absence d’un consensus européen en la matière.
B. Une politique jurisprudentielle déterminée par l’absence d’un consensus
La Cour ne manque pas de rappeler que plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour déterminer l’étendue de la marge d’appréciation. S’il est clair que pour qu’une différence de traitement basée exclusivement sur l’orientation sexuelle soit compatible avec la Convention, il faut des raisons impérieuses67, elle rappelle également que lorsqu’il n’existe pas de consensus, particulièrement dans le cadre d’affaires touchant à des sujets sensibles sur le plan de la morale ou de l’éthique, la marge d’appréciation sera plus grande68.
L’affaire Oliari s’inscrit, là encore, dans la continuité de l’affaire Schalk et Kopf. La Cour énonce que si le droit de se marier ne peut plus être considéré comme un droit limité à deux personnes de sexe opposé, en raison de l’absence de consensus des États sur ce point, elle considère qu’elle ne doit pas substituer son propre jugement à celui des autorités nationales, qui sont mieux placées pour évaluer et répondre aux besoins de la société. Malgré l’évolution graduelle des États sur la question, il en ressort que l’article 12 n’impose pas une obligation de garantir aux couples homosexuels l’accès au mariage. Le droit européen s’en remet aux législations internes pour réguler cette institution.
Maxime Huot
B – Lutte contre les violences faites aux femmes
La violence contre les femmes est une question récurrente devant la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (ci-après la Cour). Certains États peinent à réagir contre ces violences. C’est le cas du Guatemala, qui n’a pas tiré les leçons de sa précédente condamnation69.
Dans l’arrêt Velasquez Paiz et a. c/ Guatemala70, c’est l’aspect procédural qui fait débat. En effet, près de dix ans après sa mort dans un contexte de violences généralisées contre les femmes, le Guatemala peine à satisfaire les besoins de justice des parents de la victime, Claudina Isabel Velasquez Paiz.
L’intérêt de cet arrêt tient dans l’habile révélation par la Cour de l’étroite relation entre les exigences du droit à un procès équitable et la discrimination fondée sur les violences contre les femmes.
Il convient d’observer le raisonnement pédagogique par lequel la Cour exprime la défaillance par le Guatemala, des garanties judiciaires (I). Ce qui lui permet de révéler la discrimination dont sont victimes les femmes en raison des violences qu’elles subissent (II).
I. La démarche pédagogique de la Cour dans la manifestation de la violation des garanties judiciaires par le Guatemala
La Cour procède par une appréciation globale de la teneur des garanties judiciaires (A), avant de caractériser le manquement aux règles essentielles de ce droit (B).
A. L’appréciation globale de la teneur des garanties judiciaires par la Cour
Les garanties judiciaires renferment, en substance, le droit à un procès équitable. C’est ce droit substantiel et procédural qui permet de garantir l’effectivité des droits fondamentaux. Les dispositions le concernant sont exprimées aux articles 8 et 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (ci-après, la Convention). Ces garanties doivent être exercées dans un délai raisonnable.
La Cour précise que les exigences que recouvrent le droit à un procès équitable sont un élément fondamental de la règle de droit dans toute société démocratique. Il importe alors de révéler sa teneur. La Cour relève que les parents de la victime ont été contrarié dans leur tentative de reporter la disparition de leur fille. Les policiers n’ont en effet pas accueilli leur demande. Pour la Cour, cela constitue une violation du droit à un recours effectif, un droit garanti par l’article 25 de la Convention. Ces droits sont libres et pleinement exigibles. Aussi, l’enquête a été ordonnée suite à la découverte du corps de la victime. Ce qui influe pour la Cour sur la protection judiciaire devant bénéficier à la victime et à ses parents, conformément aux 8 et 25 de la Convention. Partant, les autorités guatémaltèques ont failli dans leur obligation de garantie des droits, particulièrement dans l’application des garanties judiciaires.
B. Le non-respect des exigences du droit à un procès équitable, une violation manifeste d’une obligation internationale de protection par le Guatemala
La garantie du droit à un procès équitable implique deux moments. Un premier qui connait des actes préliminaires (instruction, enquête et collection d’informations) et un deuxième relatif à la matérialisation du procès. Le discours de la Cour sera de démontrer que ce premier moment est tout aussi important que le suivant. Il procède de la réalité équitable ou non du procès à venir. Les actes de procédures de ce premier moment vont soutenir les débats du procès. De par son importance, il mérite une attention particulière, notamment dans la mobilisation des exigences du droit à un procès équitable. En l’espèce, la Cour relève un certain nombre d’irrégularités commises tout au long de la procédure. En effet, la réalisation de certains actes essentiels préliminaires a manqué de rigueur. Ce qui témoigne d’une particulière négligence des autorités guatémaltèques71. Il existe à la charge de cet État, une obligation internationale de respect des droits consacrés par la Convention. Le Guatemala doit donc, non seulement, garantir les droits de la Convention, mais aussi, prendre toutes les mesures pour protéger et assurer l’effectivité de ces droits. C’est toute la substance de la due diligence qui incombe au Guatemala. L’importance des violences contre les femmes a conduit à l’établissement de la Convention de Belem do Para. Elle agit comme une protection spécifique du droit des femmes, singulièrement son article 7. Il confère un sens particulier à la due diligence, quand sont en jeu des violences contre les femmes72. Le raisonnement de la Cour est assez emblématique de cette vision pro victima qui la caractérise. Les incidences constatées sont pour elle une atteinte aux droits, particulièrement, le droit à des garanties judiciaires, soutenues ici par le mécanisme de la Convention de Belem do Para.
Partant, la Cour décide de la responsabilité du Guatemala pour violation des règles du droit à un procès équitable. Ce qui constitue évidemment une violation par le Guatemala de son obligation de protection.
Une violation qui influe sur la protection effective des droits fondamentaux des femmes au Guatemala.
II. La révélation corrélative d’une discrimination contre les femmes dans la jouissance du droit à un procès équitable
Une discrimination qui se fonde sur le genre (A), ce qui alimente la persistance de l’impunité des violences contre les femmes (B).
A. Le genre comme objet de discrimination dans la jouissance du droit à un procès équitable
Le principe d’égalité et de non-discrimination est essentiel pour la sauvegarde et la garantie des autres droits. Il a acquis sur le plan international, une valeur de jus cogens. Il oblige ainsi les États à s’abstenir de prendre toutes mesures qui pourraient de quelque manière que ce soit, contribuer à créer des situations discriminatoires de fait ou de droit. Le principe d’égalité et de non-discrimination est évoqué aux articles 1 et 25 de la Convention.
Afin de décider si un État a violé un tel principe, la Cour devra examiner si la discrimination supposée porte sur un droit consacré par la Convention. À défaut, elle devra être examinée à la lumière de l’article 24 de la Convention. La Cour note que l’État a manqué à ses obligations de respect des droits tirées de l’article 1 de la Convention. L’État a en effet failli dans sa garantie des droits à l’égard des femmes. Ces dernières font l’objet d’une violence exacerbée. La violence est une forme de discrimination pour la Cour, tout comme le conçoit le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes73. Une violence qui procède de l’inégalité supposée entre hommes et femmes. Ce qui est contraire au principe d’égalité qui exprime une égalité du genre humain.
La discrimination se fonde sur le sexe et s’exprime au moyen de violences. Elle est par ailleurs renforcée par la ténacité des préjugés et stéréotypes qui font de la femme un être inférieur à l’homme dans la société guatémaltèque. Ce qui a des incidences sur la garantie des droits pour les femmes. Les droits consacrés par la Convention ne sont pas reconnus à tous de façon égale et non-discriminatoire. La différence de traitement originelle dont elles font l’objet fait obstacle à un accès à la justice par le biais d’un droit à un recours effectif.
La Cour décide alors de la responsabilité du Guatemala en tant qu’il manque à ses obligations de respect et de garantie du principe d’égalité et non-discrimination de l’article 25 de la Convention. Dans le même sens, le Guatemala échoue dans son obligation tirée de l’article 1 de la Convention relatif au respect des droits pour tous sans discrimination.
B. L’impunité structurelle des violences contre les femmes au Guatemala, facteur aggravant de la discrimination contre les femmes
La lutte des violences contre les femmes implique une démonstration par l’État de son engagement à éradiquer un tel phénomène dans la société. L’indignation des États ne saurait suffire. La question tient au critère de l’évaluation de cet engagement.
En l’espèce, la Cour note que les autorités publiques ont refusé de connaitre le meurtre de la victime comme une possible manifestation de la violence contre les femmes malgré le contexte généralisé de violences contre les femmes qui préexistait. La faute au poids des stéréotypes et préjugés. Des éléments discriminants qui influent sur la procédure judiciaire et sur le respect des droits de la victime, particulièrement le droit à la non-discrimination et à une égale protection judiciaire, qui passe par l’exercice du droit au recours effectif74. Partant, c’est un climat d’impunité qui est créé ayant à sa base une méfiance des femmes en l’administration de la justice et un sentiment de tolérance envers la violence contre les femmes dans la société.
Le résultat de cette situation fait que près de dix ans après, la procédure engagée dans le meurtre de Claudina Isabel Velasquez Paiz, n’a toujours pas connu son aboutissement.
Wilfried Djie
IV – Cours supranationales et questions pénales
A – Cours supranationales et coopération pénale
Précisions sur les conditions de conformité d’une détention aux fins d’extradition à la Convention européenne des droits de l’Homme
Mécanisme ancien et internationalement reconnu, l’extradition permet à un État requérant de se voir remettre un individu par un État requis, dans le but de le poursuivre et de le juger, ou de lui faire exécuter une peine. Confronté au fil du temps, le mécanisme d’extradition a su pourtant s’adapter aux fluctuations inéluctables que le droit, science nécessairement évolutive, lui a fait subir. Ce n’est pas sans compter sur l’action de la Cour européenne des droits de l’Homme (la Cour). En effet, cette dernière vient régulièrement par ses arrêts préciser les modalités de mise en œuvre de ce type d’entraide judiciaire, afin que les procédures d’extradition respectent les standards de la Convention européenne des droits de l’Homme (la Convention).
Le 24 mars 2015, la Cour a rendu sa décision concernant l’affaire Gallardo Sanchez75. M. Gallardo Sanchez, ressortissant vénézuélien, était accusé d’incendie volontaire par les autorités grecques, et avait été placé sous écrou extraditionnel le 19 avril 2005 par les autorités italiennes en vertu de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. Le requérant ne fut extradé vers la Grèce qu’un an et demi plus tard, soit le 26 octobre 2006. Il alléguait que la durée de sa détention violait ses droits garantis par l’article 5 § 3 de la Convention, assurant le droit d’être « aussitôt » traduit devant un magistrat, et d’être jugé dans un délai raisonnable, ou libéré.
Rappelant qu’elle est saisie de faits et non de qualifications juridiques, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner la requête au travers du prisme de l’article 5, § 1, f), de la Convention abordant spécifiquement la détention aux fins d’extradition. Elle conclut à une violation de cette disposition par les autorités italiennes.
Cet arrêt présente l’intérêt de fournir à son lecteur un exemple type du contrôle de conformité que la Cour effectue en présence d’une détention aux fins d’extradition. Ce contrôle se caractérise par la réaffirmation et l’extension d’un critère constant (I), mais aussi et surtout par un examen in concreto (II) du cas de l’espèce.
I. Le critère prédominant du contrôle : la diligence des autorités
L’examen de la diligence des autorités est une constante en matière de contrôle de la détention aux fins d’extradition. L’arrêt étudié ne déroge pas à la règle : il réaffirme l’utilisation de ce critère et s’inscrit par là même dans une jurisprudence pérenne (A). Cependant, il comporte un aspect totalement novateur en ce qu’il précise le niveau de diligence attendu des autorités (B).
A. Le lien entre nécessité de la détention et diligence des autorités : la réaffirmation d’une jurisprudence constante
L’arrêt commenté s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence bien établie voulant qu’en matière d’examen de la conformité d’une détention relevant de l’article 5, § 1, f), le critère prédominant est celui de la diligence dont les autorités ont fait preuve.
La Cour se fonde tout d’abord sur les termes de l’article précité, et notamment sur l’exigence d’une arrestation ou d’une détention « régulières » de la part des autorités étatiques. Comme à son habitude76, elle associe la notion de « régularité » de la détention à la notion de « respect des voies légales », ce qui est appréciable au travers du respect de la législation nationale (§ 36). La Cour relève que les juridictions internes italiennes ont correctement conclu que la procédure avait respecté les exigences du droit national.
Cependant, la Cour rappelle et confirme que la conformité d’une détention au droit national n’emporte pas nécessairement conformité de la détention au regard du droit de la Convention. Elle se consacre donc à une étude approfondie des buts de la détention. Elle réaffirme77 comme un principe fondamental que « nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5, § 1 » (§ 39). Or, pour qu’une détention ne soit pas arbitraire, elle doit être nécessaire au regard de l’objectif poursuivi. Pour que la détention soit nécessaire, les autorités doivent être actives dans l’accomplissement des objectifs qui motivent la détention, en l’espèce le contrôle de la réunion des conditions pour extrader le détenu : cette détention n’a pas de but punitif. Au point d’orgue de son développement, la Cour rappelle78 ainsi que si la procédure n’est pas menée avec la « diligence requise » par les autorités, elle cesse d’être justifiée (§ 40). En effet, si les autorités ont fait preuve de passivité au regard de la poursuite de l’objectif qui motive la détention, cette dernière n’est plus nécessaire au regard du but pour lequel elle était menée. La détention cesse alors d’être justifiée et devient arbitraire, violant ainsi l’article 5, § 1, f), de la Convention. Reste à savoir comment apprécier la notion de « diligence des autorités étatiques ».
B. Le niveau de diligence des autorités étatiques : les apports d’un arrêt novateur
L’appréciation par la Cour du niveau de diligence des autorités fait tout le caractère novateur de cet arrêt. Au paragraphe 42, la Cour distingue deux formes d’extraditions : l’extradition aux fins d’exécution d’une peine et l’extradition aux fins de jugement. Dans le second cas, la procédure est encore pendante, et cette situation appelle une diligence accrue de la part des autorités étatiques. En effet, la personne n’a pas encore été jugée, et bénéficie à ce titre de la présomption d’innocence. De plus, les droits de la défense dont bénéficie l’individu à ce stade sont très limités, et tout examen au fond de l’affaire est interdit aux autorités de l’État requis. La détention aux fins d’extradition doit donc être la plus brève possible au regard du but qu’elle poursuit, c’est-à-dire, le simple contrôle d’exigences de forme : la conformité de la demande d’extradition aux conditions de forme prévues par la Convention européenne d’extradition, le respect du principe ne bis in idem, de celui de double incrimination ainsi que l’absence de base discriminatoire ou politique des poursuites.
L’État a un rôle important de contrôle de la conformité de la détention par rapport au droit applicable, mais également un rôle actif quant à l’accomplissement des buts de la détention.
Les jalons (objectifs) du contrôle ayant été posés, la Cour s’attache ensuite à apprécier in concreto si la détention a bien été effectuée avec une diligence suffisante par les autorités italiennes.
II. L’aspect concret du contrôle : l’examen des justifications des retards dans la procédure
La Cour relève des retards dans le déroulement de la procédure, entraînant une durée conséquente de la détention. Elle s’attache à déterminer si ces retards correspondent effectivement à une nécessité pour les besoins de l’examen de la demande d’extradition – qui est, rappelons-le, le but de la détention. La réponse à apporter à cette interrogation conduit à reconnaître une violation de la Convention (A), et ce, peu importe les recours introduits par le requérant (B).
A. Les causes de la longueur de la détention : la reconnaissance d’une violation de la Convention
La Cour affirme que l’affaire n’était pas complexe et que la détention de l’individu sous écrou extraditionnel était nécessaire pour contrôler l’existence de certaines exigences formelles permettant l’extradition. Le rôle des juridictions internes se bornait ainsi au simple contrôle de conformité de ces exigences. Aucun examen au fond n’était requis de la part des autorités italiennes, aucune enquête. Pourtant, la première audience de la cour d’appel avait été fixée 6 mois après la demande d’extradition grecque, et 8 mois après le placement sous écrou extraditionnel du requérant. Aussi, la Cour de cassation a laissé s’écouler un délai de quatre mois pour déposer au greffe un arrêt d’une seule page. Le niveau de complexité de l’affaire ne nécessitait pas de tels délais.
Aucune des justifications du gouvernement italien ne trouve grâce aux yeux de la Cour, pas même celles selon lesquelles le retard de la procédure serait en partie imputable au requérant.
B. Les faits du requérant : l’impossible justification du gouvernement italien
Le requérant n’a pas consenti à son extradition et a, en trois mois, introduit trois recours afin de demander une remise en liberté, en vain. Le gouvernement avance que ces divers éléments peuvent justifier les retards dans la procédure.
Au paragraphe 47, la Cour rejette cet argument. Elle affirme en effet que le recours introduit par le requérant pour demander sa remise en liberté relevait d’une procédure distincte de la procédure de contrôle des exigences formelles pour procéder à l’extradition. La demande de remise en liberté ne requerrait qu’un examen simple, visant à vérifier si les éléments qui ont mené au placement en détention de M. Gallardo Sanchez étaient toujours valables. L’État italien a fait le choix de confier ces deux procédures à la même juridiction, pouvant entraîner des retards. Mais le requérant ne peut valablement subir les conséquences néfastes de ce choix. Ainsi, la durée de la procédure ne peut être justifiée par le fait du délinquant, et la reconnaissance d’une violation de l’article 5, § 1, f), ne saurait être évitée.
Ce refus par la Cour d’accepter les recours introduits par le requérant comme des justifications valables aux retards dans la procédure protège de manière indirecte le droit reconnu par l’article 5, § 4, de la Convention, empêchant ainsi que les détenus ne soient découragés d’introduire les recours nécessaires à leur remise en liberté.
Leslie Nardari
B – Cours supranationales et grands principes de la loi pénale
V – Cours supranationales et procéduralisation des droits substantiels
VI – Cours supranationales et droits et libertés relatifs au fonctionnement de la démocratie
A – Cours supranationales et liberté d’expression des avocats
B – Cours supranationales et droit à des élections libres
VII – Cours supranationales et enfermement
VIII – Cours supranationales et nouvelles technologies
IX – Cours supranationales et terrorisme
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
V. Andriantsimbazovina J., Burgorgue-Larsen L. et Touzé S. (dir.), La protection des droits de l’Homme par les cours supranationales, 2016, Paris, Pédone.
-
2.
CEDH, gde ch., 21 juin 2016, n° 5809/08, Al-Dulimi et Montana Inc. c/ Suisse. V. Sudre F., « CEDH – ONU : 1 – 0 », JCP G 2016, 28, spéc. n° 828 ; Andriansimbazovina J., « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », Gaz. Pal. 19 juill. 2016, n° 270t8, p. 21 ; de Koker C., « Al-Dulimi and Montana Management Inc. V. Switzerland : Norm conflict between UNSC Resolution and ECHR ? », Strasbourg Observers 5 sept. 2016 [Disponible en ligne].
-
3.
V. Keller H. et Fischer A., « The UN Anti-terror Sanctions Regime under Pressure », Human Rights Law Review 2009, vol. 9, n° 2, p. 257-266. V. aussi le rapport Emmerson (A/67/396) cité par la Cour dans l’arrêt sous commentaire et qui a jeté un jour cru sur les innombrables incompatibilités du régime des sanctions avec les normes internationales en matière de droits de l’Homme.
-
4.
V. CEDH, 2 mai 2007, n° 71412/01, Behrami et Behrami c/ France et Saramati c/ Allemagne, France et Norvège, § 128-143.
-
5.
V. CEDH, gde ch., 12 sept. 2012, Nada c/ Suisse, n° 10593/08. V. Tinière R., « Les “black lists” du conseil de sécurité devant la Cour européenne des droits de l’Homme », RTD eur. 2013, n° 3, p. 15-530.
-
6.
CJCE, 3 sept. 2008, nos C-402 et 415/05P, Kadi et Al Barakaat c/ Conseil : Rec. CJCE 2008, I, p. 6351.
-
7.
Pour reprendre l’expression du juge Pinto dans son opinion concordante (§ 59 et s.).
-
8.
V. Platon S., « Le principe de protection équivalente – À propos d’une technique de gestion contentieuse des rapports de système », in Potvin-Solis L. (dir.), La conciliation des droits et libertés dans les ordres juridiques européens, 2012, Bruxelles, Bruylant, p. 463-494.
-
9.
V. Tinière R., op. cit., p. 523
-
10.
Sudre F., op. cit.
-
11.
Roucounas E., Engagements parallèles et contradictoires, 1987, RCADI, vol. 206.
-
12.
V. notamment les opinions concordantes des juges Pinto, Keller et dissidente de la juge Nussberger.
-
13.
Virally M., « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes », in Mélanges offerts à Henri Rolin, Problèmes de droit des gens, 1964, Paris, A. Pedone, 488-505.
-
14.
Andriantsimbazovina J., « L’extension de la compétence de la Cour pour connaître de faits se déroulant sur le territoire d’un État tiers à l’espace de la Convention européenne », Gaz. Pal. 31 janv. 2015, n° 210k8, p. 13.
-
15.
CEDH, gde ch., 15 juin 2015, n° 13205/05, Chiragov et a. c/ Arménie ; CEDH, gde ch., 15 juin 2015, n° 40167/06, Sargsyan c/ Azerbaïdjan : Azarova V., « Introductory note to Chiragov and others v. Armenia », ASIL, ILM, vol. 54, n° 6, 2015, p. 961-1068 ; Laval P.-F., « Note sous CEDH, grande chambre, Arrêt du 16 juin 2015, Minas Sargsyan c/ Azerbaïdjan, Elkhan Chiragov et a. c/ Arménie », RGDIP janv. 2016, p. 53-156 ; Tavernier J., « Le Haut Karabakh devant la Cour européenne », sentinelle-droit-international.fr, Bulletin 440 du 28 juin 2015.
-
16.
CEDH, gde ch., 14 déc. 2011, n° 40167/06, Sargsyan c/ Azerbaïdjan (déc.).
-
17.
Cohen-Jonathan G. et Flauss J.-F., « Cour européenne des droits de l’Homme et droit international », in Annuaire Français de Droit International, vol. 49, 2003, p. 677 ; Benoît-Rohmer F., « Pour la construction d’un espace juridique européen de protection des droits de l’Homme. Réflexions sur l’arrêt de la CEDH, Ilascu et a. c/ Russie et Moldova du 8 juill. 2004 », L’Europe des libertés, mars 2005, n° 15, en ligne sur le site de la revue L’Europe des libertés.
-
18.
CEDH, gde ch., 8 avr. 2004, n° 71503/01, Assanidzé c/ Géorgie, § 140 ; CEDH, gde ch., 23 mars 1995, n° 40/1993/435/514, Loizidou c/ Turquie (exceptions préliminaires), § 73-80.
-
19.
Sargsyan c/ Azerbaïdjan, préc., § 147.
-
20.
Sudre F., « La notion de juridiction », in Sudre F. (dir.), Les grands arrêts de La Cour européenne, 7e éd., 2015, PUF, p. 816.
-
21.
CEDH, gde ch., 19 oct. 2012, nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, Catan et a. c/ Moldova et Russie.
-
22.
Chiragov et a. c/ Arménie, préc., § 115 ; Sargsyan c/ Azerbaïdjan, préc., § 115.
-
23.
Sargsyan c/ Azerbaïdjan, préc., § 117.
-
24.
CEDH, gde ch., 16 sept. 1996, Akdivar et a. c/ Turquie, n° 21893/93, § 68.
-
25.
Laval P.-F., préc., p. 156.
-
26.
Sargsyan c/ Azerbaïdjan, opinion concordante de la juge Ziemele, p. 89 ; Tavernier J., préc.
-
27.
CJUE, 16 juill. 2015, n° C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD. V. Popov A., « Mise au point et nouveaux développements européens sur la discrimination directe et la discrimination par association », Rev. DH mars 2016, disponible en ligne, consulté le 9 septembre 2016 ; Tsvetanka G., « Les compteurs d’électricité dans les quartiers roms en Bulgarie : à une situation délicate, une réponse délicate ? », publié en ligne jade-bordeaux, consulté le 9 septembre 2016.
-
28.
Dir. n° 2000/43/CE, 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique : JO L 180, 19 juill. 2000, p. 22-26.
-
29.
Dir. n° 2000/43/CE, 29 juin 2000, art. 1 b).
-
30.
CJUE, CHEZ, préc., pt 60.
-
31.
CJUE, CHEZ, préc., pt 91.
-
32.
CJUE, CHEZ, préc., pt 84.
-
33.
CJUE, CHEZ, préc., pt 89 (CJUE, 16 déc. 2008, n° C‑127/07, Arcelor Atlantique et Lorraine et a.).
-
34.
CJUE, CHEZ, préc., pts 88 à 91.
-
35.
CJUE, CHEZ, préc., pt 85.
-
36.
CJUE, CHEZ, préc., pt 83.
-
37.
CJUE, CHEZ, préc., pt 110.
-
38.
CJUE, CHEZ, préc., pt 119.
-
39.
CJUE, CHEZ, préc., pt 121.
-
40.
CJUE, CHEZ, préc., pt 128.
-
41.
CEDH, gde ch., 13 nov. 2007, n° 57325/00, D.H. et a. c/ République Tchèque. La CEDH y avait pourtant appliqué non seulement les dispositions antidiscriminatoires prévues par la Convention mais avait également utilisé les mêmes principes que le droit de l’Union, établissant ainsi un trait d’union entre les droits de l’Homme et les droits fondamentaux.
-
42.
CIADH, informe : « Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América », 2015.
-
43.
CIADH, 26 févr. 2016, n° 310, Duque c/ Colombie, Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais et Dépens.
-
44.
Selon l’article 33 du décret 2591 « Par lequel se réglemente le recours en protection des droits fondamentaux consacré à l’article 86 de la Constitution Politique » la Cour constitutionnelle peut sélectionner les cas qui seront traités selon des critères qu’elle établit. Ces principes et critères sont présents au chapitre XIV, section I, du règlement de la Cour.
-
45.
CIADH, 26 févr. 2016, Duque c/ Colombie, Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et Frais et Dépens.
-
46.
Opinion partiellement dissidente du juge Vio Grossi E., CIADH, Duque c/ Colombie, préc. p. 8.
-
47.
Opinion dissidente du juge M. Ventura Robles E., CIADH, Duque c/ Colombie, préc. p. 2 (traduction personnelle).
-
48.
CEDH, 3e sect., 14 juin 2016, n° 35214/09, Aldeguer Tomás c/ Espagne, § 90 (traduction personnelle).
-
49.
CEDH, 21 juill. 2015, nos 18766/11 et 36030/11, Oliari et a. c/ Italie.
-
50.
La Cour s’est penchée sur la pratique des États membres du Conseil de l’Europe, des pays sud-américains, d’Asie australe et des États-Unis, où elle prend acte de la décision du 26 juin 2015 de la Cour suprême américaine, Obergefell et a. c/ Hodges, Director, Ohio Department of Health et a.
-
51.
Gouttenoire A., Les règles communes relatives à la famille, in Le principe de subsidiarité au sens du droit de la Convention européenne des droits de l’Homme, Sudre F. (dir.), 2014, Éd. Anthemis, p. 412.
-
52.
V. DUDH, art. 12.1 ; DADDH, art. 6 ; PIDESC, art. 10.1 ; PIDCP, art. 23.
-
53.
V. déclaration de Montréal, 29 juill. 2006 ; Principes de Jogjakarta, 9 nov. 2006 (n° 24).
-
54.
CIADH, 24 févr. 2012, Átala c/ Chili, § 142 et 161.
-
55.
CEDH, 26 mai 1994, n° 16969/90, Keegan c/ Irlande, § 44 ; CEDH, 27 avr. 1997, n° 21830/93, X. Y. et Z. c/ Royaume-Uni, § 37.
-
56.
CEDH, 21 déc. 1999, n° 33290/96, Salgueiro Da Silva Mouta c/ Portugal, § 34-36 ; CEDH, 28 sept. 2010, n° 37060/06, JM. c/ Royaume-Uni, § 50.
-
57.
CEDH, 24 juill. 2003, n° 40016/98, Karner c/ Autriche, § 41 ; CEDH, 2 mars 2010, n° 13102/02, Kozak c/ Pologne, § 98-99.
-
58.
CEDH, 24 juin 2010, n° 30141/04, Schalk et Kopf c/ Autriche, § 94.
-
59.
CEDH, 27 sept. 2011, n° 39417/07, Alim c/ Russie, § 70 ; CEDH, 19 févr. 2013, n° 19010/07, X et a. c/ Autriche, § 95 ; CEDH, 16 juill. 2014, n° x37359/09, Hämäläinen c/ Finlande, § 62.
-
60.
CEDH, 7 nov. 2013, n° 29381/09, Vallianatos et a. c/ Grèce.
-
61.
V. DUDH, art. 16.4 ; PIDCP, art. 23.2 ; PIDESC, art. 10.1 ; charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, art. 6.
-
62.
Déclaration de Montréal, préc. ; principes de Jogjakarta, 9 nov. 2006 (n° 24), préc.
-
63.
CEDH, 17 oct. 1986, n° 9532/81, Rees c/ Royaume-Uni, § 49.
-
64.
CEDH, 30 juill. 1998, n° 22985/93, Sheffield et Horsham c/ Royaume-Uni, § 60.
-
65.
CEDH, 11 juill. 2002, n° 28957/95, Christine Goodwin c/ Royaume-Uni, § 100.
-
66.
CEDH, Schalk et Kopf c/ Autriche, préc., § 52-57 et 60-63. V. égal. CEDH, 13 nov. 2012, n° 37359/09, H c/ Finlande, § 38 ; CEDH, X et a. c/ Autriche, préc., § 106.
-
67.
CEDH, 11 juin 2002, n° 36042/97, Willis c/ Royaume-Uni, § 39.
-
68.
CEDH, 22 avr. 1997, n° 33290/96, X, Y et Z c/ Royaume-Uni, § 44.
-
69.
CIADH, 19 mai 2014, série C, n° 277, Veliz Franco c/ Guatemala. V. note Huot M., LPA 17 sept. 2015, p. 16-18.
-
70.
CIADH, 19 nov. 2015, série C, n° 307, Velasquez Paiz et a. c/ Guatemala. V. aussi CEDH, note d’information sur la jurisprudence de la Cour, n° 196, mai 2016, p. 30-32.
-
71.
CIADH, 19 nov. 2015, Velasquez Paiz c/ Guatemala, préc., § 150-168. V. protocole de Minnesota relatif aux mesures adéquates pour connaître des exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires.
-
72.
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, Convention de Belem do Para, Brésil, 9 juin 1994, particulièrement, art. 7.
-
73.
CIADH, 19 nov. 2015, Velasquez Paiz c/ Guatemala, préc., § 75.
-
74.
Idem, § 185. Amnesty international, « Il est temps de mettre fin à l’inaction face aux meurtres de femmes au Guatemala », 17 janv. 2013 ; Sarti Escobar carolina, « Guatemala. Pour que la honte change de camp », Courrier international 10 mars 2010.
-
75.
CEDH, 24 mars 2015, n° 11620/07, Gallardo Sanchez c/ Italie, Dreyer E., « Un an de droit européen en matière pénale (janv. – déc. 2015) », Dr. pén. 1er avr. 2016, comm. 8.
-
76.
V. parmi d’autres : CEDH, 22 mars 1995, n° 18580/91, Quinn c/ France, § 47 ; CEDH, 29 janv. 2008, n° 13229/03, Saadi c/ Royaume-Uni, § 67.
-
77.
CEDH, Saadi, préc., § 67.
-
78.
CEDH, Quinn, préc., § 48 ; CEDH, 15 nov. 1996, n° 22414/93, Chahal c/ Royaume-Uni, § 113.