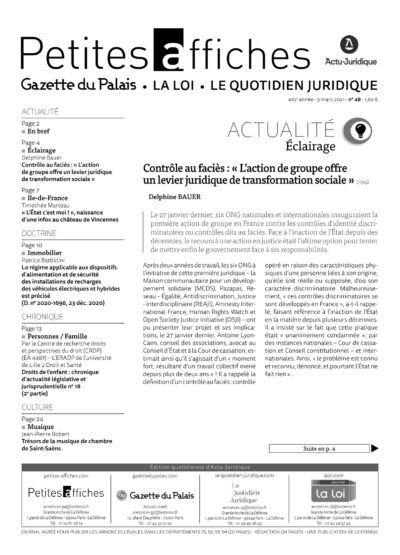Contrôle au faciès : « L’action de groupe offre un levier juridique de transformation sociale »
Le 27 janvier dernier, six ONG nationales et internationales inauguraient la première action de groupe en France contre les contrôles d’identité discriminatoires ou contrôles dits au faciès. Face à l’inaction de l’État depuis des décennies, le recours à une action en justice était l’ultime option pour tenter de mettre enfin le gouvernement face à ses responsabilités.

Après deux années de travail, les six ONG à l’initiative de cette première juridique – la Maison communautaire pour un développement solidaire (MCDS), Pazapas, Réseau – Égalité, Antidiscrimination, Justice – interdisciplinaire (REAJI), Amnesty International France, Human Rights Watch et Open Society Justice Initiative (OSJI) – ont pu présenter leur projet et ses implications, le 27 janvier dernier. Antoine Lyon-Caen, conseil des associations, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, estimait ainsi qu’il s’agissait d’un « moment fort, résultant d’un travail collectif mené depuis plus de deux ans » ! Il a rappelé la définition d’un contrôle au faciès : contrôle opéré en raison des caractéristiques physiques d’une personne liées à son origine, qu’elle soit réelle ou supposée, d’où son caractère discriminatoire. Malheureusement, « ces contrôles discriminatoires se sont développés en France », a-t-il rappelé, faisant référence à l’inaction de l’État en la matière depuis plusieurs décennies. Il a insisté sur le fait que cette pratique était « unanimement condamnée », par des instances nationales – Cour de cassation et Conseil constitutionnel – et internationales. Ainsi, « le problème est connu et reconnu, dénoncé, et pourtant l’État ne fait rien »…
C’est devant cette inaction que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle permettant l’action de groupe, offre un levier « pour transformer profondément l’action policière », espère-t-il.
Le groupement d’associations en est actuellement à la phase de « mise en demeure » des responsables de cette « carence fautive », à savoir le gouvernement par la personne du Premier ministre ainsi que les ministres de l’Intérieur et de la Justice, sous forme d’un document volumineux de 145 pages où sont rappelés les manquements de l’État. Les mesures qui semblent devoir être prises y sont également énoncées. L’avocat a une certitude : les réponses doivent être « systématiques face à un problème systémique ».
Des pratiques qui durent depuis trop longtemps
Du côté d’Amnesty International France, Cécile Coudriou, sa présidente, a justifié la démarche en rappelant que « quand les plaidoyers ne suffisent plus, parfois nous avons recours au contentieux ». En France, s’impose une action en justice contre des pratiques odieuses « qui portent profondément atteinte à la dignité des personnes victimes », et perdurent depuis trop longtemps. Cette mise en demeure souligne les « manquements de l’État », face à des preuves « irréfutables ».
Grâce au recueil de témoignages que son ONG a réalisé, Cécile Coudriou a également abordé l’aspect délétère de ces pratiques sur les forces de l’ordre elles-mêmes. Concrètement, elle appelle à « changer la loi pour interdire ces contrôles discriminatoires, modifier les instructions données à la police et les pratiques des forces de l’ordre, améliorer la formation et enfin assurer la traçabilité des pratiques et garantir l’accès indépendant à la justice ».
Pour l’avocate Myriame Matari, représentante du Réseau – Égalité, Antidiscrimination, Justice – interdisciplinaire (REAJI), cette mise en demeure « s’inscrit dans les luttes historiques » pour une « égalité réelle et effective » entre les citoyens.
« Faire cesser cet héritage historique », c’est également l’espoir de l’avocat Slim Ben Achour. « Depuis 10 ans, juridiquement ou pas, nous avons tout essayé : le récépissé de contrôle, la discrimination raciale (Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 15-24213) et son interdiction par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC), la faute lourde et la position du Défenseur des droits ». Cet avocat, figure incontournable de la lutte anti-discrimination en France, s’agace : « le contrôle de routine ne s’intéresse pas à une infraction éventuelle mais à l’être de la personne contrôlée ».
« Je ne veux pas finir en # »
Les associations de terrain constatent chaque jour les ravages de ces pratiques délétères. Omer Mas Capitolin, président de la MCDS, parle de la nécessité de « faire remonter l’impact de ces contrôles discriminatoires », pratiquées sur des citoyens « d’origine contrôle », ironise-t-il, puisque ce sont des non-blancs qui subissent ces contrôles réguliers. Pour lui, il s’agit d’une « question de dignité ». Sans oublier, point essentiel, que ces contrôles répétés ont un impact sur « le sentiment d’appartenance », avec cette désagréable impression d’être « des citoyens de seconde zone ». Face aux détracteurs de la lutte, il avance l’existence d’une « production scientifique et sociologique importante. La Commission nationale consultative des droits de l’Homme a condamné la question du profilage ethnique ». En 2016, elle reconnaissait en effet « une surreprésentation des jeunes hommes issus des minorités visibles dans les contrôles de police ».
Parfois, cette peur de la police se traduit en des phrases lourdes de sens : « Je ne veux pas finir en # », autrement dit en « bavure policière » comme Adama Traoré, décédé lors d’une arrestation policière en 2016, lâchent les jeunes qu’Omer Mas Capitolin côtoie par le biais de son association. Il est également révolté par les arrestations de « gamins de 10-12 ans ».
Alors, pour que la situation change, la mise en demeure est un premier pas, mais « nous avons également des propositions », précise-t-il. En premier lieu, « évaluer et enregistrer ces données, disposer d’une preuve de contrôle, réaliser une modification du Code de procédure pénale et enfin changer le rapport de la police à la population ». Un aspect sur lequel a également beaucoup insisté Bénédicte Jeannerod, directrice France de l’ONG Human Rights Watch, parlant de « fracture » entre la police et la population. « Si la police n’inspire pas confiance, elle sera moins efficace », a-t-elle justement souligné.
Toujours du côté des associations de terrain, Issa Coulibaly, président de Pazapas Belleville qui fait de l’accompagnement de projets, a lui aussi insisté sur « l’impact de ces pratiques sur la société tout entière », évoquant un sentiment d’appartenance à la République écorché et à la communauté nationale, et ce, « dès le plus jeune âge ». Pas de doute, pour lui, la pratique des contrôles discriminatoires encourage le « repli sur soi et le repli communautaire », pourtant bête noire du gouvernement actuel attaché à son projet de loi anti-séparatisme, et « nourrit les préjugés négatifs des autres ». En d’autres termes, cela « sape le vivre ensemble ». Ce sujet, « central », revient de manière constante.
Pour Issa Coulibaly, les mécanismes de contrôle devraient être réalisés « par une autorité indépendante des autorités policières », contrairement à ce qui se produit actuellement avec des enquêtes réalisées par l’IGPN. Indispensable également est la nécessité de « revoir la politique du chiffre et les instructions » reçues par la police, afin de « démonter les pratiques systémiques ». Enfin, à titre individuel, les policiers doivent « conscientiser ces pratiques pour un changement palpable ».
L’État a quatre mois pour réagir
« L’État a quatre mois pour engager un dialogue constructif avec nous », afin de lutter contre « une situation insoutenable », qui dure, chacun en convient, depuis bien trop longtemps, comme l’a rappelé Lanna Hollo, conseillère juridique pour OSJI. La Cour de cassation a déjà reconnu une « faute lourde » dans une affaire remontant à 2013, où 13 jeunes hommes d’origine africaine avaient porté plainte pour contrôles abusifs. En 2015, la cour d’appel de Paris avait finalement condamné l’État à verser 1 500 € à cinq des 13 plaignants. Malheureusement, malgré l’espoir de « mesures efficaces », Lanna Hollo n’a pu constater, au mieux, que des « mesures cosmétiques » tandis que sur le terrain, la situation continue de s’aggraver. À ce titre, la « loi loi de 2016 est révolutionnaire », spécialement dans un pays comme la France, « l’un des plus touchés » par ce fléau social.
Désormais, qu’attendre ? Pendant cette période de quatre mois, l’État peut prendre des initiatives, ou… ne rien faire du tout. Dans ce dernier cas, « il faudra saisir le juge et lui demander d’adopter et d’imposer des mesures que le gouvernement n’aurait pas prises spontanément. Mais nous laissons d’abord la place à la négociation », a rappelé Antoine Lyon-Caen. « Le juge a les moyens de faire respecter les injonctions, sous astreinte, s’il le faut ». Et ce faisant, de faire en sorte que des « changements profonds par le droit » arrivent dans notre société.