L’abolitionnisme pénal ou la révolution du système pénal
Gwenola Ricordeau, professeure assistante en justice criminelle à la California State University, vient de publier l’ouvrage Crimes et peines, penser l’abolitionnisme pénal aux éditions Grevis, où elle met en lumière trois penseurs et penseuses de l’abolitionnisme pénal : Nils Christie, Louk Hulsman et Ruth Morris. Porte-paroles d’un mouvement de pensée qui ambitionne de révolutionner le système pénal au sens large – policier, judiciaire et pénitentiaire –, ils offrent la vision d’un monde différent, loin du tout répressif de nos sociétés.
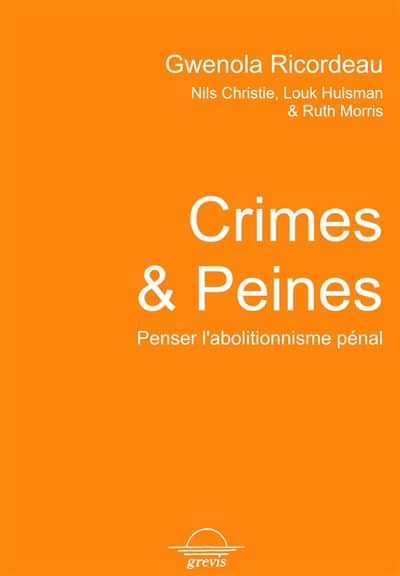 Actu-Juridique : Comment est née l’idée du livre ?
Actu-Juridique : Comment est née l’idée du livre ?
Gwenola Ricordeau : Elle est née de ma lecture d’auteurs et autrices ayant contribués aux réflexions autour de l’abolition du système pénal et de la découverte de la richesse de ce courant de pensée et des mouvements abolitionnistes. Avec le temps, j’ai regretté de n’avoir pas eu accès plus tôt, et en français, à certains auteurs et autrices majeurs de l’abolitionnisme. En effet, à l’exception d’Angela Davis avec son ouvrage La prison est-elle obsolète ?, beaucoup de ces auteurs, comme le Norvégien, Thomas Mathiesen, n’ont jamais été traduits. De plus, les publications en français autour de l’abolitionnisme pénal demeurent largement destinées à un lectorat académique, même s’il existe des exceptions, comme le livre Pourquoi faudrait-il punir ?, de Catherine Baker ou L’abolition de la prison, de Jacques Lesage de la Haye. Présenter des traductions inédites en français de Nils Christie, Louk Hulsman et Ruth Morris permet donc de faire connaître les réflexions abolitionnistes.
AJ : Pourquoi vouloir faire connaître les porte-paroles de l’abolitionnisme pénal en France ?
G.R. : D’une manière générale, l’intérêt de leurs réflexions est de dépasser la remarque fréquemment faite d’une « justice injuste ». De plus, les textes présentés montrent bien que la cible de l’abolitionnisme est le système pénal, et non pas la seule prison. Par ailleurs, ces auteurs et autrices évoquent abondamment la question des victimes alors que l’abolitionnisme pénal est souvent accusé de s’en désintéresser par les « légitimistes », c’est-à-dire les personnes qui, contre les abolitionnistes, défendent la légitimité de l’existence du système pénal, et par les critiques mal informés.
Nils Christie, Louk Hulsman et Ruth Morris ne constituent pas un « bloc » : les textes présentés ont été écrits entre 1977 et 1998 et leurs ancrages disciplinaires sont divers (Nils Christie était professeur de criminologie, Louk Hulsman professeur de droit). Ruth Morris a essentiellement vécu au Canada, Nils Christie en Norvège et Louk Hulsman aux Pays-Bas. D’ailleurs, Nils Christie représente plutôt le courant dit du « minimalisme pénal », alors que Louk Hulsman et Ruth Morris plaident pour l’abolition du système pénal.
AJ : De quels constats sont partis Nils Christie, Louk Hulsman et Ruth Morris ?
G.R. : Même s’il ne faut pas homogénéiser leurs réflexions, on peut néanmoins dire que ces trois auteurs partagent une critique de la catégorie de « crime » et de ses usages. C’est notamment l’objet du texte de Louk Hulsman qui montre comment elle est liée à l’idée de la responsabilité individuelle et invite à réfléchir plutôt en termes de « situations-problèmes ». Nils Christie, Louk Hulsman et Ruth Morris ont aussi en commun une critique des caractères afflictif et rétributif de la sanction pénale, et donc du recours à la punition.
Le texte de Nils Christie, À qui appartiennent les conflits ?, fait pour sa part le constat que le système pénal, en prenant en charge le traitement des crimes, dépossède les auteurs d’infractions et leurs victimes mais aussi le corps social dans son ensemble, de la « richesse des conflits ». Cette analyse du « vol des conflits » et des « voleurs de profession » (que sont notamment les avocats et les juges) me semble très fructueuse pour imaginer d’autres manières de gérer les conflits.
AJ : Plus de 40 ans après leur émergence, ces réflexions sont-elles toujours d’actualité ?
G.R. : Les observations de Nils Christie résonnent fortement avec l’expérience qu’on peut avoir aujourd’hui si on est confronté au système pénal, que l’on soit auteur d’une infraction ou victime, même si une reconnaissance accrue des droits des victimes depuis l’écriture de ce texte permet d’atténuer certaines remarques.
Le texte de Ruth Morris qui figure dans l’ouvrage porte sur les besoins des victimes et sur les manières d’y répondre. L’auteure dénonce ce qu’elle appelle la « dépendance au pénal ». L’actualité récente, notamment les polémiques suscitées par la décision prise dans l’affaire du meurtre de Sarah Halimi de prononcer l’irresponsabilité pénale de l’auteur, me semble témoigner de cette « dépendance au pénal ». Toujours dans l’actualité récente, le projet de création d’un crime d’écocide fait également écho aux propos de Ruth Morris.
AJ : Y a-t-il eu des évolutions positives depuis l’écriture de ces textes ?
G.R. : Tout dépend de quel point de vue on examine la question. D’abord, on peut dire que toutes les aspirations de ces pionniers de l’abolitionnisme se sont heurtées, à partir des années 1980, au durcissement des politiques pénales et au développement, partout dans le monde, de l’« industrie de la punition », pour reprendre l’expression de Nils Christie. Par exemple, on est très loin d’en avoir terminé avec la criminalisation des usages de produits stupéfiants, or Louk Hulsman a été un fervent militant de la dépénalisation dès le début des années 1970.
Sur une note plus optimiste, on peut relever le développement de pratiques qui tendent à éliminer ou amoindrir le caractère rétributif de la justice, en particulier les pratiques regroupées sous l’étiquette de « justice réparatrice » ou « restaurative », les plus connues étant les rencontres auteurs/victimes. L’essor de ces pratiques en France est plus tardif que dans d’autres pays occidentaux, puisqu’il date essentiellement de la loi Taubira. Néanmoins, d’un point de vue abolitionniste, le développement de la justice restaurative n’est pas sans susciter des critiques, à commencer par le fait qu’il contribue à gonfler encore le champ d’intervention de la sphère pénale.
AJ : Si l’abolitionnisme pénal existe aux États-Unis, y a-t-il des représentants de ce mouvement de pensée en Europe ou en France ?
G.R. : Dans le sillage des mobilisations Black Lives Matter, en particulier après le meurtre de George Floyd, les mouvements et idées abolitionnistes ont une visibilité sans précédent aux États-Unis, notamment autour des appels à « cesser le financement de la police » (Defund the police). Cette visibilité récente ne doit pas éluder le fait qu’elle est le résultat d’une montée en puissance des mobilisations abolitionnistes depuis le début des années 2000, ni du reste que ces mobilisations sont traversées par des débats sur la stratégie à suivre.
Au regard de la situation étatsunienne, l’abolitionnisme en France (et généralement en Europe) est davantage cantonné à l’extrême-gauche et il est moins visible politiquement même si, par exemple, le Genepi (association anticarcérale et féministe) qui défend des positions abolitionnistes, est une organisation bien connue en France. Autre différence : en France, l’abolitionnisme porte plus souvent spécifiquement sur la prison que sur le système pénal et/ou la police. L’abolitionnisme étant à la fois un courant de pensées et des mobilisations politiques, il faut aussi souligner que la première vague de l’abolitionnisme, dans les années 1970, a été en bonne partie portée par des juristes et des criminologues européens, comme Thomas Mathiesen et Louk Hulsman.
AJ : Pourtant les faits sont là : les prisons sont surchargées, les tribunaux aussi, la répression n’empêche pas les délits et crimes (notamment sexuels) pour lesquels sont condamnés une majorité d’hommes… N’y a-t-il pas là un paradoxe ? Existe-t-il une peur instinctive d’un laxisme pénal ?
G.R. : Oui, on peut dire qu’il y a un paradoxe dans le sens où le constat de dysfonctionnements et d’effets pervers du système pénal et de la prison est largement partagé. Dans le même temps, les reformes de la justice, de la prison ou de la police ne sont jamais absentes très longtemps de l’agenda politique, or il y a beaucoup de méconnaissance du public sur le droit, le fonctionnement de la justice… Pour ma part, je ne parlerais pas d’une peur du laxisme, mais plutôt d’une faible remise en question de la punition et de son usage. Un terme qui, me semble-t-il, revient souvent dans les débats publics, est celui de l’« impunité ». Celle-ci choque le sens commun. Mais comme le dit très bien le philosophe J. L. Mackie à travers l’expression « paradoxe de la rétribution », il est autant difficile de justifier moralement la rétribution (ou l’expiation) que de l’éliminer de nos manières de penser.
AJ : D’autres luttes – féministes, antiracistes – ont-elles aussi leur place dans le mouvement pour l’abolition du système pénal ?
G.R. : Il y a au moins deux manières de répondre à votre question. La première est de dresser un constat. Les luttes féministes et antiracistes, comme d’autres luttes d’ailleurs, se sont de plus en plus positionnées sur le terrain du droit ces dernières décennies. Elles tendent à promouvoir la révision de certaines catégories pénales ou la création de nouvelles, comme en témoignent les mobilisations pour la création d’un crime de « féminicide » ou l’introduction du terme « inceste » dans le Code pénal. Bref, dans les courants dominants du féminisme comme dans d’autres luttes, l’idée que le droit pénal et la criminalisation de certains faits peuvent être au service de l’émancipation est assez largement admise.
La deuxième manière de répondre à votre question, c’est de regarder du côté des réflexions et des mouvements abolitionnistes. Au-delà de la dénonciation du « populisme pénal » et de l’instrumentalisation de certaines causes (comme celle des femmes, des personnes LGBT, etc.) pour promouvoir une extension du champ d’action du système pénal, les abolitionnistes soutiennent que le recours au système pénal ne peut pas être émancipateur et qu’il contribue à la perpétuation des structures de domination, comme le patriarcat ou le racisme systémique.
AJ : En Amérique du Nord, d’autres formes de justice ont été expérimentées, comme la justice transformative. Ont-elles fait leurs preuves ? Que permettent-elles que la police, la justice et la prison ne permettent pas ?
G.R. : En effet, depuis une dizaine d’années, se développe la « justice transformative », qui a une filiation avec la justice restaurative dans la mesure où elle naît en grande partie de sa critique par des abolitionnistes, comme Ruth Morris justement. L’expression recouvre un grand nombre de pratiques diverses, mais celles-ci ont en commun de refuser le recours à la punition et aux institutions pénales (police, prison, etc.). Ces pratiques ont d’abord été pensées par des groupes sociaux ou des communautés qui ne pouvaient pas recourir au système pénal en raison de leur situation légale ou sociale. Ces pratiques visent à répondre aux besoins des victimes, mais aussi à ceux des auteurs et, plus largement, à ceux des communautés dans lesquelles certains faits se sont produits. Elles promeuvent la « guérison » et la « responsabilité communautaire » plutôt que la punition d’un auteur et leurs processus ont en commun avec beaucoup de pratiques de justice restaurative d’engager des membres de la communauté. La justice transformative permet de répondre au besoin des victimes qui ne peuvent ou ne veulent pas avoir recours au système pénal. Elle permet notamment aux victimes une maîtrise de la temporalité du processus et de se réapproprier la définition de leur victimation en sortant du cadre parfois trop étroit des définitions des infractions données par le droit.
Référence : AJU000i9






