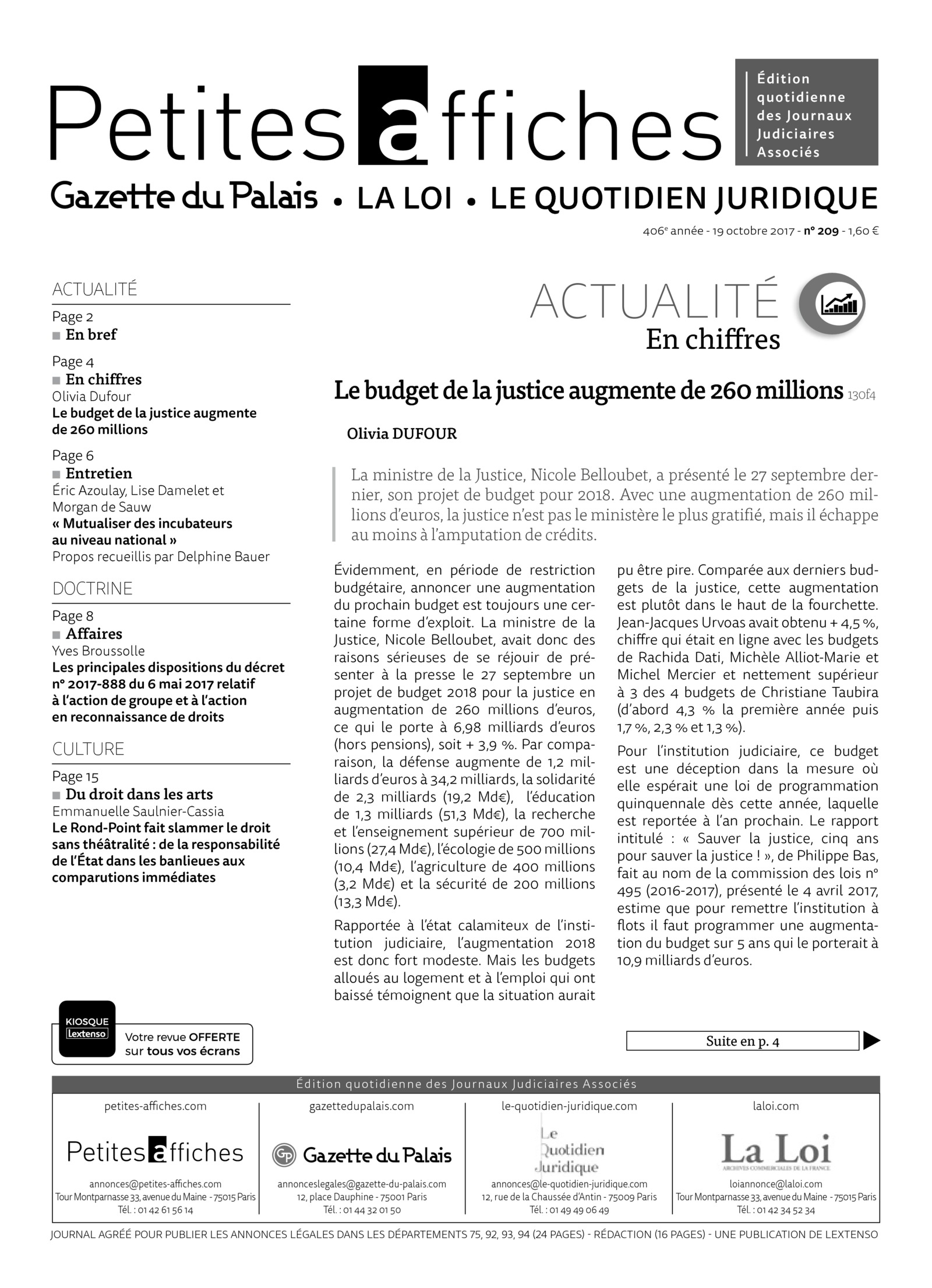Le budget de la justice augmente de 260 millions
La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a présenté le 27 septembre dernier, son projet de budget pour 2018. Avec une augmentation de 260 millions d’euros, la justice n’est pas le ministère le plus gratifié, mais il échappe au moins à l’amputation de crédits.
Évidemment, en période de restriction budgétaire, annoncer une augmentation du prochain budget est toujours une certaine forme d’exploit. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, avait donc des raisons sérieuses de se réjouir de présenter à la presse le 27 septembre un projet de budget 2018 pour la justice en augmentation de 260 millions d’euros, ce qui le porte à 6,98 milliards d’euros (hors pensions), soit + 3,9 %. Par comparaison, la défense augmente de 1,2 milliards d’euros à 34,2 milliards, la solidarité de 2,3 milliards (19,2 Md€), l’éducation de 1,3 milliards (51,3 Md€), la recherche et l’enseignement supérieur de 700 millions (27,4 Md€), l’écologie de 500 millions (10,4 Md€), l’agriculture de 400 millions (3,2 Md€) et la sécurité de 200 millions (13,3 Md€).
Rapportée à l’état calamiteux de l’institution judiciaire, l’augmentation 2018 est donc fort modeste. Mais les budgets alloués au logement et à l’emploi qui ont baissé témoignent que la situation aurait pu être pire. Comparée aux derniers budgets de la justice, cette augmentation est plutôt dans le haut de la fourchette. Jean-Jacques Urvoas avait obtenu + 4,5 %, chiffre qui était en ligne avec les budgets de Rachida Dati, Michèle Alliot-Marie et Michel Mercier et nettement supérieur à 3 des 4 budgets de Christiane Taubira (d’abord 4,3 % la première année puis 1,7 %, 2,3 % et 1,3 %).
Pour l’institution judiciaire, ce budget est une déception dans la mesure où elle espérait une loi de programmation quinquennale dès cette année, laquelle est reportée à l’an prochain. Le rapport intitulé : « Sauver la justice, cinq ans pour sauver la justice ! », de Philippe Bas, fait au nom de la commission des lois n° 495 (2016-2017), présenté le 4 avril 2017, estime que pour remettre l’institution à flots il faut programmer une augmentation du budget sur 5 ans qui le porterait à 10,9 milliards d’euros. Nicole Belloubet a indiqué qu’une loi de programmation serait présentée début 2018 et a annoncé d’ores et déjà des augmentations de + 4,3 % en 2019 et de + 5,1 % en 2020.
Plus de 700 postes pour la pénitentiaire
Pour l’heure, l’augmentation de 260 millions d’euros doit permettre de créer 1 000 emplois. Que la justice toutefois ne se réjouisse pas trop vite, 732 emplois iront à l’administration pénitentiaire. C’est l’un des problèmes de l’institution judiciaire depuis plusieurs années, les augmentations bénéficient beaucoup plus largement à la pénitentiaire qu’aux tribunaux. L’état de surpeuplement des prisons justifie amplement les renforts de moyens et par ailleurs les magistrats tiennent à ce que la pénitentiaire demeure dans le giron de la Chancellerie, mais d’un point de vue des crédits, cela n’arrange pas la situation des tribunaux. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle dans son rapport « Quelle indépendance financière pour l’autorité judiciaire ? » (rapport du groupe de travail animé par le professeur Michel Bouvier, en ligne sur le site du Sénat), publié le 11 septembre à la demande de la Cour de cassation, le professeur de finances publiques, Michel Bouvier, préconise de séparer les missions budgétaires au sein du ministère pour sanctuariser les crédits des tribunaux. Pour en revenir à la pénitentiaire, les 732 postes seront ventilés comme suit : 470 seront dédiés aux trois nouveaux établissements qui vont ouvrir (Aix, Draguignan, Paris-La Santé), 150 iront renforcer la filière insertion-probation, le reste sera affecté aux extractions judiciaires et au renseignement pénitentiaire. Au passage, la ministre a souligné lors de la présentation que ce budget « permettra de mettre en place un plan pour assurer la construction de 15 000 nouvelles places de prison ». Certains regrettent que le gouvernement s’engage dans un tel programme plutôt que de developper les alternatives à la prison, à l’instar d’autres pays comme les États-Unis.
La priorité numérique
L’institution judiciaire hérite pour sa part de 148 postes dédiés à combler les vacances de postes et à renforcer les équipes autour des magistrats. Les services judiciaires auront droit à une augmentation de 9 % « pour améliorer l’efficacité de l’activité judiciaire et les conditions de travail des personnels ». Les 80 postes restants seront affectés à l’administration centrale et seront dédiés essentiellement à la mise en œuvre du plan de transformation numérique. Les crédits informatiques bénéficient au passage d’une augmentation de 20,6 % !
L’an prochain, l’accent sera donc mis sur la transformation numérique. Et pour cause. Tous les rapports qui sortent depuis quelques mois sur l’institution judiciaire soulignent l’urgence d’accélérer la révolution numérique. Ainsi, celui de l’Inspection générale des finances publié en janvier dernier (« Les dépenses de fonctionnement courant des juridictions », rapport établi par l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de la justice en janvier 2017, en ligne sur le site du ministère de l’Économie à la rubrique IGF et sur le site du ministère de la Justice) sur les crédits de fonctionnement des juridictions insiste sur le fait que c’est une priorité et pointe les insuffisances du ministère dans ce domaine. Les auteurs soulignent notamment qu’ils ont cherché en vain durant des semaines à identifier le responsable du projet informatique au sein du ministère… La réforme du secrétariat général, mise en œuvre par Jean-Jacques Urvoas avant son départ de la Place Vendôme devrait contribuer à résoudre cette difficulté. D’ailleurs, celui-ci a laissé une feuille de route à son successeur qui insiste sur la nécessité d’accélérer la transition numérique. Tout comme le rapport Bas d’ailleurs, qui en fait également une priorité pour sauver la justice. Et sans oublier le tout récent rapport Bouvier qui constate la nécessité de mener à bien cette tâche et considère qu’elle devrait être confiée aux juridictions elles-mêmes sous le pilotage de la Cour de cassation. La Chancellerie ne va pas jusqu’à ce degré d’innovation mais semble en tout cas avoir entendu le message relatif à la nécessaire transition numérique.
Ce budget 2018, correct mais sans plus, a des allures de budget d’attente. Le vrai chantier débutera avec la loi de programmation quinquennale annoncée pour l’an prochain et les mesures de réforme d’organisation qui devront nécessairement l’accompagner. À cette fin, l’institution judiciaire dispose d’une somme de rapports qui indiquent tous les mêmes directions pour sauver l’institution et d’un élan initié par Jean-Jacques Urvoas qu’il ne faudrait surtout pas laisser retomber….